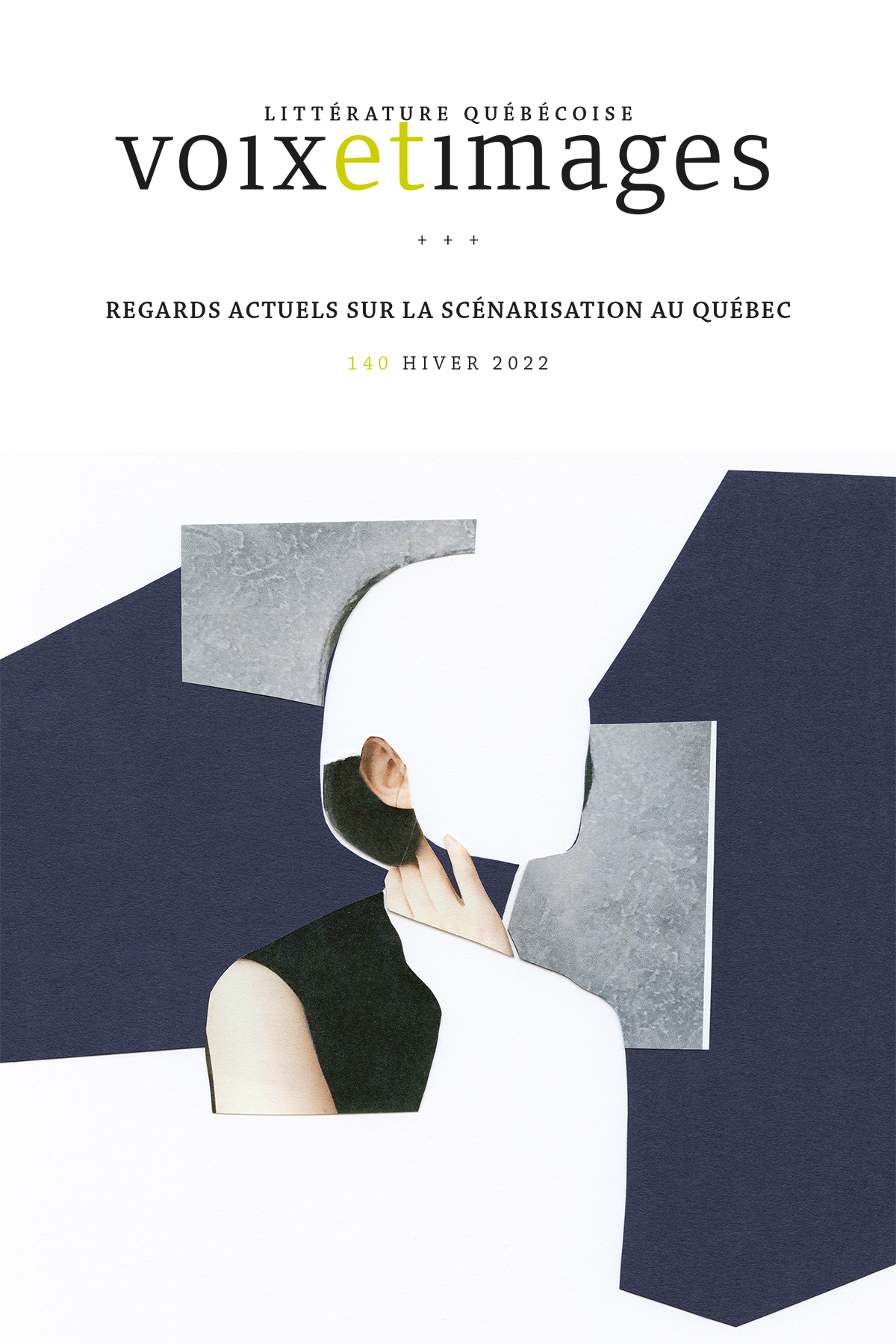Corps de l’article
Dans le domaine de la fiction, les représentations LGBTQ+ sur les petits et grands écrans du Québec sont de plus en plus courantes. Joëlle Rouleau, professeure au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, consacre une partie considérable de ses travaux à l’étude et à l’analyse de cet état de fait, depuis plusieurs années maintenant, et en problématise la teneur, la forme et les résonances socioculturelles. Parmi les domaines d’expertise de Joëlle Rouleau, on retrouve les théories queer, les approches féministes et queer, les études culturelles, ainsi que la recherche-création en cinéma et en télévision. À l’automne 2021, dans les pages de la revue CiNéMAS, elle signe la direction d’un dossier thématique ayant pour titre « Le regard queer et l’image en mouvement ». En avril 2022, elle publie aux Éditions du remue-ménage Télévision queer, un ouvrage collectif.
À ce jour, à notre connaissance, les perspectives queer ne sont que très modestement mobilisées à l’intérieur du champ des études scénaristiques au Québec. S’aventurant quelque peu en marge du domaine connu que représentent pour elle les études cinématographiques et audiovisuelles, Joëlle Rouleau développe, dans le cadre du présent entretien[1], à partir de ce qui se joue sur les écrans québécois en ce qui concerne les représentations LGBTQ+, une réflexion exploratoire autour des pratiques scénaristiques et des liens entre fiction et réalités queer dans le contexte du Québec.
+
VOIX ET IMAGES Dans votre article « Gooey Connections : A Little Detour en Route », paru en mars 2021 dans la revue Jump Cut, vous décrivez le queer comme quelque chose de « deeply good and bad » (« profondément bon et mauvais »), vous parlez même de « gooey stuff » (« substance gluante »). Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette polysémie, voire cette mixité intrinsèque que vous attribuez au queer ? Quelles incidences une telle conception a-t-elle sur votre manière d’envisager les théories et les méthodologies queer en lien avec le monde de l’audiovisuel et de la création ?
JOËLLE ROULEAU Le queer dans cette conception-là, c’est quelque chose de gluant, c’est quelque chose qui se répand partout, qui rentre dans les craques, qu’on n’arrive pas à prendre et à propos duquel on ne peut jamais dire : « Voilà ! Je tiens le queer ! » Le queer déborde et coule. Et, il y a quelque chose de vraiment dégueulasse à cette affaire qui coule de partout, tout comme il y a quelque chose de vraiment fun aussi. D’immatériel, d’explosif, on ne peut pas l’arrêter, ça ne s’arrête pas, ça continue. Si on revient à l’origine du mot « queer », c’est une insulte. Initialement, ce mot est apparu dans la langue anglaise au xvie siècle pour désigner « quelque chose d’étrange », de bizarre. Au cours des xviiie et xixe siècles, une association a été faite entre quelque chose d’étrange et une sexualité « anormale », voire « déviante », puis, après un second glissement de sens, le terme est devenu une insulte vis-à-vis de l’homosexualité. C’est ainsi que le mot « queer » est devenu une insulte homophobe en anglais, au même titre que plusieurs dérivés existant en français. Au début des années 1980, pendant la crise du SIDA, on a vu une réappropriation du terme dans les milieux militants. Il y a eu notamment l’écriture du « queer manifesto » dans lequel on dit : quand nous nous levons le matin, nous ne sommes pas « gays », nous sommes en colère – en raison de l’inaction gouvernementale par rapport à la pandémie, mais aussi par rapport à l’ostracisation homophobe. Ce fut un moment d’affirmation collective : nous sommes là, nous existons et nous sommes en train de mourir. Cela dit, dans le moment contemporain, le mot « queer » est encore utilisé de manière hautement péjorative dans certains milieux homophobes tandis que les personnes queer se le réapproprient constamment. Pour ces personnes, le queer correspond à un mouvement idéologique et culturel qui défait, remet en question et subvertit les cadres normatifs. La société fait en sorte que la marge, c’est toujours le edge, et le edge devient toujours la mode. C’est quelque chose qui se produit, se reproduit et qui explique qu’au bout du compte, la marge est toujours récupérée, normalisée : on marginalise, on normalise, on marginalise, on normalise, etc. Et le queer résiste toujours à cette normalisation, sans jamais chercher à arriver à ce moment où l’on pourrait dire : « Nous sommes enfin une société queer ! » Ce n’est pas cette conception de l’avenir qui est mise de l’avant dans les théories queer. Au contraire, on veut briser les cadres et les normes pour exister en dehors de la pensée structuraliste qui est binaire, finalement.
VOIX ET IMAGES Avec en tête les films et les séries produits au Québec, imaginons un « test de Bechdel-Wallace[2] queer québécois » : deux personnages LGBTQ+, dotés respectivement d’un nom, se parlent au moins une fois d’autre chose que d’un personnage cisgenre et hétérosexuel… C’est rare, non ?
JOËLLE ROULEAU Oui [rires] ! Il y a certes quelques exceptions, notamment des productions qui viennent du milieu indépendant québécois, surtout des courts métrages et des webséries – je pense notamment, en websérie, à Trans (en développement à ce jour) d’Alice Bédard et à Féminin/Féminin (2014, 2016) de Chloé Robichaud. Mais ce que j’observe surtout, c’est que les personnages LGBTQ+ sur les écrans du Québec sont souvent seuls et sont souvent des pivots narratifs, c’est-à-dire qu’ils occupent un espace dans le récit qui les positionne davantage comme objets que comme sujets. Ce ne sont pas nécessairement ces personnages-là qui tiennent ou portent l’action, et si ce sont eux qui la portent, ce sera souvent en fonction de leur « différence ». Pour ma part, je m’inscris dans la lignée des études culturelles et je travaille la question de la culture en empruntant le circuit de Paul du Gay. Dans cette perspective, la représentation, la production, la régulation, la consommation et l’identité sont des moments qui interagissent les uns avec les autres continuellement et sans ordre chronologique. La représentation, à mon sens, est à la fois la « matérialisation » de la culture, mais aussi sa reproduction, c’est-à-dire qu’on reproduit continuellement des images que l’on connaît. Donc, quand on se retrouve avec une représentation très stéréotypée, cette représentation tend à reproduire davantage d’images stéréotypées. Les personnages LGBTQ+ sont ainsi souvent réduits à ce lieu de la marginalisation. Je ne suis pas de l’école qui conçoit la représentation de façon simpliste où l’on doit « se voir » à l’écran. À mon sens, la question de la visibilité, elle est beaucoup plus complexe que ça, en ceci que je ne m’identifie pas à un personnage simplement parce qu’il me ressemble. Je m’identifie à un personnage pour plusieurs raisons, notamment bien sûr en raison de traits de réalité qui font écho à ma vie, mais aussi grâce à des questions de valeurs, de réactions, d’empathie… Je peux regarder une série et m’identifier à un personnage masculin sans me sentir homme. Je peux m’identifier à un personnage trans sans être une personne trans, je peux m’identifier à une personne handicapée sans être une personne handicapée. La question de l’empathie, elle n’est pas simple. Limiter la question à « je veux me voir à l’écran », c’est trop simple et ça fait un peu « placement de produit » (il y a des personnes LGBTQ+, donc je dois aimer ça ?). Mon affirmation est polémique et j’en suis consciente. Bien entendu, je souhaite une représentation diversifiée et ancrée dans la société qui la produit. Toutefois, ce qu’on veut en réalité, c’est une possibilité d’exister dans l’imaginaire collectif. Mais les représentations médiatiques ont aussi l’effet contraire. Elles « fixent » le sens. On revient à la fameuse question de la poule ou l’oeuf : les représentations stéréotypées (sinon l’invisibilisation) reconduisent une représentation homogène, et perpétuent du même coup la marginalisation sociale des personnes visées par ces représentations stéréotypées. Il est important de réfléchir à ce qu’on voit et à ce qu’on montre à l’écran, et à comment on le montre à l’écran, à ce qu’on met dans nos scénarios, parce que ça contribue aux transformations de notre conception sociale des choses. Mettre en scène un personnage gai, ça vient fixer du sens à ce que c’est d’être gai dans l’imaginaire collectif. Toutefois, exister dans l’imaginaire collectif, c’est aussi se donner des outils pour exister de façon complexe. Par exemple, une représentation stéréotypée de l’enfant immigrant de deuxième génération, homosexuel, qui ne peut pas faire son coming out parce que ses parents sont homophobes. Cette lecture-là, qui est assez classique au Québec – qu’on a vu dans 30 vies notamment –, elle est hyper raciste ! Ça vient « fixer » dans les esprits une certaine équation : si tu es immigrant·e et racisé·e, tu es homophobe. C’est problématique. Et ça, c’est parce qu’on a une seule représentation de cet ordre-là. Pour en sortir, il est important de se donner des représentations complexifiées afin de diversifier les expériences, les réalités, les représentations. Or, pour y arriver, il ne suffit pas d’une simple équation : « je me vois comme personne LGBTQ+, donc j’existe » ; il faut développer des scénarios et des personnages, les détacher de cette seule composante identitaire sans non plus la nier.
VOIX ET IMAGES Dans quelle mesure la représentation des différences sexuelles dans les scénarios et sur les écrans québécois permet-elle de concevoir le cinéma, ainsi que les domaines de la télé et de la websérie, comme un régime de la représentation (au sens où l’entend Stuart Hall) ?
JOËLLE ROULEAU Ou comme espace de résistance – je pense qu’il y a ça aussi qui va de pair avec l’idée de « régime de la représentation ». C’est une bonne question. D’une part, le scénario est écrit dans une langue qui est genrée. Dès le départ, dans l’acte d’écriture, il y a déjà une installation de cadres qui sont nécessaires pour qu’on se comprenne, mais qui viennent néanmoins fixer du sens. Tout ce qu’on va faire et choisir aura donc nécessairement un impact sur la représentation qui sera faite. Des exercices ont été faits, au théâtre notamment, pour déjouer cela. Je pense à Chienne(s) de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent : c’est une pièce de théâtre où, justement, elles ont choisi une écriture épicène, pour ne rien fixer, pour jouer avec les questions de genre. Pour l’heure, on est devant des tentatives, des essais, des volontés de résistance, mais ce n’est pas nécessairement tout le monde qui veut faire une écriture scénaristique aussi expérimentale pour défaire le genre. Je dirige actuellement les travaux de Zakia Ahasniou, une étudiante à la maîtrise en cinéma à l’Université de Montréal, option recherche-création. Dans son mémoire, dont le titre provisoire est Plaisir narratif et cinéma féministe : comment la recherche-création permet-elle de bouleverser les cadres de l’écriture scénaristique ?, Zakia tente de transformer les principes généralement admis de la scénarisation. La position qu’elle développe est très intéressante. J’ai dévoré le scénario qu’elle a écrit et j’ai hâte à la suite ! J’ai hâte de lire son mémoire, parce qu’il y a une réflexion constructive qui se développe là sur l’écriture, sur l’écriture de scénarios, sur les mots. Ensuite, il importe de prendre du recul et de réfléchir plus globalement à qui, aujourd’hui, écrit des scénarios, voire à comment on écrit des scénarios. Pourrait-on repenser l’écriture scénaristique et en faire un exercice réellement collaboratif, plutôt que solitaire, sinon contractuel et hiérarchisé ? En s’inspirant de savoirs autochtones, on pourrait développer la souveraineté narrative. On éviterait peut-être le piège du « placement de produit » (« voici notre gai de service ! ») pour avoir des représentations plus complexes et plus riches. La souveraineté narrative accorde une grande importance et une légitimité primordiale au fait de pouvoir raconter son histoire, de ne pas en être dépossédé·e. Cela implique une attention sensible à ceci : lorsqu’on raconte une histoire, lorsqu’on raconte l’histoire de quelqu’un d’autre, on ne parle pas de la personne comme d’un « autre », on parle de soi dans sa rencontre avec l’autre. Bien entendu, le ou la scénariste est présent·e dans son travail, comme le ou la cinéaste est présent·e dans son travail. On travaille toujours à partir de soi. À mon avis, il faudrait commencer par le comprendre et arrêter de prétendre que la création est au-dessus de nos subjectivités et de nos préjugés.
VOIX ET IMAGES Comment l’hétéronormativité est-elle perpétuée à travers les représentations ?
JOËLLE ROULEAU C’est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de « placement de produit ». On va mettre en scène des personnages LGBTQ+, mais leur histoire sera très conventionnelle, très classique. On va les développer comme s’ils étaient hétéros. Ils auront les mêmes rêves ou les mêmes ambitions. On va reproduire, donc, un rapport hétéronormatif très ancré dans notre conception néolibérale de la réussite : l’idée d’avoir un emploi qu’on aime, un bon salaire, d’être en couple monogame, d’avoir des enfants, de « posséder » des choses (une maison, une voiture, etc.). À mon avis, ça expose bien la matrice hétérosexuelle théorisée par Judith Butler. L’autrice conçoit l’alignement hétérosexuel entre le genre, la sexualité et le sexe comme une pratique performative. Cette pratique nous permet d’être reconnus comme sujets humains. Quand on « brise » l’alignement de la matrice, on met en péril notre reconnaissance en tant que sujet humain – on devient marginal·e, déviant·e. Ce qu’on observe actuellement, autant dans les représentations médiatiques que dans la société, c’est une « normalisation » des relations homosexuelles à même la matrice qu’on pourrait maintenant nommer « homonormativité ». Ça se produit à travers des institutions comme la famille, le mariage, le rapport au travail. À l’écran, ça se matérialise par une représentation d’un couple gai qui fonde une famille, se marie, achète une maison. On ne va pas nécessairement aborder leur couple ouvert, ou l’homophobie vécue dans l’exercice de la parentalité. On nie aussi l’existence d’une famille choisie. La famille choisie dans les communautés LGBTQ+, c’est très présent, très important. Ce rapport de filiation, il existe très peu dans les représentations LGBTQ+. On reproduit des modèles hétéros, deux parents, monogames, qui ont un bébé et qui ont les mêmes luttes et difficultés que les parents hétéros. La réalité, c’est que c’est différent. Un enfant de 5 ans en maternelle qui vit de l’homophobie à l’égard de ses parents, ce n’est pas si facile, ce n’est pas si simple. Et qu’est-ce qui arrive quand tu as un donneur présent dans un contexte homoparental ? Sur le plan législatif au Québec, on reconnaît seulement deux parents. Dans certaines provinces canadiennes, on reconnaît trois et même quatre parents sur les actes de naissance : là, on fait exploser le concept de la famille. On est en train de sortir d’un rapport hétéronormé. Une fois que ça se produit dans la « vraie vie », on le retrouve dans les représentations médiatiques. Dans le contexte des représentations fictionnelles québécoises, la seule chose qui a changé, c’est la présence de personnages LGBTQ+ et à mon avis, c’est encore très cosmétique. Poser certains jalons historiques, politiques et culturels (suprématie, criminalisation, médicalisation, décriminalisation, législation, etc.) permet de situer de manière nuancée le climat dans lequel sont produites les représentations dans nos scénarios et sur nos écrans. Cela dit, le plus souvent, les scénarios trouvent leur ancrage dans un imaginaire collectif extrêmement biaisé. On se sert de l’identité de genre et/ou sexuelle en tant que trait définissant en premier lieu un personnage. Il s’agit là de stratégies narratives encore récurrentes dans le contexte audiovisuel et scénaristique québécois. Nous sommes dans un régime de la représentation qui est homophobe, transphobe, sexiste, raciste, capacitiste, etc. Ce régime-là dure depuis des siècles ! Stuart Hall, par exemple, dans un contexte de racialisation, en situe l’origine à la traite des esclaves, il y a 400-500 ans, et démontre comment l’exercice de l’esclavage aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe et au Canada également, a modifié notre conception du monde et a enclenché la constitution d’un imaginaire collectif raciste. Par rapport à la sexualité, les travaux de Foucault ramènent au xviie siècle le début d’une répression quant aux rapports sexuels considérés comme étant normaux (c’est-à-dire ayant comme objectif la procréation entre conjoint·es marié·es et s’inscrivant une fois de plus dans un contexte d’abord mercantile, puis capitaliste) et la volonté de contrôler/guérir celleux considéré·es comme anormaux. Ce traitement de la sexualité a eu pour effet de consolider une norme sociale agissant comme une loi (n’oublions pas que l’homosexualité a été décriminalisée il y a seulement 50 ans au Canada). Si on ramène cette question à la culture et aux représentations médiatiques, on voit que notre régime de la représentation prend racine dans ce contexte sociopolitique. Ce n’est que très récemment qu’on a commencé à s’ouvrir à des représentations de sexualités marginalisées sur nos écrans. Au Québec, selon mon expérience, il y a eu quelques films de Léa Pool auxquels je n’avais pas vraiment accès en tant qu’enfant en région, sinon la première représentation lesbienne dont je me souviens, c’est dans Jasmine, et c’était un petit « bec ». Dans les années 1990, c’était vu comme un problème, un immense drame, voire une maladie. C’est au tournant des années 2010 qu’on s’est éventuellement mis à faire des représentations un peu plus assumées. Si on regarde le Queer Media Database, il y a bel et bien des films LGBTQ+ au Québec. Mais, si on compare avec l’accessibilité à la représentation mainstream, très peu. Une amie m’a convaincue récemment de visionner la série britannique Sex Education en me disant combien avoir vu ça à 13-14 ans, ça aurait changé sa vie. On est encore loin de la production de ce type de contenu au Québec. J’ai l’impression qu’on est encore dans l’explication, l’acceptation de base. Et, en étant dans l’explication, on concentre surtout notre attention sur le coming out, sur la transition, sur le « fait d’être différent·e » et non pas sur le fait d’être humain et complexe. Lorsqu’on parle du régime de la représentation, de l’imaginaire collectif, de visibilité, d’industrie, il est nécessaire pour moi qu’on développe une vue d’ensemble : à la fois culturelle, sociale, créative, et même politique. Le bon côté de la chose, c’est que nos représentations sont vitales pour la transformation, l’évolution sociale et l’acceptation. Elles ouvrent des discussions, elles contribuent à changer l’imaginaire collectif et à changer l’acceptation. Le côté négatif, c’est que c’est long et fastidieux, c’est gigantesque. On sent une urgence. Les crimes homophobes et transphobes sont en hausse, année après année, au Québec comme ailleurs. On pourrait conclure que plus de visibilité, ça engendre plus de violence. Mais cette violence-là émerge non pas à cause de la visibilité, mais parce qu’on est en train de changer le monde.
VOIX ET IMAGES Dans votre article « Gooey Connections… », dont il a été question précédemment, vous écrivez (nous traduisons) : « Pour moi, les sensibilités queer s’incarnent dans le fait d’être à la fois en colère et plein·e d’espoir, aimant·e et enragé·e. Une sensibilité queer contient tous ces sentiments compliqués et accablants simultanément, tout le temps. Politiquement et émotionnellement, une sensibilité queer signifie ne pas abandonner parce que le monde est voué à l’échec, sans non plus simplement colmater les trous dans un bateau qui coule. » Comment réfléchir l’articulation entre cette idée de « sensibilités queer » et les pratiques de création audiovisuelles et scénaristiques ?
JOËLLE ROULEAU C’est une vaste question. Ce qui prime pour moi, c’est cette idée de toujours remettre en question les cadres, les normes. C’est quelque chose de perpétuel. En matière de représentations, de travail scénaristique ou de création cinématographique ou audiovisuelle, l’idée est d’identifier le cadre normatif (ou le point normatif) et d’essayer de le défaire, sinon au minimum de le remettre en question. D’arrêter de faire semblant que les représentations sont réellement diversifiées et universelles. De remettre en question l’objectivité et de faire place à nos sensibilités. J’ai trouvé particulièrement intéressant le film français 120 battements par minute (Robin Campillo, 2017). Le film dépeint la mobilisation de Act Up-Paris durant les années 1990 et la crise du sida. Ce qui m’a fascinée, c’est qu’il y a des moments difficiles, tu vois des gens mourir, tu les accompagnes, et ensuite, il y a des moments de fête et de célébration. Il y a ça, dans la culture queer : une capacité à se retrouver, à traverser les épreuves en se donnant l’espace de vivre. La vie est dure, le monde brûle, mais on est ensemble. Il y a quelque chose de particulièrement fort et productif dans cette espèce de coopération. Le film alterne les moments, et moi, ce sont davantage les scènes de joie qui m’ont fait pleurer finalement : danser ensemble après avoir vécu quelque chose d’aussi tragique. Ce type de représentation vient ainsi défaire les codes socionormatifs du deuil selon lesquels il est attendu qu’on passe des mois à être léthargique, « endeuillé·e », tout de noir vêtu. Dans 120 battements par minute, dans la culture queer, on défait le concept du deuil. Ce n’est pas que les personnages ne sont pas en train de vivre leur deuil, c’est simplement qu’ils le vivent autrement – qu’ils essaient, à tout le moins, de le vivre autrement.
VOIX ET IMAGES La question des représentations et de la visibilité est certes à penser dans une perspective politique, mais doit-elle également être abordée en tenant compte de sa dimension industrielle et commerciale ?
JOËLLE ROULEAU Mon observation est qu’en ce moment, les gens qui font partie de l’industrie disons mainstream, en matière de productions dominantes, sont un groupe relativement homogène de personnes blanches, non handicapées, hétérosexuelles, francophones d’origine québécoise depuis plusieurs générations, et qui, finalement, cherchent à diversifier leurs représentations parce qu’il y a une pression amenée en grande partie par la démocratisation des réseaux et des plateformes. Prenons en exemple le secteur de la télévision. Ce qui se passe aux États-Unis arrive au Québec, soit la disparition des câblodistributeurs, et c’est là quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens historiquement « bien placés » dans l’écosystème de l’audiovisuel québécois. Inévitablement, le Québec sera affecté par la disparition des câblodistributeurs et la migration des contenus vers des plateformes en ligne. Et cette migration fait en sorte que l’idée même de « public cible » est chamboulée, voire tend à disparaître – soit cette idée d’orienter systématiquement la grille des contenus en fonction d’un auditoire X et d’un créneau précis. On doit à présent diversifier notre idée du public. L’industrie est obligée de se moduler, et ça passe par une pression des publics qui veulent voir autre chose… Mais, tant en télévision qu’au cinéma, en matière de représentations des réalités LGBTQ+, on est encore largement pris dans une « culture du placage » au Québec. En réalité, on fait appel à des consultant·es sur des questions ponctuelles, mais souvent ça arrive seulement lors de la dernière étape, lorsqu’on est prêt à tourner ou même prêt à diffuser et, au fond, on ne veut rien changer… On plaque donc une histoire LGBTQ+ stéréotypée au récit. C’est un effort vide, ce n’est pas réellement intégré dans le développement du projet (qui écrit, qui filme, qui monte, etc.), et ça se traduit par des représentations saugrenues.
VOIX ET IMAGES Au Québec, en fiction, est-ce que des productions audiovisuelles s’appliquent, selon vous, à remettre en question les cadres normatifs ?
JOËLLE ROULEAU Il était une fois dans l’Est d’André Brassard (1973) est un film qui, encore aujourd’hui, est particulièrement subversif, intense et singulier. Le film a d’ailleurs représenté le Canada à Cannes en 1974 alors que sa distribution au Québec n’était pas évidente. C’est un film qui, à mon sens, est certes problématique par moments, mais néanmoins très intéressant sur le plan des représentations. On peut certainement réfléchir à ce qui s’est passé entre ce film fait dans les années 1970 et maintenant, moment d’émergence de nouvelles productions qui ébranlent les cadres normatifs. Bien sûr, d’autres films ont abordé des thématiques LGBTQ+, comme ceux de Léa Pool, de John Greyson ou de Paule Baillargeon, mais peu de films québécois bouleversent la matrice hétéronormative de Butler. De façon plus contemporaine, la protagoniste de Sarah préfère la course (2013) de Chloé Robichaud incarne quelque chose de rarement vu dans notre cinématographie : un personnage awkward, étrange, à la sexualité vraiment pas claire et qui nous sort assurément des cadres normatifs. De Xavier Dolan, Mommy (2014) me paraît remettre en question les cadres normatifs de manière bien plus franche et cohérente que Laurence Anyways (2012). En ce qui concerne les représentations queer ailleurs qu’au cinéma, il y a certainement la websérie Sans rendez-vous (2021) qui « essaie » de subvertir certaines normes dans un contexte québécois. Personnellement, j’ai trouvé que la représentation y était plaquée. Oui, on y retrouve un couple lesbien, une personne non binaire, une personne grosse et noire, une personne handicapée et lesbienne, des jouets sexuels même, mais ouf, c’est vraiment de l’ordre du « trop, c’est comme pas assez ». Loin d’un humour subtil, on penche vers le malaise, le surfait. C’est là où la question des sensibilités queer me semble particulièrement affinée pour comprendre ce phénomène. En raison de mon identité, je « devrais » en théorie correspondre au « public cible » de cette série, mais honnêtement, je n’y arrive pas. Ce n’est pas parce que je m’y retrouve que j’embarque.
VOIX ET IMAGES En quoi la scénarisation peut permettre une intervention dans le codage et le décodage de sens, et l’émergence de nouvelles voix (celles de créateur·trices comme celles de personnages) ?
JOËLLE ROULEAU À mon sens, il s’agit d’un exercice autoréflexif. Idéalement, on débute par une première écriture qui, elle, sera suivie d’une analyse de son propre scénario pour identifier les cadres normatifs dans lesquels il s’inscrit, et on essaie de voir comment on peut les déjouer. Par exemple : je trace un carré. C’est bon, il est là. Il existe dans l’espace, avec son contour bien défini. C’est maintenant un objet. Mais il se situe où, dans quoi et par rapport à qui, mon carré ? L’idée ici, c’est d’effectuer un exercice autoréflexif de façon concentrée pour voir où sont les brèches, les détournements possibles.
VOIX ET IMAGES Comment les études LGBTQ+ et les approches queer, notamment dans la foulée de ce qui se fait au sein des études filmiques et des études littéraires, peuvent contribuer au développement de pistes de réflexion novatrices, ainsi qu’au renouvellement des approches créatives en matière de scénarisation à l’université et dans le monde professionnel ?
JOËLLE ROULEAU À mon avis, les bourdonnements qu’on entend au sujet de la représentation depuis quelques années sont directement liés au développement des études LGBTQ+. Ça bouge dans le milieu universitaire, dans le cadre législatif, et ça se retrouve finalement dans la culture. Le milieu de la culture, il est financé. Et son fonctionnement est régi par des façons de faire, des conventions. En ce qui concerne l’apport du milieu de la recherche au milieu de la culture, il est intéressant de voir les changements à l’étape de la prise de décisions. Sur le plan de l’écriture, dans une optique queer, on pourrait essayer de changer la façon de faire. Ça dépend du sujet, certes, mais ça pourrait être de se livrer simultanément à un exercice d’écriture et à un exercice de recherche-action ; de faire de la consultation de terrain, de l’entrevue, d’impliquer des gens concernés dans l’écriture, d’avoir une polysémie, une écriture polyvocale. Ça permet de sortir du cadre, de sortir du carré. Ça implique de repenser nos méthodes, d’aller jouer ailleurs. Dans mon travail en recherche-création, je ne m’identifie pas comme artiste, je m’identifie comme queer. C’est précisément parce que je suis queer que je cherche à défaire mon rapport à la recherche « traditionnelle ». Pour moi, la recherche-création permet de faire une place à une subjectivité, de jouer avec la façon de faire de la recherche. Ça peut aussi jouer, éventuellement, sur la manière dont on pense la scénarisation. Le scénario est une écriture, le film est une autre écriture, et le montage en est une aussi. Ces écritures sont codifiées ensemble, mais elles sont des moments différents. Et il est impossible de dire si le regard demeure le même d’un moment à l’autre. Mais c’est là quelque chose qui importe : subvertir l’action même de regarder. Il faut le faire de façon consciente, active, réfléchie, dans une optique qui fait en sorte que le·a lecteur·rice, le·a spectateur·rice se pose des questions, notamment par rapport à la sexualité, au genre ou au sexe. bell hooks a énormément travaillé la question du regard, en s’intéressant particulièrement au regard oppositionnel. En création, on peut partir de cette idée-là et parler d’un regard subversif, celui qui remet en question, qui oblige à nous interroger et qui nous ramène en pleine face nos impensés. Le queer gaze existe, à mon sens, mais c’est un gaze qui nous renvoie à nous-mêmes, et ce, dans une optique subversive : il nous interpelle sur les questions qui nous sont posées.
VOIX ET IMAGES Finalement, on se rend compte qu’il faut également changer notre regard sur les questions méthodologiques et disciplinaires à l’origine du présent entretien. Plutôt que de se demander comment les études et les approches queer pourraient « faire quelque chose » à la scénarisation ou encore comment un·e scénariste pourrait individuellement, à sa seule échelle, « écrire queer », il appert qu’on devrait davantage réfléchir à un paradigme dans lequel la scénarisation se laisserait transformer, habiter, traverser, voire occuper par des perspectives queer – tant théoriques que pratiques –, ce qui impliquerait de la part des créateur·rices, à la fois dans les sphères universitaires et professionnelles, de se poser plus de questions, d’apprendre à se défaire du sujet universel, de miser sur la diversité et le pluriel des voix et des approches.
JOËLLE ROULEAU La critique de l’universalité, c’est au centre de la posture queer et de la posture intersectionnelle. C’est une volonté d’arrêter de dire que tout le monde est pareil. C’est ce que j’essaie de faire avec la question des sensibilités queer. On est dans la même tempête, mais pas sur le même bateau. Je le mentionne souvent dans mes cours, dans mes travaux. Nos façons de réagir, d’interagir, de contribuer, d’essayer, de réfléchir diffèrent. Il n’y a pas « une » façon de faire, il n’y a pas « une » approche de la création qui serait supérieure. Le sujet universel qui veut rejoindre tout le monde, en fait, il ne rejoint personne. Il vend du rêve. Mais c’est tout, ça s’arrête là. On a besoin de certains outils pour critiquer et défaire les codes et les normes. Ce principe concerne également les études scénaristiques. On apprend à écrire un scénario, mais comment on le défait après ? Je pense qu’un tel exercice de déconstruction scénaristique pourrait engendrer de belles choses.
Parties annexes
Note biographique
GABRIELLE TREMBLAY est professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Ses travaux récents portent sur les liens entre littérature, cinéma et pratiques scénaristiques au Québec. En 2015, elle a publié Scénario et scénariste, un ouvrage dédié à la reconnaissance institutionnelle de l’objet scénaristique dans le monde de l’art cinématographique en France.
Notes
-
[1]
Nous tenons à témoigner de notre reconnaissance envers le rigoureux travail de transcription effectué par Gaëlle Baumans.
-
[2]
Le test de Bechdel-Wallace est développé dans les années 1980 par la bédéiste Alison Bechdel et son amie Liz Wallace. Pour « passer le test », un film doit comporter minimalement deux personnages féminins, respectivement identifiables par un nom et qui se parlent au moins une fois durant le film d’autre chose que d’un personnage masculin. Ce test vise, à l’origine, à mesurer la présence et la substance de la caractérisation des personnages féminins à l’intérieur d’une oeuvre.