Résumés
Résumé
Cette contribution a pour ambition de démêler les fils entre olympisme, paralympisme et deaflympisme en relation avec la participation sociale des sourds dans le sport, en prenant appui sur les premiers Jeux internationaux silencieux d’été de Paris en août 1924 et les derniers Deaflympics d’hiver en Turquie en mars 2024, sachant que les dirigeants sourds sportifs historiques, ceux de the International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) luttent depuis une quarantaine d’années pour ne pas être intégrés au mouvement paralympique et à the International Paralympic Committee (IPC). En effet, les sourds sportifs refusent toujours leur statut de personnes en situation de handicap. Tout au contraire, et si leur niveau sportif le permet comme à Paris en juillet et août 2024, sept sportifs sourds ont participé aux compétitions et aux Jeux olympiques pour montrer à la communauté entendante internationale toute la normalité dont les sourds sont porteurs lorsqu’ils pratiquent les sports et l’éducation physique.
Pour les sourds sportifs de l’ICSD, la surdité ne se résume pas à une perte auditive physiologique et évaluable avec des appareils, mais à une façon d’être au monde originale qui renvoie à un style de vie, à une identité propre, à une culture particulière et à une langue, la langue des signes (LS), qui prend naissance et se construit au cours d’expériences au sein de la communauté des sourds et notamment dans les clubs sportifs sourds. Être sourd sportif apparaît alors comme une construction sociale. On ne naîtrait pas sourd, on le deviendrait et ce, à différents moments de sa vie et à différentes occasions dans le cadre d’un processus qui se construirait dans un rapport à l’autre, à l’altérité. L’identité sourde sportive serait alors donnée par son appartenance à un club sportif, un club dit sourd au sein duquel, le sourd pratique un sport organisé par les sourds pour les sourds, un sport qui existe depuis près de cent-cinquante ans et qui souhaiterait poursuivre sa tâche alors qu’il est en danger de disparition si celui-ci se diluait dans le parasport ou le paralympisme comme certains sourds le souhaitent aujourd’hui afin de bénéficier de tous les avantages et les aides que procurerait ce rattachement en termes de suivi parasportif, de préparation physique et de récompenses financières. On assisterait alors à un changement radical de paradigme.
Mots-clés :
- Altérité,
- Culture sourde,
- Deaflympics,
- Deaflympisme,
- Identité sourde,
- International Committee of Sports for the Deaf (ICSD),
- Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024,
- Langue des signes,
- Olympisme,
- International Paralympic Committee (IPC),
- Paralympisme,
- Sportif sourd,
- Sourd sportif
Abstract
This contribution aims at untangling the threads between Olympism, Paralympism and Deaflympism in relation to the social participation of deaf people in sport, drawing on the first International Silent Summer Games in Paris in August 1924 and the last Winter Deaflympics in Turkey in March 2024, knowing that the historical deaf sports leaders, those of the International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) have been fighting for forty years not to be integrated into the Paralympic movement and the International Paralympic Committee (IPC). Indeed, deaf athletes still refuse to be regarded as people with disabilities. On the contrary, and if their sporting level allows it, as in Paris in July and August 2024, seven deaf athletes participated in the competitions and the Olympic Games to show the international hearing community all the normality of deaf people when they practice sports and physical education.
For the deaf athletes of the ICSD, deafness is not limited to a physiological hearing loss that can be assessed with devices, but to an original way of being in the world that refers to a lifestyle, a specific identity, a particular culture and a language, sign language (SL), initiated and constructed during experiences within the deaf community and in particular in deaf sports clubs. Being a deaf athlete then appears as a social construction. One was not born deaf but becomes deaf, and this, at different times in one's life and on different occasions within the framework of a process that is constructed in a relationship with the other, with otherness. The deaf sports identity would then be given by its membership in a sports club, a so-called deaf club within which the deaf person practices a sport organized by the deaf for the deaf, a sport that has existed for nearly one hundred and fifty years and is wished to continue its task while it is in danger of disappearing if it were diluted in para-sport or paralympism as some deaf people wish today in order to benefit from all the advantages and aid that this attachment would provide in terms of para-sport monitoring, physical preparation and financial rewards. We would then witness a radical paradigm shift.
Keywords:
- Otherness,
- Deaf Culture,
- Deaflympics,
- Deaflympism,
- Deaf Identity,
- International Committee of Sports for the Deaf (ICSD),
- Paris 2024 Olympic and Paralympic Games,
- Sign Language,
- Olympism,
- International Paralympic Committee (IPC),
- Paralympism,
- Deaf Athlete,
- Athlete Deaf
Corps de l’article
Introduction
La tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en juillet, août et septembre 2024, et plus encore, les commémorations des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris de 1924 (10-17 août) tout autant que la création de l’Internationale sportive des sourds le 16 août de la même année, nous donnent l’occasion et l’opportunité d’entrevoir quelques pans de l’histoire centenaire du sport international des sourds[1] (Jahan et al. 2024 ; Séguillon, 2002, 2024b). Il est notamment l’occasion de discuter de la définition même d’un sourd sportif ou d’un sportif sourd, un sportif comme les autres ou un parasportif, en un mot, ce qui avant tout semble le définir, le fait d’être sourd et accessoirement sportif ou tout au contraire, le fait d’être sportif, et sourd de façon anecdotique. Il s’agit également de déterminer et de savoir de quelles organisations sportives internationales le sourd sportif peut-il ou doit-il dépendre à l’heure où toutes les spéculations sont de mise avec le transfert, en partie pour l’international, du sport des sourds de la Fédération française handisport (FFH) au Comité paralympique et sportif français (CPSF) ? De quelle conception de participation sociale est-il question pour ce groupe minoritaire, celui des sourds sportifs aujourd’hui en recherche d’une identité en mutation (Mottez, 1979b ; Marcellini et al., 2000 ; Gaucher, 2009a ; Fougeyrollas, 2010 ; Verstraete, 2015) ? Ainsi, dans cette contribution, nous démêlerons les fils entre olympisme, paralympisme et deaflympisme en prenant appui sur les premiers Jeux internationaux silencieux d’été de Paris en août 1924 et les dernières Olympiades sourdes d’hiver en Turquie en mars 2024, sachant que les dirigeants sourds sportifs luttent, encore et toujours, pour ne pas être intégrés au mouvement paralympique. En effet, les sourds sportifs refusent leur statut de personnes en situation de handicap. Tout au contraire, et si leur niveau sportif le permet comme à Paris en juillet et août 2024, sept sportifs sourds ont participé aux compétitions et aux Jeux olympiques pour montrer à la communauté entendante toute la normalité dont ils sont porteurs, et même parfois être médaillés sans que le grand public ne connaisse leur surdité à l’image du nageur sud-africain, Terence Parkin en 2000 lors des Jeux olympiques de Sydney en Australie (Séguillon, 2024b).
Cette question pourrait, néanmoins, apparaître à certains comme sans grand intérêt scientifique, le sourd sportif serait alors, à l’évidence, ce qui semble être, et ne se résumer qu’à cela, au fait de ne pas entendre, voire de ne pas parler. Évidence qui n’en est pas une pour nous, ce qui sera questionné dans cette contribution à travers des exemples et notamment celui des child of deaf adult ou Coda, c'est-à-dire des personnes entendantes issues de familles sourdes et considérées comme appartenant aux deux communautés entendante et sourde. À la lumière de nombreuses manifestations, il s’avère qu’il est plus que difficile de se repérer dans le dédale des différents types de surdité : héréditaire, de naissance, acquise, en fonction du moment de sa survenue, des pertes auditives plus ou moins complètes, des prothèses de substitution utilisées et qui font que la personne sourde ne l’est plus, ou tout du moins seulement à certains moments de sa vie ou de la journée, à l’aide de ses prothèses.
Il s’avère également difficile de repérer les caractéristiques qui définissent un sourd parlant et un devenu sourd, un déficient auditif et un malentendant, un sourd-sourd, notion chère à Bernard Mottez (2006), ce grand chercheur, pour un sourd-muet (Mottez, 1976 ; Cuxac, 1983 ; Karacostas, 1989 ; Séguillon, 1998 ; Delaporte, 2002 ; Benvenuto, 2009 ; Gaucher, 2009a ; Bertin, 2010 ; Kerbouc’h, 2012 ; Encrevé, 2012 ; Bernard, 2015 ; Bedoin, 2018).
Pour certains, la surdité ne se résume pas à une perte auditive physiologique et évaluable avec des appareils, mais à une façon d’être au monde originale qui renvoie à un style de vie, à une identité propre et à une culture particulière qui prend naissance et se construit au cours d’expériences au sein de la communauté des sourds (Gaucher, 2007, 2012 ; Lachance 2007). Être sourd est alors une construction sociale, nous disent Andréa Benvenuto et Bernard Mottez (2006). On ne nait pas sourd, on le devient, et ce, à différents moments de sa vie et à différentes occasions, un processus qui se construit dans un rapport à l’autre, à l’altérité (Karacostas, 1999). L’identité sourde peut être donnée, par exemple, par l’établissement d’enseignement et de formation d’origine du jeune sourd, ou encore, par son appartenance à un club sportif, un club dit silencieux au sein duquel, le sourd pratique un sport organisé par les sourds, pour les sourds. Un sport qui existe depuis près de 150 ans et qui souhaiterait poursuivre sa tâche alors qu’il est en danger de disparition si celui-ci se diluait dans le parasport ou le paralympisme (Meziani et Séguillon, 2020 ; Séguillon, 2022, 2024b).
Si nous savons, par ailleurs, que les Jeux olympiques sont restaurés ou créés, selon les analyses, à la fin du XIXe siècle et perdurent depuis, que les Jeux paralympiques se sont, quant à eux, structurés à l’issue de la Seconde Guerre mondiale (Ruffié et Ferez, 2013 ; Marcellini et Villoing, 2014) et qu’ils participent probablement à l’élaboration de nouvelles visions éthiques de l’activité sportive, ouverte enfin à tous et à toutes, peut-être a-t-il existé d’autres Jeux avant même que le mouvement paralympique ne se crée dans les années 1940 et 1950 ? Il existerait alors des Jeux paralympiques avant ceux de Londres en 1948 ou encore ceux de Rome en 1960 comme ceux des sourds sportifs. La tenue des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924, il y a donc un siècle, pourrait alors en être une expression, hypothèse récusée par les sociologues et historiens des Jeux olympiques et paralympiques (Blanchard et al. 2024 ; Marcellini et Ferez, 2024)[2]. Il s’agirait de véritables Jeux olympiques pour les sourds-muets sportifs en 1924 et seulement de cela, et non des Jeux paralympiques ou parasportifs avant l’heure pour ceux qui auraient pu voir en les sourds sportifs des personnes en situation de handicap (Cuxac, 1983 ; Mottez, 2006 ; Delaporte, 2002 ; Bernard, 2015 ; Séguillon, 2017, 2022).
Les Jeux internationaux silencieux nés en 1924, mués en Jeux mondiaux des sourds dans les années 1960, mués de nouveau en Deaflympics ou Olympiades sourdes depuis 2001, se poursuivent, depuis un siècle, loin des Jeux paralympiques, fêtant ainsi, en cette année 2024, leur Centenaire, celui des premiers Jeux sportifs des sourds-muets et de la création de l’Internationale sportive des sourds, l’un des plus anciens mouvements sportifs affinitaires dans le monde. La création du mouvement des sourds sportifs, puis la mise en oeuvre de ces premiers Jeux olympiques silencieux, ont soulevé des questions auxquelles la littérature scientifique n’a que très rarement tenté de répondre (Séguillon, 2023, 2024a, 2024b). Elles doivent nous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels et de savoir dans quelles mesures les sourds sportifs sont des sportifs singuliers, des sportifs comme les autres ou des parasportifs ? Dans ce contexte, pour certains, comme la définition du para-sport[3] pourrait le permettre, les sourds-sportifs seraient aujourd’hui des parasportifs, voire des sportifs paralympiques alors que pour d’autres, et notamment les dirigeants du mouvement sportif sourd international, les sourds-sportifs sont avant tout des sourds et non des sportifs, toujours positionnés à distance du mouvement paralympique ou parasportif, les sourds ne se considérant toujours pas comme des personnes handicapées, mais comme une minorité linguistique partageant une difficulté de communication commune avec les interlocuteurs entendants, ce qui constituerait l’expression d’une identité particulière et non un handicap. Il en va, pourtant, différemment aujourd’hui pour certains et notamment des sportifs sourds de haut niveau représentant la France aux Olympiades sourdes comme les intéressés nous le rapportent dans les interviews lors des derniers Jeux d’hiver en Turquie du 2 au 12 mars 2024[4].
Au plan méthodologique, l’étude a mobilisé des fonds documentaires contemporains et nous avons compulsé notamment les archives du ministère des Sports français, celles de la FFH et du CPSF, du Comité international du sport des sourds (CISS) à Lausanne tout autant que les interviews de la direction du CPSF, de la direction de la FFH, et des deux principaux responsables du sport des sourds en Europe et dans le monde, le président de l’Organisation européenne du sport des sourds (EDSO) et le président de l’ICSD. Pour les éléments historiques, nous avons compulsé les archives de la défunte Fédération sportive des sourds de France (FSSF), celles de l’ICSD et du journal le Sportsman silencieux, le premier organe de presse de la France sportive des sourds-muets de 1914 à 1934 (Cantin, 2019b ; Séguillon, 2023).
Dans une première partie, nous allons tenter de circonscrire la notion de sourds sportifs tout autant que celle de sport-sourd et de deaflympisme au regard notamment de l’histoire du sport silencieux international et des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924. La deuxième partie de cette contribution portera sur les rapports qui existent entre les sourds sportifs, le sport et l’olympisme, sachant que régulièrement des sourds sportifs participent aux Jeux olympiques et sont parfois médaillés.
Enfin, dans la troisième partie, nous aborderons et tenterons de mettre en lumière les liens entre les sourds sportifs, le parasport, voire le paralympisme qui semble pouvoir être une nouvelle voie pour certains sportifs malentendants. Mais cela remettrait en cause les principes mêmes des précurseurs et des fondateurs du mouvement sportif sourd, entrainant un changement de paradigme amorcé depuis le début des années 1980 avec le recours aux tests auditifs pour qualifier ou non les sourds susceptibles de participer aux Olympiades sourdes, alors que précédemment, cette reconnaissance était interne, donnée par le groupe social et l’appartenance du participant à un club sportif sourd.
I. Sourds sportifs, sport-sourd et olympiade sourde
À la fin du XIXe siècle, le sport se constitue en Angleterre, puis se diffuse dans le monde entier. Les sourds ne feront alors que suivre le mouvement général dans le dernier quart du XIXe siècle et ce, tout d’abord, autour de la pratique de la bicyclette durant les loisirs pour ceux qui en ont, puis dans le cadre d’un sport amateur à visée compétitive (Benvenuto et Séguillon, 2013 ; Séguillon, 2024b). Les sourds deviennent alors rapidement des sportifs pratiquant des sports qui sont les mêmes sports que ceux pratiqués par les entendants, notamment lors des Jeux olympiques, sans aucune adaptation contrairement aux pratiques parasportives ou paralympiques.
En France, une première compétition a lieu en 1895 que l’on peut qualifier aujourd’hui, avec le recul, de premier championnat de France officieux de cyclisme sur route, le tout premier au monde. Il est organisé en région parisienne et oppose douze concurrents dont l’un s’appelle Henri Mercier, fils du fondateur des Champagnes du même nom. À l’heure où des clubs sportifs silencieux se créent un peu partout en Europe et en Amérique du Nord, le premier club sportif silencieux français, l’un des premiers clubs de sourds au monde, se constitue en 1899 à proximité de l’Institution nationale des sourds-muets de Paris à l’initiative d’anciens élèves de l’institution : le Club cycliste des sourds-muets [de Paris]. Ce club organisera durant les dix années suivantes les pratiques cyclistes et cyclo-touristiques des sourds de Paris, mais aussi de sa région et même de province (Benvenuto et Séguillon, 2014 ; Cantin, 2019a). Le sport-sourd naît aux États-Unis d’Amérique et en Europe du Nord (Norvège, Suède, Finlande et Danemark), du Centre (Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie) et de l’Ouest, dont la France dans les années 1890 à 1900 sous la forme de pratiques de loisirs non-institutionnelles (Gannon, 1981 ; Mesch et Mesch, 2018, Séguillon, 2023, 2024b). Puis, progressivement, ces pratiques s’institutionnalisent à l’image du sport silencieux français. En 1924, le sport-sourd se mue en sport-sourd olympique à partir des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris, les premiers Jeux olympiques des sourds-muets à l’initiative de Rubens Alcais. Celui-ci est alors l’un des principaux promoteurs du mouvement sportif sourd français.
Sportif au tout début du siècle autour du football-association tout d’abord, il est un excellent cycliste dans les années 1910, puis tour à tour ou simultanément, un dirigeant volontaire, un président de club de caractère, le fondateur du journal sportif le Sportsman silencieux, le secrétaire général des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924. À l’issue des premiers Jeux de Paris, il prend la direction de l’Internationale sportive des sourds le 16 août 1924 et sa présidence. Il le demeurera 29 ans jusqu’en 1953 (Séguillon et al., 2013, 2024a). Afin de répondre à la demande de diversification en 1911, un premier club omnisports est créé à Paris et organise de nouvelles pratiques dont l’athlétisme, la natation, le tir sportif, le tennis et le football en plus du cyclisme qui reste la pratique de choix, sinon la référence. Cette création d’un premier club omnisports sera très vite suivie par celle d’un deuxième, celui de Lyon en 1912, puis encore d’un troisième, à Bordeaux en 1914, puis enfin, d’un quatrième, à Paris de nouveau, en 1917. Tous ces clubs vont alors vouloir se fédérer et constituent en 1918, la FSS-M de France. Les conditions sont dorénavant réunies pour concevoir un grand mouvement sportif international en commençant par l’organisation de premiers Jeux olympiques silencieux à Paris, au lendemain des Jeux olympiques [des entendants] dont Paris vient d’obtenir l’organisation (Séguillon, 2024b).
La France sportive des sourds-muets est déclarée à la préfecture de police de Paris en 1919, une année après sa constitution sous le nom de Fédération sportive des sourds-muets de France (FSS-MF). Elle est agréée par le ministère de la Guerre le 5 mars 1920 dans les termes suivants : « la Société dite Fédération sportive des sourds-muets de France dont le siège est à Paris au 203 rue du temple, est par décision de ce jour, agréée par le ministère de la Guerre sous le numéro 7763, comme société d’instruction physique et de préparation au service militaire »[5]. Ses fondateurs et ses dirigeants ont pensé que pour être vraiment forts, « pour acquérir l’influence et parler avec autorité sans laquelle on ne peut obtenir des pouvoirs publics et des grandes administrations, les améliorations et les réformes désirées par tous les sportifs, il ne faut pas rester isolés ; qu’il ne suffit pas non plus de se regrouper en sociétés spéciales ou locales dont il est si difficile d’obtenir une action commune, mais qu’il est indispensable encore de rallier tous les groupements particuliers, tous les indépendants et les hommes de sport en un faisceau solide, qu’il faut constituer un organe unique autorisé par la généralité et la diversité de sa composition, à parler au nom de tous les sportifs »[6].
Pour les instigateurs de la création d’une France sportive des sourds-muets, il est question de se regrouper pour faire masse, pour faire communauté avec nos mots d’aujourd’hui, pour faire nation avec les mots de ces pionniers, avec une participation sociale de tous. Il s’agit de ne plus être isolé, mais de se regrouper et défendre les intérêts des sourds dans le domaine du sport, mais pas seulement. Il s’agit de défendre les droits des sourds-muets, de défendre les intérêts propres à la communauté sourde notamment en matière d’accès à l’école et à la scolarisation pour tous les jeunes sourds, ce qui n’est pas le cas alors, cinquante ans après la promulgation de la loi rendant l’école obligatoire et gratuite pour tous les petits Français. Il s’agit avant l’heure de répondre à la revendication d’une participation sociale accrue des acteurs que sont les sourds notamment dans le domaine de l’éducation, du sport ou encore d’accès à l’emploi et au travail dont les sourds-muets sont fréquemment écartés ou exclus dans la première moitié du XXe siècle. Aussi, la FSS-MF ne s’adresse-t-elle pas à une seule catégorie de sportifs, est-il dit dans le Sportsman silencieux, « partisans de tous les sports, elle regroupe tous ceux qui aiment les sports sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, tous ceux qui veulent retirer des sports tous les avantages et toutes jouissances qui apprécient aussi bien les charmes tranquilles de la route que la vive émotion des courses, tous ceux qui voient dans l’union de tous les sportsmen silencieux le véritable moyen d’assurer le succès de leurs revendications et l’idée sportive »[7].
Il est ici important de souligner que le sport et l’éducation physique dépendent encore, au début des années 1920, du ministère de la Guerre. Nous sommes dans un contexte où le sport est perçu comme un élément patriotique au service de la France. Nous ne sommes pas encore dans celui d’une pratique au service de l’éducation ou de la santé. Ainsi, la Fédération sportive est alors avant tout au service de la préparation militaire, de la formation ou plus exactement de l’instruction physique.
La tutelle va bientôt changer. Le sport ou plutôt l’activité physique va se mettre au service de la « régénération de la race » et plus sûrement encore, au service de la santé des Français et devenir un support de l’éducation. L’agrément du ministère de la Guerre marque, par ailleurs, l’entrée de la FSS-MF dans la grande « famille » du sport français. « C’est une bonne nouvelle que nous portons à la connaissance de nos amis. Les avantages de cette reconnaissance sont très grands »[8]. La FSS-MF est une structure nationale qui fédère alors deux cents membres sociétaires organisés en clubs sportifs silencieux. Ses effectifs sont en progression constante au sein de sociétés toujours plus nombreuses, est-il affirmé. En 1921, la Fédération regroupe, en effet, neuf sociétés où se côtoient les sourds sportifs et leurs familles et où l’on converse en mimique ou Langue des signes (LS).
Alors que la France est désignée pour recevoir les VIIIe Jeux olympiques en 1924, le projet de création d’une Fédération internationale de sport des sourds-muets est envisagé à l’initiative du Français, Rubens Alcais (Séguillon, 2024a). Mais, pour construire un mouvement international, il faut au moins deux entités, et ce sera chose faite, dès 1922, à la suite de la création de la Fédération sportive des sourds-muets de Belgique (FSS-MB). Dès lors, et après avoir obtenu les soutiens politiques du ministre des Sports français de l’époque, Henry Paté, et le soutien du mouvement sportif français, le projet se mue en actes et les premiers Jeux internationaux silencieux s’envisagent et se conçoivent de façon collégiale avec la participation de tous les volontaires. Cette préparation, puis la tenue de ces premiers Jeux de Paris en 1924, permet à la FSS-MF de se développer, d’obtenir les reconnaissances qui lui manquaient encore et ainsi déployer un certain rayonnement international (Séguillon, 2024b). La connaissance et la pratique de la Langue des signes (LS)[9] est une sorte de passeport, une des portes d’entrée dans la communauté sourde sportive, ce qui pourra poser question ultérieurement et notamment lors des rencontres sportives. Il s’agit de savoir si tous les « signeurs » peuvent concourir en tant que sourds sportifs. Certains de ces « signeurs » sont appelés en linguistique des codas, c'est-à-dire les enfants [puis les adultes] entendants issus de familles sourdes qui sont parfaitement bilingues : ils ont la langue des signes comme langue première, avant même le français parlé et le français écrit. Dans les premiers clubs sportifs silencieux, certains « codas » sont acceptés en tant que sourds sportifs, ce qui montre bien que la définition de la personne sourde ne réfère pas au fait de ne pas entendre ou de ne pas parler, mais plutôt au fait de s’exprimer en langue des signes, de connaître la communauté sourde, de la côtoyer et de partager la culture sourde (Mottez, 2000 ; Bull, 2000).
Que doit-on faire alors dans ce contexte des conjoints pratiquant, parfois avec une grande précision, la langue des signes, ayant intégré les valeurs de la communauté sourde, comprenant parfaitement le fonctionnement, parfois particulier, des personnes sourdes pratiquant au sein de clubs sportifs, des femmes ou hommes sourds appartenant à tel ou tel groupement sportif, voire des enfants, non sourds ou codas, inclus dans les clubs silencieux hier, comme aujourd’hui ?
Peuvent-ils être considérés comme des sourds sportifs ? Concourir lors des compétitions et des grandes rencontres sportives, telles que les Jeux internationaux silencieux hier ? La question ne se pose plus aujourd’hui lors des Olympiades sourdes comme nous allons le voir, à la suite d’une auto-imposition d’un contrôle médical ou technologique depuis 1979 sous le poids de la communauté entendante et la mise à distance, par le sport international, de la culture et de l’identité sourde.
Alors que le sport silencieux se structure, les premières pratiques sont donc le fait de sourds-muets mais aussi le fait d’entendants et d’entendantes, notamment des membres de couple mixtes, sourds-entendants et aussi de pratiques d’enfants entendants de familles sourdes. Cette spécificité serait donnée par le groupe, par la communauté qui reconnaîtrait le fait culturel d’appartenir, ou non, à la communauté et non par un quelconque degré de perte auditive comme le prêtent les diverses administrations et acceptations proches de la notion nord-américaine traduite en France sous le vocable d’audisme, concept équivalent à celui de validisme, c'est-à-dire une acceptation de la seule vision des valides. L’audisme[10] ou oralisme en France est alors une vision de celui qui entend et qui réduit la personne sourde à cette seule caractéristique, ne pouvant voir ou ne voulant envisager les autres dimensions de la personne sourde, une autre façon d’appréhender la surdité, les sourds, leur culture et notamment leur culture physique, voire leur culture sportive qui s’exprime lors des grands événements sportifs tels les premiers Jeux internationaux silencieux de Paris de 1924. Ces Jeux internationaux ont lieu du 10 au 17 août sur les stades Pershing à Paris/Vincennes pour l’athlétisme et le football, le stade nautique des Tourelles à Paris pour la natation et le plongeon, le stand de Vincennes pour le tir sportif et le vélodrome de Vincennes pour les épreuves de cyclisme sur piste, dans l’Est parisien pour l’épreuve de cyclisme sur route et enfin, sur les courts du Saint-James club de Neuilly-sur-Seine pour le tournoi de tennis. Neuf nations européennes et 146 sportifs dont une femme prennent part aux différentes épreuves durant cette semaine de compétition, une véritable semaine sportive olympique silencieuse qui est l’expression de la proximité entre les Jeux olympiques des sourds et ceux des entendants, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de cette contribution.
II. Sourds sportifs, sport et olympisme
Le règlement des Jeux internationaux de Paris en 1924 dans son article premier stipule que « les Jeux réunissent tous les quatre ans les sourds-muets de tous les pays affiliés en une compétition pacifique et fraternelle. Seuls les sourds-muets ou sourds-parlants, strictement amateurs, sont admis aux Jeux. Les pays affiliés sont responsables de l'admission exclusive de concurrents, sourds de naissance, par maladie ou par d'autres causes extérieures.
Le concurrent qui aura été convaincu d'avoir pris frauduleusement la qualité de sourd-muet sera disqualifié et s'il a conquis un titre, sera déclassé, ainsi que le pays qu'il représente, et tous les points obtenus seront supprimés. Tous les participants doivent posséder la carte de membre de leur fédération ou association, munie du visa de contrôle du Comité international du sport des sourds (CISS). (…) En cas de réclamation sur la qualité de sourd ou sourd-muet d'un concurrent, le comité exécutif se prononce sur cette réclamation et y statuera sans appel »[11]. Arrêtons-nous donc sur le passage de l’article qui dit que « seuls les sourds-muets ou sourds, strictement amateurs, sont admis aux Jeux ». Pour Rubens Alcais, la notion d’amateurisme est centrale, incontournable pour le sport silencieux international tout comme pour le sport national. « La Fédération sportive des sourds-muets de France est, avant tout, pour conserver dans la pratique du sport le caractère de haute moralité. Dans toutes les sociétés affiliées à la Fédération, on ne pratique que du sport sincère et les membres ne cultivent que de l’amour destiné pour leur club et si d’aventure, il arrive qu’un joueur se laisse tenter de donner ses muscles en compétition pour des espèces trébuchantes, la Fédération saurait agir disciplinairement »[12].
Cette question de l’amateurisme agite le mouvement sportif silencieux régulièrement depuis sa constitution et l’agitera encore par la suite tant cette question est importante, sinon fondamentale, pour le mouvement sportif silencieux français et international. Aujourd’hui encore, les sourds comme une grande partie de la population, regrettent l’abandon de l’état d’esprit de celui qui réalise des performances pour le seul plaisir de le faire, loin de toutes contingences financières, médiatiques ou nationalistes. Il est aussi question de valeurs, celle du fair-play, du désintéressement, de la camaraderie, de la fraternité, valeurs qui furent le lot du sport qu’il perdra au milieu des années 1980 avec l’inflexion du Comité international olympique (CIO) et la possibilité « officielle » de participer aux Jeux olympiques tout en étant professionnel (Séguillon, 2023). Dans la communauté silencieuse, cette question continue d’agiter le milieu sportif sourd français et international, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Les mouvements sportifs entendant et sourd dénoncent, en effet, régulièrement dans la presse le professionnalisme « déguisé » ou « rampant » dans le sport. Lors des compétitions internationales, on constate que des nations utilisent des athlètes et des sportifs non-amateurs, car professionnels de certains corps de métier d’État par exemple, comme dans les pays du bloc de l’Est à l’époque ou encore, qui possèdent un statut d’étudiant quasi-professionnel comme aux États-Unis d’Amérique.
Dans le contexte du sport silencieux, il est alors nécessaire d’appartenir à un club sportif silencieux comme imposé par le règlement des Jeux internationaux silencieux et seuls les sourds amateurs reconnus par la communauté des sourds peuvent s’y inscrire. Les athlètes et sportifs silencieux doivent donc être reconnus par la communauté sourde, et exclusivement par elle, en tant qu’amateurs et en tant que sourds. La modalité d’un contrôle auditif issue du paradigme médical, est présentée sous la pression de la société entendante, par les sourds américains promoteurs de cette réforme dans les années 1970, comme une mesure « pragmatique » ou encore « objective », alors que cette mesure tourne le dos aux principes même d’appartenir à la communauté sourde, à ses valeurs, à sa langue et à sa culture chère à Bernard Mottez (2006). Cette modalité permet, dès lors, toutes les dérives possibles et la participation d’athlètes, non-amateurs et non-sourds, dans la mesure où ce sont les pays qui contrôlent eux-mêmes la surdité des sportifs qu’ils sélectionnent. Ainsi, certaines nations peuvent faire participer des déficients auditifs qui parfois, sinon souvent, ne le sont que très partiellement et qui s’entraînent à un très haut niveau dans des clubs dits entendants permettant ainsi des rémunérations, d’abord illicites, puis à partir des années 1980, de façon légale dans le contexte de la marchandisation du sport entendant comme sourd. Ceci marquera la fin d’un certain modèle du sport silencieux originel, celui des sourds sportifs et celui de Rubens Alcais. Cette modalité va permettre, à terme, l’entrée des sports silencieux dans un autre paradigme, celui des sportifs sourds et non plus des sourds sportifs, de moins en moins muets et de plus en plus entendants, mettant ainsi à distance la pratique de la LS et la culture sourde.
Pour illustrer notre propos, nous allons prendre trois exemples. En 1924, il y a 100 ans, le cas de l’Italien Roberto de Marchi est des plus éclairants pour illustrer notre démonstration et notamment la relation entre les sourds sportifs, le sport et l’olympisme dans lequel le mouvement sportif sourd s’inscrit, dès sa naissance. Roberto de Marchi est le représentant de l’Italie sportive silencieuse lors des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924. Ce dernier regrette, d’ailleurs, être le seul sportif italien présent. Il présente néanmoins lors du Congrès constitutif de l’Internationale sportive silencieux le 16 août 1924 les sentiments de ses compatriotes d’au-delà les Alpes. Roberto de Marchi va gagner les deux épreuves du 100 et du 1500 mètres nage-libre durant la demi-journée de compétition, le mardi 12 août 1924 consacrée à la natation dans l’antre de la piscine des Tourelles, haut lieu des épreuves de natation des Jeux olympiques de Paris qui a vu les exploits de l’Américain Johnny Weissmuller notamment. Il est donc important de noter que, bien que sourd, il vient de participer aux Jeux olympiques de Paris quelques semaines plus tôt, et ce, parmi les entendants en tant que sportif et que, dans le cadre de ces premiers Jeux internationaux silencieux, il représente l’Italie sportive silencieuse en tant que sourd sportif. Au terme des Jeux silencieux de Paris, il reste, d’ailleurs, à Paris pour trouver du travail, est licencié jusqu’en 1929 au club de l’Étoile sportive des sourds-muets de Paris et a sa place dans son équipe de football. Roberto de Marchi, sélectionné olympique en « lutte » gréco-romaine avec l’équipe d’Italie, participe victorieusement à ces premiers Jeux internationaux silencieux de Paris. Il est important de souligner que les Jeux olympiques peuvent donc accueillir, hier comme aujourd’hui, les athlètes sourds, sans problème. Un départ à la seule vision de la fumée du pistolet est néanmoins particulièrement handicapant par rapport à un départ au son du pistolet du starter.
Il en sera alors, en grande partie, fini de la participation des sourds dans les grandes compétitions entendantes dans certaines disciplines par la suite à part quelques exceptions comme à Sydney avec une adaptation, à la marge, accordée par le règlement de la Fédération internationale de natation, tout spécialement destinée au nageur sourd Terence Parkin. En 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney en Australie, un départ visuel et sonore simultané est alors utilisé pour la première fois (et la dernière à notre connaissance) lors des qualifications et de la finale du 200 mètres brasse pour mettre à égalité de chances, le nageur sourd sud-africain et ses concurrents, modalité qui fera couler beaucoup d’encre, provoquant différentes réclamations des nations se classant derrière la deuxième place du nageur sourd sud-africain d’un haut niveau exceptionnel, prétextant un avantage, non-fondé, pour lui.
Terence Michael Parkin, né sourd le 12 avril 1980 à Bulawayo au Zimbabwe, est un nageur sud-africain spécialiste des épreuves de brasse. Il commence la natation à 14 ans et il est dit qu’il s'illustre aux Jeux olympiques des sourds, c’est-à-dire aux Olympiades sourdes de Copenhague au Danemark qui s’appelaient encore les Jeux mondiaux des sourds, où il remporte cinq médailles d'or et bat quatre records du monde des sourds lors de sa première participation en 1997, à dix-sept ans. Prenant le départ des courses grâce à un signal lumineux, le Sud-africain fait également des apparitions avec les nageurs entendants grâce à cette adaptation qui ne l’avantage pas, mais qui le remet au même niveau que ses concurrents entendants, chacun ayant les mêmes informations par deux canaux sensoriels différents, ce qui peut sembler une modalité équitable et véritablement inclusive, visant une meilleure participation sociale. En 1999, le nageur obtient même sa première récompense dans une compétition internationale majeure, non réservée aux sourds. Lors des championnats pan-pacifiques, Parkin décroche le bronze sur 200 mètres brasse. En mars 2000, Parkin remporte deux médailles d'argent lors des championnats du monde en petit bassin organisés à Athènes. Il s'y distingue sur 200 mètres brasse - deuxième - puis de nouveau second, lors de l’épreuve du 400 mètres quatre nages. Quelques mois plus tard, le nageur sud-africain participe donc à ses premiers Jeux olympiques à Sydney. Il s'illustre lors des Jeux olympiques d'été de 2000 en remportant la médaille d'argent sur 200 mètres brasse. Questionné sur sa surdité, Terence Parkin répond qu’il a participé aux Jeux olympiques pour représenter l'Afrique du Sud mais aussi car « c'était très important pour moi d'y aller et de montrer que les sourds peuvent faire quelque chose » (site Wikipedia, Terence Parkin).
24 ans après les exploits de Terence Parkin, la Française Paméra Losange a tenté, sans succès, de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette jeune d’origine antillaise est une athlète de haut niveau, sourde ou plus exactement, malentendante, ce qui ne l’empêche pas d’entendre l’ordre du starter semble-t-il, et ne l’handicape que partiellement au départ de la course, élément clé pour réaliser une grande performance en sprint. Paméra Losange, née le 28 août 2002 à Sarcelles, est une athlète française, spécialiste des épreuves de sprint et du 200 mètres notamment. En 2022, elle participe aux Olympiades sourdes au Brésil. Lors de ces Jeux d’été 2022, Paméra Losange s’offre l’or à deux reprises et les records du monde sourd du 100 mètres et 200 mètres. Elle signe le huitième titre pour la délégation française et la seizième médaille au total pour le clan français. En 2023, elle se classe deuxième du relais 4 × 100 mètres des championnats d'Europe espoirs et fin juillet, elle remporte le titre du 200 mètres des championnats de France élite en 2023 à Albi.
Ces trois exemples montrent que depuis un siècle, les sourds sportifs sont à la fois des sportifs ordinaires pouvant participer, voire gagner des titres et des médailles lors des grandes compétitions sportives et même lors des Jeux olympiques, mais n’oublient pas de participer aux Jeux internationaux silencieux hier ou aux Deaflympics aujourd’hui. Les sourds sportifs peuvent donc être aussi des sportifs comme les autres, mais restent, pour l’essentiel, défavorisés par le fait qu’ils n’entendent pas ou qu’ils entendent mal ou peu, ce qui ne leur permet pas de concourir à égalité avec les concurrents ou adversaires, non-sourds. Cette reconnaissance, ils vont alors la chercher dans les compétitions ou rencontres entre sourds comme les Olympiades sourdes, ce qui demeure encore aujourd’hui, pour la majorité des sportifs sourds, la plus grande des compétitions, leurs Jeux olympiques à eux, ceux de la petite mais valeureuse communauté sourde sportive internationale. Le sourd, dans le contexte des Olympiades sourdes, est un sourd sportif et dans le cadre des Jeux olympiques, il est un sportif sourd démontrant la normalité des sourds lorsqu’ils pratiquent les sports et l’éducation physique. Dans ce cadre, il est un sportif comme les autres et les dirigeants du sport international souhaitent un statut quo et ne pas le voir classé dans la catégorie des personnes en situation de handicap, dépendre des instances parasportives ou paralympiques et que le sourd-sportif ne devienne un parasportif ou un paraathlète.
III. Sourds sportifs, parasport et paralympisme
Avant d’aller plus loin, rappelons brièvement les frontières et les acceptations qui unissent et séparent les différents concepts, notamment ceux de parasport et de paralympisme. Pour faire synthétique, le parasport est le sport pratiqué par les athlètes et sportifs parasportifs. C’est-à-dire toutes les pratiques des publics accueillis au sein du mouvement parasportif et handisportif en France, alors que les sports paralympiques, au nombre de vingt-deux aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, ne sont que les pratiques présentes à ces Jeux. Les pratiques parasportives sont donc à la fois les activités pratiquées lors des Jeux paralympiques [pratiques sportives paralympiques d’été et d’hiver] et les activités physiques, non paralympiques, compétitives ou de loisirs incluant les pratiques des personnes déficientes intellectuelles ou psychiques et également, selon le site du Comité paralympique et sportif français (CPSF), les pratiques des sourds sportifs, opinion ou définition pas forcement partagée par la communauté sourde sportive internationale et française, notamment suite à la disparition de la Fédération sportive des sourds de France (FSSF) et des interdictions qui s’en sont suivies.
Il est nécessaire de se souvenir que les sourds et les sourds sportifs en particulier ne se considèrent pas comme des personnes handicapées, mais comme une minorité linguistique. Ils se souviennent également qu’en 2005, la FSSF a mis la clé sous la porte faute de subventions d’État conséquentes notamment et fut dissoute en 2008 après quatre-vingt-dix ans d’existence en tant qu’entité politique revendiquant toute la normalité des sourds sportifs lorsqu’ils pratiquent, entité de défense des intérêts des sourds et de la communauté. Une partie des associations de la défunte fédération intègrent alors la Fédération française handisport (FFH). Afin que le sport sourd continue d’exister institutionnellement en France, quelques anciens dirigeants n’ont d’autre choix que d’intégrer la FFH et d’épouser le modèle du handicap et de l’inadaptation, seule alternative pour sa survie et son maintien dans le concert sportif. Dès lors, une petite proportion de sourds sportifs de la défunte FSSF intègre la FFH au sein d’une commission du sport sourd, créée pour l’occasion.
Le sport sourd est désormais sous tutelle d’une organisation fédérale organisant le sport des personnes en situation de handicap ayant des incapacités motrices et sensorielles, la FFH et d’un président qui n’est pas sourd. Or, les statuts des organisations internationales du sport sourd stipulent que les instances nationales doivent être indépendantes, élues et dirigées par un sourd. Une controverse éclate alors. Il est fait interdiction aux sourds sportifs français de participer aux compétitions internationales sous la bannière de la FFH, décision prise par les structures sportives européennes et mondiales des sourds : the European Deaf Sport Organisation (EDSO) et l’ICSD (Meziani et Séguillon, 2020). Le mouvement sportif international finit par suspendre les sourds sportifs affiliés à la FFH de toutes compétitions internationales privant ainsi les sourds sportifs français de participation aux rencontres internationales organisées par le mouvement sportif sourd. Afin de pallier cette interdiction, la commission est dissoute et une nouvelle structure voit le jour au sein de la FFH : le Comité de coordination des sportifs sourds de France (CCSSF) qui marque à la fois la « victoire » provisoire du ministère des Sports français et celle de la FFH, et de son président, Gérard Masson, et la défaite ou vécue comme telle, par les sourds sportifs. Par cette action, la FFH reconnaît, en partie, la spécificité de la communauté sportive sourde en son sein.
Cette décision met un terme à trois années de tensions entre la FFH et l’ICSD. La décision prise à contrecoeur par l’ICSD reconnaît le CCSSF et la FFH comme interlocuteurs nationaux et internationaux. L’assemblée générale de l’EDSO en juin 2012 à Moscou entérine la décision prise par l’ICSD. L’opposition entre FFH et ICSD s’achève donc sur un compromis jugé en interne du mouvement sourd largement défavorable aux sourds sportifs et à l’ICSD, mais permet néanmoins aux sourds sportifs français de participer, de nouveau, aux compétitions et rencontres internationales dont les Deaflympics (Séguillon et al. 2013 ; Séguillon, 2022).
À la suite de cette fusion et du transfert des sourds sportifs de la FSSF vers la FFH et après quinze années passées à la FFH, les sourds sportifs reprennent, en partie, leur errance et viennent d’intégrer, pour les questions internationales au 1er janvier 2024, le Comité paralympique et sportif français (CPSF). Les sourds sportifs viennent donc de réintégrer une structure qu’ils ont, en partie, créée en 1992 avec le Comité français dit de liaison pour les activités physiques et sportives des personnes handicapées (COFLAPSH) et qu’ils ont quittée en 1996, soit trente ans auparavant, ce qui peut être perçu comme un pied de nez à l’histoire commune du parasport et du sport des sourds français. Que ce soit au sein du CPSF ou bien encore de la FFH ou enfin au sein de la FSS-M de France, le sport silencieux français s’est construit à l’aide et avec le soutien de politiques publiques, par notamment l’octroi de subventions d’État et avec l’aide du ministère ou du secrétariat des Sports depuis la naissance du sport en France tout autant que des aides octroyées par les collectivités locales : communes, départements, régions. Le sport silencieux en a bénéficié dès la naissance du mouvement sportif français et ce, jusqu’aux années 1970-1980. Ce fonctionnement étatique est alors remis en cause progressivement et en fonction des sensibilités politiques des gouvernements successifs. La part de l’État français est de moins en moins importante dans le fonctionnement du sport et du mouvement sportif français et on note un désengagement certain au profit du mouvement sportif (Comité national olympique et sportif français, CNOSF) et parasportif (CPSF), et un financement privé ou produit du mécénat ou du sponsoring en constante augmentation.
Pour la France sportive des sourds, cette transformation a été violente, comme nous l’avons vu, au tout début des années 2000. En effet, dès la fin des Trente Glorieuses, le mouvement sportif sourd est remis en cause, à la suite du changement de paradigme conceptuel lié à la déficience et à l’incapacité, celui de faire entrer les sourds dans la catégorie des personnes en situation de handicap, alors qu’ils n’ont fait que clamer leur opposition face à cette nouvelle catégorisation. Suite à cette profonde évolution et en parallèle du modèle sportif français tel que nous l’avons décrit, voyant une baisse continue des subventions d’État, le mouvement sportif des sourds français est contraint comme, par exemple, lorsque le président de la FSSF, José Vazquez en 1993, doit hypothéquer son propre appartement pour permettre à la petite délégation de sourds sportifs français de participer aux Jeux mondiaux silencieux de Sofia en Bulgarie. Depuis ces années-là, le mouvement sportif sourd autonome s’est progressivement replié sur lui-même pour, en définitive, s’éteindre. Il a rejoint par la suite le mouvement handisportif à contrecoeur et sans vraiment de projet de développement.
Depuis 2017, la FFH n’est, néanmoins, plus la seule fédération à organiser les sports pour les personnes sourdes en France et au plan international. À la demande du ministère des Sports, la FFH a transféré les responsabilités à l’international à une nouvelle instance, une commission dédiée aux sports pour les sourds du CPSF. Cette décision de transfert de compétences vers le CPSF, actée en avril 2023 par l’assemblée générale de la FFH, n’impacte que l’inscription des équipes de France des sports pour les sourds aux compétitions internationales et le dialogue avec l’ICSD. La FFH tient, quant à elle, à réaffirmer sur son site, tout « son attachement et son engagement en faveur du développement des pratiques sportives pour toutes les personnes touchées par un handicap sensoriel » et dans le cas présent, pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette mission « entamée en 2008 et solidement ancrée dans chacune des disciplines dont elle a la responsabilité » est-il dit, ainsi que dans les territoires, les comités et les clubs affiliés, est au coeur des attentions de la FFH qui, en parallèle, « souhaite renforcer ses liens avec l’ensemble des acteurs de la communauté sourde » (Site Handisport, mars 2024).
En 2017, le ministère des Sports délègue certains « para-sports » à d’autres fédérations, candidates et volontaires comme le judo, le tennis, le volley, etc. La délégation comprend l’organisation du sport sur le territoire et l’édiction des règlements sportifs, la gestion du haut niveau et l’attribution de titres nationaux notamment les championnats de France. La FFH reste « la première fédération proposant des activités physiques et sportives pour les personnes atteintes d’un handicap physique et sensoriel en nombre de disciplines déléguées et de sports proposés dans ses clubs affiliés au nombre de soixante » tels que le football, l’athlétisme, la natation, le tennis de table, les sports de boules, le bowling, le ski, etc. Aujourd’hui, n’étant plus, depuis 2017, la seule fédération à organiser les pratiques sportives pour les sourds en France, la FFH n’a plus, est-il rappelé sur son site « la légitimité pour représenter toutes les disciplines auprès des instances internationales ». Dès lors, l’ICSD semble avoir reconnu et accepté la proposition d’une nouvelle organisation pour la représentation du sport sourd en France faite conjointement par la FFH et le CPSF, faisant qu’à ce jour « le CPSF est reconnu à titre temporaire comme le représentant et l’interlocuteur de l’ICSD sur le territoire français et suspendant de ses fonctions la FFH et son organe dédié, le CCSSF, avec application immédiate ». L’ensemble de ces dispositions sera validé « de manière définitive au prochain congrès de l’ICSD » à Paris en octobre 2024, est-il prévu.
Une commission dédiée aux sports sourds du CPSF a vu sa pleine effectivité le 23 janvier 2024. Elle est composée des membres référents des sports sourds des fédérations délégataires, dont trois représentants de la FFH. Il est dit que celle-ci « organise toujours le développement des pratiques, des compétitions et des équipes de France des sports pour les sourds dont elle possède la délégation, notamment en athlétisme, bowling, cyclisme, football, natation, tennis de table, sports de boules ou encore en ski ». Cela semble ne rien changer pour la pratique sportive des personnes sourdes et malentendantes en France. Elle se fait toujours au sein des clubs FFH, avec l’accompagnement des comités handisport et des commissions sportives handisport. À cette occasion, la FFH a renforcé ses équipes dédiées spécifiquement à l’accompagnement des sports pour les sourds, l’un en charge du développement et l’autre en charge de la performance, et des liens avec les acteurs de la communauté sourde. Des référents sport sourd ont été identifiés ou sont en passe de l’être, dans les commissions sportives concernées.
Enfin, est-il dit, « la FFH poursuit l’accompagnement des comités régionaux et départementaux dans le développement des sports pour les sourds sur les territoires, et avec les grandes associations de la communauté sourde, essentielles à la promotion de la pratique sportive » (source site FFH, mars 2024).
Au terme de cette troisième et dernière partie, nous pouvons affirmer que le sport sourd à l’image du parasport ou encore du sport en France ne relève plus que faiblement de l’État français au profit des mouvements sportifs et parasportifs français. Depuis le début de l’année 2024, nous assistons à une nouvelle reconfiguration de l’organisation du sport sourd en France, celui-ci migrant en partie, pour l’international de la FFH vers celui du CPSF, réorganisant ainsi, en continuité avec le système précédent piloté par la FFH, le mouvement sportif sourd français et l’accompagnement de ses pratiquants de haut niveau sans un accord formel avec les sourds sportifs, ou plus encore, de la communauté sourde ; seuls les athlètes de haut niveau sourds ou plus exactement malentendants aspirent à rejoindre le parasport et le paralympisme, et ainsi obtenir les mêmes aides financières et matérielles que les parasportifs.
Conclusion
Au regard des dernières Olympiades sourdes en Turquie en mars 2024, les sourds sportifs français sont avant tout aujourd’hui des sportifs sourds à leurs dires ; s’entrainent très majoritairement dans des clubs ou des structures entendantes et non plus sourdes ; sont pour l’essentiel des malentendants et non pas des sourds de naissance, ne possédant généralement pas la langue des signes comme outil de communication ; ne partagent pas, ou à la toute marge, la culture des sourds et les activités de la communauté. Ces derniers souhaiteraient devenir des sportifs paralympiques à part entière et ainsi bénéficier de toutes les aides des sportifs olympiques ou paralympiques. Ils souhaiteraient, participer aux Jeux paralympiques dans des catégories qui resteraient à créer et obtenir, comme les sportifs paralympiques en France, les primes d’intéressement octroyées par le ministère de tutelle selon les places et les résultats obtenus, demandes en rupture avec les valeurs promues par les pionniers et les premiers militants du mouvement sportif sourd français du début du XXe siècle, par les fondateurs du sport des sourds international et notamment par son porte-parole, Rubens Alcais.
Le 25 avril 2024, à Paris, à l’Institut national de jeunes sourds, lors de l’inauguration de l’exposition du Centenaire des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924 et la création du Comité international des sports silencieux lors de leurs discours respectifs, le représentant du sport international des sourds, Yosif Stavrakakis [sourd], il fut brièvement question de la place qui doit être réservée aux sourds sportifs ou aux sportifs sourds en France. Cette nouvelle place commence à prendre forme actuellement, a amorcé sa métamorphose qui remet en cause, en partie au moins, la place des sourds sportifs dans le processus de décision et de fonctionnement accordée au sport pour les sourds dans les prochaines années et la place des sourds sportifs vis-à-vis du parasport et du sport sourd. Encore faudra-t-il que la communication puisse exister et que la volonté d’aboutir à un consensus soit présente et ne laisse personne sur le bas-côté. À la lumière de ces faits et de cette nouvelle situation en France, les membres de la communauté sportive sourde ont-ils leur rôle à jouer ou seulement les sportifs de haut niveau ?
Doivent-ils tenter de peser sur les décisions pensées, sans eux, sans la communauté sourde, sportive ou non ? Doivent-ils entrer en négociations avec le pouvoir sportif et parasportif français, et notamment celui du CPSF, avec le pouvoir politique français également, celui du ministère des Sports ? Doit-on aller vers la reconstitution d’une structure autonome comme la défunte Fédération sportive des sourds de France, comme l’ICSD le souhaiterait semble-t-il ? Mais il apparaît qu’il n’en est pas question du côté des instances ministérielles du sport. Doit-on souscrire à l’édification d’une structure hybride au sein du CPSF pour le sport international et rester à la FFH pour le sport pour tous et pour chacun ? Inscrire et entériner l’entrée du sport des sourds dans le parasport comme cela commence à se faire et, s’agissant du mouvement sportif international, doit-t-il perdre alors son autonomie ou être absorbé, à son tour, dans les Jeux paralympiques ?
Nombre de questions demeurent, aujourd’hui, sans réponse. Il faudra, néanmoins, en trouver une par et pour les sourds sportifs, la communauté ne perdant pas de vue, comme l’adage le dit, que « rien ne doit se faire sans nous », soulignant la participation sociale pleine et entière des sourds sportifs et de la communauté au projet sportif les concernant en France et à l’international.
Il s’agit d’être confiant dans l’avenir et de laisser les parties prenantes souscrire à l’idée majeure que toutes les activités doivent inclure la participation sociale de tous et en premier lieu des personnes concernées, c'est-à-dire des sourds. Une page de l’histoire internationale, mais aussi française, du sport des sourds est en train de s’écrire dans un contexte incertain à bien des égards. L’enjeu pour le mouvement sportif international des sourds et pour the International Committee of Sport for the Deaf (ICSD) est de première importance. À cette occasion, sa survie en tant qu’entité autonome et revendicatrice se joue-t-elle, à l’image de ce qui s’est passé en France au tout début des années 2000 lorsque disparurent la Fédération sportive des sourds de France tout autant qu’un pan entier de l’identité et de la culture sourde ?
Parties annexes
Notes
-
[1]
Voir à ce sujet, le contenu de l’exposition La Folle semaine des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924 - 10-17 août. 29 avril au 4 octobre 2024. Institut national de jeunes sourds de Paris, 254 rue Saint-Jacques, Paris 5e. Commissaire principal : Didier Séguillon.
-
[2]
Voir à ce sujet, le contenu de l’exposition Histoire paralympiques. De l’intégration sportive à l’inclusion sociale (1948-2024) au Panthéon à Paris du 11 juin au 29 septembre 2024. Le titre même et la datation de l’exposition excluent l’histoire du mouvement des sportifs sourds, celle-ci ne relevant, pour ses sociologues et historiens, que de l’histoire du paralympisme. Il est donc clair que les sourds sportifs ne sont pas des athlètes paralympiques à la lecture de cette histoire, mais catégorisés à part, liés par des rapports privilégiés avec la sphère olympique, et n’auraient aucun lien avec la galaxie parasportive, ce qui se trouve démenti pourtant suite au maintien des associations sportives sourdes à la Fédération française handisport (FFH) et au rattachement en ce qui concerne toutes les questions du sport international des sourds, des sportifs sourds français au Comité paralympique et sportif français (CPSF) depuis le 1er janvier 2024.
-
[3]
Selon le site du Comité paralympique et sportif français (CPSF) et à la réponse à la question quelle différence entre les termes paralympique, parasport ou encore handisport, il est dit que le parasport « est le terme générique pour désigner l’ensemble des sport pratiqués par les personnes en situation de handicap, en loisir comme en compétition, inscrits au programme des Jeux Paralympiques ou non » (mars 2024).
-
[4]
Deaflympics : entre besoin de reconnaissance et culture de la différence, le combat des athlètes sourds pour se faire entendre. Article rédigé par Clément Mariotti-Pons, France Info-Sport. France télévision. 2 mars 2024.
-
[5]
Le Sportsman silencieux. Le but et le rôle de la Fédération sportive des sourds-muets de France. Septième année, nouvelle série, n°13-14, janvier-février 1920, p. 1.
-
[6]
Op. cit, n°13-14, janvier-février 1920, p. 1.
-
[7]
Op. cit, n°13-14, janvier-février 1920, p. 1.
-
[8]
Le Sportsman silencieux. Fédération sportive des sourds-muets de France. Septième année, nouvelle série, n°16, avril-mai 1920, p. 2.
-
[9]
La langue des signes (LS) est la langue première par laquelle les sourds communiquent entre eux. Elle possède sa propre syntaxe, évolue, se complexifie, comme n'importe quelle langue orale. Les sourds en s'exprimant en langue des signes obéissent à un ensemble de règles.
-
[10]
L’audisme, d’origine nord-américaine ou audism, est un néologisme utilisé pour qualifier les préjugés négatifs, la discrimination ou l'hostilité à l'encontre des sourds et de la communauté. Ce phénomène de société concerne un groupe social et linguistique minoritaire, celui des sourds et est, pour des militants de la communauté sourde, comparable au validisme ou encore au capacitisme en Amérique du Nord. (Grenier et Fougeyrollas, 2020). Ce concept d’audism en anglais a été inventé aux États-Unis en 1975, par Tom Humphries, dans sa thèse de doctorat non publiée Audism: The making of a word. L'idée est que quelqu'un serait supérieur « sur la base de sa capacité à entendre ». Le terme audisme n’est pas un mot de la langue française, il n’a pas reçu un accueil favorable par l’Académie française et n’apparaît donc toujours pas dans le dictionnaire de la langue française.
-
[11]
Op. cit., édité par Druckerei Siepmann à Essen, 1924, p. 24.
-
[12]
Le Sportsman silencieux. Éditorial. Au Comité national des sports. Dix-huitième année, n°144, février 1931, p.1.
Bibliographie
- Bedoin, D. (2018). Sociologie du monde des sourds. La Découverte.
- Benvenuto, A. (2009). Qu’est-ce qu’un sourd ? De la figure au sujet philosophique [thèse de doctorat, Université de Paris VIII].
- Benvenuto, A. et Séguillon, D. (2014). Des premiers banquets des sourds-muets à l’avènement du sport silencieux. 1834-1924. Dans Surdités, langues, cultures, identités : recherches et pratiques. La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation (n°64, p.135-150). INSHEA.
- Bernard, Y. (2015). L’esprit des sourds. Les signes de l’antiquité au XIXe siècle. Éditions du Fox.
- Bertin, F. (2010). Les sourds. Une minorité invisible. Autrement.
- Blanchard, P., Bancel, N., Boli, C., Bolz, D., Charitas, P., Cissé, S.-H., Gastaut, Y., Gökalp, S., Jolys-Shimells, E., Lemaire, S., Mourlane, S., Tétart, P. et Thomas, D. (2024). Olympisme : une histoire du monde. Des premiers Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Catalogue de l’exposition au Palais de la Porte Dorée. Musée de l’histoire de l’immigration. Éditions de La Martinière.
- Bull, T. (2000). En marge de la culture sourde : enfants entendants, parents sourds. Enfants de parents sourds. Revue internationale Surdités, 2.
- Cantin, Y. (2019a). La communauté sourde de la Belle Époque (1870-1920). Archives et Culture.
- Cantin, Y. (2019b). Les archives de la communauté sourde à Paris, quelles possibilités d’un regard élargi ? Cahiers d'histoire, 37(1), 197-215.
- Cuxac, C. (1983). Le langage des sourds. Payot.
- Delaporte, Y. (2002). Les sourds, c’est comme ça. Édition de la Maison des sciences de l’homme.
- Encrevé, F. (2012). Les sourds dans la société française au XIXe siècle. Idée de progrès et langue des signes. Créaphis.
- Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le fil et la toile. Transformation réciproques du sens du handicap. Presses de l’Université Laval.
- Gannon, J. R. (1981). Deaf heritage: A narrative history of deaf America. National Association for the Deaf.
- Gaucher, C. (2007). L’indiscutable différence des Sourds : intégration et pluralisme au sein des mondes occidentaux. Dans S. Vibert (dir.), Le pluralisme dans les sociétés modernes : culture, droit et politique (p. 354-392). Québec-Amérique.
- Gaucher, C. (2009a). Ma culture, c’est les mains. La quête identitaire des sourds au Québec. Les Presses de l’Université Laval.
- Gaucher, C. (2009b). L’altérité des sourds : deux lieux communs pour interroger la liminalité des sociétés individualistes. Monde commun, 1, 2. CIRCEM. Université d’Ottawa.
- Gaucher, C. (2012). Les sourds ne gesticulent pas, ils signent : réflexion sur le rapport entre corps sourds et langues des signes. Anthropologie et Sociétés, 36(3), 153-170.
- Grenier, Y. et Fougeyrollas, P. (2020). Capacitisme. Dans Dictionnaire anthropologique Anthropen. Université Laval.
- Jahan C., Gueret, W. et Séguillon, D. (2024). La Folle semaine des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924. Catalogue de l’Exposition. Institut national de jeunes sourds de Paris du 29 avril au 5 juillet 2024. INJS de Paris.
- Karacostas, A. (1999). Oublions les choses. Ne considérons que les rapports. Revue internationale Surdités. Les professionnels, 1.
- Kerbouc’h, S. (2012). Le Mouvement Sourd. 1971-2006. De la langue des signes française à la reconnaissance sociale des sourds. L’Harmattan.
- Lachance, N. (2007). Territoire, transmission et culture sourde. Perspectives historiques et réalités contemporaines. Les Presses de l’Université Laval.
- Marcellini, A., Lefèvre, N., De Leseleuc, E. et Bui-Xuan, G. (2000). D’une minorité à l’autre… Pratique sportive, visibilité et intégration sociale de groupes minoritaires. Loisir et Société, 23(1), 251-272.
- Marcellini, A. et Villoing, G. (2014). Corps, Sport, Handicaps. Tome 2. Le mouvement handisport au XXIe siècle. Lectures sociologiques. Téraèdre.
- Mesch, U. et Mesch, J. (2018). The Deaf Sport. Movement in Europe. Deaf Sport Without Borders. European Deaf Sport Organisation (EDSO).
- Meziani, M. et Séguillon, D. (2020). De faire communauté à faire société. Controverse entre les Sourds sportifs et le monde de l’handisport. Aequitas, Revue de développement humain, handicap et changement social, 26(2).
- Mottez, B. (1976). À propos d’une langue stigmatisée, la Langue des signes. École des hautes études en sciences sociales. Centre d’études des mouvements sociaux.
- Mottez, B. (1977). À s’obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap : l’exemple des sourds. Revue du Département de sociologie de l’Université de Montréal, 1.
- Mottez, B. et Markowicz, H. (1979). Intégration ou droit à la différence, les conséquences d’un choix politique sur la structuration et le mode d’existence d’un groupe minoritaire, les Sourds (rapport au CORDES). CEMS.
- Mottez, B. (1979a). Contenu des concepts : la culture sourde et la langue des signes. Dans J. Simonin (dir.), Le langage mimo-gestuel dans l’éducation des déficients auditifs. CTNERHI.
- Mottez, B. (1979b). Les sourds comme minorité linguistique. Rééducation orthophonique, 17(107). Dans A. Benvenuto (dir.), Les Sourds existent-ils ? L’Harmattan.
- Mottez, B. (2000). Les Codas, une communauté de vécu. Enfants de parents sourds. Revue internationale Surdités, 2.
- Mottez, B. (2006). Les Sourds existent-ils ? Textes réunis et présentés par Andréa Benvenuto. L’Harmattan.
- Ruffié, S. et Ferez, S. (2013). L’institutionnalisation du mouvement handisport (1954-2008). Corps, Sport, Handicaps. Tome 1. Téraèdre.
- Séguillon, D. (1998). De la gymnastique Amorosienne au sport silencieux : le corps du jeune sourd entre orthopédie et intégration ou l'histoire d'une éducation À Corps et à Cri (1822–1937) [thèse de doctorat, Université Bordeaux-II].
- Séguillon, D. (2002). The Origins and Consequences the First World Games for the Deaf, Paris, 1924. The International Journal of the History of Sport, 19(1), 119-136.
- Séguillon, D., Ferez, S. et Ruffié, S. (2013). L’inclusion des Sourds sportifs au sein du mouvement handisport : un impossible défi ? Dans S. Ruffié et S. Ferez (dir.), Histoire du mouvement handisport. Téraèdre.
- Séguillon, D. (2017). L’éducation de l’écolier sourd, histoire d’une orthopédie (1822-1910). De l’art de prévenir et de corriger les difformités du corps à celui de faire parler et entendre. Presse universitaire de Paris-Nanterre.
- Séguillon, D. (2022). Quelle place pour le sport de l’entre soi dans le contexte d’une société inclusive ? Un exemple d’exclusion autour des pratiques sportives des Sourds. Dans I. Queval (dir.), Altérité (s) et société inclusive. INSHEA.
- Séguillon, D. (2023). Le Sportsman silencieux. Monographie du premier organe de presse de la France sportive des sourds-muets. 1914-1934. L’Harmattan.
- Séguillon, D. (2024a). Rubens Alcais. Biographie d’un sourd sportif engagé pour la défense et l’émancipation de la communauté silencieuse. 1884-1963. L’Harmattan.
- Séguillon, D. (2024b). Les Jeux internationaux silencieux de Paris en 1924. Les autres Jeux olympiques. 10 au 17 août. L’Harmattan.
- Stewart, D. A. (1991). Deaf Sport. The Impact of Sports Within the Deaf Community. Gallaudet University Press.
- Verstraete, P. (2015). Vers une approche plus fluide de la culture et de l’histoire des sourds : quelques réflexions sur le rôle des organisations sportives pour les sourds dans la naissance d’une culture sourde en Belgique. Alter, European Journal of Disability Research, 9(4), 265-277.

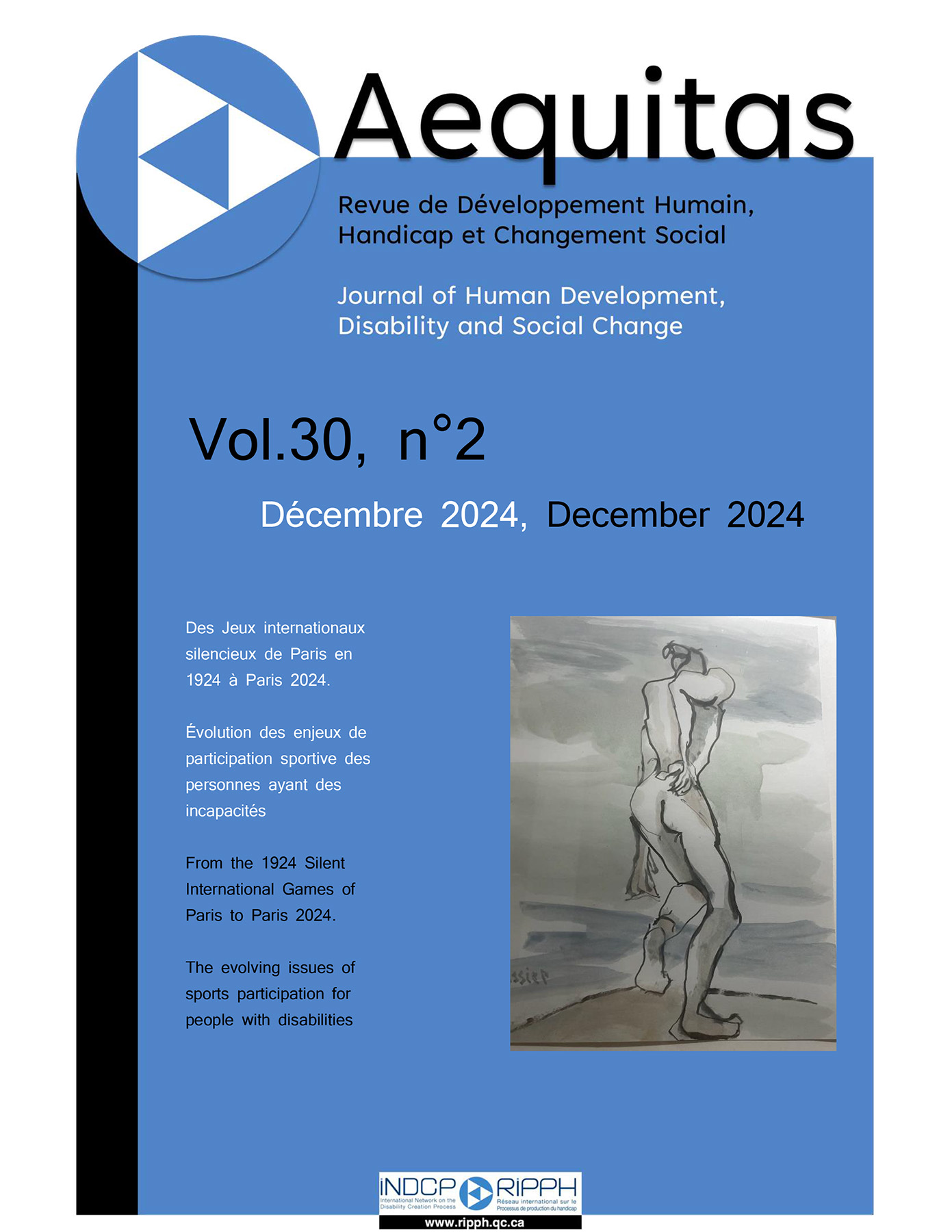
 10.7202/1067961ar
10.7202/1067961ar