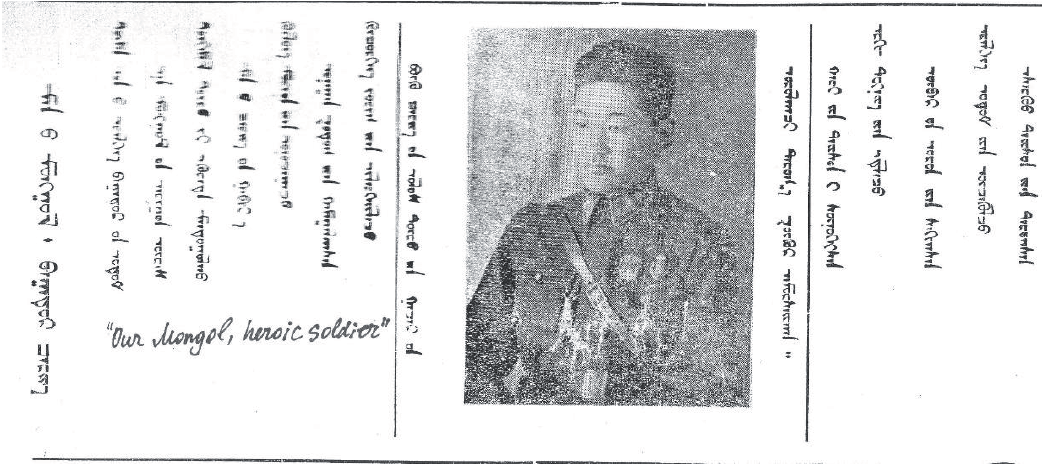Résumés
Résumé
À travers quelle sorte de panoptique une communauté sociale regarde-t-elle la société dans laquelle elle vit et comment donne-t-elle à l’image de cette société l’apparence d’une totalité bienveillante? Ce texte pose l’hypothèse de la perpétuation, dans la Mongolie postsocialiste, d’un dispositif de mise en confiance façonné dans la dernière phase de l’édification du socialisme en Mongolie (vers la fin des années 1950). Ce dispositif ancre un type particulier de mémoire sociale – la mémoire sociale des exemples – dans un sentiment nostalgique commun mais très prégnant en Mongolie : l’absence des êtres chers. J’avance que cet ancrage permet de comprendre la pérennité de ce dispositif dans une société mongole postsocialiste surtout caractérisée par une situation de précarité de la confiance sociale.
Mots-clés:
- Legrain,
- confiance sociale,
- Mongolie,
- post-socialisme,
- nostalgie,
- mémoire sociale
Abstract
Through which kind of panopticon a social community looks the society in which it lives? How this community gives to the image of this society the appearance of a benevolent totality? This text make the assumption of the perpetuation, in postsocialist Mongolia, of a technology of trust implemanted during the last phase of the construction of socialism in Mongolia (from the end of the Fifties). This technology roots a particular type of social memory – « the social memory of exemplars » (Kaplonski 2004 : 182) - in a common but very well distributed nostalgic feeling : the absence of the beloved beings. I argue that this emotional fundation makes it possible to better understand the perenniality of this kind of technology in a Mongolian postsocialist society characterized by a situation of precariousness of social trust.
Keywords:
- Legrain,
- social trust,
- Mongolia,
- postsocialism,
- nostalgia,
- social memory
Corps de l’article
Pour le sociologue Emmanuel Belin, la confiance n’est pas un donné de la relation sociale. Elle se génère, s’instaure et se maintient grâce à « des mécanismes sociaux de mise en confiance qui prennent des formes historiques spécifiques » (Belin 2002 : 136 ; voir aussi Gambetta 1988 et Giddens 1990). Cet article pose l’hypothèse de la persistance dans la Mongolie contemporaine d’un dispositif de mise en confiance façonné durant la période soviétique (1921-1991). Ce dispositif s’ancre dans ce que Christopher Kaplonski a nommé « la mémoire sociale des exemples ». Plutôt qu’une mémoire se construisant autour du souvenir d’évènements et de lieux, l’auteur souligne le travail, dans le contexte mongol, d’une mémoire « organisée autour d’individus particuliers agissant comme des exemples » (Kaplonski 2004 : 182). Je montrerai comment cette forme de mémoire sociale est mobilisée et permet aux individus de penser leur société sous un jour plus flatteur que celui de l’image habituelle d’une société dérégulée, où celui que l’on ne connaît pas personnellement (tanihgui hün) représente un danger potentiel.
Mais comment peut-on comprendre la pérennité de ce dispositif de mise en confiance dans la tempête des changements socio-économiques qui caractérise la Mongolie postsocialiste? À mon sens, il tire une partie de sa vitalité d’une forme commune de nostalgie – provoquée par l’absence des êtres chers –, qui constitue une corde particulièrement sensible de l’émotivité mongole sur laquelle les politiques culturelles des années 1950 jouèrent avec insistance. J’avancerai l’idée que le dispositif de mise en confiance opérant aujourd’hui trouve son agencement actuel dans ces années marquées par d’intenses changements sociaux.
Mon postulat de départ est qu’il existe en Mongolie un sentiment diffus mais bien présent que je nommerai « la précarité de la confiance sociale ».
La précarité de la confiance sociale
« Le danger pour les Mongols, c’est les Mongols » (Mongolyn ayul n’mongol). Cette petite phrase assassine est le titre d’une section d’un ouvrage historique récent écrit par un journaliste mongol renommé[1] (Tsenddoo 2007 : 8). Elle constitue la morale tirée de la relecture d’un épisode de l’histoire du pays. À la fin du XVIIe siècle, alors que des luttes intestines font rage entre les Mongols occidentaux (l’empire Zungar) et les Mongols Halha à l’est, ces derniers font alliance avec les Mandchous, fondateurs de la dynastie Qing (1644-1911). Aujourd’hui, les conséquences de cet épisode historique sont regardées comme désastreuses par bon nombre de Mongols. Pour eux, cette alliance fut à l’origine des deux siècles d’oppression mandchoue, synonyme d’isolement total, de stagnation et de pillage du pays par les maisons commerciales chinoises. L’histoire nationale selon Tsenddoo est truffée de ces « trahisons », et si la Mongolie n’est plus aujourd’hui (et depuis longtemps) capable de jouer un rôle politique de premier plan, c’est que les Mongols n’ont pas assez médité cet adage : « le danger pour les mongols, c’est les mongols ». Cette relecture historique est très populaire en Mongolie. Elle donne lieu à deux types d’interprétations. Le premier se développe sur un registre ethnique : ce sont les Halha, ethnie numériquement majoritaire, qui sont responsables de cette catastrophe historique. La phrase peut par conséquent être relue de la manière suivante : « le danger pour une ethnie mongole, se sont les autres ethnies mongoles ». Cette interprétation est d’autant plus en vogue aujourd’hui que les politiques culturelles des années socialistes ont affermi et hiérarchisé les différenciations ethniques en Mongolie (Bulag 1998 : 27-103). Mais la possibilité de lire cette phrase sur le registre ethnique ne doit pas occulter une lecture au premier degré : un mongol est en général mal intentionné vis-à-vis de son congénère. Cette dernière interprétation est peut-être plus prégnante encore que la précédente. J’en veux pour preuve non seulement la popularité d’une maxime comme « les Mongols sont mauvais l’un envers l’autre, comme les arbres détestent leurs noeuds » (Mongol mongoldoo muu, mod yarandaa muu) (ibid. 1998 : 169) ou la pléthore de petites histoires illustrant les coups bas et les arnaques entre deux personnes qui ne se connaissent pas. La mise en scène de ces entourloupes est un ressort humoristique des plus usités dans le genre théâtral très en vogue des « moqueries » (hoshin shog). Pour le spectateur, ces farces sont d’autant plus percutantes qu’elles trouvent un ancrage dans son quotidien. La myriade des interactions sociales avec l’inconnu est toujours teintée de suspicion : la peur du vol (Humphrey 1993), le soupçon permanent de corruption à tous les niveaux de la vie politique et académique, les faux chamanes, les moines incompétents… les figures de l’insécurité sociale sont nombreuses. Lorsque les membres d’un réseau de connaissances se lancent dans une entreprise qui nécessite l’aide de personnes extérieures, les palabres, hésitations et revirements sont nombreux. Et si les discussions sont si longues, c’est que les individus sur qui l’on peut compter (naidvartai hün) doivent être localisés parmi une pléthore de personnes « peu fiables ».
Il existe bien sûr des dizaines de mécanismes qui viennent adoucir cette sombre vision de la société. Dans le quotidien des relations sociales par exemple, des marqueurs interactionnels – des manières de se tenir, de s’exprimer et de se comporter – réalisent les conditions nécessaires au bon déroulement d’une relation sociale (Hamayon 1971 ; Humphrey 1987) et instaurent la confiance entre deux inconnus[2]. Mais à un niveau plus général, qu’est-ce qui permet à un individu de se donner l’impression d’une totalité sociale bienveillante? Ni le sentiment de partager une histoire nationale commune (voir supra), ni le rapport avec des institutions étatiques (censées pourvoir les individus en services sur une base égalitaire mais qui peinent à remplir cette mission) ne jouent ce rôle.
La mémoire sociale des exemples
Dans le couloir principal de l’école du district de Rinchinlhümbe, petit bourg accroché aux contreforts montagneux des Horidol Sar’dag dans la Mongolie septentrionale, sont suspendus quatre panneaux. Deux d’entre eux (photographies 1 et 2) comportent des listes de noms sous les titres : « Réussites brillantes » (Onts tögsögchid) et « Nos individus talentueux » (Manai av’yastnuud). Sur le premier, les noms sont classés par année de promotion et sur le deuxième, ordonnés suivant le prestige des médailles remportées (or, argent ou bronze) dans des disciplines comme le chant, la danse ou la lutte.
Figure
Réussites brillantes
Figure
Nos individus talentueux
Le troisième, intitulé « la diffusion de la renommée de nos élèves » (Shaviin Aldar Badrahui), accroché dans la classe de musique, comporte quelques photos et de courts résumés des études réalisées et des positions professionnelles occupées par les personnes représentées (photographie 3).
Figure
La renommée de nos élèves
Le dernier panneau est une peinture représentant Dejidiin Jigjid dans un cadre imposant sculpté de motifs et d’emblèmes de la culture socialiste (photographie 4). Cet homme, natif du district, devint dans les années 1970 un réalisateur réputé de l’industrie cinématographique mongole.
Figure
Dejidiin Jigjid
Les aînés comme les plus jeunes évoquent ces noms avec beaucoup de respect même s’ils ne les connaissent pas personnellement. De plus, la vie à l’école est ponctuée de constants rappels de leurs réalisations. Tous ces éléments façonnent une sorte de cartographie qui, au départ du district, trace les trajectoires de vie idéales, dessine une ossature de modèles, d’exemples d’individus ayant réussi à infléchir le cours de la vie en leur faveur. La plupart de ces personnes exemplaires poursuivent leurs études dans les universités d’État ou exercent leur profession au loin. Tous sont décrits sans hésitation comme des personnes fiables (naidvartai) ou comme des gens bien (sain hün), et ceci même par des membres de réseaux sociaux qui leur sont étrangers.
Faut-il y voir uniquement l’étalage du prestige conféré par l’éducation dans les sociétés postsocialistes? Je l’interprète plutôt comme une modalité de fonctionnement de cette mémoire sociale des exemples, que j’évoquais dans l’introduction. L’ensemble des cadres suspendus, les rappels des professeurs, les discussions des élèves entre eux constituent à mes yeux l’un des dispositifs permettant à la fois la réalisation de la mémoire et la restauration de la confiance.
L’analyse de deux autres documents (photographies 5 et 6) me permettra d’approfondir la compréhension des caractéristiques de ce genre de dispositifs et de montrer leur caractère évolutif. Je reviendrai alors sur cette première interprétation. Le premier document provient d’un des premiers journaux de propagande (1937, n°1) à diffusion nationale : La voie nationale de la culture (Soyolyn ündesnii zam). Le deuxième est une carte postale envoyée en 1973 par un jeune homme effectuant son service militaire. Ils peuvent être vus comme les ancêtres des panneaux scolaires décrits ci-dessus dans la mesure où ils constituent également des éléments de dispositifs mettant en scène des individus et leur conférant le statut d’exemples.
Figure
La voie nationale de la culture
Figure
Carte postale
Dans le document no 5, la photographie d’un homme en uniforme militaire est insérée au milieu d’un poème à la gloire d’un soldat héroïque. Le poème est signé mais le doute plane sur l’identité exacte de l’homme photographié. Est-il le compositeur? Est-il lui même le soldat héroïque dont le texte évoque les hauts faits? Hors de la capitale, ces journaux parvenaient aux éleveurs nomades par l’intermédiaire des yourtes rouges (ulaan ger) où des soldats formés avaient pour tâche de diffuser les idées du parti (Legrain 2007). Ces soldats s’appuyaient fréquemment sur ce genre de littérature généreusement illustrée.
Dans le document no 6 figure la photo d’un jeune homme dans un médaillon entouré de fleurs, lui-même inséré dans un paysage montagneux stylisé. Sur la partie de droite, en regard de notre homme, les paroles d’une de ses chansons favorites. Ces cartes postales étaient envoyées par des jeunes gens accomplissant leur service militaire (d’une durée de trois ans à cette époque), ou par des personnes en poste dans d’autres provinces. Les destinataires étaient le plus souvent la famille ou la fiancée, voire un ami intime de l’homme représenté. Les compositions étaient réalisées par des photographes de districts, sur la base d’éléments préconstruits. Les clients pouvaient choisir certains décors et le texte d’une chanson en vogue. La photo prise sur place était ensuite insérée dans le médaillon.
Il y aurait de nombreux commentaires à faire sur les contextes historiques qui ont présidé à la production de ce genre de documents, mais le point qui importe ici est l’évolution des caractéristiques des documents présentés. À mon sens, il y a entre les deux documents une différence qui va entraîner des conséquences importantes dans le fonctionnement de la mémoire sociale des exemples. Aux yeux de celui qui reçoit la carte postale, les traits du modèle ne sont plus ceux d’un inconnu (comme c’est le cas dans le document no 5). De plus, alors que le journal était conservé dans la yourte rouge du district, la carte postale au contraire, était placée en évidence dans le hoimor de la yourte familiale, la place des invités de marque. Les visiteurs de la famille pouvaient y jeter un oeil et y reconnaître également des traits familiers. Le texte des chansons choisies pour figurer sur la carte postale était souvent celui d’un succès que les expéditeurs aimaient à chanter et dont les paroles susciteraient, du moins l’espéraient-ils, le souvenir ému et le sentiment de manque chez ceux qu’ils avaient laissé au pays. L’agencement de la carte postale devait piéger la mémoire du destinataire et l’entraîner vers le doux souvenir des moments passés en compagnie de l’absent.
Je peux avancer quelques pistes de compréhension de cette évolution dans les dispositifs de construction des figures du modèle. Elles me seront utiles pour la clôture de mon argumentation.
À la fin des années 1950, le gouvernement mongol, jugeant que les « conditions objectives de l’édification du socialisme » sont rencontrées, lance le second grand mouvement de collectivisation de l’élevage rural. Dix ans plus tard, tous les éleveurs sont membres d’une coopérative. Les autorités mettent en place un processus d’« émulation socialiste ». Les brigades concourent pour obtenir les meilleurs rendements, les coopératives font de même, les provinces comparent leurs chiffres. Les cérémonies de récompense des meilleurs éléments se multiplient d’abord au centre culturel du village, ensuite au palais de la culture du chef-lieu de la province, puis dans les hauts lieux de la capitale. L’émulation socialiste fonctionne essentiellement grâce au prestige conféré à des individus exemplaires[3]. Dans le quotidien des ruraux, ces figures héroïsées sont bien plus présentes que les pères de la révolution eux-mêmes. Chaque matin, la cérémonie de la lecture d’un journal local (sonin unshlaga) composé majoritairement d’articles sur les mérites de ces héros du peuple, consacre et renforce leur emprise. L’émulation socialiste ancre dans la proximité la figure du modèle. Idéalement, elle permet à chacun de se muer en héros de la nouvelle société. Concrètement, à partir d’une figure exemplaire incarnée par un proche, elle façonne l’image d’une société avançant vers un idéal communiste grâce à cette personne particulière et à une foule d’autres individus équivalents, mais inconnus cette fois. Qu’importe, tous sont des modèles à suivre et tous sont dotés de la même force de conviction, de la même foi en la société à venir. Tous sont fiables.
Un autre élément est crucial. La Mongolie du deuxième mouvement de collectivisation est aussi celle des déplacements de population. D’abord parce que de nombreux habitants des districts ruraux vont soutenir l’effort d’industrialisation en marche dans les zones urbaines. Ensuite parce que les gens instruits sont souvent appelés à des postes éloignés de leur contrée. D’autre part, au sein de l’économie planifiée, le besoin de travailleurs qualifiés apparaît en des lieux spécifiques. En de telles occasions, le gouvernement dépêche des contingents de travailleurs parfois pour de très longues périodes. Les personnes qui se déplacent dans le but d’édifier le socialisme font également l’objet d’une modélisation héroïque. Ceci est notamment visible dans le travail des brigades culturelles de l’époque. Voici par exemple le texte d’un chant composé suite à l’ouverture d’une mine de charbon au début des années 1960 dans le district d’Alag-Erdene. La mise en activité de cette mine demandait le déplacement de nombreux travailleurs provenant de districts éloignés et parmi eux, un fort contingent de chauffeurs. Mishig Darhan, alors en charge de la propagande dans le district d’Ulaan-Uul, est le compositeur de ce texte (Purevdorj 1998 : 9).
J’entre dans la steppe de Hadtai Eg
En galopant sur mon accélérateur vert
Je déposerai à l’usine de Hatgal
L’or noir que j’aurais chargé
J’entre dans la steppe de Asgatai Eg
Ma bâche verte galope
Je déchargerai à l’usine de province
Le charbon doré que j’aurais chargé ici
Je loue et chante l’éloge
Des chauffeurs de ma région
Ils se réjouiront
D’entendre ma chanson
Consécutivement à ces déplacements et parallèlement à l’héroïsation de ces individus se développe une profonde nostalgie tournée vers le temps où la communauté était rassemblée, le temps où ces héros de la nouvelle société étaient présents. Cette coloration nostalgique est très présente dans l’agencement de la carte postale et dans les paroles de très nombreuses compositions des brigades culturelles de l’époque. Or, cette nostalgie provoquée par la séparation des êtres chers est, de tout temps, l’un des thèmes de prédilection de la chanson mongole, mais aussi l’une des rares émotions dont les débordements sont socialement acceptés. J’illustrerai cette affirmation par une histoire ironique entendue à maintes reprises.
Un voyageur est reçu dans une yourte et se voit présenter un bol rempli de raviolis de mouton bouillants. Affamé, il en engloutit un sans plus attendre. La chaleur de la nourriture lui fait verser une larme. L’hôte se méprenant sur la cause de cette larme compatit : « Qu’il est difficile d’être loin de son pays et des siens! ».
Alors que les larmes entraînent en général une réprobation unanime, la nostalgie du pays et des proches (nutgaa sanakh) est un vecteur de compassion. Ce sentiment n’est pas nouveau dans un pays qui a toujours connu d’intenses déplacements de population. Mais dans le contexte particulier de la fin des années 1950, cette coloration nostalgique permet d’ériger et de consolider des figures exemplaires : des gens fiables qui édifient pour le bien commun une société nouvelle.
Une dernière vignette ethnographique me permettra de montrer que, dans les classes de l’école de Rinchinlhümbe, le même agencement d’éléments opère toujours aujourd’hui.
Conclusion : retour à l’école
C’est l’effervescence dans la classe de musique. En cet été 2005, pour fêter le quarantième anniversaire du théâtre de Mörön (le chef lieu de la province), les artistes du palais de la culture entament une tournée de tous les districts provinciaux. Ils seront en concert à Rinchinlhümbe ce soir. Aux élèves rassemblés devant le panneau « La diffusion de la renommée de nos élèves » (document no 3), le professeur de musique Bathüü rappelle que la troupe compte dans ses rangs Amraa, un ancien étudiant de l’école devenu chanteur au théâtre. Il demande à l’un de ses élèves de s’approcher du panneau et de lire à voix haute le petit récapitulatif de la trajectoire de cette célébrité locale. Il donne ensuite ses instructions. « La salle de concert doit être impeccable ». Les plus belles jeunes filles de la classe sont chargées d’apporter des fleurs au chanteur durant le concert. La scène est répétée. Une fille s’exécute sans beaucoup de conviction. Bathüü s’emporte. « Ce ne sont pas des gens ordinaires (jirin hün). Ils y a beaucoup de gens titrés (tsoltoi hün) parmi eux. Ce sont les meilleurs de notre province (manai aimgyn hamgiin sain hün) ». Reprenant son calme, il se lance dans une longue remémoration de la manière exemplaire dont Amraa se comportait en classe. Il rappelle tout ce que cet étudiant modèle a fait pour le centre culturel avant d’être appelé à des tâches plus importantes. « À cette époque il n’y avait pas autant de matériel. La vie était plus difficile. Il fallait se débrouiller pour tout faire de ses propres mains. S’il n’y avait pas eu des gens fiables comme eux (ted nar shignaidvartai hün), vous n’auriez pas eu autant de facilité ».
Les souvenirs de Davaadji, un sexagénaire de la première brigade, évoquent eux aussi, lorsqu’il se remémore l’atmosphère éducative de son enfance, un horizon rempli de figures exemplaires et emblématiques : « Au départ, c’étaient des proches, mais ils devenaient aussi éloignés que le ciel (tengerees hol) […] Des modèles respectés pour ce qu’ils avaient fait pour la communauté ». La plupart des gens regrettaient constamment leur absence mais trouvaient logique que des personnes d’une telle qualité soient appelées à de hautes responsabilités.
À une génération d’intervalle, les discours de Bathüü le professeur de musique et Davaadji l’éleveur illustrent la même saillance de discours teintés d’une nostalgie tournée vers des figures exemplaires, vers des hommes qui ne semblent se soucier que du bien commun et être doués du pouvoir de changer la société. Michael Herzfeld a nommé « nostalgie structurelle » (2005 : 147) ce sentiment, que l’on retrouve de génération en génération, de la perte d’une communauté meilleure. En focalisant mon analyse sur la perpétuation des dispositifs de mise en confiance dans une société mongole en proie à de profonds bouleversements, je pense avoir également montré que la compréhension de cette nostalgie structurelle passe sans doute par l’ethnographie des dispositifs qui la vivifient et des agencements historiques spécifiques qui façonnent ces dispositifs.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Ce livre fut sacré meilleure vente de l’année 2007 dans la rubrique « livre mongol ».
-
[2]
Dans ce domaine, ce qui est d’ailleurs le plus frappant, c’est la tension entre le postulat de départ – hors de mon réseau de connaissances, tout le monde représente un danger potentiel – et la facilité avec laquelle les amitiés se nouent.
-
[3]
Françoise Aubin décrit et analyse plus complètement l’ensemble des mécanismes de propagande mis en place pour parvenir à une « éthique du dépassement de soi-même » (Aubin 1973 : 36). Elle montre l’importance et les effets de cette éthique dans les politiques culturelles de la Mongolie socialiste.
Références
- Aubin, F., 1973, « Fêtes et commémorations en république populaire de Mongolie. Apport à l’étude de la propagande éducative en pays socialiste », Revue Française de Science Politique, XXIII, 1 : 33-58.
- Belin, E., 2002, Une sociologie des espaces potentiels. Logique dispositive et expérience ordinaire. Bruxelles, Deboeck Université.
- Bulag, U., 1998, Nationalism and Hybridity in Mongolia. Oxford, Clarendon Press.
- Gambetta, D., 1988, Trust : Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford, Blackwell.
- Giddens, A., 1990, The consequence of Modernity. Stanford, Stanford University Press.
- Hamayon, R., 1971, « Protocole manuel », Études Mongoles et Sibériennes, cahier n°2 : 145-207.
- Herzfeld, M., 2005, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. New-York et Londres, Routledge.
- Humphrey, C., 1987, « The Host and the Guest : One Hundred Rules of Good Behavior in Rural Mongolia », Journal of the Anglo-Mongolian Society, XI : 42-55.
- Humphrey, C., « Avgai Khad : Theft and Social Trust in Post-Communist Mongolia », Anthropology Today, 9, 6 : 13-16.
- Kaplonski C., 2004, Truth, History and Politics in Mongolia. The Memory of Heroes. Londres et New-York, Routledge.
- Legrain, L., 2007, « Au bon vieux temps de la coopérative. À propos de la nostalgie dans un district rural de Mongolie », Civilisations, LVI, 1-2 : 103-120.
- Pürevdorj, D., 1998, Darkhad ezentei duunuud (Les chants darkhad à personnages). À compte d’auteur, Mörön.
- Tsenddoo B., 2007, Soyolyn Dovtolgoo : Anhny het gürnees süülchiin nüüdelchin (le mouvement culturel : Premier avenir des derniers nomades de l’État). Oulan-Bator, Nepko Publishing.
Liste des figures
Figure
Réussites brillantes
Figure
Nos individus talentueux
Figure
La renommée de nos élèves
Figure
Dejidiin Jigjid
Figure
La voie nationale de la culture
Figure
Carte postale