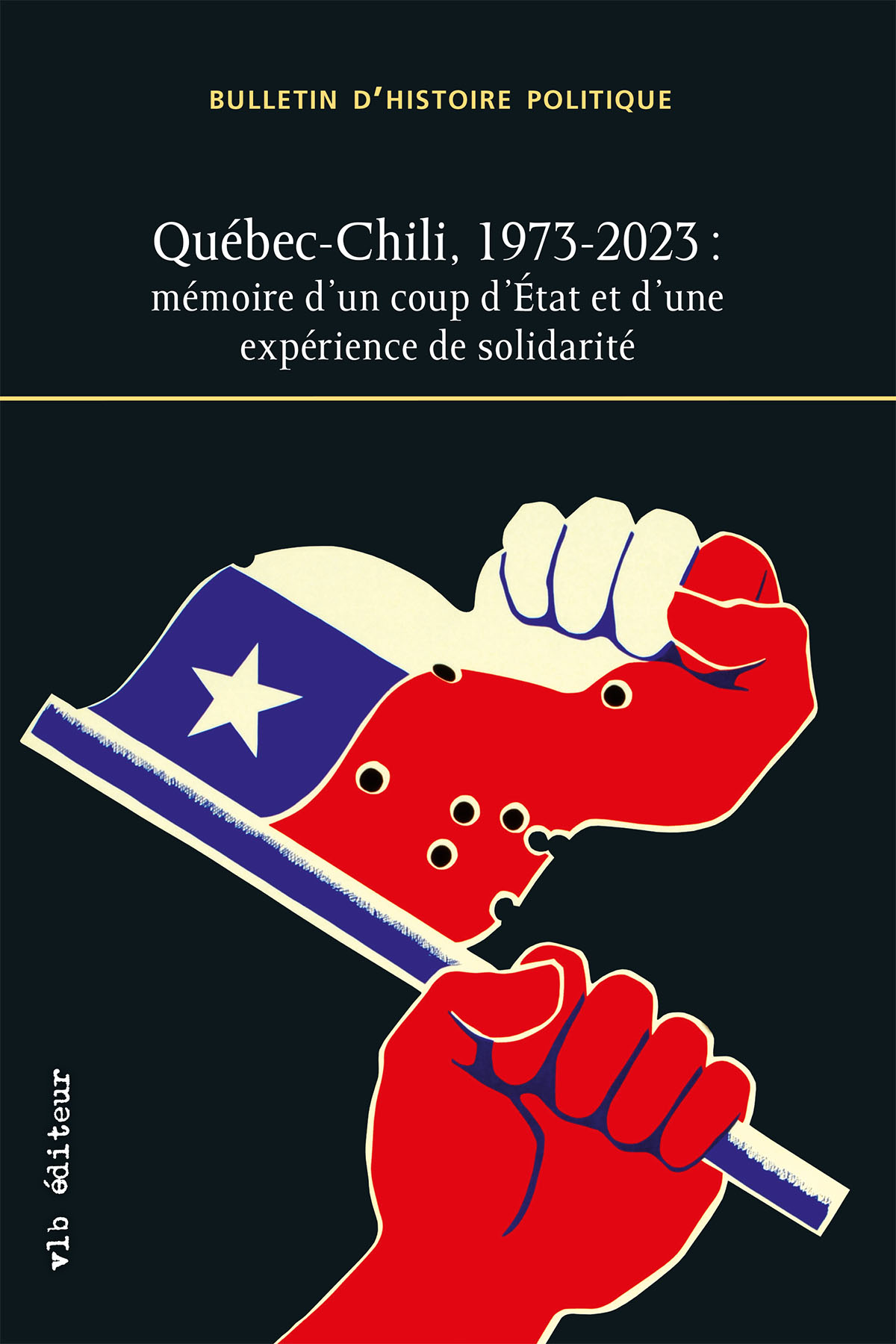Corps de l’article
Traumavertissement : on discute dans ce texte de la thèse de la « panique morale » de Stanley Cohen, du « mot en n » (en anglais), de polémistes médiatiques, dont Éric Zemmour et Mathieu Bock-Côté, et de sapins de Noël.
Quand ils n’apprécient pas certaines lectures, Yves Gingras et Thierry Nootens aiment qu’on le sache. Ils ont ainsi signé une critique virulente de 20 pages d’un article de 19 pages de l’historienne Geneviève Dorais paru dans le Bulletin d’histoire politique, « Racisme anti-noir et suprématie blanche au Québec : déceler le mythe de la démocratie raciale dans l’écriture de l’histoire nationale[1] ». Apparemment, mon essai Panique à l’université. Rectitude politique, wokes et autres menaces imaginaires (Lux, 2022) ne méritait que 24 pages de critiques, à peine quatre de plus que pour un simple article. Me voilà rassuré.
Cela dit, je ne suis pas tout à fait certain de comprendre pourquoi le comité de rédaction du Bulletin d’histoire politique a jugé opportun de consacrer à mon livre près de 10 % des pages de son numéro du printemps 2023, mais je l’en remercie. Cette « note de lecture », véritable pétarade sans nuance ni bienveillance, est donc signée d’abord par Yves Gingras, sociologue des sciences au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il s’agite depuis des années au sujet de la liberté académique, gravement menacée – selon lui – par les programmes Équité, diversité et inclusion (EDI), et il a même siégé à la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, qui a recommandé au gouvernement du Québec d’imposer une loi sur la liberté académique à toutes les universités. Cette loi a finalement été votée en 2022 par les parlementaires. N’ayant pas la victoire joyeuse, notre collègue continue à s’agiter sur le sujet dans les médias. Le second auteur est Thierry Nootens, historien à l’UQTR spécialiste du droit. Il a aussi été le second directeur, avec son collègue Laurent Turcot, de l’ouvrage Une histoire de la politesse au Québec.
Assurément, cette « note de lecture » ne passera pas à l’histoire de la politesse. S’ils en appelaient à des « échanges sereins » entre collègues dans leur critique contre Geneviève Dorais, ils ne se privent pas pour autant de me reprocher mon « aveuglement total », ma pratique de « l’amalgame à outrance » et de l’ « insinuation malveillante », qu’ils pratiquent eux-mêmes sans gêne aucune… Moralistes de haut vol, ils mettent en doute mon « honnêteté intellectuelle » et mon « éthique » de professeur, me rappelant qu’on est « censé réfléchir avant d’écrire ». S’ils déplorent à répétition mon manque de rigueur « scientifique » (un tic, chez Gingras), ils forgent un bien curieux concept pour qualifier mon livre de « véritable fatwa woke ». Bref, de la belle et bonne moraline. Ils me blâment enfin, apparemment sans rire, pour « la nuée d’insultes qui cache mal les faiblesses argumentatives d’une pensée indigente ». Voilà pour le ton !
Pour la substance, l’ensemble de leurs accusations se fonde sur une distraction de leur part, ou un malentendu, ou des difficultés de lecture, allez savoir. Le malentendu, voyez-vous, tient au « à » dans le titre Panique à l’université, une véritable obsession puisqu’ils reviennent sur ce « titre » pas moins de six fois dans leur texte. Ils en ont déduit qu’ils allaient lire un livre « sur le champ universitaire » au sujet de « ce qui se passe dans l’université » (p. 236), et non sur les polémiques médiatiques contre les féministes et les antiracistes à l’université. Ils me reprochent donc de ne pas avoir écrit le livre qu’ils voulaient lire, évitant ainsi de discuter sérieusement du livre que j’ai écrit.
On aurait pu espérer que l’un des deux lecteurs, à tout le moins, se rende compte de leur méprise en lisant l’introduction. J’y explique que je vais m’intéresser aux discours de polémistes médiatiques aux États-Unis, en France et au Québec qui prétendent que les féministes et les antiracistes ruineraient l’enseignement et la recherche à l’université et y imposeraient une véritable terreur rappelant le stalinisme ou le maoïsme (d’où le titre du livre, by the way). Dès les premières pages, je nomme et cite ces polémistes médiatiques : Ben Shapiro, Éric Zemmour, Mathieu Bock-Côté, Pascal Bruckner, etc. Si la double lecture de mon introduction n’y suffisait pas, on aurait pu espérer que leur double lecture du premier chapitre les éclaire. J’y présente dès les premières pages la fabrique de mots piégés – political correctness, social justice warriors, wokes – par des politiques (je donne l’exemple du ministre français de l’Éducation) et des polémistes médiatiques (avec l’exemple de Christopher F. Rufo). Je consacre le reste du chapitre à présenter la thèse de « panique morale » du sociologue Stanley Cohen, rappelant qu’il s’agit de procéder à une analyse de la « presse à sensation » (p. 50) et du processus de « diabolisation » – par certains médias – de catégories d’individus, ici les féministes et les antiracistes qui ne respecteraient pas la sacro-sainte valeur de la liberté académique. Je rappelle aussi qu’une panique morale peut évidemment se nourrir d’événements réels – comme les affrontements entre mods et rockers dans les stations balnéaires anglaises dans les années 1960, discutés par Stanley Cohen – mais que c’est l’amplification médiatique (p. 56 et ailleurs) qu’il importe d’étudier, selon le sociologue, pour comprendre les rapports de force dans nos sociétés (p. 61). Stanley Cohen indique même à plusieurs reprises, dans son livre Folk Devils and Moral Panics, que les étudiant.e.s contestataires sont souvent la cible de pareilles couvertures médiatiques alarmistes et catastrophistes. Il rappelle aussi que des politiques profitent de ces attaques médiatiques pour se positionner (je cite dès l’introduction Boris Johnson, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Donald Trump, le pape François, etc.).
C’est ainsi qu’Éric Zemmour, à la fois polémiste médiatique et politique, a déclaré en 2022, lors de la campagne présidentielle en France : « je combattrai l’idéologie woke et décoloniale à l’Université. […] Je ne laisserai pas l’Université être gangrénée par cette idéologie » (p. 13, dans mon livre – je souligne). Quelques mois plus tôt, il lançait que « des indigénistes, des féministes racisées, des luttes intersectionnelles gangrènent nos facs après avoir pourri les plus grandes universités américaines » (je souligne) et mènent une « guerre d’extermination de l’homme blanc hétérosexuel » (p. 13) ! Il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres, présentés au fil des chapitres.
Ce genre d’attaques très virulentes contre des domaines d’études universitaires – et donc contre des collègues et des étudiant.e.s – méritait selon moi une étude pour essayer d’en saisir le sens sociopolitique, surtout qu’elles se répètent si régulièrement dans certains médias. Ce choix m’a déjà valu le reproche de la part d’autres collègues de ne pas m’intéresser au « fond » (la liberté académique) du débat. Or, la réalité peut avoir plusieurs fonds… Comme Stanley Cohen, je considère que de telles attaques médiatiques répétées contre les féministes et les antiracistes à l’Université méritent une attention en soi et pour soi et soulèvent des questions sociopolitiques de fond. Mes deux lecteurs voudraient que je parle d’autre chose, mais c’est pourtant là le sujet de mon livre… À ce point confus quant au sujet d’un livre qu’ils lisaient à deux, ils ont perdu leur temps à compter certaines occurrences (leur « analyse lexicométrique » [p. 236] présentée sous forme de tableaux), pour arriver au constat que le mot « médias » revient 73 fois dans mon livre et que les auteurs dont je parle le plus sont des polémistes médiatiques : Mathieu Bock-Côté, Éric Zemmour, Pascal Bruckner et Christian Rioux. Bravo, Sherlock Holmes et docteur Watson !
Même leur double lecture du dernier chapitre n’a pas suffi à saisir l’objet du livre, alors qu’il est intitulé « Produire la panique : l’industrie des idées réactionnaires ». J’y présente plus précisément l’écosystème médiatique des trois pays étudiés (États-Unis, France et Québec) et le parcours de deux polémistes influents par pays. Qui ? Eh bien ! justement : Pascal Bruckner et Éric Zemmour pour la France et Christian Rioux et Mathieu Bock-Coté pour le Québec. Pourquoi ? Parce qu’ils ont consacré de nombreuses interventions – livres, chroniques, conférences – à présenter l’université comme un lieu dévasté par les « wokes », un mot piégé que récupèrent nos deux collègues[2].
Empêtrés dans leur erreur initiale, mes deux lecteurs déclarent enfin que « malgré son titre, cet ouvrage porte sur le champ médiatique plutôt que sur le champ universitaire » (p. 236 – je souligne). Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ils gaspillent donc 24 pages du Bulletin d’histoire politique pour une simple erreur de titre… Cela ne les empêche pas de poser des questions rhétoriques absurdes, comme « Pourquoi avoir choisi de placer des “polémistes” et “agitateurs” au coeur de l’ouvrage et non des professeurs d’université ? » (p. 235). Réponse simple : parce que c’est le sujet du livre. Ils me reprochent aussi, de manière non moins absurde, de faire référence à Donald Trump, un « autre intellectuel crédible dans le monde universitaire », écrivent-ils avec sarcasme (p. 240), Éric Zemmour, « peu connu pour ses réflexions sur l’université » (p. 236), ou Mathieu Bock-Côté, « érigé en source incontournable sur l’université » (p. 239). Décidément, cette fausse « note de lecture » est pour le moins comique.
Trois dernières remarques, avant de conclure sur une touche personnelle. Premièrement, nos deux moralistes mobilisent des citations hors contexte comme preuve de mes péchés et pour me blâmer – avec insistance – de ne pas avoir réalisé un travail scientifique. Encore de la moraline. On retrouve ainsi dans leur texte sept fois le mot « science » et un rappel – convenu – de la distinction wébérienne entre science et morale (p. 225) [3]. Or, il est bien triste qu’un spécialiste des sciences aussi renommé qu’Yves Gingras confonde une collection d’essais avec une presse universitaire, si occupé à lire et relire le titre du livre qu’il n’ait pas vu sur la couverture, juste au-dessus, le nom de la collection : « Lettres libres ». Les éditions Lux la présentent comme une collection qui « fait place aux pamphlets, chroniques et enquêtes » (je souligne), sans mention d’études universitaires ou de rapports scientifiques. On aurait pu espérer que son collègue de l’UQTR repère l’indice en page couverture, mais non. Or, cette simple erreur les empêche – apparemment – de saisir des éléments stylistiques qui relèvent justement des conventions de l’essai, comme des évocations de mon parcours personnel pour situer ou illustrer mes propos (y compris la référence – qu’ils qualifient d’ « ignominie » – à l’attentat de Polytechnique en 1989), ou encore du maniement de l’humour qui semble échapper aux deux lecteurs (au sujet des sapins de Noël, entre autres).
Si les deux lecteurs admettent – comme en passant – que mon livre est un « essai » (p. 243), ils placent ce mot entre guillemets. Pourquoi ? Mystère. Ils qualifient aussi mon livre de « pamphlet médiatique » (p. 233), mais continuent à traiter cette pauvre matière comme s’il s’agissait d’une publication d’une presse universitaire. Or, choisir ouvertement la forme de l’essai plutôt que l’étude universitaire relève d’une démarche qui devrait être protégée par la liberté académique bien comprise. Pour nos moralistes, il s’agit apparemment d’un nouveau péché capital, à tout le moins pour un professeur d’université. J’ajouterai que contrairement à ce que veulent nous faire croire leurs sermons scientistes dogmatiques, l’essai peut être compatible avec la quête de la vérité, avec une démonstration argumentée et fondée empiriquement et avec la mobilisation d’études universitaires pour éclairer la discussion. Je m’appuie d’ailleurs sur plusieurs enquêtes universitaires tout au long de ma démonstration.
Les deux moralistes me reprochent surtout de confondre la science et l’empirie, puisque j’alignerais selon eux des faits et des chiffres « insignifiants ». Là encore, ils déforment ma démarche pour mieux me tourner en ridicule et me faire la morale. J’explique pourtant noir sur blanc que je suis la recommandation du professeur à HEC et chroniqueur au Journal de Montréal Joseph Facal, qui suggère « de regarder les sujets des thèses, les montants des subventions reçus, les profils demandés pour les embauches » pour se convaincre que « les sciences humaines et sociales sont en voie d’être détruites, si ce n’est pas déjà fait, par l’idéologie woke » (p. 219-220). C’est ce que j’ai fait (et refais régulièrement dans mes billets du média Pivot) pour arriver au constat que Joseph Facal et ses complices disent, en réalité, n’importe quoi (voir le chapitre « Déformer la réalité : l’Université dominée par les études sur le genre et le racisme »). Ce genre de désinformation médiatique au sujet de féministes et d’antiracistes qui « détruisent » l’Université correspond bien au processus de diabolisation et d’amplification de la menace dont parle Stanley Cohen dans son étude sur les paniques morales. Ne peut-on pas légitimement se préoccuper de telles attaques mensongères contre des champs d’études universitaires, et les documenter pour mieux les analyser ? Apparemment, rien de tout cela mérite attention aux yeux de mes deux lecteurs, qui se présentent pourtant comme les preux défenseurs de la science.
Deuxièmement, ces deux collègues m’accusent de « sophisme » parce que j’avancerais que ce qui se passe aujourd’hui sur les campus n’est pas important, simplement parce que des faits similaires existent depuis longtemps. En réalité, je mobilise l’histoire pour montrer que ce qui arrive aujourd’hui n’est pas nouveau, contrairement à ce que les polémistes médiatiques tentent de nous faire croire pour stimuler un sentiment d’urgence (voir les quatre premières pages du livre, ainsi que le chapitre 2 : « Sonner l’alarme : un “nouveau” problème éternel »). Je reviens sur la polémique des années 1980-90 au sujet de la « censure » qu’auraient imposée des féministes et des antiracistes sur les campus aux États-Unis, au nom de la « rectitude politique » (political correctness). Cette fable était portée par Allan Bloom, Alain Finkielkraut et leurs complices qui répétaient qu’on ne pouvait plus lire les « dead white males » (Platon, Aristote, Hobbes, Rousseau, etc.), mais qu’on devait obligatoirement lire Franz Fanon et Rigoberta Menchú. Je suis d’ailleurs toujours étonné de constater que nos spécialistes de la liberté académique – Normand Baillargeon, Yves Gingras, etc. – ne discutent jamais des ressemblances entre les polémistes médiatiques d’hier et d’aujourd’hui, qui sont parfois les mêmes, car tous les « white males » ne sont pas si « dead » que ça. Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut, entre autres, sont encore à la manoeuvre (voir les sections du chapitre 2 : « L’effet Bloom », « Les années de la political correctness (1980-1990) » et « Récupération à la française »). Il existe plusieurs études universitaires – que je cite – au sujet de cette polémique des années 1980-90 et qui montrent que ces polémistes avaient tout faux au sujet de ce qui se passait alors sur les campus aux États-Unis. Cela mérite réflexion, non ?
À chaque fois, mes deux lecteurs feignent de ne pas comprendre pourquoi je rappelle tel ou tel fait ou telle ou telle donnée empirique, pour mieux me faire la morale (« Sophiste ! Sophiste ! »), alors qu’il s’agit toujours de la même démarche : je cite des propos hyperboliques et catastrophistes de polémistes médiatiques bien connus, je les compare avec la plate réalité universitaire d’hier et d’aujourd’hui, et je démontre ainsi qu’il s’agit au mieux de désinformation, au pire de mensonges, qui ont pour objectif de délégitimer les études féministes ou sur le racisme (entre autres). Donnons un dernier exemple. Mes deux lecteurs distraits se demandent pourquoi je passe en revue les cours offerts en histoire de l’art à Yale (et « pourquoi pas Harvard ? », ajoutent-ils), avant d’affirmer que ces informations « n’ont en fait aucune signification » (p. 239). Sérieusement ? J’écrivais au paragraphe juste avant que « les médias ont rapporté que l’université Yale n’offrirait plus le cours “Introduction à l’histoire de l’art, de la Renaissance à aujourd’hui”. Le New York Post a qualifié la décision d’“idiotie PC” (acronyme de political correctness), alors que le magazine conservateur The New Criterion a comparé le directeur du programme à Joseph Staline [et que] le correspondant du Devoir à Paris Christian Rioux évoquait une “chasse aux sorcières” et une “véritable entreprise de destruction des savoirs et de la culture” » (p. 207). Oui, oui, Joseph Staline et la destruction des savoirs et de la culture, rien de moins… Prenant ensuite mes lecteurs par la main, j’écrivais : « Pour évaluer l’étendue du désastre, il faut évidemment replacer cette décision dans son contexte institutionnel. J’ai donc consulté la liste de tous les cours offerts au département d’histoire de l’art à Yale » (p. 207-208), pour constater que l’offre reste très traditionnelle pour un département d’histoire de l’art. Voilà pourquoi je mobilise ces données empiriques, voilà à quoi je réponds et voilà pourquoi je parle de Yale plutôt que de Harvard. Bien d’autres reproches de mes deux lecteurs sont de la même eau trouble.
Troisièmement, mes deux lecteurs me reprochent de nier le problème des conférences boycottées ou des professeurs mis à pied. C’est faux. J’en parle à plusieurs reprises et je présente même de nombreux exemples concrets, au Canada, aux États-Unis et en France, y compris les cas célèbres de l’Université d’Ottawa et du collège Evergreen, auxquels je consacre cinq pages chacun. Le chapitre 4 s’intitule « Fabriquer le problème : “On ne peut plus rien dire” » et compte 50 pages, entièrement consacrées à discuter de tels événements (il est même divisé en deux sections : « La culture de l’annulation » et « Qui est chahuté, qui est boycotté »). Cela dit, je montre d’abord que les polémistes médiatiques présentent ces cas de manière simpliste et déformée. Je montre aussi et surtout qu’ils ne présentent que les cas qui confirment leur thèse catastrophiste, mais n’évoquent jamais les cas de collègues progressistes mis à pied ou boycottés pour avoir critiqué Israël ou s’être déclarés sympathiques à Black Lives Matter ou aux antifascistes. Je conclus enfin, chiffres à l’appui, que de telles situations ne surviennent en réalité qu’exceptionnellement (je cite des études à ce sujet), alors que les polémistes nous les présentent comme relevant d’un phénomène social et culturel hégémonique et même « totalitaire ».
Par souci de transparence, je rappelle que j’ai moi-même été aux prises avec des tensions et des conflits en classe. Je mentionne aussi les appels sur le web à imiter l’attentat de l’École polytechnique, mais cette fois à l’UQAM, avec des références nominales à certaines de mes collègues en études féministes (et à moi-même). S’il y a eu procès et condamnation, les médias du Québec n’ont consacré que deux ou trois articles à cette affaire. Curieusement, les chantres de la liberté académique ne sont jamais intervenus publiquement, il n’y a pas eu (zéro) d’éditoriaux, de chroniques, de lettres ouvertes, d’interventions à l’Assemblée nationale, rien. Ce qui n’empêche pas mes deux moralistes, muets sur ces appels à commettre un véritable attentat antiféministe à l’UQAM, de me servir des leçons d’empathie.
Enfin, mes deux moralistes jouent aussi aux psychologues, avançant que je me suis intéressé aux polémistes médiatiques pour « avoir un peu de visibilité médiatique » (p. 235, et encore p. 244). Quelle analyse rigoureuse ! Cela dit, je me réjouis d’avoir été invité à parler des polémiques au sujet des « wokes » à l’université par des médias en Belgique et en Italie, où ces polémiques sont importées des États-Unis ou de France par la droite et l’extrême droite. Ce phénomène me confirme la validité de mon analyse de la diffusion et de la fabrication de ces paniques morales (résumée en une simple illustration, p. 247 : « Le marché transatlantique des idées »).
J’ai aussi été sollicité dans la dernière année par une dizaine d’étudiant.e.s des cégeps et des écoles de journalisme qui voulaient m’interviewer sur le sujet pour leur projet de fin d’études. À chaque fois, je leur demandais combien de collègues exactement avaient été mis à pied depuis dix ans au Québec, à la suite de propos jugés choquants sur le féminisme ou le racisme. En tant que syndicaliste, je considère qu’il s’agit là d’une question importante. À chaque fois, je me suis heurté à un silence gêné. La réponse est pourtant simple : zéro. Il y a bien un collègue en biologie à l’Université Laval qui a été suspendu, puis réintégré, puis suspendu, mais c’est à la suite de déclarations au sujet de vaccins pour enfants, sans aucun rapport avec les « wokes ».
Or, j’ai noté à deux reprises en 2022, dans Le Devoir (7 novembre) et à Radio-Canada (14 décembre), qu’on parlait maintenant de « congédiement » de deux professeures à l’Université d’Ottawa et l’autre à l’Université de Concordia, en lien avec l’usage du mot anglais « nigger », qui est au coeur de plusieurs conflits depuis des décennies aux États-Unis. Pourtant, aucune des deux professeures n’a été congédiée. La première, Verushka Lieutenant-Duval, était professeure temporaire lorsqu’elle s’est retrouvée au coeur d’une crise nationale après que la direction lui eut retiré son cours pour quelques jours, sans même l’entendre. Elle a depuis saisi le comité d’arbitrage de l’Université d’Ottawa, avec l’appui de son syndicat, et on comprend qu’elle ne veuille plus y enseigner. Mais elle n’a pas été « congédiée » et elle est maintenant chargée de cours au royaume des « wokes », l’UQAM. La seconde, Catherine Russell, est toujours professeure à l’Université Concordia et n’a été l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Que l’image déformée produite par les médias de ce qui se passe sur les campus devient peu à peu la vérité médiatique est sans doute un des effets de la panique morale discutée dans mon livre, et dont n’ont pas voulu discuter Yves Gingras et Thierry Nootens dans leur (fausse) « note de lecture ». Cette dernière relève, comme ils l’écrivent si bien, d’ « une stratégie d’évitement bien connue qui consiste à regarder dans une autre direction » (p. 235).
P.S. Au moment où je terminais cette réponse, les médias rapportaient qu’un étudiant de l’Université de Waterloo a planifié et mené une attaque motivée par la haine contre une classe de philosophie sur le genre, blessant à coups de couteau la professeure Katy Fulfer et deux étudiant.e.s. Le lendemain, plusieurs médias au Canada anglais traitaient de cet attentat, ainsi que la BBC, CNN et d’autres médias aux États-Unis, mais pas une ligne dans Le Devoir, qui a pourtant accordé tant de place au débat sur la liberté académique. Au moment de la reprise du cours sur le genre à l’Université de Waterloo, dès la semaine suivante, le recteur déclarait pourtant qu’il fallait assurer « un environnement de liberté d’expression » sur le campus[4]. Presque deux mois plus tard, alors que je révisais les épreuves de ce texte, cet attentat n’avait toujours fait l’objet au Québec d’aucune (zéro) intervention médiatique des chroniqueurs du Journal de Montréal et du Devoir qui ont fait de la défense de la liberté universitaire leur fonds de commerce, car leur objectif premier est en réalité de dénigrer les féministes et les antiracistes. D’autres chroniques ont d’ailleurs été publiées dans ces deux quotidiens au cours de l’été, épinglant à nouveau les méchants « wokes » qui détruiraient l’université, mais sans jamais aucune évocation de l’attentat à l’Université de Waterloo. Aucun éditorial, aucune lettre ouverte. On comprendra donc qu’un étudiant qui tente d’assassiner une professeure qui enseigne un cours sur le genre n’a aucun intérêt pour ceux qui s’efforcent frénétiquement de nous faire croire que la liberté académique serait menacée par les féministes et les antiracistes. Cela dit sans prétention scientifique.
Parties annexes
Notes
-
[*]
Ce texte est une réponse à la note de lecture qu’Yves Gingras et Thierry Nootens ont consacrée à l’ouvrage de Francis Dupuis-Déri dans le précédent numéro du BHP (vol. 30, n° 3). Considérant que le livre constitue le texte originel, le Comité de rédaction estime qu’il ne sera pas opportun de poursuivre le débat au-delà de la publication de cette réplique de l’auteur à la note critique.
-
[1]
« Les périls de la moralisation ou comment “l’épistémologie woke” veut réécrire l’histoire », Bulletin d’histoire politique, vol. 29, no 2, 2021, p. 217-238.
-
[2]
Pour la récupération et le détournement du mot « woke » dans les médias francophones au Québec, voir Raphaël Canet et Léo Palardy, « L’invention des Wokes par le nationalisme conservateur », Possibles, 1er septembre 2022, revuepossibles.ojs.umontreal.ca.
-
[3]
Comme tant d’autres, ils oublient de rappeler que Max Weber parlait aussi des « intérêts de connaissance » et considérait que des motivations personnelles, culturelles ou sociales peuvent évidemment animer la recherche scientifique. Voir, à ce sujet, Charles-Henry Cuin, « La nature du savoir sociologique : considérations sur la conception weberienne », L’Année sociologique, vol. 56, 2006, p. 369-388.
-
[4]
Kevin Nielsen, « Gender studies students at University of Waterloo returning to class this week : school president », Global News , 4 juillet 2023, globalnews.ca.