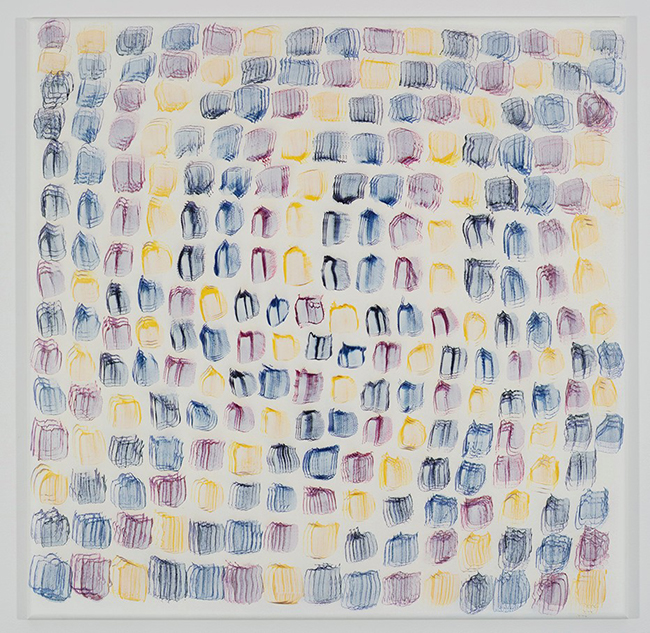Résumés
Résumé
De nombreuses nouvelles de l’écrivain américain George Saunders ont pour cadre un parc à thème. À travers l’analyse sociocritique de deux nouvelles tirées de son premier recueil, Grandeur et décadence d’un parc d’attractions, cet article explore les codes du genre et souligne comment la fiction autoréflexive donne un éclairage particulier à l’héritage de la guerre civile américaine.
Abstract
Countless short stories of American writer George Saunders are set in a theme park. Through the socio-critical analysis of two short stories from his first collection, CivilWarLand in Bad Decline, this article explores the codes of the subgenre and highlights how self-reflexive fiction sheds a particular light on the legacy of the American Civil War.
Corps de l’article
Disneyland est là pour cacher que c’est le pays « réel » qui est Disneyland.
Jean Baudrillard[1]
Depuis l’avènement de la modernité, l’une des fonctions caractéristiques de la littérature est, selon Jacques Rancière, de rendre aux « choses banales leur aspect suprasensible, fantasmagorique, pour y voir apparaître l’écriture chiffrée du fonctionnement social » (2007: 31). Ainsi, le fait qu’un écrivain comme George Saunders situe nombre de ses nouvelles dans les parcs à thème est un signe qu’il importe d’interpréter non seulement à l’aune de ses implications narratives, mais aussi pour sa portée symbolique. Dans ces nouvelles, les éléments fantastiques qui devraient a priori nous éloigner de la réalité sociale nous y ramènent. La représentation de la société américaine y est d’autant plus problématique qu’elle se construit sur une mise en abyme entre deux univers, l’un considéré comme réel (incarné par les employés du parc) et l’autre comme fictif (dépeint par les personnages du passé qu’ils interprètent). On se trouve donc dès le départ face à une représentation de la représentation, et pris du vertige interprétatif qui en résulte. On peut alors se demander si ces parcs à thème entretiennent véritablement un rapport allégorique avec l’Amérique actuelle, voire avec ses tendances historiques.
Ianick Raymond, Trace CMYK (5, 10) (2020), Oeuvre issue de la série OOPart, Acrylique et impression sur bois | 122 x 122 cm, Photographie par Richard-Max Tremblay
L’Histoire occupe une place prépondérante dans l’oeuvre de Saunders. La guerre de Sécession se trouve d’ailleurs dans le titre de son premier recueil de nouvelles (CivilWarLand in Bad Decline, 1996) et constitue le cadre de son dernier roman (Lincoln in the Bardo, 2017). Cet événement, qui a joué un rôle majeur dans la construction de la culture états-unienne (pour ne pas dire de ses tensions raciales, territoriales, économiques et politiques), semble chez Saunders accéder au statut d’épopée fondatrice, se situant presque systématiquement en filigrane de la trame principale des nouvelles. Dans son essai La bataille des mémoires. La Seconde Guerre mondiale et le roman français, Yan Hamel remarque que « l’identité ne se trouve pas d’emblée dans la guerre; un travail de (re)construction doit être mené à bien avant que celle-ci puisse servir à (ré)affirmer l’existence et la valeur de celle-là. » (2006) Les productions culturelles jouent un rôle décisif dans cette structuration du champ mémoriel, offrant à l’individu la possibilité de se rattacher à une identité qui n’est pas uniquement déterminée par les groupes sociaux auxquels il appartient, mais qui se constitue par la récupération et la reconfiguration de traces mémorielles issues de différentes sources. En s’appuyant sur une classification élaborée par Régine Robin, Hamel propose entre autres de distinguer la mémoire collective de la mémoire culturelle[2]. Nous partirons de son analyse pour voir comment le premier recueil de George Saunders, CivilWarLand in Bad Decline (1996), paru en français sous le titre Grandeur et décadence d’un parc d’attractions (2001), interroge le rôle de la représentation dans la fabrication des mémoires collectives. Ce premier livre, sans thématique centrale, regroupe sept nouvelles d’abord parues en revue. Parmi celles-ci, quatre mettent en scène des parcs d’attractions. Nous nous pencherons sur la première, qui donne son titre au recueil, et sur la dernière, « Bountyland » (« Bounty »), car ce sont les deux propositions les plus à même de modifier notre regard sur l’héritage de la guerre civile.
Il ne faut pas oublier que ces nouvelles n’attaquent pas les questions historiques et sociales de front. D’ailleurs, elles s’éloignent à première vue du registre réaliste en intégrant fantômes, mutants et autres créatures invraisemblables à l’intrigue. Loin d’être traitée comme problématique, l’existence de ces créatures n’est jamais remise en cause par la narration ou les personnages : elle va de soi, comme dans le genre du merveilleux. Et ces apparitions surnaturelles cohabitent avec les considérations les plus concrètes sur notre mode de vie capitaliste. Ce parti pris rapproche les nouvelles de Saunders de la vision de l’Amérique promue par l’historien Kurt Andersen :
Little by little for centuries, then more and more and faster and faster during the last half-century, Americans have given ourselves over to all kinds of magical thinking, anything-goes relativism, and belief in fanciful explanation, small and large fantasies that console or thrill or terrify us. […] And while there are believers in flamboyant supernaturalism and prophecy and religious pseudoscience in other developped countries, nowhere else in the rich world are such beliefs central to the self-identities of so many people. We are Fantasyland’s global crucible and epicenter.
2018 [2017]: 5
Lorsque l’on part de cette prémisse d’une porosité de plus en plus importante entre fait et fiction dans la culture états-unienne, l’enchevêtrement entre créatures imaginaires et préoccupations réalistes dans les nouvelles de George Saunders prend tout son sens. D’ailleurs, le fait que nombre d’entre elles se déroulent dans un parc à thème permet non seulement de mettre à distance les prétentions de la représentation historique (on se trouve dès le départ dans un univers plein d’inexactitudes et entretenant un rapport fantasmatique au passé), mais aussi de traiter des problématiques sociales bien réelles. Celles-ci sont certes déformées et décalées, mais elles n’en sont pas moins reconnaissables. C’était déjà la position défendue par Jean-François Chassay peu après la parution de Pastoralia (2000), deuxième recueil de Saunders :
Contrairement à ce qu’on a pu parfois écrire dans certains articles critiques, cette Amérique est, à sa manière, terriblement réaliste. Elle se contente, en illustrant l’Histoire américaine en marche, de la déplacer, d’y imprimer quelques dérapages, suffisamment pour qu’on en voie le mouvement chaotique et désordonné, révélant ses apories.
2002: 84
À la manière de certains artistes contemporains qui, par la distorsion des formes et les pièges tendus à nos réflexes visuels, interrogent les limites du regard[3], la fiction autoréflexive nous permet d’apercevoir les mécanismes avec lesquels nous construisons notre rapport à l’Histoire et aux histoires, et donc au réel. Dans cette perspective, nous ferons l’hypothèse que les nouvelles de parcs à thème constituent un sous-genre en soi dont notre analyse vise, en conclusion, à dégager les codes.
Le spectre de la guerre. Entre spéculaire et spectaculaire
Ianick Raymond, Peinture CMYK (90) (2020), Oeuvre issue de la série OOPart, Acrylique et impression sur bois | 122 x 122 cm, Photographie par Richard-Max Tremblay
La première nouvelle que nous analysons, « Grandeur et décadence d’un parc d’attractions », est la plus emblématique de ce sous-genre. Le narrateur est un père de famille oeuvrant depuis neuf ans à titre d’« inspecteur de vraisemblance » dans un parc consacré à la reconstitution historique de la guerre de Sécession. La scène d’ouverture met rapidement en place la mauvaise posture économique dans laquelle l’établissement se trouve. Le narrateur est ainsi chargé de convaincre un investisseur potentiel en le conduisant aux abords d’une reconstitution du canal Érié. Alors que la narration met l’accent sur les erreurs factuelles qui, faute de moyens, n’ont pas pu être corrigées, on découvre qu’une écluse a été taguée par les gangs sévissant dans le parc. L’investissement espéré, bien sûr, part en fumée. Le patron, Mr. A., souhaite se débarrasser au plus vite de ces vandales dont les méfaits nuisent au financement et à la fréquentation du parc. Après avoir confié la sécurité à un incapable, il décide de faire appel à Sam, un vétéran du Vietnam peu bavard, pour en finir avec ces fauteurs de trouble. Seul comédien muni d’une arme véritable, Sam libère d’abord une jeune catholique prise en otage par un gang multiracial. La famille est ravie, d’autant plus que l’adolescente a gardé sa virginité. Seul bémol : les kidnappeurs ont payé le prix fort. La séquence est racontée avec un humour absurde qui brouille la frontière entre les événements se déroulant réellement dans le parc et ceux mis en scène. Les homicides sont d’ailleurs lâchement attribués à un autre gang, sans que la police intervienne d’une quelconque manière.
Toute l’intelligence du texte de Saunders se situe dans le déploiement d’un double standard dont les termes correspondent aux deux niveaux diégétiques développés dans la nouvelle. D’un côté, dans le récit enchâssé, la représentation de la guerre civile a été amputée de ses antagonismes, les attractions du parc cherchant à la « déconflictualiser », par exemple en répartissant les rôles d’esclaves et d’« Indiens » parmi les groupes raciaux dans un souci d’équité assez douteux; de l’autre, dans la diégèse correspondant au monde réel, la situation dans laquelle se trouve le parc fait renaître les tensions raciales entre les membres du personnel et les gangs de jeunes qui y entrent par effraction. Autrement dit, tout se passe comme si la guerre de Sécession était finalement plus présente dans les rapports sociaux actuels que dans sa grossière mise en spectacle.
D’ailleurs, les traumatismes de guerre du justicier improvisé apparaissent rapidement plus sérieux qu’anticipé. Ses tendances héroïques s’apparentent bientôt à un donquichottisme gore : le narrateur se voit confier la tâche d’enterrer la main sanguinolente d’un enfant assassiné dont le seul méfait est d’avoir chapardé quelques friandises. Quand il suggère de dénoncer Sam à la police, Mr. A le semonce :
Avez-vous vu les longues files de chômeurs massées devant le Service du Personnel tous les matins? […] Laissons derrière nous cette sordide et déplorable affaire et tâchons de continuer à procurer une vie enviable à ceux que nous aimons.
Saunders, 2001 [1996]: 28-29
À nouveau, le ton humoristique est employé pour railler les travers du capitalisme. Le narrateur souhaiterait bien éviter de plonger plus avant dans le mensonge et la criminalité, mais ce désir entre en contradiction avec la nécessité de pourvoir aux besoins de sa famille. Il est d’ailleurs prêt à tout sacrifier pour le bonheur de ses deux garçons, et ce, même si sa femme, Evelyn, le trompe et l’humilie sans arrêt. C’est cet amour tordu, presque masochiste, qui le pousse à s’enfoncer dans l’infamie. Par une cinglante ironie, Evelyn finit par le quitter sans avertissement, emmenant les deux enfants, et allant jusqu’à leur raconter que leur père les a abandonnés pour se mettre « avec une obscure pétasse. » (35) Quant au parc de la guerre de Sécession, il ne survivra pas à l’ultime bévue de Sam. Celui-ci, croyant avoir affaire à des criminels, assassine un groupe d’adolescents qui s’avèrent n’être que les membres pacifiques d’une association d’ornithologues amateurs[4]. Ici, la traduction française omet un détail d’importance : dans le texte original, les adolescents sont désignés comme des « Chicanos », et on comprend que le carnage est attribuable à un profilage racial abusif.
À la folie de cet ancien marine correspond celle d’un fantôme hantant le parc : McKinnon. Ayant vécu dans « les vrais [sic] années 1860 » (19), il est revenu complètement traumatisé de la bataille d’Antietam[5]. La polysémie qui en résulte n’existe qu’en français, mais reste parlante : le spectacle aussi débite l’Histoire à coup de faux.[/fn] et éventre sa femme avant de se faire « sauter le caisson » (36), et puis de rejouer la scène. Alors que la violence qui empoisonne le parc est systématiquement dépeinte avec une certaine ironie, celle générée par McKinnon semble accéder au tragique, notamment par le biais de cette anaphore :
37Il crie qu’il implore leur pardon.
Il crie qu’il n’est qu’un homme.
Il crie que la haine et la guerre l’ont rendu fou.
On pourrait considérer ce fantôme comme un souvenir refoulé, impossible à représenter dans une attraction qui vise avant tout la rentabilité économique et la constitution d’un récit national sans tache. À travers lui, ce sont les conséquences psychologiques réelles du conflit que Saunders dépeint comme l’angle mort de la représentation culturelle de la guerre de Sécession, en tout cas de celle proposée par les attractions du parc.
Déconstruction du récit mémoriel
Ianick Raymond, Paint skin (W:90, H:90) (2020), Oeuvre issue de la série OOPart, Acrylique et impression sur toile | 102 x 229 cm, Photographie par Richard-Max Tremblay
Cette critique du rapport des Américains à leur mémoire collective est loin d’être propre à George Saunders. En fait, il s’agit d’un des filons les plus exploités par les nouvelles qui traitent de la guerre civile. La plus célèbre est probablement celle d’Ambrose Bierce : « An Occurrence at Owl Creek Bridge » (1995 [1890]). Bierce, lui-même vétéran de la guerre de Sécession, publie cette nouvelle vingt-cinq ans seulement après la ratification du treizième amendement[6]. On y trouve déjà une construction narrative à plusieurs niveaux qui met en tension l’image héroïque de la guerre et la brutalité de sa réalité. En effet, au début de la nouvelle, un propriétaire d’esclaves de l’Alabama se voit condamné à mort pour avoir mis le feu au pont de Owl Creek afin de freiner la progression de l’armée de l’Union. Or lorsque les Yankees tentent de le pendre sous le pont, la corde se rompt. La nouvelle raconte l’évasion épique de ce « gentleman du Sud » à travers les torrents de la rivière. Mais, par un retournement de situation inattendu, au moment où le héros est enfin rentré chez lui et qu’il s’apprête à enlacer son épouse, il est ramené au bout de la hart, rendant son dernier souffle. Sa fuite n’aura été qu’une simple projection mentale. La critique de la représentation opère ici, comme chez Saunders, par l’enchâssement d’un récit mémoriel imaginaire, qui simplifie et glorifie l’Histoire, au sein d’un récit considéré comme réel qui s’oppose à cette édulcoration.
Dans « Shiloh » (1980) de Bobbie Ann Mason, ce sont davantage les mémoires individuelle et collective qui sont mises en parallèle. La nouvelle décrit également une déréalisation du rapport à l’Histoire, notamment par le biais du personnage de Leroy, un camionneur en congé forcé, qui entretient une conception assez sommaire de la guerre civile : « He can only think of that war as a board game with plastic soldiers. » (57) Le récit se termine dans un parc national établi sur le champ de bataille de Shiloh, où le couple formé par Leroy Moffitt et Norma Jean revisite son histoire personnelle à partir des traces laissées par les affrontements entre unionistes et confédérés. Leroy constate que son rapport à l’Histoire est aussi sommaire que celui qu’il entretient avec sa vie amoureuse : « Leroy knows he is leaving out a lot. He is leaving out the insides of history. » (57)
Chez Ron Rash, les traces du passé sont littéralement réduites à leur valeur marchande alors que, dans « Des confédérés morts » (2015 [2010]), deux travailleurs de la construction routière en Caroline du Nord se mettent en tête de se remplir les poches en pillant les tombes de lieutenants confédérés. Ici, la mémoire est profanée sans qu’on en fasse un cas de conscience, jusqu’à ce que le vieux gardien du cimetière redonne un peu de relief à l’Histoire : « Des tas de gens s’embarrassent plus de le savoir, mais y en a eu autant dans ces montagnes qui se sont battus du côté Union que côté confédérés. » (68) Ainsi, le narrateur découvre que même dans cet état esclavagiste, les opinions et les allégeances étaient contrastées.
De façon générale, les fictions autoréflexives remettent en question « les visions rassurantes du passé, et avec elles les formes de confort intellectuel qui pourraient se fonder sur son rappel » (Hamel, 2006). Mais alors que chez Rash, Mason et Bierce, la diégèse est ancrée dans un réalisme qui tend à briser les illusions des personnages, chez Saunders, la conscience de la teneur tragique du passé surgit grâce à l’intervention du surnaturel. Par un curieux retournement, les créatures les plus chimériques ne mettent pas la réalité à distance, mais permettent, au contraire, de la regarder en face. Au lieu d’établir une limite claire entre fiction et réalité, les éléments imaginaires et illusoires y sont dépeints comme partie prenante de notre rapport à l’Histoire.
Subjectivité et empathie narratives
Dans un essai paru récemment sur les nouvellistes russes, George Saunders consacre un chapitre à Nikolaï Gogol intitulé « The Door to the Truth Might Be Strangeness » (2021: 276-304). Il y soutient que les narrateurs omniscients de Tolstoï, Tchékhov et Tourgueniev, qui semblent à première vue réalistes, dissimulent en fait la subjectivité et la faillibilité de tout regard et de toute mémoire. La narration gogolienne apparaît alors comme une alternative aux prétentions du réalisme :
Since all narration is misnarration, Gogol says, let us misnarrate joyfully. It’s like a prose version of the theory of relativity : no fixed, objective, « correct » viewpoint exists […]. There is no world save the one we make with our minds, and the mind’s predisposition determines the type of world we see.
282-283
La nouvelle « Grandeur et décadence d’un parc d’attractions » se termine justement sur une focalisation narrative ambivalente, très proche de celle qu’on retrouvera dans le roman Lincoln in the Bardo (2017), et qui tient de la capacité qu’ont les fantômes de pénétrer l’âme d’autrui et d’en avoir instantanément une vue d’ensemble. Le jeu de miroirs qui en résulte, entre le passé et le présent, fait penser à la célèbre citation de Marx[7] : « [L]’histoire se répète toujours deux fois […] la première fois comme tragédie, la deuxième comme farce. » (2001 [1850]: 172) La fin de la nouvelle démontre d’ailleurs la fine maîtrise du registre tragi-comique de Saunders, comme si la tragédie ne se distinguait plus de la farce :
2001 [1996]: 38Je ne peux pas y croire. Ne plus jamais voir mes enfants? Ne plus jamais m’endormir et me réveiller au son liquide de leur voix haut perchée et de leur respiration si douce?
Ma pauvre Evelyn, je n’ai jamais su t’aimer.
J’ai toutes les réponses et je plane au-dessus de Sam qui me découpe en morceaux. Je vois son enfance horrible. Je vois sa mère lui faisant des choses ignobles avec un manche à balai. Je vois la haine dans son coeur et tous les gens qu’il devra encore tuer avant qu’une pneumonie l’emporte à quatre-vingt-trois ans.
Même si le narrateur est découpé en morceaux par l’ex-militaire devenu complètement fou, le récit se poursuit, sa mort n’ayant pour effet que d’entraîner le passage à une narration omnisciente, toujours homodiégétique et à la première personne, mais se rapprochant cette fois-ci, par le ton empathique, d’une dimension éthique que l’on distingue clairement chez l’auteur implicite, et que l’on peut rapporter aux intentions de l’auteur réel.
En entrevue avec The New Yorker, Saunders confiait avoir le souci constant, dans son processus d’écriture, d’élever ses personnages à sa hauteur, pour éviter de les surplomber et pour s’assurer de générer une réelle empathie (Dylan-Robbins et Lavey, 2013: 2 min 20 s). C’est pourquoi les fantômes occupent une place privilégiée dans son oeuvre : leur capacité de pénétrer l’âme semble correspondre précisément à l’idée que Saunders se fait de la création littéraire : « The tools that we develop through writing, those are great tools to enable us to [empathize]. When we imagine a character, we’re basically having a conversation with somebody other than ourselves. » (Yeh, 2017) Dans « Grandeur et décadence d’un parc d’attractions », la relation empathique défie les limites temporelles, se déployant comme un pont suspendu entre deux époques. Le fantôme de Mrs McKinnon se prend d’ailleurs de sympathie pour le narrateur et lui apprend « d’obscures ballades du XIXe siècle » (21). Prisonniers de cet éternel retour du passé, les personnages de la nouvelle recréent inconsciemment les massacres que leur parc thématique cherche à commémorer. Mais cette fois-ci, c’est sur le mode de l’absurde qu’ils ont lieu.
La ségrégation des Mutants
Ianick Raymond, Peinture décalée (1 à 12) (2020), Oeuvres issues de la série OOPart, Acrylique et impression sur bois | 74 x 74 cm chacune, Photographie par Richard-Max Tremblay
La nouvelle « Bountyland », dernière du recueil, reprend la thématique de la guerre civile mais en opérant quelques transferts audacieux : dans un futur proche, la ségrégation se base sur de mystérieuses mutations génétiques que certaines personnes ont subies en buvant de l’eau contaminée; le territoire n’est pas divisé entre l’Union au nord et les États confédérés au sud, mais plutôt entre l’est, où les Mutants sont relativement bien traités, et l’ouest, où ils sont réduits en esclavage, quand ils ne sont pas carrément lynchés; le treizième amendement a été remplacé par l’Édit d’Esclavage. Le récit débute au sein du parc thématique Bountyland situé à quelques heures de route de Syracuse, à l’intérieur duquel les Normaux viennent « expérimenter le confort personnel » (Saunders, 2001 [1996]: 121) dans un Moyen Âge factice où les Mutants incarnent des paysans, des bohémiens, des bandits de grand chemin ou des serviteurs dans des châteaux numérotés. Cet environnement médiéval édulcoré apparaît comme « une époque au charme ensorceleur » (131) à côté du chaos qui a gagné cette Amérique. Mais à nouveau, Saunders oppose la représentation idyllique proposée par le parc aux resurgissements bien réels du passé dans la société états-unienne[8].
Au début du récit, des élections nationales viennent d’avoir lieu et le parti défendant les droits des Mutants a encore une fois subi une cuisante défaite. Cole et sa soeur Connie vivent à l’intérieur de Bountyland depuis leur enfance, et cela leur est présenté comme une chance inouïe, puisqu’ils sont nourris et protégés de l’ambiance post-apocalyptique qui règne à l’extérieur. Toutefois, tous deux Mutants, ils sont munis de bracelets permanents qui indiquent leurs anomalies — Cole a des griffes à la place des orteils, Connie, une queue de singe atrophiée — et sont contraints d’obéir aux désirs des Normaux : elle comme prostituée, lui comme garçon de table. Lorsqu’un riche client s’éprend de Connie et l’emmène vivre dans son fastueux ranch du Nouveau-Mexique, Cole le soupçonne des plus mauvaises intentions et subodore le pire pour sa soeur. Incapable de se faire à son absence, il s’échappe de Bountyland et se lance à sa recherche. S’ensuivent les passages les plus rabelaisiens de l’oeuvre de Saunders.
En effet, la nouvelle est construite sur des systèmes d’oppositions qui montrent la division du pays entre un extrémisme et un autre. Cole va traverser le territoire américain d’est en ouest pour retrouver sa soeur, donnant au texte des allures de roman de la route où chaque rencontre vient contrebalancer la précédente par une position antagoniste. Par exemple, aux excès des riches, qui se livrent à d’étranges bacchanales dans les enceintes du parc, s’opposent les restrictions abusives des adeptes de la doctrine de l’Austérité (sorte de simplicité volontaire poussée à l’extrême), l’un d’entre eux se déguisant en « Mort-mangeant-des-chips » (130) pour protester contre le style de vie luxueux des nantis. Le voyage de Cole s’articule ainsi autour de discours tranchés, à travers lesquels on reconnaît bien sûr les clivages de l’Amérique contemporaine. Saunders pousse la caricature à la limite du grotesque, opérant des rapprochements comiques entre des éléments a priori inconciliables (le McDonald’s qui devient une église pour les Culpabilisateurs, un propriétaire d’esclaves qui pratique l’éthique du care). Le lecteur prend plaisir à reconnaître ces discours exaltés qu’on pourrait croire tout droit sortis d’un fil d’actualité Facebook.
Derrière ce portrait au vitriol des travers de la société américaine, la nouvelle pose une question inquiétante : peut-on réellement sortir du parc à thème? Le narrateur a beau s’échapper de Bountyland, il rencontre des personnages tout aussi fantaisistes et déconnectés de la réalité que les habitants du parc. Prenons ce passage, dans lequel deux adeptes de la secte de la Juste Humilité discutent du système d’attribution des Victors, une unité qui sert à mesurer la douleur, et donc le mérite de chacun :
157— [S]i tu ressens du plaisir à envisager tes prochains Victors, ça pourrait vouloir dire que tu dois ajouter des anti-Victors au total cumulé.
— […] Je ne tiens pas tellement à suivre les conseils spirituels de quelqu’un qui collectionne des Victors faciles en refusant de pisser quand il en a besoin. […] Le genre de type à ne pas se faire souffrir pendant des semaines entières et ensuite à réclamer des Victors parce qu’il s’inquiète d’être aussi paresseux.
Difficile de ne pas voir là une critique de l’éthique protestante et d’une certaine valorisation de la souffrance qui ressurgit dans l’époque actuelle. Mais il s’agit ici clairement d’une représentation humoristique, proche de celle qu’on retrouvait à l’intérieur du parc. Plus loin, le même procédé est employé pour railler le discours du self-made man qui « a construit des huttes en boue pendant cinq années exténuantes » (161) durant lesquelles il s’est nourri exclusivement de croutes de pain.
L’image la plus saisissante de la nouvelle est celle de parents qui, pour préserver la curiosité naturelle et l’estime de soi de leurs enfants, préfèrent ne leur imposer aucune discipline. Ainsi, lorsque leur fils s’approche dangereusement d’un criminel pour lui voler son couteau à la lame acérée, le père n’ose intervenir, de peur d’aller à l’encontre de sa philosophie. Cette déconnexion de la réalité est l’affaire de la plupart des personnages esquissés à gros traits par Saunders, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de Bountyland. Obnubilés par des croyances irrationnelles, ils n’arrivent plus à jauger les phénomènes qui les entourent. La perspective manichéenne que l’on penserait réservée aux parcs thématiques est devenue leur manière naturelle de voir le monde. Ces esprits polarisés ne contribuent pas tant au déroulement narratif qu’au développement d’une forme de carnavalisation[9] — ou plutôt à l’expression d’une Amérique déjà « carnavalisée ». Si les saltimbanques ont bel et bien pris le contrôle, c’est que nul renversement n’est désormais envisageable. Au sommet de la hiérarchie, les fous sont à leur place, comme le mentionne un informateur qui préfère ne plus retourner dans le monde : « À la tête, tu trouves des gens puissants mais cinglés. » (145) À la fin du récit, le narrateur retrouve sa soeur parfaitement heureuse et enceinte dans son ranch du Nouveau-Mexique. Sa quête découlait d’une lubie paranoïaque et le voyage n’aura fait que le confirmer. Cole vit quelques mois sur cette terre fertile, le temps de voir naître sa nièce et de s’émouvoir en la regardant digérer. Puis, incapable de se laisser bercer par le confort et l’indifférence, il rejoint un groupe de résistants qui luttent pour améliorer les droits des Mutants.
Ianick Raymond, Paint skin (-10) (2020), Oeuvre issue de la série OOPart, Acrylique et impression sur toile | 183 x 68 cm, Photographie par Richard-Max Tremblay
Dans la tente de Judith, la première chef rebelle rencontrée par Cole, se trouvent « des posters de Lincoln et de Che Guevara » (218). Le parallèle n’est pas aussi falot qu’il peut en avoir l’air. Les deux ont payé de leur vie la défense de leurs idéaux et ont acquis le statut d’icônes de la libération universelle. Sauf que Lincoln, loin d’embrasser l’errance et l’intransigeance du révolutionnaire cubain, était avant tout un diplomate qui, au début de la guerre civile, insistait « sur le fait que le Nord combattait uniquement pour l’Union et non pour la libération des esclaves » (Blackburn, 2012: 15). Certes, il s’opposait aux injustices générées par l’esclavage mais, en tant que dirigeant du pays, il cherchait surtout un compromis qui permettrait à la fois l’émancipation graduelle des esclaves et la compensation monétaire des propriétaires et esclavagistes. Son argumentaire a évolué à mesure que le conflit prenait de l’ampleur et que le maintien de l’Union n’apparaissait plus comme une raison valable de poursuivre la guerre.
Les intrigues imaginées par Saunders, derrière leur humour parfois extravagant, nous indiquent que les opinions découlent avant tout des rapports de force. Doit-on rappeler qu’à l’époque de la guerre civile, les progressistes européens avaient tendance à soutenir l’autodétermination des peuples — la Belgique vient de se séparer des Pays-Bas en 1830, le Mexique de l’Espagne en 1810 — et donc à prendre parti naturellement pour les sécessionnistes? Comme l’écrit Jacques Rancière, « c’est toujours de cela qu’il est question dans les fictions avouées de la littérature comme dans les fictions inavouées de la politique, de la science sociale ou du journalisme : de construire avec des phrases les formes perceptibles et pensables d’un monde commun » (2017: 13). La nouvelle de parc à thème semble proposer une construction particulièrement appropriée pour réfléchir à comment la sphère discursive laisse place à des luttes de pouvoir. C’est pourquoi dans « Bountyland », le lecteur gardera l’impression d’être confronté à une suite de discours, plus qu’à de véritables péripéties.
Le sous-genre des nouvelles de parcs à thème
Bien que le corpus étudié soit insuffisant pour tirer des conclusions plus générales sur le sous-genre de la nouvelle de parcs à thème, nous partirons de notre analyse pour proposer une première ébauche des codes qui le régissent. Évidemment, l’exercice se veut conjectural : on ne saurait y voir une suite de lois immuables. Il s’agit avant tout de mettre en lumière la fonction symbolique du parc à thème chez George Saunders, et de voir comment ce lieu conduit à des constructions narratives problématisant le rapport entre fait et fiction.
Les protagonistes sont des employés du parc et non des visiteurs fascinés ou effrayés par l’univers qui leur est présenté.
Le parc thématique se trouve généralement en difficulté financière et ses employés, tout aussi perdus, se présentent comme des beautifullosers.
S’y développe une forme particulière de mise en abyme, où les personnages sont dédoublés par le rôle qu’ils incarnent dans le parc. On assiste alors à des superpositions surprenantes et anachroniques, qui sont souvent de l’ordre du grotesque.
Les fantômes, les mutants et autres créatures extraordinaires confèrent une dose de merveilleux au récit.
Si les récits utopiques et certains récits dystopiques[10] nous ont habitués à un style descriptif, se voulant avant tout une présentation de l’univers et de la philosophie qui s’y rattache, Saunders s’attarde très peu à décrire les parcs à thème, si bien que certains demeurent, même après la dernière ligne, assez énigmatiques.
Si les allusions aux attractions qui garnissent le parc, superflues d’un point de vue narratif, se multiplient, ce n’est pas tant pour en donner une meilleure idée que pour générer des effets comiques[11].
Les dialogues sont truffés d’expressions familières, de tournures vernaculaires ainsi que de références à des marques de commerce et à la culture populaire[12]. Le jargon propre au monde des affaires contamine d’ailleurs la narration qui, rapidement, se distingue à peine du discours rapporté.
La violence mine l’ambiance festive qu’on supposerait régner dans ce genre de complexes de divertissement.
L’Histoire apparaît d’abord dans une version édulcorée et folklorisée : les parcs embrassent les clichés et les références au passé y sont aussi vides de sens que les divertissements proposés. Elle finit pourtant par se manifester au-delà des attentes des investisseurs et des dirigeants à travers les fantômes qui hantent les lieux et les dynamiques sociales qui se recréent.
L’excentricité de cet univers imaginaire est contrebalancée par des considérations pragmatiques qui touchent à la réalité des relations sociales, du consumérisme effréné, de la culture entrepreneuriale et des médias de masse.
Ce dixième et dernier point mérite d’être repris et approfondi. En effet, à travers cette observation des bassesses ordinaires, l’auteur parvient à dresser un portrait réaliste non seulement de la joute sociale et de ses règles implicites, mais aussi des motivations personnelles de ses concurrents. Souvent, les pires dérives procèdent de bonnes intentions : celle d’élever ses enfants dans un milieu sécurisé, d’éviter un mauvais mariage à sa soeur ou de ne pas trahir une collègue de travail. De la parodie fantaisiste et humoristique, le texte passe alors à un registre tragique, et rejoint en quelque sorte l’oeuvre essayistique de Saunders. À première vue, le lien semble ténu entre le style ironique et cru des nouvelles et une position théorique comme celle-ci : « [L]iterature is a form of fondness-for-life. It is love for life taking verbal form. » (Saunders, 2015) Force est de constater, pourtant, que l’empathie et la générosité finissent par discrètement émerger dans les nouvelles, apparaissant d’autant plus vraies et puissantes que l’ambiance est à la sauvagerie.
On pourrait se demander en quoi le fait de situer l’univers diégétique à l’intérieur d’un parc à thème contribue à ce passage entre l’ironie et l’empathie. Autrement dit : pourquoi George Saunders inscrit-il si souvent ses histoires dans ce type de lieu? Lorsqu’on lui pose la question en entrevue, l’auteur fournit plusieurs pistes de réflexion :
I think it has something to do with being able to say, “This is not realist fiction. This is something else.” It’s a way of reminding myself not to bash my head against a wall trying to be Hemingway or somebody. Instead I can just goof off, which is the only thing I’m really good at. Basically, using theme parks creates a sort of cartoon-like mood, and that keeps me from trying to launch into some earnest, twenty-page description of some character’s childhood.
Lester, 2000
S’éloigner des prétentions réalistes, créer une distance entre le récit et le réel, c’est ce que permet un lieu comme le parc thématique, d’autant plus lorsqu’il est estampillé du sceau de la fiction. Néanmoins, l’analyse de « Grandeur et décadence d’un parc d’attractions » et de « Bountyland » a montré que la réalité historique y ressurgissait à travers les éléments les plus chimériques, comme si Saunders avait trouvé dans cette tension entre fiction et réalité le moteur même de son écriture.
La guerre est un événement limite qui, par bien des aspects, « dévoile l’insuffisance de la raison » (Hamel, 2006). D’où cette tendance au soupçon qui caractérise la représentation de la guerre dans la littérature autoréflexive. C’est parce qu’elle reprend à son compte les antagonismes du discours social que la « fiction est en mesure de révéler une vérité sur la guerre qui échappe aussi bien à la démonstration historienne qu’aux autres prises de parole sérieuses et autoritaires ». (Hamel, 2006) Or, les nouvelles de George Saunders, en défiant la logique narrative classique et en opérant des déplacements qui tordent l’Histoire, font apparaître les biais idéologiques de toute représentation et ouvrent vers ce qui leur échappe. En commentant la réception du prix Folio pour son recueil Tenth of December (2013), George Saunders l’avait d’ailleurs exprimé de la sorte : « [T]he things we were feeling coming off of American culture couldn’t be reached by just simple realism. It had to be a little nutty. » (cité dans Clark, 2014)
Dès que la fiction s’intéresse à la représentation historique se pose la question du rôle de l’acte narratif dans la construction du réel. Et c’est sur ce point que le parc à thème devient un élément réellement productif : en intégrant un monde considéré comme fictif à la narration — monde auquel les personnages prennent eux-mêmes part en tant que comédiens —, il met en lumière les interactions entre fait et fiction qui forgent tout rapport à la réalité. Nous avons vu comment cette construction est d’autant plus paradoxale dans les nouvelles de Saunders que la diégèse considérée comme réelle renferme elle-même des éléments imaginaires, et que la représentation orchestrée dans le parc a souvent des répercussions tangibles sur la vie des protagonistes. C’est par le développement de ces deux pôles (fictif et historique) et la problématisation de leurs frontières que la prose de Saunders tend vers la métafiction : en se présentant dès le départ comme un discours fictif, elle renoue de manière surprenante (et souvent surnaturelle) avec les tragédies de l’histoire américaine, sa critique de la représentation prenant alors une tournure autoréflexive.
Parties annexes
Notes
-
[1]
BAUDRILLARD, Jean. 1981. Simulacre et simulation. Paris : Galilée, p. 26.
-
[2]
Voici les définitions qu’il propose : « [L]a mémoire collective proprement dite, [est] relative aux groupes, à leurs identités et à leurs luttes; la mémoire culturelle, [est un] agencement opéré par chaque individu entre, d’une part, l’ensemble de ses connaissances culturelles et, d’autre part, les [mémoires nationale, savante et collective]. » (Hamel, 2006)
-
[3]
Les toiles de Ianick Raymond qui accompagnent cet article en sont un bel exemple.
-
[4]
La situation est d’autant plus absurde que le narrateur a dû congédier le chef ornithologue du parc au début de la nouvelle. Le vieil homme avait commis des erreurs dans le calcul visant à ce que le nombre d’oiseaux présents dans le parc corresponde à celui de l’époque de la guerre civile.
-
[5]
Il s’agit de la première bataille à se dérouler sur le territoire de l’Union. Elle a lieu le 17 septembre 1862 et se solde par un repli des troupes confédérées dirigées par le général Lee. Elle demeure à ce jour l’une des batailles les plus sanglantes de l’histoire des États-Unis avec près de 23 000 morts en une seule journée (McPherson, 1991: 3).[/fn]. C’est à travers lui et sa famille que la teneur réelle du conflit surgit dans le récit. D’ailleurs, les visiteurs du parc ne doivent absolument pas les rencontrer, comme si les attractions visaient plutôt à les préserver de la vérité historique. La famille McKinnon est condamnée à répéter éternellement son destin tragique : le père assassine ses filles l’une après l’autre à coup de faux
-
[6]
Le treizième amendement à la constitution des États-Unis est celui qui abolit l’esclavage. Il est adopté par le Congrès le 6 décembre 1865, peu après la fin de la guerre civile.
-
[7]
Qui a d’ailleurs lui-même beaucoup écrit sur la guerre civile américaine alors qu’elle avait cours, principalement dans Die Presse et le New York Daily.
-
[8]
Kurt Andersen rappelle d’ailleurs que les mythes chevaleresques ont joué un rôle déterminant dans l’imaginaire des Sudistes. Nombre d’entre eux percevaient les esclaves comme les nouveaux serfs et s’identifiaient eux-mêmes à la noblesse des chevaliers rendus célèbres par les romanciers écossais et britanniques. Mark Twain ira jusqu’à écrire, dans une de ces déclarations hyperboliques dont il avait le secret, que l’écrivain Walter Scott était en grande partie responsable de la guerre civile américaine (Andersen, 2018 [2017]: 97).
-
[9]
À ce titre, le parc à thème pourrait être vu comme une reprise postmoderne du carnaval, où le renversement des hiérarchies laisserait place à un aplatissement tout en apparences.
-
[10]
Je pense ici à Le ParK (2010) de Bruce Bégout.
-
[11]
Par exemple, par souci de vraisemblance, le narrateur de la nouvelle « Grandeur et décadence d’un parc d’attractions » recommande qu’on remplace « les jeunes et attirantes simili-putes » de la Maison Close de Cimarron par des femmes d’âge mûr « beaucoup plus laides et moins dans le coup » (Saunders, 2001 [1996]: 27-28).
-
[12]
La traduction de ces références laisse parfois à désirer dans la version française (« Humpty-Dumpty » devient « le Vilain Petit Canard » [13]; « Garbage in, garbage out » devient « Des ordures dedans, des ordures dehors » [17]).
Bibliographie
- Andersen, Kurt. 2018 [2017]. Fantasyland. How America Went Haywire. New York : Random House, 462 p.
- Baudrillard, Jean. 1981. Simulacres et simulation. Paris : Galilée, 240 p.
- Bierce, Ambrose. 1995 [1890]. « An Occurrence at Owl Creek Bridge ». Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/ebooks/375. Consultée le 28 mai 2021.
- Blackburn, Robin. 2012. « Introduction », dans Karl Marx et Abraham Lincoln. Une révolution inachevée. Sécession, guerre civile, esclavage et émancipation aux États-Unis. Paris : Syllepse, p. 11-104.
- Chassay, Jean-François. 2002. « Candide au pays des mutants ». Revue française d’études américaines, no 74, p. 78-84. https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2002-4-page-78.htm. Consultée le 15 juillet 2020.
- Clark, Alex. 2014. « George Saunders. “The things we felt about American culture couldn’t be reached by simple realism. It had to be a little nutty” ». The Guardian, 13 mars. https://www.theguardian.com/books/2014/mar/13/george-saunders-folio-prize-winner-interview. Consultée le 28 mai 2021.
- Dylan-Robbins, Sky et Nate Lavey. 2013. « Writer Georges Saunders on Reading, Writing and Teaching », États-Unis : The New Yorker, 4 min. https://youtu.be/xS168QJfiU4. Consultée le 20 juillet 2020.
- Hamel, Yan. 2006. La bataille des mémoires. La Seconde Guerre mondiale et le roman français, nouvelle édition. Montréal : Presses de l'Université de Montréal. http://books.openedition.org/pum/20532. Consultée le 23 février 2021.
- Lester, Toby. 2000. « A satirist in full stride ». The Atlantic, 17 mai. https://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/interviews/ba2000-05-17.htm. Consultée le 5 juillet 2020.
- Marx, Karl. 2001 [1850]. Les luttes de classes en France. Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, traduit de l'allemand par Jules Molitor et Léon Rémy. Paris : La Table ronde, 320 p.
- Mason, Bobbie Ann. 1980. « Shiloh ». The New Yorker, 20 octobre, p. 50-57.
- McPherson, James M. 1991. La Guerre de Sécession, 1861-1865. Paris : Robert Laffont, 1056 p.
- Rancière, Jacques. 2007. Politique de la littérature. Paris : Galilée, 229 p.
- Rancière, Jacques. 2017. Les bords de la fiction. Paris : Seuil, 190 p.
- Rash, Ron. 2015 [2010]. « Des confédérés morts », dans Incandescences. Paris : Seuil, p. 51-79.
- Saunders, George. 2001 [1996]. Grandeur et décadence d’un parc d’attractions, traduit de l'anglais par Marie-Lise et Guillaume Marlière. Paris : Gallimard, « La Noire », 223 p.
- Saunders, George. 2015. « My writing education. A time line ». The New Yorker, 22 octobre. https://www.newyorker.com/books/page-turner/my-writing-education-a-timeline. Consultée le 13 juillet 2020.
- Saunders, George. 2021. A Swim in a Pond in the Rain. New York : Random House, 410 p.
- Yeh, James. 2017. « George Saunders thinks empathy can still save us ». Vice, 15 février. https://www.vice.com/en_us/article/9agwmd/george-saunders-thinks-empathy-can-still-save-us. Consultée le 20 août 2020.