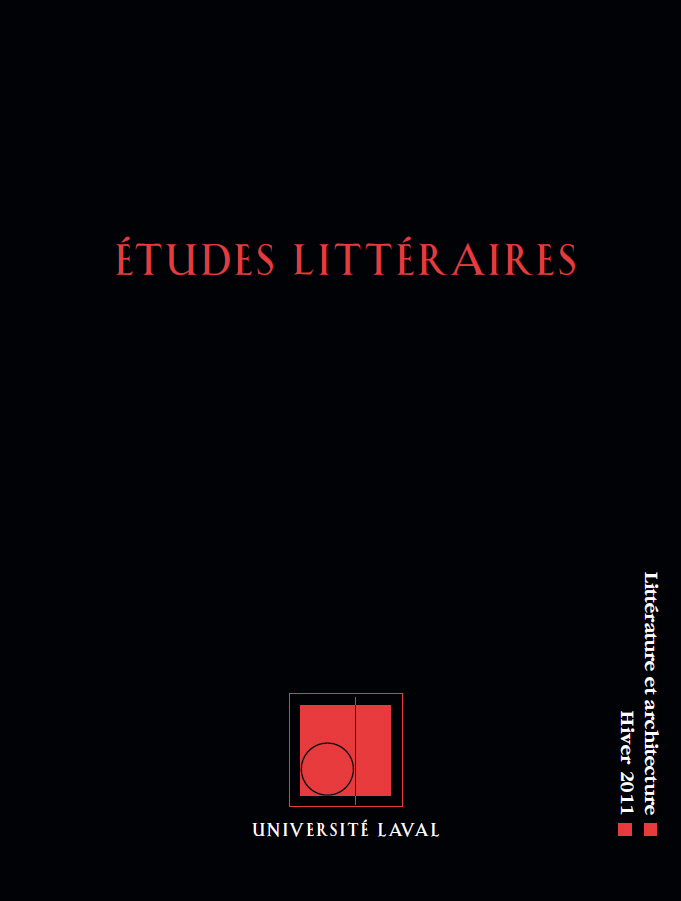Corps de l’article
L’analyse et la critique littéraire se prêtent particulièrement bien au motif de l’architecture. Les métaphores entre la littérature et l’architecture ne manquent pas : tel un architecte, un auteur est créateur de son oeuvre, il en conçoit les fondations, voit évoluer la structure de son travail, et finit par habiter, explicitement ou plus subtilement, le projet qu’il a formé ou qu’il voit se dérouler sous la plume. Que son ouvrage soit fictionnel ou autobiographique, l’auteur s’y investit en travaillant ou retravaillant des souvenirs, des fantasmes, des observations, des topoï ou des mythes connus de tous. Les couches successives qui mènent à la version définitive d’un texte peuvent être vues comme autant de « brouillons de soi[1] » — un architecte n’est-il pas un constructeur espérant concrétiser une vision toute personnelle du monde et de l’espace ? Sans chercher à déceler dans chaque texte littéraire des indices autobiographiques, on doit remarquer que la construction d’une oeuvre relève souvent du domaine de la projection : projection de ses propres obsessions dans l’imaginaire puis dans le matériau écrit, mais aussi projection comprise comme domaine de tensions entre les souvenirs, le moment de l’écriture et la vision de l’oeuvre achevée[2]. Projection à prendre aussi dans le sens cinématographique du texte, comme moment de contemplation d’un produit achevé, d’une histoire, moment pendant lequel le cerveau travaille, enregistre, où la suspension du temps « réel », qui s’effectue au moment de la plongée dans l’imaginaire, suscite des émotions et des souvenirs, et donne au spectateur un rôle actif à jouer.
Car la thématique de l’architecture appelle les enjeux de la réception des textes, et le rôle joué par l’auteur et les lecteurs dans leur lecture — et par extension, dans leur écriture et leur réécriture. Construire un texte, y inclure des motifs, des symboles, des références intertextuelles, c’est faire jouer son propre rôle de lecteur — capable d’interpréter, de détourner, d’adapter, d’assimiler — mais c’est aussi susciter la coopération active de ceux et celles qui recevront le texte. L’activité critique n’a de cesse de vouloir montrer, quand elles ne sont pas déjà visibles, les coutures cachées d’un texte, d’un ensemble. Quand ces structures sont déjà visibles, le critique se donnera pour tâche d’en trouver d’autres. Dans ce sens, comme l’a montré Barthes, l’activité de lire et celle de critiquer sont concomitantes : « le lecteur est un critique[3] ». En utilisant une métaphore de construction, Barthes note que le « matériau premier » d’un texte, et par extension l’outil de travail de l’écrivain comme du critique, est un langage déjà existant, parfois éculé, « qui est toujours antérieur[4] ». Afin de donner vie à ce langage, le rôle du lecteur est indispensable : les théories de réception des textes (reader-response) ayant émergé dans les années 1970 proposent ainsi une vision du texte dont la signification dépend non de la toute-puissance de l’auteur, mais du rôle du lecteur ; non de critères arrêtés et immuables, mais du processus de transformation et d’interprétation. La pluralité de significations d’un texte et des voix qu’il comporte, son dialogisme pour reprendre un terme de Bakthine, ne pourront être mis au jour que par ces lectures et relectures qui lui donnent du sens. Par ailleurs, c’est par la lecture et l’interprétation que se mettent en place, au fil des années ou des siècles, les canons de la littérature, et que sont définis des « monuments[5] », oeuvres à l’architecture imposante qui n’ont de cesse de révéler de nouvelles couches de signification. Comment le critique parvient-il à continuer à enrichir la signification d’un texte ? Autant (sinon plus) que les indices qui nous sont présentés dans un texte, ce sont les blancs, les trous, qui attirent l’oeil du critique. L’entreprise proposée par Genette dans son ouvrage Seuils, sur le paratexte, est révélatrice : le critique, en empruntant au langage de la construction et de l’occupation de l’espace, démonte et démontre les mécanismes de construction d’un texte, des portes d’entrées et de sortie qui opèrent une jonction entre le lecteur, l’auteur et le texte. Il met en lumière ce que montrent ces éléments — titres, épigraphes, avant-propos, notes, dédicaces, etc. — mais aussi ce qu’ils peuvent cacher, et ce que leur présence ou absence peut apporter à la compréhension d’un texte. Les pistes de lecture proposées par Genette dans cet ouvrage, parmi tant d’autres, rappellent que l’architecture d’un texte, qu’elle soit complexe ou plus sobre, pose la question de la relation entre le visible et le caché.
Si elle est un outil précieux de lecture et de compréhension des textes, l’architecture est aussi une thématique privilégiée des oeuvres littéraires : les motifs architecturaux (qu’il s’agisse de la ville, de l’immeuble ou de la cathédrale, qu’ils englobent le cosmique, l’imaginaire ou le concret) parsèment la littérature et sont souvent associés à des structures narratives ou poétiques subtilement façonnées. Par ailleurs, l’entreprise littéraire est apte à utiliser des métaphores de construction et de destruction pour proposer une certaine vision du monde. Le roman du XIXe siècle propose de nombreux exemples où l’architecture comme motif est utilisée en tant que jonction entre l’individu et le monde — l’on pense aux étages de la pension Vauquer dans Le père Goriot, à la cathédrale dans Notre-Dame de Paris. Alors que le roman se dote d’une fonction de réflexion sur la société, sa structure va aussi façonner le développement des personnages et du récit. La construction de Madame Bovary, alternant la banalité du quotidien avec des « scènes » (la rencontre, le bal, les comices agricoles) qui semblent rompre avec lui, met en relief la médiocrité et la monotonie de l’existence. La structure peut se faire véritable monument, processus reflété par exemple dans l’imposante table des matières des Misérables, ouvrage traversé de part en part par une réflexion sur le lien entre le minuscule et l’infini. En posant la question du rapport entre le texte et le réel, le roman invite à questionner le rôle joué par l’imaginaire dans le façonnement de l’illusion littéraire. La présence de l’imaginaire et d’images mythiques dans le processus même de construction d’un texte nous engage à nous interroger : qu’est-ce que le texte cherche à représenter ? Comment faire le lien entre le texte et le « monde » ? Est-ce que la littérature a pour but de représenter la réalité ou de produire une réalité ? Problématiques qui recouvrent tous les genres, et pas seulement le roman, comme le montrent dans les pages qui suivent les articles de Giovanni Berjola et de Julie Dekens, prenant tous deux comme point d’appui la lecture ou relecture de mythes et leur intégration dans le tissu poétique complexe des Illuminations de Rimbaud et du Bestiaire ou cortège d’Orphée d’Apollinaire. Au XXe siècle, le processus de construction des textes, le rôle de l’auteur et de ses influences, ont été mis à nu par de nombreux écrivains n’hésitant pas à briser l’illusion de réel (ou de vrai) produite par le texte littéraire. La place du mythe a également été repensée et modernisée, comme dans l’Antigone de Anouilh, texte réfléchissant (à) l’illusion produite par le rapport entre lecteur / spectateur et personnages. En nous dévoilant les rouages de ce « mécanisme bien huilé » qu’est la tragédie, le choeur rend visibles certaines des couches de signification nécessaires à la construction et à la modernisation du mythe. Le recours à l’architecture comme outil ou motif va donc engendrer le travail non seulement de l’imaginaire, mais aussi de la mémoire — mémoire collective ou individuelle —, véritable ciment de la compréhension et de l’interprétation de textes littéraires.
* * *
Les sept articles qui composent cet ensemble sont issus du colloque « French Studies in Scotland », également connu sous le nom de « Burn conférence », qui s’est tenu en novembre 2008 à Edzell, en Écosse. Lors de ces deux journées de rencontres et de discussions, dans un cadre architectural et géographique incitant à la rêverie, la question de l’imaginaire et celle du matériau mythique n’ont cessé de ressurgir à travers les différentes communications. Alors que la neige tombait et recouvrait la campagne écossaise, nous nous interrogions sur ce qui se situe dessous ou derrière les choses, sur les mécanismes — cachés ou plus visibles — qui sous-tendent la construction d’un récit, d’un recueil, d’un poème, sur les structures qui cachent autant qu’elles dévoilent. Il existe autant de structures architecturales qu’il existe de textes, chaque oeuvre littéraire composant (ou jouant) avec les conventions de l’époque, les contraintes du genre (y compris celles qu’on s’impose), l’ensemble dans lequel elle s’insère, les motifs et motivations qui la composent, et l’héritage littéraire par rapport auquel l’auteur se positionne. Les articles composant ce numéro donnent à lire un échantillon de mélanges entre construction, imaginaire et mémoire, qu’il s’agisse de structures en trompe-l’oeil (chez Sarraute et Perec), de pierres d’achoppement (chez Proust), de dédoublements (chez Darrieussecq), de déplacements horizontaux ou verticaux (dans le roman Kamouraska d’Anne Hébert), de reprises, fantasmées ou non, de mythes (chez Rimbaud et Apollinaire).
L’imaginaire médiéval est au coeur de l’étude de Guillaume Perrier, qui démontre comment l’art médiéval de la mémoire, se manifestant dans le motif de la cathédrale et passant d’une architecture concrète à une architecture mentale, est à l’oeuvre dans À la recherche du temps perdu. Dans son étude sur les Illuminations de Rimbaud, Giovanni Berjola s’interroge sur la jonction opérée entre rêveries urbaines, mythes et obsessions personnelles dans la composition du recueil et ses thématiques. La place jouée par le mythe dans la construction poétique est également soulevée par Julie Dekens qui, dans son article sur le Bestiaire ou cortège d’Orphée d’Apollinaire, évalue la manière dont le poète retravaille le matériau mythique afin de créer une architecture poétique hybride et contemporaine. L’étude de Jean-Pierre Thomas se situe à la jonction entre espaces mythiques et romanesques, en soulignant comment Anne Hébert, dans son roman Kamouraska, utilise des structures architecturales cosmiques dans la mise en place du tissu narratif et du relief donné aux personnages. Laëtitia Desanti propose d’aller derrière la surface des romans de Sarraute et de Perec, où la représentation des choses et des espaces concrets sert à orienter la lecture vers le vide. Enfin, l’article de Philippe Willocq sur Le pays de Darrieussecq met en avant les fluctuations de l’appareil énonciatif, le motif de l’acte créateur et leur rôle dans la construction et la structure du texte.
La place que tiennent l’imaginaire, le mythe et les motifs de construction et destruction dans ces formes architecturales reflètent le rôle du processus d’invention et de vision dans tout projet artistique, qu’il soit littéraire ou plastique. Ce regroupement d’articles, qui comprend des études allant de la période médiévale à la littérature contemporaine, permet ainsi d’envisager la question de l’architecture en littérature suivant plusieurs perspectives : celle de la narratologie, celle du rôle de l’imaginaire dans la construction littéraire, celle du mythe, celle de la réécriture, et celle des échos entre représentations (visuelles, d’objets) et création. Par des études qui cernent la place cruciale que jouent les structures souterraines, le rapport au temps, à l’espace et aux représentations visuelles, les liens complexes entre le concret et l’imaginaire, dans le matériau littéraire, ce volume pose des questions centrales à la définition même de la littérature.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Expression de Philippe Lejeune dans son ouvrage Les brouillons de soi (Paris, Éditions du Seuil, 1998).
-
[2]
Vincent Colonna propose une définition de l’autofiction comme cette capacité de l’auteur à se projeter dans un matériau fictif, définition qui englobe non seulement des autobiographies ou des autofictions mais aussi de nombreuses oeuvres de fiction. Voir Autofiction et autres mythomanies littéraires, Auch, Tristam, 2004.
-
[3]
Roland Barthes, Essais critiques, 1964, p. 9.
-
[4]
Ibid., p. 14. (l’auteur souligne).
-
[5]
Métaphore empruntée à Andrew Bennett et Nicholas Royle dans Introduction to Literature, Criticism and Theory, seconde édition, London, Prentice Hall Europe, 1995, p. 44-53.
Références
- Barthes, Roland, Essais critiques, Paris, Éditions du Seuil, 1964.