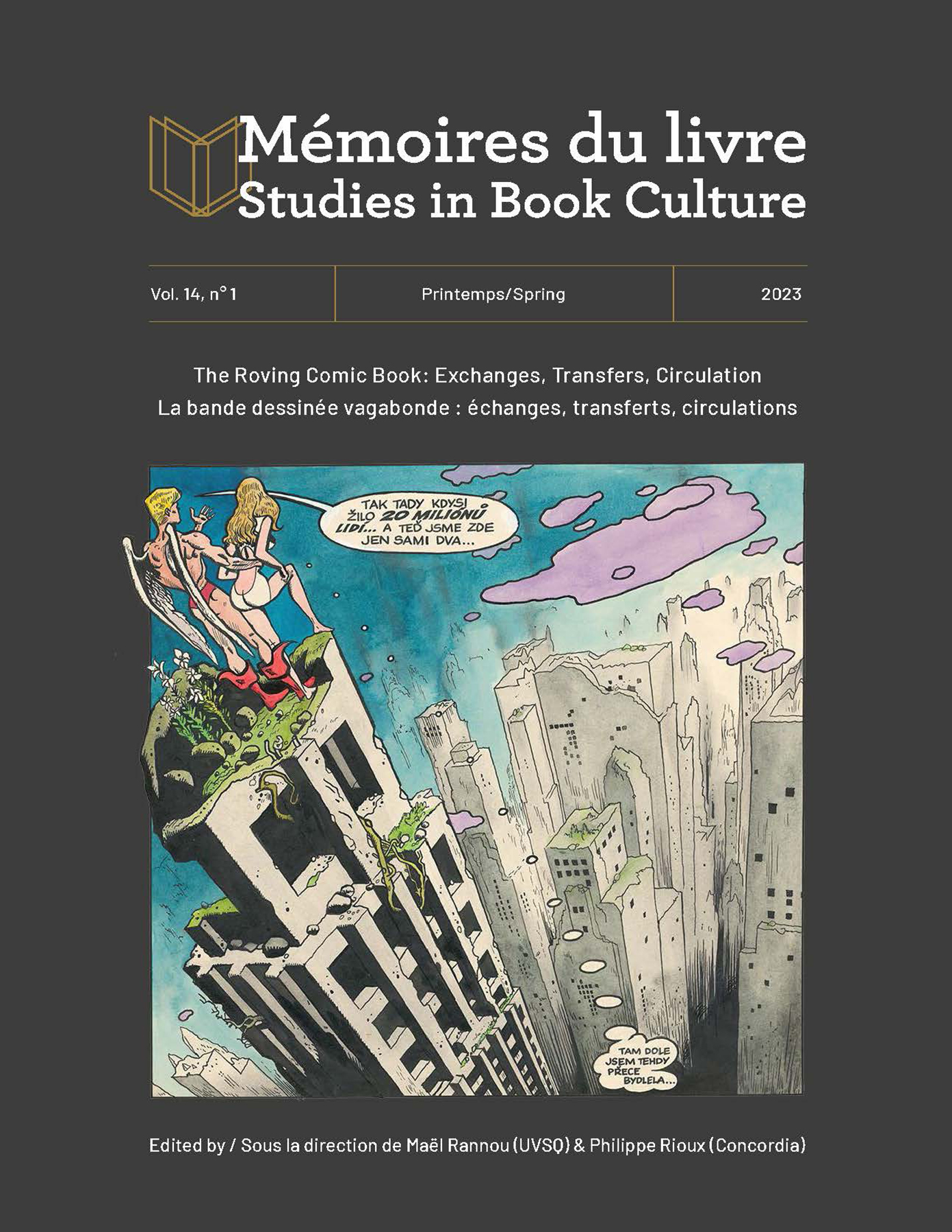Résumés
Résumé
Entre 1962 et 1975, le journal néerlandais Pep présente une tentative de diffusion et d’imitation du modèle franco-belge. À sa création, Pep mise sur les deux héros Tintin et Mickey. Mais au bout d’une année d’existence, pour atteindre un nouveau lectorat adolescent, le journal adopte une identité inspirée de la tradition franco-belge d’après-guerre, en s’appuyant surtout sur Spirou et Pilote associés dans un même modèle. À partir de 1965, les rédacteurs en chef Peter Middeldorp et Hetty Hagebeuk favorisent même l’émergence d’une scène esthétique nouvelle largement tributaire du modèle francophone, avec notamment Daan Jippes, Henk Albers ou Dick Matena, qui réinvestissent à leur manière les traditions de Morris, Goscinny, Uderzo et Franquin. Le marché qui se constitue autour du journal apparaît comme prometteur pour un certain nombre d’acteurs belges, comme Morris et Delporte qui produisent directement pour Pep. Pour autant, cette dynamique ne permettra pas aux auteurs néerlandais de parvenir à des publications durables à l’international.
Mots-clés :
- Pep,
- Pays-Bas,
- tradition franco-belge,
- presse jeunesse,
- diffusion internationale
Abstract
From 1962 to 1975, the Dutch magazine Pep represented an attempt to spread and emulate the Franco-Belgian model. In the beginning, Pep relied on the two heros, Tintin and Mickey Mouse. By the end of its first year, however, in order to reach a teenage audience, the magazine adopted an identity inspired by the post-war Franco-Belgian tradition, with a combination of Spirou and Pilote as its main reference. After 1965, editors-in-chief Peter Middeldorp and Hetty Hagebeuk actually encouraged the emergence of a new artistic scene derived from the Franco-Belgian model. Local artists such as Daan Jippes, Henk Albers or Dick Matena, each in his own way, perpetuated the legacy of Morris, Goscinny, Uderzo and Franquin. The market developing around the journal was deemed promising by a number of Belgian players such as Morris and Delporte, who began creating works directly for Pep. Even so, the dynamics were not substantial enough to enable the Dutch authors to create publications of lasting international prominence.
Keywords:
- Pep,
- Netherlands,
- Franco-Belgian tradition,
- youth press,
- international distribution
Corps de l’article
Il est difficile d’oublier que la bande dessinée franco‑belge construit son identité en face à face avec les deux grands pôles lointains du Japon et des États‑Unis. Le constat en a été fait fréquemment. Mais il ne faudrait pas que cet équilibre international laisse dans l’ombre les enjeux continentaux : au sein même de l’Europe, la francophonie représente ainsi une force de gravitation autour de laquelle les autres cultures peinent souvent à émerger.
Le cas des Pays‑Bas est d’autant plus frappant qu’ils entretiennent un lien linguistique naturel avec la Belgique. Territoire reconnu pour sa participation à l’histoire picturale, mais rarement évoqué dans l’actualité médiatique, le royaume n’est pas réputé pour ses traditions en bande dessinée. Or, si les traductions forment la majeure partie des publications néerlandaises, les créations locales existent bel et bien.
Parmi les différents journaux et éditeurs du xxe siècle, Pep, entre 1962 et 1975, présente une histoire particulière. On peut notamment y lire la volonté d’entrer dans les acteurs majeurs de ce monde éditorial européen; mais Pep a cette autre spécificité d’inscrire son projet dans le sillage des publications franco‑belges, en cherchant à en imiter les réussites. Une ambition d’autant plus invisible pour les lecteurs francophones qu’elle fut inaboutie.
Dans cette naissance, puis dans l’échec partiel de cette génération d’auteurs, se lit l’apport d’un pays frontalier à la bande dessinée franco‑belge.
La naissance de Pep comme espace de publication de la bande dessinée franco‑belge
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’histoire de la bande dessinée néerlandaise ressemble dans ses grandes lignes à celle de ses voisines : traduction de Töpffer au xixe siècle, domination des importations américaines au début du xxe, croissance de la bande dessinée dans les illustrés pour la jeunesse, apparition de créations indigènes avec textes sous vignette, restrictions enfin pendant l’occupation allemande qui favorisent l’émergence des auteurs locaux. C’est ainsi qu’apparaissent notamment Dick Bos d’Alfred Mazure et Tom Poes de Marten Toonder, tous deux extrêmement populaires : le premier se présente sous la forme de livres de la taille d’une boîte d’allumettes au rythme énergique d’une vignette par page; le second remporte un succès durable en tant que fable animalière dans la presse quotidienne, valant à Toonder et à son studio le surnom de Walt Disney européen. Parmi les strips de l’immédiat après‑guerre, Eric de Noorman de Hans Kresse et Kapitein Rob de Pieter Kuhn font aussi figure de classiques.
On soulignera pourtant deux différences notables avec la bande dessinée franco‑belge. Tout d’abord, le modèle du texte sous vignette domine jusque dans les années 1960, tandis qu’il est rapidement perçu comme archaïque dans les espaces de création les plus actifs. Ensuite, l’album luxueux reste rare, longtemps après qu’il a commencé sa croissance économique en France et en Belgique. Dans les années 1960, le marché de la bande dessinée est essentiellement représenté par des fascicules brochés et par des journaux à destination de la jeunesse, souvent d’origine étrangère, parmi lesquels Robbedoes et Kuifje (traduits respectivement de Spirou et Tintin), Donald Duck (avec du matériel Disney et Toonder), Sjors (dont le héros éponyme poursuit les aventures de Perry Winkle, comme Bicot en France) ou encore Fix & Foxi (majoritairement traduit de l’allemand).
C’est dans ce contexte que l’hebdomadaire Pep, lancé le 6 octobre 1962, apparaît comme l’application aux Pays‑Bas d’une recette qui fait ses preuves ailleurs en Europe. Il semble que le démarrage médiatique de Pilote en France ait convaincu la Geïllustreerde Pers de proposer un autre titre conjointement à Donald Duck, qu’elle publie déjà depuis 1952. L’objectif assumé est d’attirer les lecteurs du journal Disney en leur présentant un contenu moins puéril. La presse néerlandaise rejoint là une problématique commune à plusieurs pays européens lors de la décennie 1950‑1960 : la prise en compte des adolescents comme lectorat spécifique, et la recherche d’une bande dessinée qui pourrait leur être propre. Il est probable que cette découverte d’une cible cohérente soit liée à l’ascension de la jeunesse américaine dans la culture populaire, représentée par James Dean et les premiers blousons noirs. S’il demeure difficile de l’affirmer, il est en revanche indéniable que plusieurs revues d’Europe occidentale se prêtent alors des concepts, des rubriques et des auteurs, formant un véritable réseau.
Il s’agit d’abord du magazine anglais Eagle, lancé par Hulton Press le 14 avril 1950. Eagle présente l’intérêt de se vouloir plus moral que les comics américains, et surtout de s’insérer progressivement dans une gamme qui comprend à la fois un titre féminin (Girl, 1951), un titre pour la prime jeunesse (Robin, 1953) et un titre pour enfants (Swift, 1954). Par la suite, en 1955‑1956, les éditions Dupuis tentent d’introduire leur propre journal pour adolescents, Risque‑Tout, où se retrouvent brièvement les vedettes de l’écurie Spirou. Enfin, Pilote en France affiche cette même visée en 1959 – toucher « les moins de quinze ans débrouillards[1] » – et Georges Dargaud le rachète avec l’objectif de lui trouver un lectorat complémentaire à celui de Tintin.
L’ambition de ces journaux est de s’attacher un lectorat déjà rompu à la pratique de la narration en images, mais qui ne veut pas se limiter à l’illustré traditionnel perçu comme enfantin. On y trouve une impression grand format, un goût pour l’actualité, des images techniques présentées en coupes, des photographies, et une incitation des lecteurs à s’éveiller à la pratique journalistique[2]. On doit noter que Georges Dargaud s’appuie sur un partenariat avec Hulton Press pour repasser des bandes de Girl dans son journal Line, puis des bandes d’Eagle dans Pilote. On retrouve également dans Pilote un certain nombre d’auteurs de Risque‑Tout : Goscinny, Uderzo, Charlier et Hubinon, pour ne citer que les principaux. Pep, dernier‑né en 1962 de cette courte série, s’inscrit bien dans ce canevas par son partenariat avec Dargaud‑Lombard, mais il s’oppose économiquement à Eagle dont existe déjà une version néerlandaise, Arend[3].
Il est significatif que Pep se tourne vers le marché franco‑belge pour trouver un matériel adolescent qui sera perçu comme plus respectable que les bandes américaines. L’école belge wallonne, dont les équipes de Pilote et Tintin découlent pour beaucoup, apparaît visiblement comme la principale solution de rechange compétente aux images dépréciées venues des États‑Unis.
Si Pep se donne d’emblée l’objectif d’un lectorat adolescent, ses premières années de publication se distinguent par un certain flottement identitaire. Non seulement l’hebdomadaire opte pour les bandes de Lombard et non pas pour celles de Dargaud (Tintin, Modeste et Pompon, Dan Cooper, Clifton, Ric Hochet, Oumpah‑Pah…), mais il y ajoute également le Mickey Mouse de Paul Murry et des adaptations de séries télévisées Disney, dont Zorro, ainsi que des comic strips comme Beetle Bailey ou Pete the Tramp. De plus, la présence en couverture de Tintin, de Mickey et de Pep, héros‑titre créé pour le journal par Tenas et Duchâteau, toujours en plan moyen, dans la vie quotidienne, souvent face au lecteur, rappelle les couvertures‑gags des publications Disney ou celles du journal Sjors. Pep persiste à s’identifier à un personnage, laissant à la bande dessinée une fonction de mascotte plutôt que de support à un imaginaire narratif. À la différence d’Eagle et Arend, le ton affiché est celui d’une revue humoristique, malgré les titres réalistes à l’intérieur. La cible adolescente, contrairement à ce qui s’est passé dans les autres titres de presse européens, se construit ici en dehors d’un carcan moral édifiant, et en donnant d’emblée un avantage à la fiction.
Rapidement pourtant, de façon analogue à l’histoire française de Pilote, la direction de Pep va affiner cet objectif en cherchant à grandir avec ses lecteurs. Le constat est lié aux résultats des ventes, qui sont peu satisfaisantes et inférieures à celles du rival Sjors. La volonté de fidéliser son lectorat grandissant plutôt que de le renouveler est alors inédite. C’est Peter Middeldorp, rédacteur en chef de Robbedoes, qui est chargé en 1965 de donner un nouvel angle d’attaque au journal.
Le Néerlandais Peter Middeldorp se joint à la section flamande de Spirou en 1957, et en assume la rédaction en chef l’année suivante. Son rôle, peu gratifiant, consiste essentiellement à traduire et à éditer le matériel francophone. Sa relation avec l’éditeur s’envenime lorsque, à la suite d’un conflit sur les salaires, il crée un syndicat pour l’ensemble de la rédaction. C’est donc sans regret qu’il se sépare de Dupuis pour prendre les rênes de Pep, où il trouve plus de liberté[4].
Il est significatif que les personnages‑mascottes Pep, Tintin et Mickey désertent alors le journal. Middeldorp puise l’essentiel de ses nouvelles bandes dans le catalogue Dargaud : Barbe‑Rouge, Valérian, Astérix, Achille Talon, ainsi que Lucky Luke, encore chez Dupuis mais qui a déjà atteint un lectorat adolescent, voire adulte. La politique de traduction de Middeldorp met en avant une bande dessinée qui est en train d’accéder en France à une forme de légitimité culturelle et qui s’impose dans le débat public. Le succès d’Astérix, qualifié de « phénomène » à la une de L’Express le 19 septembre 1966, est très contemporain. Avec intuition, le rédacteur en chef choisit des bandes majeures peu après leurs dates de première publication : Valérian en 1968 (1967 dans Pilote), Achille Talon en 1966 (1963 dans Pilote).
Cette mise en avant de la création française au moment de sa réussite critique va avoir des conséquences sur la bande dessinée aux Pays‑Bas. Il est remarquable que Middeldorp, qui avait constaté l’absence de création flamande dans Robbedoes, fonde son expérience sur la tradition wallonne. De fait, les liens entre bande dessinée flamande et bande dessinée néerlandaise sont singulièrement faibles, malgré l’unité linguistique. Seul Willy Vandersteen, le créateur belge de Suske en Wiske (Bob et Bobette) et d’un nombre colossal de publications, a réussi à franchir la frontière durablement.
Le développement d’une création inspirée des recettes voisines
De son expérience à Robbedoes, Peter Middeldorp sort également convaincu que la popularité d’une oeuvre tient à son lien avec le lectorat local :
Dat is niet iets wat je leren kan, je weet intuïtief wat Nederlanders zullen waarderen en wat niet. Wat Franstalige lezers leuk vinden is voor een Nederlander moeilijk aan te voelen. En binnen de redaktie van Spirou/Robbedoes was dat heel belangrijk, want Robbedoes is een blaadje dat je kunt verwaarlozen[5].
Il n’est donc pas surprenant qu’il soit aussi celui qui va donner naissance à une branche néerlandaise indépendante : une création importante qui s’appuie sur le modèle franco‑belge tout en cultivant sa différence.
Avant même l’arrivée de Middeldorp, la page centrale alternait déjà entre d’authentiques Pilotoramas traduits des journaux Pilote ou Record et des créations sur la même formule, dessinées notamment par Thijs Postma. Grâce à Henk Tol ou à l’Espagnol Ferran Sostres, Pep‑plaat durera ainsi jusqu’en 1973, plusieurs années après son interruption dans Pilote. À partir de fin 1964, alors que les bandes publiées sont encore quasi exclusivement franco‑belges et américaines, ce sont toujours des artistes locaux – Hans Kresse, Jan Wesseling ou Daan Jippes – qui s’approprient les personnages de leurs confrères étrangers pour les illustrations de couverture. Wesseling, particulièrement prolifique, livre ainsi de superbes réinterprétations d’Astérix, de Barbe‑Rouge ou encore de Blake et Mortimer.
Mais, sous la rédaction en chef de Middeldorp, Pep amorce une transition : il s’agit de moins en moins d’importer du matériel étranger, et de plus en plus de favoriser la création locale. C’est ainsi qu’en 1965, Zorro est remplacé par Vidocq, de Hans Kresse. Ancien pilier du studio Toonder, au sein duquel il a créé la série à succès Eric de Noorman, ce maître de la bande dessinée réaliste est déjà l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée néerlandaise lorsqu’il rejoint Pep. Outre Vidocq, Kresse illustre les nouvelles de Paul Nowee consacrées au personnage d’Arendsoog, une sorte d’alter ego réaliste de Lucky Luke, héros d’une série de romans jeunesse très populaires aux Pays‑Bas.
Petit à petit, de nouvelles séries néerlandaises font leur apparition au sommaire, à mesure que se constitue une équipe d’artistes recrutés par Peter Middeldorp dans un premier temps, puis par Hetty Hagebeuk, qui lui succède à la rédaction en chef en 1968 après deux ans de tuilage. Avec eux va émerger une scène esthétique nouvelle, largement tributaire du modèle franco‑belge.
Sur une suggestion du rédacteur en chef, Martin Lodewijk crée Agent 327, une série d’espionnage parodique inspirée par la popularité des films de James Bond. Avant de rejoindre Pep, Lodewijk a produit quelques histoires pour des magazines « pulp », et travaillé dans la publicité. Il est appelé à devenir l’une des principales figures du magazine, en tant qu’auteur complet, scénariste, et finalement rédacteur en chef d’Eppo, le successeur de Pep. L’Agent 327 restera son personnage emblématique et connaîtra de nombreuses aventures, jusqu’aux années 2010. Dans les premières histoires, le trait de Lodewijk est encore marqué par son travail dans l’illustration et la publicité; mais rapidement, l’influence de Franquin prend le dessus, et le dessinateur adopte un style rond et nerveux qui ne détonnerait pas dans les pages de Spirou.
Henk Albers, quant à lui, va directement puiser à la source et s’approprier un personnage phare du magazine belge. Créateur fantasque, flambeur et alcoolique, il rejoint Pep en 1965 pour illustrer la rubrique Peppers, consacrée à l’actualité culturelle. Albers fait appel à tous les personnages du journal, tout en donnant une place de choix à son héros favori, Lucky Luke. Peu à peu, le dessinateur se libère du texte pour se recentrer sur le personnage de Morris. À partir de 1969, il réalise diverses variations sur des oeuvres littéraires – Les Trois Mousquetaires, Don Quichotte ou Robinson Crusoé – avec Lucky Luke, les Dalton ou Calamity Jane comme principaux membres de la distribution. L’année suivante, avec l’aval de Morris, la parodie d’oeuvres tierces laisse place à des gags et des nouvelles illustrées situés directement dans l’univers du cow‑boy, qui constituent le premier véritable développement apocryphe de Lucky Luke, bien avant les initiatives ultérieures chez Dargaud et Lucky Productions.
L’année 1968 voit l’arrivée de deux jeunes dessinateurs, Dick Matena et Daan Jippes. Le premier a 25 ans, il est issu du studio Toonder, au sein duquel il a notamment travaillé sur des séries animalières et des productions Disney. Le second, qui a grandi en lisant Robbedoes et Donald Duck, a 23 ans et démarre tout juste sa carrière de dessinateur. Tous deux vont inscrire leur contribution à Pep dans la tradition franco‑belge. Matena, avec son graphisme rond et énergique, s’affiche ouvertement comme un disciple d’Uderzo. Seul ou en compagnie du scénariste Lo Hartog van Banda, il donne naissance à trois grandes séries qui assument leur proximité avec Astérix : De Argonautjes (Les Petits Argonautes, 1968‑1973) parodie la mythologie grecque; Ridder Roodhart (1969‑1971) s’inspire de la geste arthurienne; enfin, Grote Pyr (Knut le Viking, 1971‑1974) est située dans l’univers des Vikings. Entre autres personnages éminemment astérixiens, De Argonautjes met en scène le fils d’Hercule : un garçon roux, enveloppé et naïf qui pourrait aussi bien être celui d’Obélix; ou encore une certaine Reine Mata, dont le fort caractère et le physique évoquent étrangement Cléopâtre (à l’exception notable du nez, que la reine d’Égypte a plus joli). Le Viking Grote Pyr, quant à lui, semble sortir tout droit d’Astérix et les Normands.
De son côté, Jippes assure dans un premier temps une présence continue dans le magazine à travers des histoires courtes, gags et illustrations, réalisant notamment des couvertures consacrées à Ric Hochet, Iznogoud ou encore Astérix. Son imitation du style d’Uderzo, particulièrement confondante, donne lieu à quelques images mémorables. Bientôt, le jeune dessinateur s’attaque à un grand récit d’aventures humoristique en 44 planches, écrit par Martin Lodewijk : Twee voor thee. De façon générale, et pour cette oeuvre en particulier, Jippes revendique ouvertement des inspirations franco‑belges : Morris, pour son trait épuré qui l’aide à conjurer sa propre tendance à la surcharge; Uderzo, sa référence la plus flagrante, notamment en seconde partie du récit; et Franquin, dont il considère le trait comme la base de son style[6]. Investi corps et âme dans la réalisation de ce qui doit être son grand oeuvre, Jippes craque à mi‑parcours et doit s’interrompre. Durant le hiatus, il dessine des histoires de commande pour Donald Duck. Lorsqu’il revient à Twee voor thee, son trait a intégré les influences disneyennes : Carl Barks, Floyd Gottfredson. Il a également gagné en rigueur et en clarté. Publié dans Pep en 1972, et en album la même année, Twee voor thee s’impose aux Pays‑Bas comme une référence dans la profession. Mais l’accueil plus tiède des lecteurs déçoit Jippes, et l’énergie lui manque pour continuer[7]. Il préfère retourner à l’univers Disney, au grand regret de ses admirateurs, parmi lesquels Dick Matena :
Hij moest het boegbeeld van de Nederlandse strip zijn, heb ik tegen hem gezegd. De Nederlandse Franquin of Hergé. Als hij er zijn schouders onder had gezet, had Nederland in die tijd een rol van betekenis kunnen gaan spelen als stripland[8].
En 1970, Fred Julsing Jr. rejoint Pep et crée les séries Wellington Wish (1971‑1973) et De Broertjes Samovarof & Co (1974‑1975). Il est, avec Jippes, l’autre chef de file de l’école « franquinienne » néerlandaise. En examinant le travail des deux dessinateurs, on est d’ailleurs frappé par les similitudes : non seulement Jippes et Julsing partagent‑ils les mêmes influences, mais ils en dérivent peu ou prou dans la même direction, sans doute par un jeu d’émulation réciproque[9]. Chez l’un comme chez l’autre, les vignettes fourmillent de détails, la caméra virevolte, multipliant plongées et contre‑plongées, et les personnages comme les véhicules poussent le dynamisme jusqu’à surgir de leurs cases. Malgré des maladresses, leur travail anticipe dans une certaine mesure celui des dessinateurs belges et français qui, dans les années 1980, s’empareront à leur tour du modèle franquinien pour le moderniser : Conrad, Hardy ou encore Warnant.
Autre pilier du magazine, Peter de Smet se singularise par son humour, inspiré de Mad et porté sur le burlesque, comme par son style graphique épuré qui rappelle davantage le strip américain que la tradition franco‑belge. Fils d’un illustrateur, et issu de la publicité, il entre à Pep après avoir essuyé un refus de Tintin. Sa série De Generaal est constituée d’histoires courtes bâties sur un schéma immuable : le Général tente de s’emparer du fort défendu par le Maréchal, et échoue invariablement. En 1972, de Smet crée Joris P.K., une série d’aventures située dans un univers médiéval. Très inspirée de Johan et Pirlouit, l’oeuvre en reprend tous les ingrédients – attaques de châteaux‑forts et tournois de chevalerie, sorcières et Vikings –, mais assaisonnés façon de Smet, avec un grain de folie supplémentaire. Au fil des pages, l’auteur néerlandais convoque en sus de Peyo d’autres références franco‑belges : ici, un vautour qui semble tout droit sorti d’une page de Morris; là, un bon gros barbare qui fait valdinguer ses ennemis si brutalement que leurs chaussures restent au sol, comme chez Uderzo.
Il est difficile d’établir les différences stylistiques entre les créations de Pep et le modèle dont elles s’inspirent. Les auteurs, dans leurs déclarations, revendiquent plus souvent leur fidélité envers les originaux. Se dégage pourtant de l’ensemble des travaux néerlandais ce qu’on pourrait qualifier d’approche assumée du divertissement. Après mai 1968, la bande dessinée française, y compris lorsqu’elle se veut populaire, intellectualise et politise son approche. Goscinny, notamment, fait évoluer ses séries dans le sens d’un plus grand rapport à l’actualité et de thématiques ouvertement adultes[10]. À l’inverse, les auteurs néerlandais se situent consciemment dans une dynamique candide et un récit plus transparent. Lo Hartog van Banda et Martin Lodewijk, par exemple, qui écriront ensuite plusieurs scénarios de Lucky Luke, se détacheront nettement des concepts pour plonger dans l’aventure proprement dite, dans le récit western sans arrière‑pensée. Lodewijk, devenu entre‑temps rédacteur en chef d’Eppo, portera même un jugement sévère sur les textes de Goscinny :
Ik zou wel in de richting van Vogelvrij willen werken. Dat vind ik toch wel een topper op eenzame hoogte. […] Die [Goscinny] heeft overigens ook fantastische verhalen gemaakt, maar vooral de laatste tijd was het toch meer zoals een Parijzenaar het Wilde Westen ziet, dan een échte western. Het had iets, ik weet niet wat, dat ook de laatste Asterixen hadden[11].
De la même façon, en remplaçant la Gaule d’Astérix par la mythologie grecque, De Argonautjes revient aux sources du péplum fantastique à la Ray Harryhausen, et le choix des Vikings dans Grote Pyr permet de renouer avec un décor épique plus propice à l’aventure qu’au commentaire sociétal. Les grandes séries de Pep se raccrochent toujours à un genre : la cape et l’épée pour Joris P.K., l’espionnage pour Agen 327, ou le médiéval‑fantastique pour Ridder Roodhart.
Une nouvelle Belgique?
À la même époque, la bande dessinée française évolue vers des travaux plus modernes. En Belgique, le journal Spirou connaît alors, sous la rédaction en chef de Thierry Martens, un épisode vécu par beaucoup comme une décadence. Les Pays‑Bas apparaissent donc comme un territoire où les aventures plus classiques pourront poursuivre leur essor. Pep promet un temps de devenir la nouvelle référence, au point de donner des ailes aux rédacteurs en chef successifs et à leurs auteurs. Dick Matena fait partie de cette jeune génération qui nourrit le secret espoir de battre la Belgique sur son propre terrain : « In die tijd verwachtte ik dat de Europese weekstripmarkt zou overgaan van de Belgen op de Nederlanders[12]. »
C’est que cet imaginaire ne se limite pas aux acteurs locaux. Ailleurs en Europe, on considère aussi cet espace comme un eldorado naissant. Au fur et à mesure du développement des productions locales, plusieurs auteurs confirmés du marché européen, parfois de premier plan, vont rapidement miser sur la bande dessinée néerlandaise.
Le premier d’entre eux à sauter le pas est, ce n’est sans doute pas un hasard, d’origine flamande : il s’agit de Morris, qui réalise pour Pep une série d’illustrations de couverture consacrées à son personnage. Peter Middeldorp a pris l’initiative de le solliciter via ses contacts à Bruxelles[13]. Flatté, Morris accepte, et fournit une trentaine de superbes couvertures en couleurs directes, qui accompagneront toutes les sérialisations de ses histoires dans Pep entre 1965 et 1969, ainsi que quelques illustrations supplémentaires pour les pages intérieures.
Par la suite, d’autres auteurs belges rejoignent le magazine pour y collaborer de façon plus substantielle. À la fin des années 1960, Dino Attanasio vient de quitter le journal Tintin, s’étant brouillé avec Raymond Leblanc qui lui reproche ses infidélités avec d’autres éditeurs. En Italie, sa collaboration avec le Corriere dei Piccoli est également sur la fin, le magazine cherchant désormais à s’adresser à un public plus âgé[14]. Le marché néerlandais sera pour le dessinateur une planche de salut. Avec Martin Lodewijk au scénario, il crée pour Pep le personnage de Johnny Goodbye, un détective privé dont les aventures se déroulent dans le Chicago de la prohibition. Une vingtaine d’histoires longues écrites par divers scénaristes paraîtront dans Pep, puis dans Eppo et Sjors en Sjimmie Stripblad, jusqu’au début des années 1990. Ses deux autres grandes séries pour le magazine sont De Macaroni’s, écrite par Dick Matena, et Bandonéon, pour laquelle il est accompagné au scénario d’un autre Belge exilé : Yvan Delporte. Éjecté de Spirou en 1968, le fantasque ex‑rédacteur en chef et scénariste s’est lui aussi tourné vers les Pays‑Bas. C’est Hetty Hagebeuk qui suggère à Attanasio de travailler avec lui, ravie de cette prise de choix pour son magazine. Outre Bandonéon, Delporte collabore avec des dessinateurs locaux pour deux séries éphémères : Anna Tommy, avec Peter de Smet, et Llewelyn Fflint avec Peter van Straaten. Il introduit même dans Pep Claire Bretécher, qu’il avait déjà fait entrer dans Spirou quelques années plus tôt et qui vient de quitter le magazine. Ensemble, ils signent Alfred de wees (Fernand l’orphelin), une série d’histoires courtes. Delporte apporte également son aide à Robert Gigi, qui crée dans Pep les aventures du samouraï Ugaki. Enfin, c’est avec René Follet, arrivé dès 1967, qu’il crée Steven Severijn (Steve Severin).
L’ancien rédacteur en chef de Spirou joue aussi un rôle dans la réappropriation de Lucky Luke par Pep. Henk Albers, dont les parodies de la série sont appréciées par Morris, est sollicité pour illustrer à quatre reprises des nouvelles d’ambiance western, écrites par Delporte sur idées de Goscinny. Ainsi est adoubée la réécriture du cow‑boy solitaire et de son univers aux Pays‑Bas.
C’est encore Delporte qui encourage un autre transfuge de Dupuis, Eddy Ryssack, à le rejoindre de l’autre côté de la frontière. Depuis une dizaine d’années, ce talentueux dessinateur flamand est l’un des piliers invisibles de la maison carolorégienne. Initialement employé au studio de dessin dirigé par Maurice Rosy (« des gars talentueux, mais que Charles n’arrive pas à voir autrement que comme des employés de bureau[15] »), il dirige par la suite le studio d’animation TVA et occupe divers postes administratifs dans la maison mère, tout en signant pour le magazine Spirou nombre d’histoires courtes et de mini‑récits. Sa carrière d’auteur n’a jamais véritablement décollé en Belgique, mais qu’importe : les Pays‑Bas lui donneront sa revanche. À la suite d’une brouille avec Dupuis, il démissionne et rejoint le magazine Sjors, concurrent de Pep, à partir de 1970 (les deux magazines fusionneront en 1975 pour devenir Eppo). Dans Sjors, puis Eppo, Ryssack anime les aventures de Brammetje Bram, un jeune mousse embarqué malgré lui sur un navire pirate. Les histoires sont initialement écrites par Frank Buissink, rédacteur en chef du magazine, puis par divers auteurs, dont Ryssack lui‑même et Yvan Delporte.
À la même époque, un autre dessinateur belge, Berck, rejoint également Sjors. Néerlandophone, Berck produit déjà pour le marché flamand depuis une dizaine d’années. Dans les pages de Sjors, il crée De Donderpadjes et surtout Lowietje, qui se poursuivra dans Eppo. Pour cette seconde série, il entraîne avec lui son complice Raoul Cauvin (qui officie anonymement, car son contrat avec Dupuis ne l’autorise pas à travailler pour la concurrence[16]).
À leur arrivée dans le marché néerlandais, ces auteurs, à leur tour, vont se situer dans le prolongement des traditions européennes. Lorsqu’il crée De Donderpadjes et Lowietje, Berck s’inscrit naturellement dans la lignée des oeuvres que ces séries sont destinées à remplacer : La Ribambelle et Benoît Brisefer. À la bande de copains imaginée par Roba, il substitue une troupe de scouts et, si le petit Lowietje n’a pas la force surhumaine du héros de Peyo, il en hérite tout de même l’astuce et le goût de l’aventure. En outre, Lowietje est accompagné dans toutes ses aventures par son majordome, Jacob, qui fait clairement écho au personnage de James dans La Ribambelle (jusqu’à lui emprunter son prénom en version française). De même, Brammetje Bram, supposé remplacer Le Vieux Nick et Barbe‑Noire, emprunte à la série de Remacle son thème principal et son atmosphère de piraterie bon enfant, mais lorgne aussi et surtout du côté de l’oeuvre de Goscinny, pour ce qui est du ton et de l’humour. La représentation des stéréotypes nationaux et le jeu sur les différences de langues sont parmi les ressorts comiques récurrents de la série de Ryssack, et certains personnages croisés au fil des épisodes semblent tout droit échappés de l’oeuvre du scénariste français.
À l’inverse, certaines séries néerlandaises devancent leurs équivalents belges et français. Sammy ne démarre dans Spirou qu’un an après Johnny Goodbye, sur un argument quasiment identique, ce qui ne manquera pas d’agacer Attanasio : « Credo che abbia ispirato Berk e Cauvin, gli autori di Sammy, un personaggio molto simile che ha raggiunto una maggior popolarità[17]. »
Plus troublant : De Barker‑bende, l’un des épisodes de la série, met en scène un gang familial constitué de quatre frères et dirigé par leur mère, une femme à poigne nommée Ma Barker, qui manie aussi bien les armes à feu que le rouleau à pâtisserie, fait évader ses fils de prison à l’aide de gâteaux piégés, et confesse une préférence pour le dernier de la fratrie. On pense bien sûr à Ma Dalton; mais la matriarche de Lodewijk et Attanasio sévit en 1970, soit un an avant celle de Morris et Goscinny. L’inspiration est loin d’être avérée, et il pourrait s’agir d’une coïncidence[18]. Mais il n’est pas interdit de supposer que Morris, qui avait forcément lu De Barker‑bende, ait pu souffler à Goscinny l’idée de doter les Dalton d’une mère. Rétrospectivement, le dessinateur de Lucky Luke préférait cependant remarquer une influence en sens inverse (indéniable en l’occurrence) : « Ik herinner me speciaal zijn boek over Ma Barker en het begin daarvan is helemaal in de stijl van Calamity Jane[19]. »
Bandonéon, signé Delporte et Attanasio, s’affiche plus ouvertement comme un pastiche un brin décalé de Lucky Luke. La figure du gaucho argentin reflète, en moins légendaire, celle du cow‑boy de western. Entre autres similitudes, les épisodes s’achèvent par la disparition du héros au moment où on veut lui rendre honneur. Mais Delporte joue de cette transposition avec ironie, en imaginant des duels où la guitare a remplacé le revolver et des scènes de torture où les terribles Apaches portent des bonnets péruviens.
C’est donc dans un esprit commun avec les créations locales – celui de la perpétuation du modèle classique –, mais aussi parfois avec une pointe d’irrévérence supplémentaire, que s’inscrit l’apport de ces visiteurs belges. Leurs oeuvres contribuent à construire l’identité du magazine durant son âge d’or, sous la direction de Peter Middeldorp et, surtout, d’Hetty Hagebeuk.
Pendant les années qui suivent, le phénomène d’attraction perdure dans une certaine mesure, y compris après que Pep et Sjors ont fusionné pour devenir Eppo. Ainsi, c’est à ce magazine que l’on doit la survie de la série Léonard, de Turk et de Groot. Créée à l’origine pour Achille Talon Magazine en 1975, elle aurait pu ne pas survivre à l’arrêt de son support de publication, six mois plus tard. Pourtant, elle trouve un refuge inattendu dans les pages du magazine Eppo, comme s’en souviennent ses auteurs dans le livre commémorant les 20 ans du personnage :
Eppo était un journal néerlandais assez proche, dans l’esprit et le format, du Spirou des années 60. Il cherchait précisément du matériel, et son rédacteur en chef a demandé à nous rencontrer. La publication a commencé et, après consultation et réponses positives des lecteurs, continué[20].
Par un effet boomerang, ce transfert va permettre à Léonard de revenir chez Dargaud par la grande porte :
Parallèlement, Dargaud, qui avait mobilisé un certain nombre de dessinateurs sur son projet de magazine et qui, en quelque sorte, leur en était redevable, signait avec Eppo un accord de coédition qui nous a permis, pour la première fois, de paraître à la fois en presse et – inconcevable consécration – en album[21].
Le magnétisme des Pays‑Bas s’exerce également par‑delà la mer du Nord. Lorsque Don Lawrence, dessinateur du space opera The Trigan Empire, quitte son éditeur londonien au milieu des années 1970, à la suite d’un conflit sur ses droits d’auteur à l’étranger, il n’a aucun mal à relancer sa carrière aux Pays‑Bas. The Trigan Empire y est particulièrement populaire, et Lawrence a déjà des contacts avec l’éditeur Oberon, pour avoir collaboré à l’éphémère magazine Babariba. C’est ainsi que naît Storm, une saga à mi‑chemin entre fantasy et science‑fiction, dont les scénarios seront signés entre autres par Martin Lodewijk et Dick Matena. La série s’impose comme l’une des plus importantes d’Eppo, le successeur de Pep, et Lawrence continuera de l’illustrer jusqu’à sa retraite en 2002.
Au‑delà de ces multiples expériences individuelles, la bande dessinée néerlandaise se présente comme un espace de choix pour la mise en valeur des productions francophones : une plate‑forme économique à vocation internationale qui se développe encore après la fin de Pep en 1975, et notamment sous les nouvelles formules du journal, Eppo (de 1975 à 1985) puis Eppo Wordt Vervolgd (de 1985 à 1988). L’hebdomadaire accueille souvent certaines aventures de Lucky Luke avant toute autre publication internationale, notamment tous les récits complets dessinés par Morris et ses assistants entre 1979 et 1981. Intégrées dans la foulée à la collection d’albums par l’éditeur néerlandais Oberon, ces histoires ne seront reprises en français par Dargaud que dans un second temps, dans des recueils improvisés pour la collection « 16/22 », ou plus tard encore dans la collection officielle. De la même façon, les albums d’Astérix chez Albert René, qui ne sont pas prépubliés en France, sont proposés systématiquement en avant‑première internationale aux lecteurs d’Eppo[22]. L’hebdomadaire a également la primeur du premier épisode de La Jeunesse de Blueberry dessinée par Colin Wilson en 1984, Les Démons du Missouri.
Retour sur le marché français
Malgré son dynamisme, on sait que la bande dessinée néerlandaise n’est pas devenue une nouvelle Belgique. Il faut même constater que les histoires de Pep, qu’elles soient issues d’auteurs locaux ou d’acteurs d’origine internationale, n’ont eu qu’un succès relatif à l’étranger.
Ils sont pourtant un certain nombre parmi les auteurs de Pep à vouloir pénétrer le marché franco‑belge dans les années 1970. C’est une suite logique, après l’espoir de la fondation d’un nouveau marché européen. On retrouve les uns et les autres dans les périodiques francophones d’inspiration belge : Gideon Brugman dans Spirou en 1969 (Zonk et Stronk), Henk Albers dans le mensuel Lucky Luke en 1974 (pour de nouvelles parodies de Lucky Luke), Peter de Smet et Martin Lodewijk dans Le Trombone Illustré et Pendant ce temps à Landerneau (suppléments de Spirou et [À Suivre]) de 1977 à 1979. Delporte joue sans doute un rôle‑clé dans le passage de la plupart de ces pages. Il reprend aussi dans Le Trombone les planches dessinées par Bretécher pour Alfred de wees, sous le titre de Fernand l’orphelin, planches qui susciteront des conflits avec Charles Dupuis pour la grossièreté de leur traduction.
Cependant, ces expériences restent globalement sans lendemain. Franka (Henk Kuijpers) et Le Général (Peter de Smet) tiendront un peu plus longtemps dans Spirou et Gomme au début des années 1980. À la même période, Robbedoes opte brièvement pour une formule indépendante de Spirou, dans laquelle sont publiés des auteurs belges flamands mais aussi néerlandais, comme Peter de Smet ou Gerrit de Jager. Mais ces publications vont rarement jusqu’à l’album : des auteurs de Pep, peu parviennent vraiment jusqu’au marché français. En 1980, Fershid Barucha publie aux éditions du Triton un album des Petits Argonautes, un autre de Knut le Viking et un troisième de Supermax de Lo Hartog van Banda, mais les trois séries sont interrompues par la disparition de la maison. Twee voor thee est traduit par Glénat en 1982 sous le titre de Tea for two, mais n’obtient qu’un succès d’estime. Ces éditions sont par ailleurs tardives par rapport aux publications d’origine. Même les séries créées par des auteurs français ou belges ne sont que partiellement retraduites en dehors du pays de Pep. Si l’on met de côté une première tentative dans la confidentielle collection « Kaléidoscope » des éditions Albin Michel en 1976 (sous le nom de Brieuc Briand), c’est seulement après avoir connu un certain succès en Allemagne que Brammetje Bram, renommé Colin Colas, débarquera enfin en France dans Super As, version française du magazine allemand Zack, à partir de 1979. Mais le millier de planches de la version originale ne donnera lieu qu’à six maigres albums dans l’Hexagone. De la même façon, parmi les dix histoires de Lowietje parues aux Pays‑Bas, seules six seront reprises en français pour Lou dans Spirou. Quant à Ugaki de Gigi, si la série remporte un certain succès d’estime, ce ne sera qu’à partir de nouveaux récits parus dans Tintin, Pilote ou Charlie mensuel.
Autre expérience avortée, qui aurait pu s’avérer d’ampleur, c’est l’ouverture d’Astérix à la possibilité d’une variante néerlandaise. Au printemps 1981, Albert René ayant l’intention de diffuser en France un mensuel autour du petit Gaulois, une agence d’Amsterdam met sur l’affaire Daan Jippes et Lo Hartog van Banda[23]. Le second imagine le synopsis d’Asterix en de Lucullus maaltijden (Astérix et le repas de Lucullus), une histoire de 32 pages dont Jippes dessine les deux premières planches. Parmi les raisons de l’échec, Hartog van Banda évoque le refus d’Uderzo que les deux Néerlandais signent leur récit[24]. Le projet tombe à l’eau, de même que le magazine.
Cette initiative sans suite débouche en revanche sur une collaboration active de Lo Hartog van Banda aux scénarios de Lucky Luke. Motivé par l’idée de reprendre une série francophone, il contacte Morris et lui reproche la piètre qualité de son dernier album. Le dessinateur, qui travaille depuis longtemps pour Pep, se montre logiquement ouvert à la participation d’auteurs néerlandais. Outre l’expérience Albers, il a déjà demandé en 1980 à Martin Lodewijk de scénariser une histoire courte, Règlement de comptes. Fingers, premier scénario de Hartog van Banda pour Lucky Luke, obtient un large succès public et critique. Deux autres titres suivront dans les années 1990, avec un résultat moins convaincant. Plus tard encore, entre 2005 et 2012, Martin Lodewijk s’inscrira dans l’héritage de Willy Vandersteen en scénarisant les albums de De Rode Ridder pour Claus Scholz.
Le cas de Henk Albers est plus tragique : alors qu’il a cru sa réussite assurée en dessinant des aventures parodiques de Lucky Luke pour Dargaud, la veine s’est vite tarie, compliquée par les délais brefs et les scénarios livrés au dernier moment par Delporte. Albers s’épuise dans de nombreux trajets sur Paris, et finalement s’y perd, esthétiquement et physiquement. Les histoires du magazine Lucky Luke ne valent pas celles de Pep. Un recueil, préfacé par Morris, rassemble en 1980 les chroniques de De wereld van Lucky Luke, mais l’essentiel est derrière lui. Le projet de strip, dont seules trois bandes sont dessinées, ne semble plus sérieux à grand monde[25]. Henk Albers meurt en 1987, laissant inabouti un second volume de De wereld van Lucky Luke. Son style de vie extravagant continue de faire parler dans la bande dessinée néerlandaise, faisant de lui, selon le site Lambiek, une légende[26].
En France, en revanche, la tiédeur de l’accueil s’accompagne d’une méconnaissance flagrante des auteurs. La publication des Lucky Luke de Lo Hartog van Banda ne donne pas lieu à une présentation du scénariste, chose exceptionnelle dans l’histoire de la série, au point que certains journalistes se demandent s’il s’agit d’un pseudonyme ou affirment que Dargaud ne le connaît pas[27]. Encore aujourd’hui, sur le site de référence qu’est BDoubliées, Gideon et Brugman sont indexés comme deux personnes différentes dans la base de données du journal Spirou. Un regard rapide sur le Wikipédia francophone permet de constater que la notice d’Agent 327 est de 568 caractères seulement, celle d’Hartog van Banda de 498, celle de Pep de 275. La notice de Lodewijk, elle, est traduite depuis la page anglophone[28]. Si certaines séries continuent d’exister sous la forme d’albums français, c’est essentiellement le fait d’éditeurs très spécialisés, voire militants : ainsi de Franka, abandonnée par Dupuis après trois albums et reprise par Les Humanoïdes Associés après trois autres, aujourd’hui rééditée par BDMust. Des 20 albums d’Agent 327 aux Pays‑Bas, aucun n’a encore été traduit en français.
Face au bilan économique mitigé, les auteurs néerlandais vont souvent rapidement changer de voie, d’autant plus qu’en 1974, la nouvelle formule de Pep a réduit les bandes locales. Dick Matena, en 1977, opte pour un style réaliste. C’est à la faveur de ses albums parus chez Métal Hurlant qu’il est le seul Néerlandais retenu, en 1987, dans le collectif Art et innovation dans la BD européenne. Daan Jippes, dès 1972, s’est mis à travailler pour Disney. C’est cette partie de sa production qui suscitera le plus de commentaires, et sa propre série, Havank, traduite par Glénat en 2008 et 2010, sera publiée sous le pseudonyme de Danier. Comble de l’ironie, la collection française s’appellera « Paris‑Bruxelles ».
Il est délicat de distinguer une raison unique à cet échec. Parmi les causes invoquées, on peut citer la faiblesse économique de l’édition néerlandaise. Même aux Pays‑Bas, les albums issus de Pep n’ont dans l’ensemble pas été de grands succès de librairie, un regret que Dick Matena explique en accusant ses éditeurs de ne pas avoir assez investi dans la génération montante, y compris commercialement[29]. Peter Middeldorp reconnaît sur ce point que les droits d’auteur ont toujours été inférieurs à ce qu’ils étaient en Belgique[30]. Il est aussi possible que les références au contexte néerlandais aient agi comme un frein : c’est du moins ce qui a pu être donné comme explication à l’interruption de Franka. Soulignons par exemple que le vrai nom de l’Agent 327, Hendrik IJzerbroot, est une allusion à deux figures historiques néerlandaises, Hendrik Koekoek et Bernardus IJzerdraat. Mais on peut également se demander si la création de Pep ne souffrait pas d’emblée d’un décalage chronologique avec son modèle : les timides tentatives de republication en France et en Belgique arrivent en moyenne dix ans après le « phénomène Astérix », au moment où la scène culturelle est occupée par un discours créatif plus singulier et la revendication d’une bande dessinée adulte, voire intellectuelle.
Le contraste est frappant entre l’échec des auteurs issus de Pep et le succès contemporain d’un Joost Swarte. En 1980, Les Humanoïdes Associés publient L’Art moderne et Futuropolis un volume à son nom dans la collection « 30/40 », inaugurant l’essor de Swarte comme artiste de référence en France dans la décennie suivante. On peut aussi évoquer le sort de deux auteurs issus du mouvement contestataire Provo au milieu des années 1960 : Willem et Theo van den Boogaard. Willem, qui s’installe en France en 1968, sera en 2013 le premier Néerlandais à se voir décerner le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Quant à Léon van Oukel s’en tire toujours, première compilation française en 1980 de Sjef van Oekel, série dessinée par Theo van den Boogaard sur un scénario de Wim T. Schippers, elle fera partie des ouvrages sélectionnés pour les rééditions populaires au Livre de Poche en 1987.
Notons pourtant qu’il s’agit essentiellement de parcours individuels : les autres auteurs du courant underground néerlandais, qui atteint les lecteurs francophones en même temps que la vague issue de Pep, ne semblent pas obtenir durablement un écho plus favorable[31]. Encore faut‑il souligner, d’une part, que ceux‑ci n’ont pas la même visée populaire que leurs compatriotes plus classiques et, d’autre part, que la critique contemporaine a intégré leurs travaux dans sa réflexion. Le projet de Tante Leny présente semble alors en phase avec la redécouverte française de la ligne claire, poussant Bruno Lecigne à y consacrer un chapitre des Héritiers d’Hergé, tout comme les éditions émergentes Artefact trouvent en lui le sujet de leurs premiers livres. Swarte incarne alors une vague européenne à la fertilité esthétique indéniable, alors que Lodewijk ou Jippes doivent se résigner à un isolement culturel.
Il serait facile de voir dans l’échec des auteurs de Pep la marque du sens de l’Histoire. Le lent évincement de la bande dessinée classique par d’autres formes narratives plus ouvertement adultes était déjà entamé, et le renouveau de la bande dessinée jeunesse ne devait arriver qu’autrement, et plus tard. Cet échec souligne sans doute aussi le lien substantiel entre une forme et son circuit économique. Trop isolées, trop éloignées de l’album, les bandes de Pep ne pouvaient pas investir le marché francophone comme l’avaient fait leurs aînées françaises et belges. Pourtant, pour les bandes prises en exemple, pour Astérix, pour Lucky Luke, ce moment néerlandais constitue aussi un palier vers une internationalisation reconnue. L’aventure allemande de Super As, en 1979‑1980, caressera comme Pep l’espoir de sortir la bande dessinée franco‑belge classique de son cadre national et de la diffuser en s’appuyant sur les pays frontaliers. La popularité de ces personnages au centre de l’Europe va indéniablement peser dans leur transformation en icônes, vedettes de parcs d’attractions ou héros de longs métrages en production internationale. Enfin, même si, économiquement, l’aventure trouve ses limites, Daan Jippes et ses camarades se sont taillé une solide réputation auprès de leurs pairs. Leur travail mérite encore d’être mis à l’honneur.
Parties annexes
Note biographique
Michaël Baril et Clément Lemoine ont surtout publié en dehors des structures universitaires. Ils ont notamment participé à de nombreux ouvrages collectifs de la microstructure d’édition Onapratut, qu’ils ont longtemps coanimée. Leurs travaux, qu’il s’agisse de scénarios ou de dessins, sont généralement tournés vers la question du patrimoine de la bande dessinée et sa réinvention. Du côté de la critique, la plus grande partie de leurs recherches communes a consisté à étudier la bande dessinée franco-belge de la deuxième moitié du xxe siècle, et notamment la série Lucky Luke. Leurs textes sont parus ensemble ou séparément dans des publications allant du sérieux au trivial (Neuvième Art, Papiers Nickelés, Marsam, Presses universitaires de Liège, deux livres sur René Goscinny aux éditions La Déviation). N’étant pas néerlandophones, ils ont été surpris de découvrir la vivacité de cette scène voisine et les liens avec un pan de l’Histoire mieux connu.
Notes
-
[1]
François Clauteaux, « “Pilote” a fait jouer toute la France », Pilote, n° 2, 5 novembre 1959, p. 2.
-
[2]
On peut même ajouter à cette liste, quoique les liens éditoriaux soient plus délicats à établir, les premières années des Weekly Shonen Sunday et Weekly Shonen Magazine apparus en 1959 au Japon.
-
[3]
Arend, publié par le Bureau Jeugdblad Arend‑Wageningen entre 1955 et 1966, ne comprend que des bandes étrangères, dont Dan Dare de Frank Hampson.
-
[4]
Ger Apeldoorn, De jaren Pep, Oosterhout, Don Lawrence Collection, 2014.
-
[5]
« Ça ne s’apprend pas, on sait intuitivement ce que les Néerlandais vont apprécier ou non. C’est difficile pour un Néerlandais de comprendre ce qu’aiment les lecteurs francophones. Et au sein de l’équipe éditoriale de Spirou/Robbedoes, Robbedoes a une importance négligeable » [nous traduisons]; Hans van den Boom, avec la collaboration de Martin Wassington, « De Haarlemse stripbladen, een gesprek met Peter Middeldorp », Stripschrift, n° 104, 1977, p. 18.
-
[6]
Freddy Milton, « Interview med Daan Jippes », Carl Barks & Co, n° 8, 1977.
-
[7]
Jeroen Mirck, « Tien voor thee? », Stripschrift, n° 338, septembre 2001.
-
[8]
« Je lui disais qu’il devait être la figure de proue de la bande dessinée néerlandaise. Le Franquin ou le Hergé néerlandais. S’il s’était retroussé les manches, les Pays‑Bas auraient pu devenir l’un des grands pays de la bande dessinée à l’époque » [nous traduisons]; Jeroen Mirck, « Tien voor thee? », Stripschrift, n° 338, septembre 2001.
-
[9]
Émulation réciproque qui s’accompagnait, semble‑t‑il, d’une certaine rivalité : une anecdote rapportée par Ger Apeldoorn prétend que la femme de Julsing interceptait les exemplaires de Pep envoyés à son mari et collait entre elles les pages de Twee voor thee, afin de lui en épargner la vue. Ger Apeldoorn, De jaren Pep, Oosterhout, Don Lawrence Collection, 2014, p. 65.
-
[10]
Voir à ce sujet notre article « Cours, Lucky Luke, le vieux monde est derrière toi », NeuvièmeArt2.0, mai 2018, https://www.citebd.org/neuvieme-art/cours-lucky-luke-le-vieux-monde-est-derriere-toi.
-
[11]
« Je voudrais aller vers le style de Hors‑la‑loi. Je pense que c’est un chef d’oeuvre incomparable. […] Goscinny a écrit des histoires fantastiques, mais ces derniers temps, c’était plus un western parisien qu’un vrai western. Les derniers Astérix souffraient de ce même quelque chose » [nous traduisons]; Rob van Eijck et Martijn Daalder, Stripschrift, n° 139/140, 1980, p. 19.
-
[12]
« Je m’attendais à ce que le marché européen du magazine hebdomadaire passe des Belges aux Hollandais » [nous traduisons]; Jan de Rooij, « Dick Matena : elke tekenaar wil applaus », Pep, n° 15, 12 avril 1974, p. 26‑27. Peter Middeldorp évoquera son ambition dans des termes proches : « Ik zag het ook wel een beetje als “kan het in België dan moet het hier toch ook kunnen”. » « On se disait que si c’était possible en Belgique, ça devait l’être ici aussi » [nous traduisons]; Hans van den Boom, avec la collaboration de Martin Wassington, « De Haarlemse stripbladen, een gesprek met Peter Middeldorp », Stripschrift, n° 104, 1977, p. 18.
-
[13]
Ger Apeldoorn, De jaren Pep, Oosterhout, Don Lawrence Collection, 2014.
-
[14]
Denis Coulon et Alain de Kuyssche, Dino Attanasio 60 ans de BD, Bruxelles, Miklo, 2006.
-
[15]
Maurice Rosy, José‑Louis Bocquet et Martin Zeller, Rosy c’est la vie, conversation avec Maurice Rosy, Charleroi, Dupuis, 2014, p. 205.
-
[16]
« C’était aussi Cauvin qui signait les scénarii mais nous n’avions pas le droit de le dire, par rapport à son contrat »; interview de Berck par Stéphane Lucien, Hop!, n° 123, 2009, p. 8.
-
[17]
« Je crois que j’ai inspiré Berck et Cauvin, les auteurs de Sammy, un personnage très similaire qui a acquis une plus grande popularité » [nous traduisons]; interview de Dino Attanasio par Bepi Vigna au CBBD, 1997, http://aproposdebobmorane.net/viewtopic.php?t=4786.
-
[18]
Le personnage, authentique, de Ma Barker est également l’objet d’un film de Roger Corman, Bloody Mama, sorti la même année que De Barker‑bende.
-
[19]
« Je me rappelle en particulier son album sur Ma Barker, et le début est exactement dans le style de Calamity Jane » [nous traduisons]; Martin Wassington et Rob van Eijck, « Morris : “Strip is essentieel een visueel medium : de tekst is bijkomstig” », Stripschrift, n° 119, mars 1979, p. 9.
-
[20]
Propos de Turk dans Turk & de Groot, Léonard, 20 ans de génie, Appro, 1994, p. 38.
-
[21]
Propos de de Groot dans Turk & de Groot, Léonard, 20 ans de génie, Appro, 1994, p. 38.
-
[22]
Les parutions dans Eppo précèdent de quelques semaines ou quelques mois la sortie des albums : mars et avril 1980 pour Le Grand Fossé, juillet et octobre 1981 pour L’Odyssée d’Astérix, juillet et octobre 1983 pour Le Fils d’Astérix, septembre et octobre 1987 pour Astérix chez Rahazade. Les épisodes ne sont pas prépubliés en France. « De stripverhalen van Asterix verschenen in alle stripbladen », Comicweb, s. d., http://www.comicweb.nl/zzstripbladen/alle+stripbladenseries-Asterix.html (2 septembre 2022), et « Astérix », Bédéthèque, s. d., https://www.bedetheque.com/serie-59-BD-Asterix.html (2 septembre 2022).
-
[23]
Joakim Gunnarsson, « Asterix by Jippes », Sekvenskonst (Sequential Art), 15 juin 2008, http://sekvenskonst.blogspot.com/2008/06/asterix-by-jippes.html (2 septembre 2022).
-
[24]
« De man die sneller schrijft dan z’n schaduw », Eppo Wordt Vervolgd, n° 13, 27 mars 1987, p. 22‑23.
-
[25]
« Il m’a aussi proposé de faire un strip quotidien avec Lucky Luke, mais rien n’en est sorti » [nous traduisons]; Martin Wassington et Rob van Eijck, « Morris : “Strip is essentieel een visueel medium : de tekst is bijkomstig” », Stripschrift, n° 119, mars 1979, p. 9.
-
[26]
En 1998, Peter Pontiac et Typex publient The Quick Brown Fax, une correspondance par fax entre membres de la Henk Albers Society.
-
[27]
« Plusieurs scénaristes dont Lo Hartog van Banda (pseudonyme?) », L’essentiel pour pouvoir parler B.D, t. 1, Paris, L’Instant, 1985. « Totalement inconnu dans le petit monde de la BD francophone (et semble‑t‑il dans les bureaux de son éditeur parisien!) mais connu, affirme‑t‑on, dans sa Hollande natale »; Robert Netz, « Les héros par la bande. Lucky Luke », 24 heures, 10 septembre 1983.
-
[28]
Sans compter les sources en annexe et les encadrés. Pages consultées le 6 février 2023.
-
[29]
Jan de Rooij, « Dick Matena : elke tekenaar wil applaus », Pep, n° 15, 12 avril 1974, p. 26‑27.
-
[30]
Hans van den Boom, avec la collaboration de Martin Wassington, « De Haarlemse stripbladen, een gesprek met Peter Middeldorp », Stripschrift, n° 104, 1977.
-
[31]
Si deux anthologies de Tante Leny présente! paraissent chez Artefact en 1977 et 1979, Peter Pontiac, Marc Smeets et Evert Geradts restent ensuite relativement peu visibles sur la scène éditoriale française. En 1985, Jean‑Pierre Mercier exprime ses regrets à Thierry Groensteen de voir les auteurs néerlandais, à l’exception de Swarte, se tourner vers l’édition jeunesse faute de circuit de distribution approprié. « On peut dire que la bande dessinée hollandaise a fait marche arrière depuis quelques années. Hormis Swarte – qui est surtout connu sur le marché français – tous les anciens de l’underground ne font plus que de la BD pour enfants »; Thierry Groensteen, « L’édition selon Artefact, conversation avec Jean‑Pierre Mercier », Les cahiers de la bande dessinée, n° 64, juillet‑août 1985, p. 44‑46.
Bibliographie
- Échanges des auteurs avec Martin Lodewijk par courrier électronique, juillet 2017.
- Échanges des auteurs avec Rolf Hartog van Banda par courrier électronique, septembre 2017.
- Échanges des auteurs avec Ger Apeldoorn sur Facebook, novembre-décembre 2020.
- Pep, 1962-1975.
- Manon Albers, Henk Albers, een leven, s. l., s. é., 2007.
- « Alfred Mazure (1914-1974) », dans Maz, Jiu-Jitsu, une enquête de Dick Bos, Bruxelles, La Crypte Tonique, 2019.
- Ger Apeldoorn, De jaren Pep, Oosterhout, Don Lawrence Collection, 2014.
- Piet Bakker, De Pep Site, s. d., http://www.depepsite.nl/.
- Bédéthèque, s. d., https://www.bedetheque.com/.
- Alain Beyrand, « Marten Toonder et M. Bommel », Pressibus, première version en janvier 1997, http://www.pressibus.org/bd/toonder/indexfr.html.
- Bernard Coulange, BDoubliées, s.d., https://bdoubliees.com/.
- « Dutch comic history », Lambiek, s. d., https://www.lambiek.net/dutchcomics/index.htm.
- Lambiek Comiclopedia, s. d., https://www.lambiek.net/comiclopedia.html.
- Gert Meesters, « La presse néerlandophone », dans Christelle Pissavy-Yvernault et David Amram (dir.), La véritable histoire des éditions Dupuis, Marcinelle, Dupuis, 2023.
- PEWS, dernière modification le 28 septembre 2022, https://mmoree.home.xs4all.nl/index.html.
- René Smulders, Mat Schifferstein et Fred Wald, « Grenoble, radiographie du marché hollandais », Les cahiers de la bande dessinée, n° 62, mars-avril 1985, Glénat, p. 43-45.