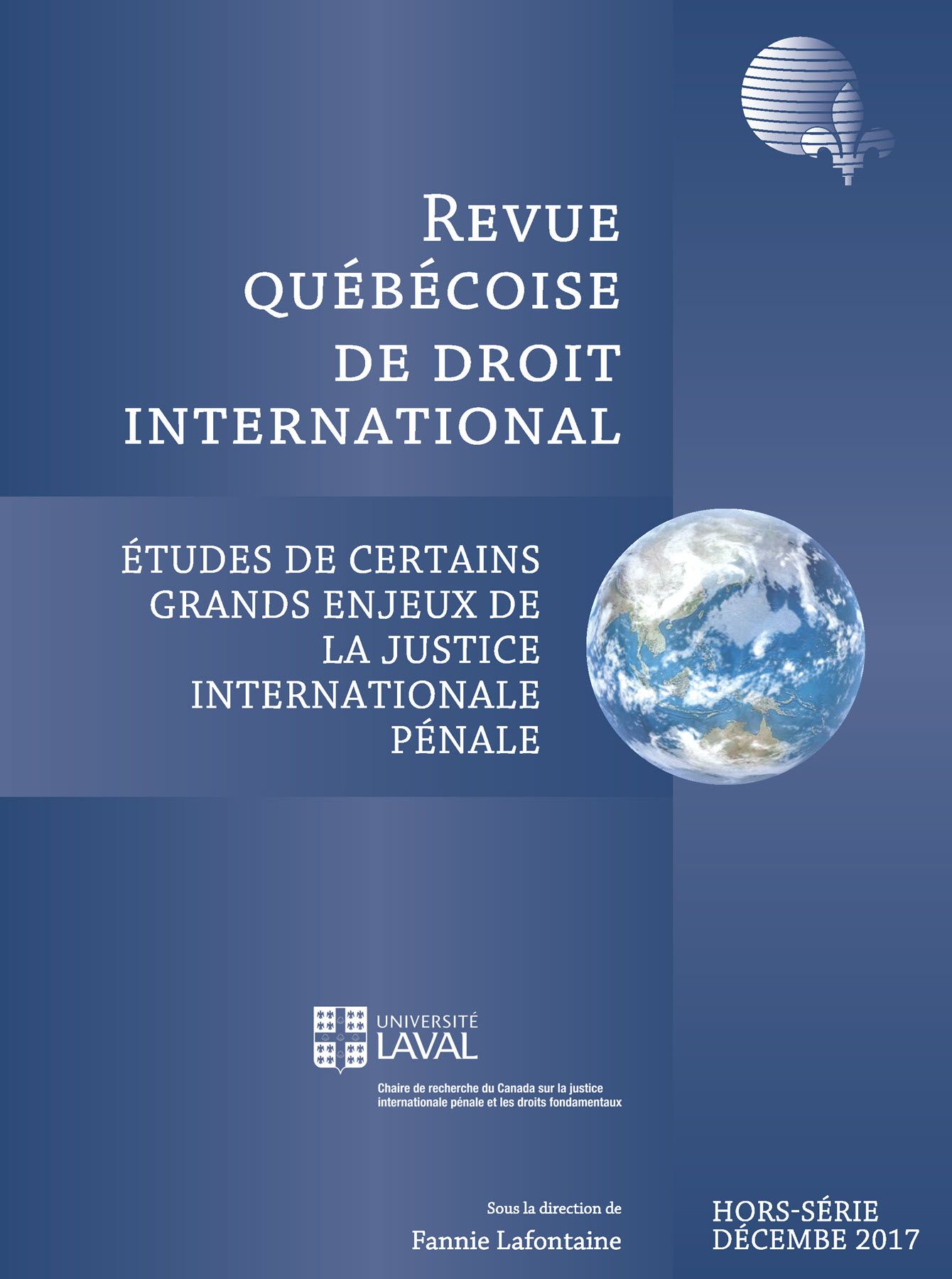Résumés
Résumé
Le présent article jette un regard critique sur le jugement de la Cour pénale internationale appliquant à M. Bemba, un ancien rebelle congolais, la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques. En analysant la nature de cette forme de responsabilité ainsi que ses conditions d’application, l’article démontre, dans un premier temps, qu’il existe un lien entre la connaissance (antérieure ou postérieure) qu’avait le supérieur hiérarchique sur la conduite criminelle de ses forces et les mesures (préventives ou répressives) nécessaires et raisonnables qu’il aurait dû prendre. Par rapport précisément à ces mesures, l’article démontre, dans un second temps, que si la qualité de rebelle n’a aucune incidence sur l’obligation de prendre les mesures préventives dès lors que le rebelle savait que les crimes vont être commis par ses soldats, il en est autrement des mesures répressives concernant les crimes déjà commis et dont le rebelle n’a eu la connaissance qu’après coup, puisque le Statut de Rome doit être interprété dans le respect des droits de l’homme internationalement reconnus. La critique principale formulée à l’encontre de ce jugement réside ainsi dans les incertitudes qu’il a apportées à ces deux problématiques qui semblent marquer la limite de la responsabilité des supérieurs lorsqu’il s’agit des rebelles.
Abstract
This article takes a critical look at the Bemba judgment in which the International Criminal Court applied the criminal responsibility of superiors to Mr. Bemba, a former Congolese rebel leader. By analyzing the nature of this form of responsibility and its conditions of application, the article first demonstrates that there is a link between the knowledge (prior or posterior) that the superior had on the criminal conduct of his/her forces and the necessary and reasonable measures (preventive or repressive) that he/she should have taken. In relation to these measures, the article goes on to show, secondly, that if the status of rebel does not affect the ability of a rebel to take preventive measures when he/she knew that the crimes would be committed by his/her forces, this is not the case when it comes to repressive measures concerning crimes already committed and of which he/she knew that they were already been committed, since the interpretation of the Rome Statute must be consistent with internationally recognized human rights. Finally, the main criticism that can be made against this judgment is about the uncertainty it has brought to these two issues, which seem to mark the limit of the criminal responsibility of superiors when it comes to the rebels.
Resumen
El artículo presente articulo pone una mirada crítica sobre el juicio de la CPI que aplica sobre Sr. Bemba, un antiguo rebelde congolés, la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos. Analizando la naturaleza de esta forma de responsabilidad así como sus condiciones de aplicación, el artículo demuestra, primeramente, que existe un lazo entra el conocimiento (anterior o posterior) que tenía el superior jerárquico sobre la conducta criminal de sus fuerzas y las medidas (preventivas o represivas) necesarias y razonables que habría debido tomar. Con relación precisamente a estas medidas, el artículo demuestra, en segundo lugar, que si la calidad de rebelde no tiene ninguna incidencia sobre la obligación de tomar las medidas preventivas desde que el rebelde sabía que los crímenes van a ser cometidos por sus soldados, hay de allí de otro modo unas medidas represivas que conciernen a los crímenes ya cometidos y cuyo conocimiento el rebelde tuvo sólo fuera de tiempo, ya que el Estatuto de Roma debe ser interpretado en el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La crítica principal formulada en contra de este juicio reside así en las incertidumbres que aportó a estas dos problemáticas que parecen marcar el límite de la responsabilidad de los superiores cuando se trata de unos rebeldes.
Corps de l’article
Un grain de maïs a toujours tort devant la poule.
Proverbe africain
Jean-Pierre Bemba Gombo est un sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC) entre 2003 et 2006. Il est surtout le fondateur et président du Mouvement de libération du Congo (MLC), un mouvement rebelle congolais créé au nord-est de la RDC en 1998 et devenu parti politique en 2003. En 2002, pendant qu’il était président du MLC, Bemba a décidé d’envoyer ses soldats en République centrafricaine (RCA) pour prêter main-forte au président centrafricain Ange-Félix Patassé, menacé par une rébellion dirigée par François Bozizé, laquelle rébellion a fini par le chasser du pouvoir. Comme cela arrive souvent lorsqu’on envoie ses forces à l’étranger, les soldats du MLC ont été suspectés d’avoir perpétré de graves exactions contre les populations civiles centrafricaines. Arrêté à Bruxelles depuis le 24 mai 2008 en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI), Bemba a finalement été déclaré coupable, en tant que « personne ayant agi effectivement comme un chef militaire » en vertu de l’article 28(a) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome[1]), des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, par la Chambre de première instance III de la CPI (Chambre III) dans un jugement rendu le 21 mars 2016[2]. Le 21 juin 2016, la même Chambre, après avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances de commission des crimes et de la personnalité de Bemba, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement[3].
Le jugement ainsi rendu était très attendu tant par les 5 229 victimes centrafricaines autorisées à participer à la procédure, que par les nombreux sympathisants congolais de Bemba, puisque le parti politique de ce dernier reste très actif dans la scène politique congolaise malgré l’incarcération de son leader à La Haye. D’autre part, ce jugement est tombé à une période de fortes tensions politiques en RDC où certains Congolais suspectaient le président Joseph Kabila de vouloir s’éterniser au pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Bemba, qui était le principal rival de Joseph Kabila lors de l’élection présidentielle de 2006 et qui n’a pas pu se représenter à l’élection présidentielle de 2011 en raison de sa détention par la CPI, était alors perçu, à tort ou à raison, comme un contrepoids efficace contre la pérennisation au pouvoir du président Kabila. Sa condamnation par la CPI a eu comme effet de renforcer politiquement le régime du président Kabila et, d’une certaine façon, d’affaiblir l’opposition politique contre ce dernier.
Cependant, au-delà des attentes des uns et des autres par rapport au résultat et aux conséquences politiques de ce verdict, le raisonnement développé par la Chambre III dans ce jugement soulève d’importantes questions relatives d’un côté, à la définition des crimes de droit international, et tout particulièrement les crimes contre l’humanité et, de l’autre côté, aux conditions de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques militaires (command responsibility), et plus spécifiquement, lorsque ceux-ci sont issus des groupes rebelles. Dans le présent article toutefois, nous n’aborderons pas ces deux questions de manière égale. L’espace limité pour cet article oblige à s’atteler beaucoup plus aux conditions de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et à n’aborder que de façon sommaire les questions portant sur la définition des crimes contre l’humanité. Nous commencerons ainsi par l’analyse faite par la Chambre III au sujet de la nature juridique de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques (I) et nous verrons ensuite la manière dont ladite Chambre III a interprété les conditions de cette forme de responsabilité (II). Notons enfin que l’objectif de cette étude n’est pas de prendre la défense de l’une ou l’autre partie au procès, mais de voir dans quelle mesure le jugement a contribué à la clarification des normes et concepts juridiques ; et que l’analyse du jugement sous examen se fera en parallèle avec les constatations faites par la Chambre préliminaire II de la CPI (Chambre II) et reproduites dans la décision du 15 juin 2009 relative à la confirmation des charges dans la même affaire (décision Bemba[4]), décision commentée dans une précédente étude[5].
I. Nature juridique de la command responsibility : une forme de responsabilité sui generis?
La formulation de l’article 28 du Statut de Rome, qui consacre la command responsibility, invite à se positionner par rapport à ces trois alternatives : s’agit-il (i) d’un crime autonome fondé sur une omission, (ii) d’une forme de participation à la commission d’un crime, ou encore (iii) d’une responsabilité pénale pour fait d’autrui?
La Chambre III pour sa part a observé que l’article 28 du Statut de Rome prévoit une forme de responsabilité par laquelle un supérieur hiérarchique peut être tenu pénalement responsable pour les crimes commis par les forces placées sous son commandement et contrôle. Tout en soulignant le mot « pour », la Chambre III a précisé que cette forme de responsabilité est différente de celle d’une personne qui « commet » un tel crime; et qu'une telle distinction découle des termes employés par l’article 28 du Statut de Rome[6] lui-même où, selon la Chambre III, les crimes pour lesquels le supérieur hiérarchique est tenu responsable sont ceux qui ont été commis par ses subordonnés et non par le supérieur lui-même directement[7].
En présentant ainsi son raisonnement, la Chambre III a écarté la thèse d’un crime à part entière, et a consacré celle d’une forme de participation à la commission d’un crime. Par ce même raisonnement, la Chambre III a aussi implicitement écarté la thèse d’une responsabilité pénale pour omission, en tout cas, telle qu’elle a été présentée par certains auteurs[8] et certaines juridictions internationales. Il découle par exemple de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) que la command responsibility est une « responsabilité pour omission[9] »; et que « cette omission est coupable, car le droit international fait obligation aux supérieurs hiérarchiques d’empêcher leurs subordonnés de commettre des crimes ou de les en punir[10] ». Cette même approche est également consacrée en 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kononov c Lettonie où cette Cour a vu « dans le principe de la responsabilité individuelle des commandants, un mode de responsabilité pénale qui permet de sanctionner un supérieur ayant manqué à son devoir d’exercer son autorité et non un mode de responsabilité reposant sur le fait d’autrui[11] ». Dans ces approches en effet, l’omission du supérieur hiérarchique à contrôler ses subordonnés est présentée comme un crime autonome.
La Chambre III ayant ainsi écarté la première alternative, il lui restait de trancher entre les deux alternatives restantes : la command responsibility est-elle une forme de complicité, ce qui suppose une certaine contribution du supérieur hiérarchique dans la commission de ces crimes, ou une forme de responsabilité pénale pour fait d’autrui, la culpabilité du supérieur hiérarchique pouvant être retenue même en l’absence de toute contribution de sa part?
Pour répondre à cette question, la Chambre III a commencé par expliquer l’objectif visé par l’institution de cette forme de responsabilité en rappelant que cette dernière vise le renforcement du respect des règles du droit international humanitaire et, par conséquent, la protection des personnes et des biens dans les conflits armés. Elle a ensuite soutenu que, dans le Statut de Rome, cette forme de responsabilité est présentée comme une forme différente de celles qui sont prévues à l’article 25 du Statut de Rome[12], tout en étant liée aux crimes commis par les subordonnés. Sur cette base, elle a estimé que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques est sui generis[13].
En argumentant ainsi sa position, la Chambre III ne tranche pas clairement entre les deux alternatives précitées. Certains passages du jugement semblent toutefois trahir le fait que derrière la thèse d’une responsabilité sui generis, se cache en réalité celle d’une responsabilité pour fait d’autrui (sans faute). Ainsi, la Chambre III a déclaré que pour établir l’une des exigences contextuelles des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, à savoir la connaissance d’une attaque lancée contre une population civile ou celle de l’existence d’un conflit armé, le procureur était tenu de prouver uniquement que l’auteur direct de l’acte, et non le supérieur hiérarchique poursuivi, avait connaissance de l’existence d’une telle attaque ou du conflit armé[14]. À suivre un tel raisonnement, un supérieur hiérarchique pourrait être tenu pénalement responsable des crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, même s’il ignorait l’existence d’une attaque lancée par ses subordonnés contre une population civile ou l’existence d’un conflit armé dans lequel ses subordonnés étaient impliqués.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons craindre que l’invocation de la nature sui generis de la command responsibility soit un prétexte pour ne pas clarifier davantage la nature de cette forme de responsabilité, pour justifier l’extension abusive de son champ d’application et pour l’appliquer à un accusé même en l’absence d’un lien entre son inaction et la perpétration des crimes par ses subordonnés. Comme l’écrit le professeur de la Faculté de droit de la Queen’s University, Darryl Robinson,
[The] problem with placing command responsibility in an ill-defined twilight world between mode of liability and separate offence is that it enables a kind of ‘shell game’. The ambiguity allows the ‘mode’ nature of command responsibility to be downplayed when the culpability principle is being discussed, and then to shift back to a mode of liability just in time for conviction and sentencing. James Stewart has aptly described related arguments as ‘more of a smokescreen to ward off conceptual criticisms than a marked normative change’[15].
Dans la décision Bemba[16], la manière dont la Chambre III a interprété les conditions de cette forme de responsabilité, et tout particulièrement l’exigence de la connaissance du supérieur hiérarchique sur la conduite criminelle de ses subordonnés et du lien entre son inaction et la perpétration des crimes semble confirmer ces craintes.
II. Les conditions de la command responsibility : les pièces du puzzle
Pour établir la command responsibility en vertu de l’article 28(a) du Statut de Rome[17], la Chambre III a posé six conditions[18]. Dans les lignes qui suivent, nous analyserons l’interprétation faite par la Chambre III de chacune de ces conditions.
A. La perpétration de l’un des crimes prévus par le Statut de Rome
La commission de l’un des crimes prévus par le Statut de Rome[19] est la première condition de la command responsibility posée par la Chambre III. Elle se justifie par le fait que cette forme de responsabilité n’est pas prévue pour les crimes de droit commun[20]. La Chambre III l’a bien compris et c’est pourquoi elle l’a ajoutée aux cinq conditions précédemment énoncées dans la décision de confirmation des charges et lui a consacré de longs développements.
Il faut rappeler que, par rapport à cette condition, la Chambre III a conclu à l’existence des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité perpétrés par les soldats du MLC. Pour y arriver, elle a d’abord établi trois actes spécifiques ci-après : les meurtres, les viols et les pillages. Elle a ensuite essayé de les placer dans le contexte propre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Comme nous le verrons, c’est toutefois dans ces exigences contextuelles que l’argumentation de la Chambre III suscite certaines réserves.
1. Existence des crimes de guerre?
Par rapport aux crimes de guerre, la Chambre III a démontré que les meurtres, viols et pillages ont été commis dans le cadre d’un conflit armé non international, opposant d’un côté les forces armées centrafricaines (FACAs), auxquelles étaient alliées toute une série d’autres forces armées, y compris celles du MLC de Bemba, et de l’autre, le groupe armé organisé dirigé par le général-rebelle François Bozizé soutenu par les forces armées tchadiennes. La Chambre III a également démontré que ces trois actes spécifiques avaient un lien de connexité avec ledit conflit armé puisque les victimes étaient attaquées par les forces du MLC parce qu’elles étaient soupçonnées d’être des sympathisants du général Bozizé, alors qu’elles ne prenaient aucune part active aux hostilités.
De manière générale, cette argumentation est certes convaincante, mais n’appelle pas à beaucoup de commentaires. Notons toutefois que l’établissement du caractère organisé des parties au conflit présente certaines ambigüités. Nous observons, par exemple, que tout en reconnaissant que les parties au conflit centrafricain étaient d’un côté les FACAs auxquelles étaient alliées le MLC et, de l’autre, les rebelles de Bozizé, la Chambre III s’est curieusement attelée à démontrer le caractère organisé du MLC et de sa branche armée[21]. Pourtant, puisque les FACAs étaient la véritable partie dans ce conflit, l’organisation interne du MLC importait peu. C’était donc du côté des FACAs qu’il fallait rechercher le caractère organisé. D'ailleurs, celui-ci n’était pas difficile à établir puisqu’il s’agissait de l’armée gouvernementale. La démarche de la Chambre III donne finalement l’impression que le conflit armé opposait les soldats du MLC aux rebelles de Bozizé, alors qu’une telle image est trompeuse. De même du côté des rebelles de Bozizé, nous constatons que, pour établir leur caractère organisé, la Chambre III a procédé par une méthode inédite consistant à déduire un tel caractère à partir de l’étendue, de la gravité et de l’intensité des opérations militaires dans lesquelles ces rebelles étaient impliqués dans le conflit armé centrafricain[22]. Cette démarche est quelque peu discutable puisque la durée d’un conflit armé peut être due à d’autres facteurs propres au conflit, en particulier lorsqu’il y a des interventions extérieures dans ledit conflit armé, sans nécessairement être lié au caractère organisé de l’une des parties. En réalité, la Chambre III a suivi la tendance observée chez certaines juridictions congolaises qui, confrontées à ce type de question, se sont préoccupées beaucoup plus du caractère organisé de la partie belligérante à laquelle appartient l’accusé et ont négligé, pour ainsi dire, de procéder au même exercice par rapport à la partie contre laquelle l’accusé était opposé[23].
Quoi qu’il en soit, et mis à part ces quelques détails qui ne remettent pas en cause l’existence d’un véritable conflit armé de caractère non international dans le cadre duquel les crimes précités ont été commis, ni le lien de connexité entre les crimes établis et ledit conflit armé, nous pouvons affirmer que la qualification des crimes de guerre est globalement convaincante.
2. Existence des crimes contre l’humanité?
Si la qualification des crimes de guerre ne pose pas de problèmes majeurs, il en est autrement de celle des crimes contre l’humanité. En effet, sur cette question, notons que la Chambre III elle-même a reconnu que pour établir cette qualification, il faut démontrer au moins l’existence d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile (i) et l’élément politique propre aux crimes contre l’humanité (ii).
En commençant par le caractère généralisé ou systématique de l’attaque, il apparaît que la Chambre III s’est gardée d’établir le caractère systématique de l’attaque et qu’elle n’a analysé que le caractère généralisé de celle-ci estimant à juste titre qu’elle n’était pas tenue d’établir les deux caractères en même temps puisque ces éléments sont alternatifs[24].
Cependant, par rapport au caractère généralisé d’une attaque, la Chambre III a rappelé qu’une attaque généralisée tient au nombre des victimes et à l’étendue géographique couverte par les attaques[25] et non uniquement à sa durée totale[26]. Jusqu’ici la Chambre III reste en accord avec la jurisprudence et la doctrine sur cette question. Le problème se pose plutôt dans la manière dont elle a appliqué ce cadre juridique aux faits et tout particulièrement sur le sens à donner à l’exigence des nombreuses victimes.
Par rapport à cette question, nous constatons que la Chambre III ne s’est pas fondée sur le nombre élevé de victimes autorisées à participer à la procédure, à savoir 5 229. D'ailleurs, la Chambre III n’explique pas comment elle est parvenue à un tel chiffre au regard du fait que (i) elle n’a établi, au-delà de tout doute raisonnable, que trois meurtres[27], vingt-huit viols, et vingt-et-un actes de pillage; que (ii) dans la plupart de cas, ces trois actes spécifiques ont porté sur les mêmes victimes, parfois inconnues[28]; et que (iii) la jurisprudence de la CPI est ferme sur la distinction entre les victimes d’une affaire et celles d’une situation de telle sorte que seules les victimes d’une affaire sont admises à participer au procès[29].
Pour démontrer que l’attaque imputée aux soldats du MLC a fait de nombreuses victimes, la Chambre III a procédé par une méthode inédite qui sort pratiquement du cadre auquel la jurisprudence et la doctrine se sont jusqu’ici référées : d’une part, elle a établi, au-delà de tout doute raisonnable, ces quelques actes criminels spécifiques[30]; et d’autre part, elle s’est dite convaincue que ces actes ne constituaient qu’une faible proportion d’un comportement criminel beaucoup plus large rapporté par des sources indirectes, à savoir les revues de presse, les rapports d’organisations non gouvernementales (ONGs), et surtout ceux de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et le procès-verbal d’audition des victimes soumis à la Cour d’appel de Bangui[31].
Pour soutenir cette méthode assez singulière d’établir l’existence des victimes nombreuses, la Chambre III a cité certaines jurisprudences des tribunaux pénaux internationaux qui, selon elle, permettent de se limiter à des « éléments de preuve invoquant de “nombreux” meurtres ou des “centaines” de meurtres sans donner de chiffre précis[32] ». Nous constatons toutefois que ces jurisprudences se rapportent à une situation différente concernant des massacres à grande échelle commis contre des centaines, voire des milliers de personnes, tuées au même endroit et au même moment, massacres rapportés par des témoins oculaires ayant survécu aux massacres par miracle[33]. Ces jurisprudences ne se rapportaient donc pas à des situations, où les juges s’étaient contentés d’établir deux ou trois meurtres à titre illustratif, pour se dire ensuite convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, que de nombreux meurtres, rapportés par des sources indirectes, ont effectivement été commis. La démarche de la Chambre III tend à confondre, à tort, la preuve par la déclaration d’un témoin direct qui affirme avoir assisté à des meurtres de masse ou avoir vu de nombreux cadavres sans être en mesure de donner un chiffre exact précisément parce qu’ils étaient très nombreux et la preuve par la production des revues de presse ou du rapport d’ONG qui rassemble les déclarations des personnes ayant perdu chacun, et de façon séparée, un proche dans le contexte d’un conflit armé. Comme nous pouvons le voir, le premier cas se rapporte à une source directe, tandis que le second se rapporte à des sources indirectes qui ne permettent pas d’établir un fait (attaque généralisée) au-delà de tout doute raisonnable.
La Chambre III elle-même ne semble pas avoir tenu compte de ces sources indirectes lors de la fixation de la peine. En effet, elle a condamné Bemba à une peine de seize ans d’emprisonnement pour les meurtres et à dix-huit ans pour les viols[34]. Pourtant, toutes les législations et plus particulièrement le Code pénal centrafricain[35] punissent le meurtre plus sévèrement que le viol. Si nous suivions le raisonnement de la Chambre III selon lequel les meurtres et les vols étaient nombreux et avaient été commis dans les mêmes circonstances, nous ne comprendrions pas pourquoi la Chambre III a puni les viols plus sévèrement que les meurtres. La différence de répression de ces deux actes spécifiques lors de la fixation de la peine ne peut s’expliquer que par le fait que la Chambre III a considéré que le nombre des victimes de meurtre, à savoir trois, était largement inférieur à celui des victimes de viol, à savoir vingt-huit. La Procureure de la CPI semble, elle aussi, avoir compris le jugement dans ce sens puisque dans sa déclaration à la suite du verdict de la condamnation de Bemba, elle a affirmé que « la campagne de terreur perpétrée par les troupes de M. Bemba en Centrafrique a été menée à grande échelle et a visé un grand nombre de civils [et qu'en l'espèce] il y a plus de viols que de meurtres[36] ».
Comme nous pouvons le constater, la méthode employée par la Chambre III conduit finalement à une confusion entre les actes spécifiques et l’attaque généralisée et donne un résultat tel que seuls les actes spécifiques sont établis au-delà de tout doute raisonnable, tandis que l’existence même d’une « attaque généralisée » ne l’est pas puisque pour établir cette dernière, la Chambre III a accordé un poids exagéré à des sources indirectes. Ces sources, si elles peuvent être retenues à la phase de confirmation des charges, ne peuvent, en principe, l’être pour établir une culpabilité au-delà de tout doute raisonnable à la phase du procès.
Certes, le jugement, et même la décision de confirmation des charges dans la décision Bemba, contiennent certains passages dans lesquels les Chambres II et III semblent théoriquement opérer une distinction entre les actes spécifiques et l’attaque et disent, à juste titre, que « seule l’attaque, et non pas les actes individuels de l’auteur, doit présenter un caractère généralisé et systématique[37] ». Cette position est convaincante puisque ces actes spécifiques, qui peuvent ne pas être nombreux, doivent avoir un lien de connexité avec l’attaque qui, elle, par contre, doit être généralisée ou systématique[38]. Sur ce point, la doctrine et la jurisprudence convergent parce que nul ne conteste qu’un seul acte puisse être qualifié de crime contre l’humanité dès lors qu’il présente un lien avec une attaque généralisée[39]. Le professeur Antonio Cassese relate, par exemple, le simple fait de dénoncer un voisin juif auprès des autorités nazies qui, dans le contexte de l’époque, a, à juste titre, été considéré comme un crime contre l’humanité[40]. Toutefois, dans une telle hypothèse, la distinction entre l’attaque généralisée et l’acte spécifique lié à une telle attaque ne doit pas être que théorique. Le problème du jugement Bemba[41] réside précisément dans la difficulté à percevoir concrètement une telle distinction puisque la Chambre III tente de démontrer le caractère soi-disant généralisé de l’attaque au travers des actes spécifiques, cités à titre illustratif, mais dont le caractère nombreux reste finalement douteux.
Le deuxième point de réserve quant à la pertinence de la qualification de crimes contre l’humanité porte sur l’établissement de l’élément politique propre à de tels crimes. Rappelons que cet élément est exigé par la formule « attaque lancée dans le but ou en application de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » figurant à l’article 7(2)a du Statut de Rome[42]. Comme l’ont expliqué la jurisprudence, la doctrine et les éléments des crimes de la CPI[43], cet élément exige de démontrer que les crimes ont été ordonnés ou encouragés par un État ou une organisation ayant pour but une telle attaque[44].
Dans le jugement Bemba[45], il apparaît que pour établir l’élément politique, la Chambre III a, ici encore, recouru à une méthode inédite qui sort du cadre auquel la jurisprudence et la doctrine se sont jusqu’ici référées. En effet, bien que la Chambre III ait invoqué plusieurs faits pour démontrer cet élément, nous constatons toutefois qu’elle s’est principalement fondée sur le fait que la hiérarchie du MLC avait, selon elle, implicitement encouragé essentiellement les pillages au cours desquels les meurtres et les viols ont été commis pour conclure à l’existence d’une politique au sein du MLC de prendre délibérément les civils pour cible de leur attaque.
Pourtant, cette démarche se heurte au fait que l’élément politique établi se rapporte à l’encouragement aux pillages et non aux meurtres ni aux viols. C’est en effet la Chambre III elle-même qui a déclaré que « the acts of murder and rape were regularly committed together, or during the course of, the commission of acts of pillaging against the civilian population[46] ». Or, si les meurtres et les viols figurent dans l’énumération de l’article 7(1) du Statut de Rome[47], tel n’est pas le cas des pillages sur lesquels le jugement s’est principalement fondé. Il faut rappeler à ce propos que la Chambre III elle-même avait déclaré que l’élément politique dans l’établissement des crimes contre l’humanité ne peut prendre en compte que les actes énumérés à l’article 7(1) du Statut de Rome[48].
Il apparaît ainsi que le problème suscité par la démarche de la Chambre III est qu’elle a tenté d’établir l’élément politique des crimes contre l’humanité en se fondant sur un éventuel encouragement des actes non listés à l’article 7(1) du Statut de Rome. Strictement parlant, cette démarche ne permet pas d’établir un encouragement, même implicite, aux meurtres et aux viols, puisque celui qui encourage les pillages n’encourage pas nécessairement les meurtres et les viols qui seraient commis dans le cadre des pillages. En effet, de même qu’« il y a une différence entre le discours haineux en général (ou l’incitation à la discrimination ou à la violence) et l’incitation directe et publique à commettre le génocide[49] », de même qu'il existe une distinction entre l’encouragement aux pillages et l’encouragement aux meurtres et aux viols qui seraient perpétrés lors de ces pillages. Une approche contraire serait un raisonnement par analogie interdit par l’article 22(2) du Statut de Rome[50]. En distinguant clairement l’encouragement aux pillages et l’encouragement aux meurtres et viols qui seraient commis lors de ces pillages, nous aboutissons finalement à un doute sur l’élément politique propre aux crimes contre l’humanité.
Sur la base de ce qui précède, nous pouvons légitimement douter de la pertinence de la qualification des crimes contre l’humanité et, par conséquent, ce doute entraîne celui de la pertinence du cumul de qualifications des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité pratiqué par la Chambre III sur les mêmes actes spécifiques.
Cela étant, même si nous écartons la qualification des crimes contre l’humanité, celle des crimes de guerre demeure puisque ces derniers n’exigent pas un caractère généralisé ni l’élément politique. Nous en arrivons ainsi à la conclusion selon laquelle, malgré quelques critiques qu’on puisse formuler contre l’argumentation de la Chambre III, la première condition de la command responsibility, à savoir la commission de l’un des crimes prévus dans le Statut de Rome a malgré tout été respectée puisqu’il y a tout au moins les crimes de guerre.
B. La qualité de chef militaire ou assimilé
L’article 28(a) du Statut de Rome[51], qui consacre la responsabilité des supérieurs hiérarchiques militaires, s’adresse au « chef militaire » et à la « personne faisant effectivement fonction de chef militaire ». Sur quoi repose la distinction entre ces deux statuts? Comme nous le verrons plus loin, cette distinction n’est pas sans intérêt lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité du supérieur à prendre des mesures répressives contre ses subordonnés.
Selon la Chambre III, la notion de « chef militaire » couvre deux types d'individus : (i) celui qui est désigné formellement et légalement pour exercer des fonctions de commandement militaire dans la mesure où les chefs militaires et leurs subordonnés font généralement partie des forces armées régulières d’un État et sont nommés et agissent conformément aux lois, procédures et pratiques internes de cet État; et (ii) les individus désignés comme tels dans des forces irrégulières non gouvernementales, conformément à leurs règlements et pratiques internes, qu’ils soient écrits ou non[52]. Quant à l’expression « personne faisant effectivement fonction de chef militaire », la Chambre III a conclu qu’elle renvoyait aux individus qui n’ont pas été désignés formellement ni légalement pour exercer des fonctions de commandement militaire, mais qui l’ont exercé effectivement à l’égard des personnes qui ont commis les crimes[53].
Il faut relever que cette approche s’écarte de celle de la décision de confirmation des charges. La Chambre II a quant à elle conclu que la notion de « chef militaire » renvoie aux personnes qui exercent une responsabilité de commandement au sein des forces armées régulières (chefs militaires de jure); tandis que celle de « personne agissant effectivement comme chef militaire » renvoie aux supérieurs hiérarchiques dont l’autorité et le contrôle s’exercent sur des forces étatiques régulières ou sur des forces irrégulières (non étatiques) comme les groupes rebelles ou des unités paramilitaires (chefs militaires de facto)[54]. La différence entre la décision précitée et le jugement réside précisément dans le fait que celui-ci inclut les supérieurs hiérarchiques issus des forces irrégulières et désignés conformément à l’organisation et à la pratique internes de telles forces dans la catégorie des « chefs militaires » et non dans celle des « personnes agissant effectivement comme un chef militaire ». En interprétant ainsi l’article 28(a) du Statut de Rome, la question qui se pose est celle de savoir dans quelle catégorie nous pouvons situer les rebelles, puisque, d’une certaine manière, Bemba pourrait relever de cette catégorie.
Dans le jugement Bemba, la Chambre III a pris en compte le fait que (i) l’article 12 du Statut du MLC conférait à Bemba de larges pouvoirs dans la direction militaire de l’Armée de libération du Congo (ALC) qui était la branche armée du MLC[55]; (ii) durant la période des faits, Bemba était le président du MLC et le commandant en chef de l’ALC avec le grade de général de brigade; et (iii) il détenait tous les moyens militaires, financiers, disciplinaires pour contrôler ses troupes[56]. Sur cette base, la Chambre III a toutefois conclu que Bemba relevait de la catégorie, non pas des « chefs militaires », mais de celle des « personnes ayant effectivement agi comme chef militaire » à l’égard de ceux qui ont commis les crimes en RCA[57]. Cette conclusion est surprenante puisque si nous appliquions les critères de distinction entre ces deux statuts, tels qu’ils ont été précédemment énoncés par la Chambre III, nous classerions logiquement Bemba dans la catégorie de « chef militaire », et non dans celle de « personne ayant agi effectivement comme chef militaire », puisque Bemba tient ses pouvoirs directement de l’organisation et des pratiques internes du MLC.
En réalité, les ambigüités de l’argumentation de la Chambre III s’expliquent par la difficulté à se positionner par rapport aux rebelles. En effet, si nous nous situions par rapport à l’organisation interne du groupe rebelle, les supérieurs hiérarchiques issus de tels groupes seraient des chefs militaires de jure. Tandis que si nous nous situions par rapport à l’organisation étatique, les rebelles seraient des supérieurs de facto, parce qu’ils ne sont pas reconnus au niveau étatique. Par ailleurs, même si nous semblons nous accorder sur le fait que la notion de supérieur hiérarchique couvre aussi bien les supérieurs de jure que les supérieurs de facto[58], il semble toutefois que derrière cette notion, nous voyions beaucoup plus les supérieurs non officiellement reconnus par le gouvernement, mais agissant pour le compte de celui-ci, comme les milices progouvernementales. Ceux qui ont invoqué cette notion n’avaient pas nécessairement en tête les rebelles.
Dans la décision Bemba, les choses se compliquent davantage puisque Bemba avait le statut de rebelle en RDC, alors qu’en RCA, ses forces combattaient pour le compte d’une armée gouvernementale. Ainsi, il est possible qu’en plaçant Bemba dans la catégorie de « personnes ayant effectivement agi comme chef militaire », c’est-à-dire les supérieurs de facto, et non dans celle de « chef militaire », les juges de la Chambre III aient favorisé la position de la RCA, où les crimes ont été commis, plutôt que celle de la RDC, où l’accusé résidait au moment des faits.
En tout état de cause, il semble plus approprié de classer les rebelles, comme l’a fait la décision de confirmation des charges, dans la catégorie de supérieurs de facto parce que c’est par rapport à l’ordre étatique qu’il faut se situer et non par rapport à l’organisation et la pratique internes du mouvement rebelle. Finalement, la conclusion de la Chambre III, consistant à considérer Bemba comme une personne ayant effectivement agi comme chef militaire » (chef militaire de facto) est valable, quand bien même les prémisses sont loin de l’être.
C. L’exercice d’un commandement et d’un contrôle effectifs
Bemba exerçait-il un commandement et un contrôle effectifs sur les auteurs des crimes en RCA? Le contrôle effectif, pour la Chambre III, renvoie à la capacité matérielle de prévenir ou de réprimer la commission des crimes ou de soumettre l’affaire à une autorité compétente pour enquête et poursuites et exclut le simple pouvoir d’influence, aussi substantiel soit-il[59]. Selon la Chambre III, un tel contrôle n’est pas exclu lorsque les forces sont mises à la disposition d’autres chefs militaires, puisque l’article 28 du Statut de Rome[60] n’exige pas qu’un chef militaire ait un contrôle exclusif sur les forces ayant commis les crimes. N'est ni exclu un contrôle effectif concurrent puisque plusieurs chefs militaires peuvent être tenus concurremment responsables des actions de leurs subordonnés. Enfin, déterminer l’existence d’un contrôle effectif qu’un chef militaire exerce sur les subordonnés est une question de fait à analyser au cas par cas en fonction de plusieurs facteurs[61].
En ce qui a trait spécifiquement à la situation de Bemba, la Chambre III s’est essentiellement fondée sur les éléments qui l’ont amenée à le considérer comme une « personne agissant effectivement comme un chef militaire » pour conclure qu’il avait exercé un tel contrôle sur ses soldats en RCA. La Chambre III a en outre relevé que, contrairement aux propos de la Défense, les soldats du MLC n’ont pas été mis à la disposition des autorités centrafricaines pour être sous leur responsabilité et sous leur commandement. Selon elle, (i) même en étant déployées en RCA et guidées par un nombre limité d'éléments des FACAs, les troupes du MLC ont continué à recevoir des ordres directement de Bemba; (ii) c’est à lui, et non aux autorités centrafricaines, qu’elles adressaient directement leurs rapports; (ii) Bemba répondait de leur comportement en RCA auprès des autorités des Nations Unies en RCA, auprès des médias ou encore auprès des ONG comme la FIDH qui avait rédigé un rapport accablant sur la conduite des troupes du MLC en RCA; (iii) Bemba a continué à exercer sur ses troupes le pouvoir disciplinaire en ouvrant certaines enquêtes et en sanctionnant certaines d’entre elles; et (iv) c’est finalement lui qui a décidé de leur retrait en RCA[62]. Ainsi, au regard de ces éléments, la Chambre III a conclu que, bien qu’étant resté en RDC, Bemba a continué à exercer le commandement opérationnel sur ses forces en RCA, à travers le colonel Moustapha[63].
Ces éléments apportent une précision d’une importance capitale puisque la question du contrôle effectif que Bemba a continué à exercer sur ses troupes en RCA a été traitée de façon plutôt ambigüe dans la décision de confirmation des charges. En effet, cette décision contient des propos qui semblent plutôt indiquer que même si Bemba avait décidé de l’envoi et du retrait de ses forces en RCA, ses soldats étaient apparemment sous le commandement opérationnel des autorités centrafricaines[64]. Dans une telle optique, il aurait été injuste de lui imputer la responsabilité du comportement criminel de ses soldats en RCA, alors qu’ils étaient sous commandement d’autres individus.
D. La connaissance du comportement criminel des subordonnés
Bemba avait-il la connaissance de la conduite criminelle de ses soldats en RCA? Il faut rappeler que l’article 28(a) du Statut de Rome exige d’établir que le chef militaire « savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ses forces commettaient ou allaient commettre ces crimes[65] ». Une lecture attentive de cette disposition montre qu’elle consacre deux types de distinctions. La première concerne les deux normes de connaissance « savait » et « aurait dû savoir ». La seconde distinction se rapporte aux deux variantes de la connaissance : la connaissance postérieure (ex post facto) qui est établie lorsque l’accusé savait que les crimes avaient été commis par ses subordonnés; et la connaissance antérieure (ante factum, ou encore prior knowledge) qui se rapporte au fait que l’accusé savait que ses subordonnés allaient commettre des crimes (non encore commis)[66]. Rappelons encore qu’aux termes de l’article 30(3) du Statut de Rome, « il y a connaissance […] lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des évènements[67] »; et que la mesure dans laquelle cet article s’applique à l’article 28 du Statut de Rome demeure toutefois controversée[68].
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que le débat autour de la connaissance du supérieur hiérarchique s’est jusqu’ici limité à la première distinction (savait/aurait dû savoir), c’est-à-dire au sens et au contenu exacts de ces deux normes de connaissance. Très peu d’auteurs et de jurisprudences se sont, à ce jour, consacrés à la seconde distinction (connaissance antérieure/connaissance postérieure) et surtout à l’incidence que cette seconde distinction a d’une part sur l’appréciation des mesures nécessaires et raisonnables que le supérieur est censé prendre pour prévenir ou réprimer les crimes et, d’autre part, sur l’établissement du lien de cause à effet entre l’inaction du supérieur et la perpétration des crimes comme il est exigé à l’article 28[69]. Comme nous le verrons, le jugement Bemba soulève de façon particulière la nécessité de cette seconde distinction.
1. première distinction : Bemba savait-il ou aurait-il dû savoir?
Par rapport à la première distinction (savait/aurait dû savoir), il apparaît que dans le jugement Bemba[70], la Chambre III a estimé qu’elle avait suffisamment d’éléments pour établir que Bemba « savait » et que par conséquent, il ne lui était pas nécessaire d’examiner la norme « aurait dû savoir »[71]. Pour établir que Bemba « savait[72] », la Chambre III a pris en compte le fait que (i) il disposait d’un contrôle effectif sur tous ses soldats et sur toutes les structures du MLC et de sa branche militaire (ALC) de sorte que rien ne pouvait être fait sans qu’il soit tenu informé; (ii) il avait à sa disposition d’importants moyens de communication pour directement entrer en contact avec ses soldats en RCA et que, dans les faits, il les avait effectivement utilisés à ces fins; (iii) il disposait des services de renseignement internes au sein du MLC par lesquels il pouvait être informé de tous les faits et gestes de ses soldats et que, dans les faits, ces services lui avaient communiqué des informations sur la conduite criminelle de ses soldats en RCA; (iv) le comportement criminel de ses soldats en RCA était régulièrement dénoncé par les médias et un rapport de l’organisation FIDH et que, dans les faits, Bemba s’informait régulièrement par la voie des médias et discutait même de ces informations avec ses proches collaborateurs; et (v) en créant des organes chargés d’enquêter sur la conduite criminelle de ses forces, dans le but non pas d’établir la vérité, mais de contrer ces allégations, Bemba démontrait par-là indirectement qu’il savait que les faits ont eu lieu[73].
L’application ainsi faite de la norme « savait » ne permet pas d’en clarifier le contenu ni surtout de la distinguer avec la norme « aurait dû savoir » que la Chambre III affirme avoir écartée. Rappelons à cet égard que la norme « savait » renvoie à une connaissance effective de la conduite criminelle des subordonnés[74]. Tandis que la norme « aurait dû savoir » est applicable lorsque le supérieur « ne savait pas », mais qu'en raison de sa propre faute (négligence) à s’informer dans un contexte tel, il « aurait dû savoir »[75].
Dans l’argumentation de la Chambre III, il se pose un problème par rapport à la signification exacte de la norme « savait » au regard de l’objet même de la connaissance imputée à Bemba. Qu’est-ce que ce dernier savait précisément? Nous retrouvons ici le problème, déjà invoqué, relatif à l’établissement du caractère généralisé des crimes et plus spécifiquement celui de l’existence des victimes nombreuses. Comme nous l'avons relevé en effet, la Chambre III n’a établi, au-delà de tout doute raisonnable, que quelques actes criminels et s’est fondée sur des sources indirectes (rapports d’ONGs, revue de presse, etc.) pour soutenir que ces actes ne constituaient qu’une faible proportion d’une criminalité plus vaste. C’est donc par cette étrange méthode qu’elle est parvenue à la conclusion selon laquelle de nombreux meurtres, viols et pillages ont été commis par les soldats du MLC.
En employant cette méthode, dont nous avons déjà relevé les limites, la question qui se pose alors quant à la signification de la norme « savait » est celle de savoir si la connaissance de Bemba doit être établie au regard des faits établis par la Chambre III elle-même ou si elle doit être établie sur la base des allégations rapportées par les médias, les ONGs, etc.
Sur ce point, la position de la Chambre III n’est pas claire et par moment, elle manque de cohérence. Nous voyons par exemple la Chambre III soutenir, non sans quelques ambigüités[76], que les services de renseignement de Bemba lui ont rapporté de nombreux meurtres, alors qu’elle n’a établi que trois meurtres en rejetant près d’une dizaine d’allégations de meurtre. En procédant ainsi, la Chambre III tente d’établir la connaissance de Bemba sur des faits dont elle-même n’a pas établi l’existence au-delà de tout doute raisonnable. Concernant par exemple, les meurtres, nous nous attendrions à ce que la Chambre III établisse la connaissance de l’accusé sur les meurtres établis par elle et non sur les allégations de meurtres véhiculées par les rapports d’ONGs ou autres sources indirectes.
Par ailleurs, en affirmant que Bemba « savait » parce qu’il lisait les journaux et écoutait la radio qui rapportaient ces crimes, la Chambre III confond en fait la connaissance d’un fait et la connaissance d’une allégation portant sur ce fait. Pourtant, ce n’est pas parce qu’un fait est allégué par les médias et les ONGs qu’il existe effectivement.
Lorsqu’on s’appuie principalement sur le fait que les allégations des crimes étaient régulièrement rapportées par les médias et les ONGs, et que l’accusé avait connaissance de telles allégations et s’en défendait parfois, cela établit, non pas qu’il savait, mais qu’il « avait des raisons de savoir », ou en tout cas, « aurait dû savoir ». Une telle qualité de connaissance ne fait pas naître chez un supérieur hiérarchique une obligation automatique de sanctionner ses subordonnés. Elle fait naître plutôt une obligation procédurale d’ouvrir une enquête, étant entendu que si cette enquête (menée de bonne foi) ne confirme pas ces allégations, nous ne pouvons plus continuer à dire qu’il « savait » ou « aurait dû savoir ». Comme nous le verrons plus loin, la Chambre III a reconnu que Bemba a pris certaines mesures pour faire face aux allégations des crimes; mais, selon elle, ces mesures étaient largement insuffisantes pour établir la vérité et sanctionner les coupables. Si tel est effectivement le cas, ce n’est pas pour autant que la norme de connaissance « aurait dû savoir » deviendrait alors celle de « savait ». Nous resterons toujours dans l’esprit de la norme « aurait dû savoir », à moins de soutenir, comme l’a fait la Chambre III, que, puisque les enquêtes instituées par Bemba avaient pour objectif, non pas d’établir la vérité, mais de l’étouffer, cela démontre qu’il « savait ». Cette argumentation est séduisante, mais n’est pas soutenue par des éléments de preuve solides. À beaucoup d’égards, elle s’apparente à un simple procès d’intention contre l’accusé.
Finalement, lorsque nous prenons en compte (i) la poignée d’actes criminels établis par la Chambre III, (ii) le fait que la Chambre III s’est principalement fondée sur la connaissance qu’avait Bemba, non pas de cette poignée d’actes criminels, mais des allégations véhiculées par les médias et les ONGs, et (iii) en critiquant les mesures prises par Bemba pour faire face à ces allégations, il semble que la norme qui a été appliquée n’est pas celle de « savait ». Sans l’avouer, la Chambre III a, en réalité, opté pour la norme « aurait dû savoir », adoptant ainsi une démarche qui crée la confusion entre ces deux normes.
2. deuxième distinction : connaissance antérieure ou connaissance postérieure ?
Sur cette question, nous pouvons constater que l’ensemble des éléments mis en avant par la Chambre III tend à établir une possible connaissance postérieure de la commission des crimes puisqu’ils visent à démontrer que Bemba savait que les crimes avaient été commis. Aucun élément mentionné par la Chambre III ne se rapporte à une connaissance antérieure.
L'unique passage où la Chambre III a fait allusion à une éventuelle connaissance antérieure est en rapport avec l’attaque de Mongumba survenue le 5 mars 2003, c’est-à-dire au moment du retrait des forces du MLC en RCA, lorsqu’elle a dit que Bemba savait que ses soldats allaient commettre des crimes contre des civils au cours de cette attaque[77]. Cependant, la manière dont cette connaissance antérieure a été établie (par déduction raisonnable) n’emporte pas entièrement conviction.
Il faut rappeler que l’opération de Mongumba, commandée par le colonel Moustapha du MLC, était une expédition punitive destinée à libérer quelques soldats du MLC (y compris l’épouse du colonel Moustapha) arrêtés et détenus par les FACAs et certains gendarmes centrafricains. Cette opération visait aussi à récupérer les biens (issus des pillages) que détenaient lesdits soldats au moment de leur arrestation[78]. Pour conclure que Bemba savait que cette expédition punitive était imminente, la Chambre s’est fondée sur le fait qu’il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec le colonel Moustapha la veille et le jour même de l’expédition et que c’est à la suite de ces contacts que le colonel précité avait ordonné ladite expédition punitive. Toutefois, bien que n’ayant pas eu accès au contenu de ces contacts téléphoniques, la Chambre III a tout de même soutenu que sa déduction était la « seule » conclusion raisonnable pouvant être déduite des circonstances de fait[79]. En soutenant cela, la Chambre III n’a pas dévoilé les autres hypothèses possibles qu’elle aurait analysées pour aboutir ainsi à la conclusion que sa déduction était la seule qui était raisonnable. Cette démarche intellectuelle était pourtant nécessaire puisque, même en admettant que Bemba sût que l’expédition punitive était imminente, les faits semblent indiquer qu’il aurait logiquement eu en tête une attaque dirigée, non pas contre la population civile, mais contre les FACAs et les gendarmes. Certes, la Chambre III a relevé que le 5 mars 2003, il n’y avait plus aucun soldat des FACAs ni de gendarmes à Mongumba[80]. Toutefois, elle n’a pas précisé si Bemba et Moustapha étaient informés de cette situation ni n’a expliqué pourquoi les soldats du MLC (y compris l’épouse du colonel Moustapha) sont, malgré tout, restés en captivité à Mongumba alors qu’il n’y avait plus aucun soldat des FACAs ni gendarme centrafricain. Ainsi, contrairement à ce que dit la Chambre III, cet élément montre que les FACAs et les gendarmes étaient encore à Mongumba et qu’en tout état de cause, Bemba et Moustapha ne pouvaient pas savoir qu’ils avaient déjà quitté le lieu. Il s’ensuit que si la déduction faite par la Chambre III par rapport à cet élément peut passer pour raisonnable, elle est loin d’être la seule raisonnable. Quoi qu’il en soit, mis à part cet incident de Mongumba, rien d’autre ne permet de dire que la Chambre III a cherché à savoir si Bemba avait une connaissance antérieure de la conduite criminelle de ses soldats.
Plus grave encore, la Chambre III n’a nulle part tenté d’explorer l’hypothèse du lien entre une possible connaissance postérieure de Bemba et sa connaissance antérieure. En effet, s’il était établi que Bemba savait que des crimes avaient été commis par ses soldats au tout début de l’intervention du MLC dans le conflit armé centrafricain (connaissance postérieure), cela impliquait qu’il savait, ou tout au moins, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ses soldats allaient commettre des crimes dans la suite ou vers la fin de cette intervention militaire (connaissance antérieure). Cette question, complètement ignorée par la Chambre III, était pourtant d’une importance cruciale puisque, lors de la confirmation des charges, le Procureur avait soutenu que Bemba aurait dû prévoir qu’en envoyant ses soldats en RCA, ceux-ci y commettraient des exactions contre la population civile comme ils l’avaient fait plusieurs fois dans le passé et notamment en RDC[81]. Mais, la décision de confirmation des charges avait rejeté cet argument en soutenant que le Procureur n’avait pas démontré que les unités et leurs commandants envoyés en RCA étaient les mêmes que ceux qui ont, par la suite, été envoyés en RCA[82]. La Chambre II dans sa décision avait surtout déclaré
qu’il n’existe pas de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Jean-Pierre Bemba était conscient que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par les soldats du MLC adviendraient dans le cours normal des évènements du fait de l’envoi des troupes du MLC le 26 octobre 2002 ou vers cette date en RCA et de leur maintien sur place jusqu’à leur retrait le 15 mars 2003[83].
En se prononçant ainsi dans la décision précitée, la Chambre II a écarté de façon radicale la possibilité d’une connaissance antérieure de la conduite criminelle de ses soldats en RCA. Cette approche n’a nulle part été remise en cause dans le jugement de la Chambre III.
Certes, sur ce point précis, la décision de confirmation des charges a été critiquée par Kai Ambos, professeur à l’Institute for Criminal Law and Criminal Justice de l’Université Göttingen (Allemagne), qui s’est demandé comment il pouvait être possible qu’une seule et même personne n’ait pas la connaissance des crimes en tant que coauteur, mais qu’elle ait une telle connaissance en tant que supérieur hiérarchique[84]. Il semble toutefois que l’approche de la décision précitée s’explique par la distinction entre connaissance antérieure et connaissance postérieure. La connaissance qu’elle a retenue à la charge de Bemba (en tant que supérieur hiérarchique) est une connaissance postérieure, tandis que celle qu’elle a rejetée en sa faveur (en tant que coauteur) est une connaissance antérieure[85]. La Chambre III a dit exactement que Bemba « savait effectivement que des crimes avaient été commis pendant les cinq mois qu’a duré l’intervention[86] ».
Ce qui est donc certain, c’est que la décision de confirmation des charges avait exclu la connaissance antérieure de Bemba sur la conduite criminelle de ses soldats. Le jugement final, quant à lui, n’a apporté aucun élément nouveau contredisant cette décision de confirmation puisque son attention a été orientée essentiellement vers la connaissance postérieure et non vers la connaissance antérieure. Or, comme nous le verrons bientôt, en se focalisant exclusivement sur la connaissance postérieure, sans se préoccuper d’une connaissance antérieure, l’argumentation de la Chambre III va se heurter à une incohérence évidente par rapport, d’un côté, à l’analyse des mesures nécessaires et raisonnables que devait prendre Bemba et, de l’autre côté, au lien entre l’inaction supposée de Bemba et la perpétration des crimes par ses soldats.
E. L’abstention de prendre les mesures nécessaires et raisonnables
Bemba s’est-il abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui s’imposaient face à la conduite criminelle de ses soldats en RCA? L’article 28(a)ii du Statut de Rome exige de démontrer que le supérieur hiérarchique « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher [les crimes] ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites[87] ». Cette disposition consacre deux obligations distinctes à l’égard du supérieur hiérarchique : l’obligation de prendre des mesures préventives et celle de prendre des mesures répressives, celles-ci pouvant couvrir l’enquête, les poursuites ou le renvoi de l’affaire à une autorité compétente aux fins d’enquête et de poursuites. Comme l’a précisé la Chambre III elle-même, soutenue par une doctrine avisée[88], l’obligation de prendre des mesures préventives naît avant la commission des crimes; tandis que celle consistant à prendre des mesures répressives intervient après la commission des crimes[89].
Pour établir que Bemba avait omis de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou pour réprimer les crimes commis par ses soldats, la Chambre a adopté un raisonnement que nous pouvons subdiviser en deux temps. Dans un premier temps, elle a jeté un regard critique sur les mesures prises par Bemba en réaction aux allégations des crimes rapportées par les médias et la FIDH. Elle a, à cet égard, passé en revue la création et l’activité des commissions d’enquête (la Commission Mondonga, la Commission de Zongo, la Mission de Sibut, etc.) instituées par Bemba, le procès de huit soldats du MLC devant la Cour martiale de Gbadolite dans l’affaire Willy Bomengo et consorts[90], les contacts entrepris par Bemba avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) et le président de la FIDH[91], etc. Elle en a conclu que ces mesures étaient largement insuffisantes[92] au regard de la gravité des informations qui parvenaient à Bemba et qu’elles n’ont pas été exécutées de bonne foi puisque leur objectif consistait, non pas à établir la vérité, mais à réhabiliter l’image du MLC[93].
Dans un second temps, la Chambre III a relevé un certain nombre de manquements dans la formation des soldats du MLC dans la mise en oeuvre effective du Code de conduite qui existait au sein du MLC[94]. Elle a également observé que Bemba avait la possibilité de retirer ses forces dès les premiers jours quand il a été informé des allégations portant sur leur conduite criminelle en RCA, mais qu’il s’est abstenu de le faire[95]. Sur la base de ces deux séries d’arguments, la Chambre III a conclu que « [Bemba] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher [les crimes] ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites[96] ».
Ce qui apparaît dans cette argumentation est que, même si la Chambre III ne le dit pas explicitement, la première série de mesures prises par Bemba (création des commissions d’enquête, le procès de Gbabolite, etc.), et contre lesquelles elle s’est montrée plutôt très critique, se rapporte à des mesures répressives; tandis que la seconde série de mesures (formation de ses soldats, retrait de ses troupes de la RCA, etc.) se rapporte à des mesures préventives. L’approche de la Chambre III suscite toutefois trois problèmes qui en révèlent les limites.
1. Lien entre les mesures exigées et la connaissance établie
Puisque l’obligation de prendre des mesures préventives n’intervient qu’avant la commission des crimes et que celle de prendre des mesures répressives n’intervient qu’après la commission des crimes, il faut se demander s’il n’existe pas un lien entre la nature des mesures à prendre et le type de connaissance dont dispose le supérieur hiérarchique.
Sur ce point, il ne semble pas contesté par la doctrine que l’obligation de prendre les mesures préventives suppose une connaissance antérieure; tandis que celle de prendre les mesures répressives suppose une connaissance postérieure. Otto Triffterer, regretté professeur de la Salzburg Law School, a écrit à cet égard que « the precise awareness of the stage of the crime shapes the measures necessary and reasonable to prevent the crime or further harm[97] ». Sandesh Sivakumaran, professeur de droit international public de l’Université de Nottingham (Angleterre), précise encore que « the time at which the knowledge is to be judged differs for the obligation to prevent a crime and the obligation to punish that crime[98] ». En d’autres termes, les mesures répressives vont de pair avec la connaissance postérieure; tandis que les mesures préventives vont de pair avec la connaissance antérieure. Comme nous pouvons le constater, il existe donc un lien entre le type de connaissance qui a été établi et la nature du manquement à retenir contre un supérieur hiérarchique. Ce lien s’explique donc par le fait qu’il est illogique de retenir à la charge d’un supérieur un manquement à une obligation de prévenir un fait dont il n’a eu la connaissance qu’après coup.
Le problème posé par le jugement Bemba[99] réside ainsi dans la difficulté à établir ce lien. La Chambre III a en effet reproché à l’accusé un manquement aux mesures préventives alors même que, comme nous l’avons vu, elle n’a pas établi une connaissance antérieure par l’intéressé et que toute son attention était orientée vers une connaissance postérieure. Puisque la Chambre III s’est beaucoup plus attelée à établir une connaissance postérieure, c’est donc sur un manquement à l’obligation de prendre des mesures répressives qu’elle aurait logiquement dû se focaliser. Le premier point faible de l’argumentation de la Chambre III réside ainsi dans le fait qu’elle a ignoré ce lien nécessaire et logique entre la nature de mesures à prendre et le type de connaissance dont dispose le supérieur hiérarchique.
2. La « capacité » de Bemba à prendre des mesures répressives dans le respect des droits de l’homme
La question de la « capacité » d’un supérieur hiérarchique à prendre des mesures répressives dans le respect des droits de l’homme appelle à préciser préalablement ce qu’il faut entendre par mesures répressives, tant il est vrai que le jugement n’est pas clair sur la distinction entre les mesures répressives et les sanctions disciplinaires. L’on verra ensuite si le rebelle est obligé de prendre lui-même de telles mesures ou si, au contraire, il est obligé de renvoyer l’affaire à une autorité compétente, lui-même n’en disposant pas.
a)- Mesures répressives : sanctions disciplinaires ou sanctions pénales ?
Par rapport à la signification des mesures répressives, la Chambre III a sous-entendu que le supérieur hiérarchique qui prend des mesures disciplinaires s’acquitte de l’obligation qui lui est imposée par l’article 28(a) du Statut de Rome[100]. Certes, cette invocation des mesures disciplinaires peut trouver une base à l’article 87(3) du Protocole I du Protocole additionnel aux Conventions de Genève[101], article relatif aux devoirs des commandants, et dans la jurisprudence du Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL) notamment dans l’affaire Brima et consorts[102] et même dans les écrits de certains auteurs[103]. Elle suscite toutefois la question de savoir si de telles mesures peuvent être considérées comme nécessaires et raisonnables. Les mesures disciplinaires (exclusion ou suspension au sein d’un groupe armé, privation de salaire, rétrogradation, interdiction de porter une arme, privation de certains avantages, etc.), ne doivent pas être confondues avec les mesures répressives (emprisonnement, peine de mort, etc.). Or, il semble que compte tenu de la gravité des crimes prévus dans le Statut de Rome, de simples mesures disciplinaires ne seraient pas suffisantes pour réagir à un tel comportement criminel. Il doit donc s’agir de sanctions pénales (mesures répressives) suffisamment sévères pour décourager ce type de comportement[104].
Puisque les mesures répressives visent de véritables sanctions pénales, la question est alors de savoir si un rebelle, comme Bemba, a la capacité de prendre des mesures de cette nature. Par rapport à cette seconde question, la Chambre III a soutenu que si un supérieur hiérarchique n’a pas de pouvoir de sanction à l’égard des auteurs des crimes, il serait alors tenu de transférer l’affaire à une autorité compétente pour que celle-ci ouvre une enquête et le cas échéant, engage des poursuites[105]. La Chambre III s’est toutefois gardée de trancher la question de savoir si Bemba, en tant que rebelle, était tenu de poursuivre lui-même les coupables, ce qui suppose que la Chambre III l’estimait apte à prendre ces mesures répressives, ou s’il était plutôt tenu de renvoyer l’affaire à une autorité compétente.
b)- Bemba était-il obligé de soumettre l’affaire à des tribunaux institués par son mouvement rebelle?
Pour soutenir que Bemba, en tant que rebelle, avait l’obligation de soumettre les suspects aux tribunaux criminels institués par son mouvement rebelle, il faut préalablement se prononcer sur la légalité et la légitimité de tels tribunaux, tant il est vrai qu’il serait absurde de lui reprocher de n’avoir pas soumis ses soldats à des tribunaux illégaux. Toutefois, le jugement a choisi d’éviter cette question.
La volonté d’éviter cette question est présente d’abord dans les critiques faites par la Chambre III au procès de Gbadolite[106]. Nous remarquons en effet que la Chambre III a émis toute une série de critiques à l’endroit de ce procès[107], mais s’est gardée de se prononcer sur la légalité et la légitimité de celui-ci. Pourtant, cette question était au coeur de la lettre du président de la FIDH adressée à Bemba et à laquelle la Chambre III a fait allusion. Dans cette lettre, la FIDH a décliné l’offre de collaborer avec Bemba dans les enquêtes et les poursuites, l’a informé qu’elle avait transféré l’affaire à la CPI et lui a plutôt recommandé de coopérer avec cette dernière[108].
Il y avait donc là une question fondamentale que la Chambre III a éludée : interpréter l’article 28 du Statut de Rome[109] comme obligeant un rebelle à poursuivre pénalement ses soldats coupables de crimes graves devant un système judiciaire crée par la rébellion est-il conforme aux droits de l’homme internationalement reconnus comme l’exige l’article 21(3) du Statut de Rome[110]? Il était important que la Chambre III tranche cette question au regard de la controverse constatée à travers la doctrine où certains auteurs soutiennent que les Cours et tribunaux créés par les rebelles sont légitimes[111], tandis que d’autres (y compris les Nations Unies) rejettent cette proposition en soutenant que même les individus suspectés des pires crimes comme ceux qui sont prévus dans le Statut de Rome bénéficient aussi du droit au procès équitable et tout particulièrement du droit à un tribunal établi par la loi ou créé en vertu de la loi[112].
Bien qu’il existe une controverse sur cette question, la tendance nettement majoritaire qui semble toutefois se dégager est que les juridictions criminelles instituées par les groupes armés irréguliers n’ont ni légitimité ni légalité. Telle est d’ailleurs la position du président de la FIDH dans sa lettre adressée à Bemba et il semble que c’était la principale motivation ayant justifié le refus de cette organisation de défense des droits de l’homme de coopérer avec le MLC dans les enquêtes sur les allégations de crimes imputés aux soldats du MLC.
Sur cette question, le professeur Sandesh Sivakumaran a écrit un article remarquable dans lequel il démontrait que rien n’interdit juridiquement aux groupes armés irréguliers de créer des juridictions criminelles, et que pour cela, il faut reconnaître leur légalité et leur légitimité. Toutefois, cet éminent auteur a lui-même reconnu le caractère révolutionnaire de sa proposition et que, selon lui, l’opinion publique n’était pas favorable à accorder une reconnaissance à ces juridictions singulières[113].
Certes, l’obligation de prendre des mesures préventives (non répressives) et même celle d’ouvrir une enquête criminelle ou de renvoyer l’affaire à une autorité compétente n’exigent pas que le supérieur hiérarchique dispose d’un pouvoir légal pour le faire[114]. Le statut de rebelle n’est pas un argument pour échapper aux obligations découlant des normes du droit international humanitaire (DIH), et tout particulièrement celles de respecter et de faire respecter ces normes[115]. Toutefois, le problème se pose différemment concernant l’obligation imposée au supérieur hiérarchique (rebelle) de prendre des mesures répressives contre ses subordonnés. Une telle obligation fait nécessairement intervenir les règles relatives au respect du procès équitable qui imposent certaines limites au supérieur hiérarchique. Il est peu convaincant de soutenir que puisque les rebelles ont l’obligation de respecter et de faire respecter les normes fondamentales du DIH, leurs systèmes répressifs seraient reconnus comme valables.
Il devient ainsi surprenant de constater que la Chambre III a conclu à un manquement à l’obligation de réprimer les crimes imputés aux soldats du MLC sans s’être préalablement prononcée sur la question de savoir si Bemba avait la capacité de créer un système répressif ayant la légalité et la légitimité nécessaires à son fonctionnement, système auquel il était tenu de soumettre ses soldats coupables des exactions en RCA.
c)- Vers quelle « autorité compétente » le rebelle peut-il renvoyer l’affaire ?
Dans l’hypothèse où Bemba, en tant que rebelle, n’avait pas le pouvoir de créer des cours et tribunaux au sein de son mouvement rebelle, mais qu’il était plutôt tenu de renvoyer l’affaire à une autorité compétente pour enquête et poursuites, la question est alors de savoir qui pouvait être considéré comme étant cette autorité compétente, compte tenu des circonstances de l’époque.
Sur cette question, la réponse de la Chambre III reste vague une fois de plus. En effet, elle a reproché à Bemba de n’avoir rien fait pour mettre en oeuvre les recommandations du président de la FIDH[116]. Or, comme vu précédemment, ce dernier lui avait recommandé de coopérer avec la CPI. Mais, au moment de cet échange de correspondance (février 2003), le tout premier Procureur de la CPI n’était pas encore élu. Son élection s'est tenue le 21 avril 2003, il n’a prêté serment que le 16 juin 2003 et, une fois en fonction, il avait encore la lourde tâche de recruter ses collaborateurs avant de procéder à des enquêtes et des poursuites[117]. Puisque la Chambre III avait déclaré que le renvoi d’une affaire à une autorité non fonctionnelle ne libérait pas le supérieur hiérarchique de son obligation de renvoyer l’affaire[118], nous nous attendions logiquement à ce qu’elle précisât si elle considérait le Procureur de la CPI en 2003, comme une autorité fonctionnelle à laquelle Bemba pouvait renvoyer l’affaire. Mais, là encore, la Chambre III a esquivé cette question délicate.
Dans tous les cas, même en se situant en 2016, année du jugement Bemba[119], il n’était pas certain que le Procureur de la CPI soit une « autorité fonctionnelle » auquel un rebelle pouvait renvoyer l’affaire. Comme l’écrit encore Sivakumaran, le renvoi au Procureur de la CPI n’est pas une mesure réaliste en raison des limitations de la compétence de la CPI et de ses capacités opérationnelles. En tout état de cause, il n’est pas prudent d’encourager de tels renvois puisque cela permettrait aux supérieurs hiérarchiques issus des groupes rebelles d’échapper à leurs propres obligations lorsqu’ils savent très bien que ce Procureur ne pourra rien faire[120].
La Chambre III a par ailleurs reproché à Bemba de n’avoir pas coopéré avec la Commission internationale d’enquête qui devait être créée par le Tchad et la RCA (et qui n’a plus été créée) ni d’avoir associé le RSSG en RCA dans les enquêtes[121]. Mais ici encore, la Chambre III n’a pas précisé si elle considérait cette Commission d’enquête ou le RSSG comme une autorité fonctionnelle à laquelle Bemba pouvait renvoyer l’affaire. En outre, comme l’ont relevé certains auteurs, le renvoi aux autorités de l’État contre lequel un groupe armé est, ou était, engagé dans un conflit armé, en l’occurrence les autorités centrafricaines, n’est tout simplement pas une mesure raisonnable[122]. Dans le jugement Bemba,[123] cette question se posait puisque ceux contre qui le MLC avait combattu avaient, par la suite, pris le pouvoir et qu’il n’était pas raisonnable de demander à Bemba de leur renvoyer l’affaire.
La Chambre III n’a pas non plus abordé la question de savoir si Bemba aurait pu renvoyer l’affaire aux Cours et tribunaux des États voisins. L’efficacité d’une telle hypothèse dépend d’une part, de la disponibilité dans ces États d’une législation autorisant leurs juridictions pénales à exercer une compétence extraterritoriale sur des crimes commis à l’étranger, contre des étrangers et par des étrangers qui d’ailleurs résident à l’étranger. Elle dépend, d’autre part, de bonnes relations entre le groupe armé précité et l’État en question[124].
Aucune de ces questions n’a retenu l’attention des juges de la Chambre III alors même que le statut de rebelle de Bemba leur imposait de les aborder et clarifier ainsi d’un côté, la signification exacte de l’expression « mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir » figurant à l’article 28(a)ii du Statut de Rome[125]; et, de l’autre côté, ce qu’il faut entendre par une « autorité compétente » vers laquelle un rebelle peut renvoyer l’affaire.
Finalement, nous constatons que (i) la Chambre III a retenu contre Bemba un manquement à l’obligation de prendre des mesures préventives, alors qu’elle avait retenu à sa charge principalement une connaissance postérieure; (ii) qu’elle a également retenu contre l’intéressé un manquement à l’obligation de prendre des mesures répressives, sans avoir démontré que ces mesures étaient en son pouvoir et qu’elles étaient raisonnables compte tenu de sa qualité de rebelle au moment des faits.
F. Le lien de causalité entre l’inaction du supérieur et la perpétration des crimes par les subordonnés
La sixième et dernière condition de la command responsibility est le lien de causalité entre l’inaction du supérieur hiérarchique et la perpétration des actes criminels par ses subordonnés. Cette condition découle de l’article 28 du Statut de Rome qui dispose que le chef militaire est pénalement responsable des crimes commis par ses soldats lorsqu’« il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces[126] ». Ce lien de causalité est beaucoup plus affirmé dans la version anglaise selon laquelle les crimes doivent avoir été commis « as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces[127] ».
Dans le jugement sous examen, la Chambre III a consacré très peu de développement sur l’interprétation qu’elle accorde à cette condition. En effet, elle s’est contentée de déclarer que
la condition qu’il existe un lien est manifestement remplie lorsqu’il est établi que les crimes n’auraient pas été commis dans les circonstances où ils l’ont été si le chef militaire avait exercé le contrôle qui convenait, ou que le chef militaire aurait empêché l’exécution des crimes en exerçant le contrôle qui convenait[128].
Par rapport spécifiquement au jugement Bemba,[129] la Chambre III a estimé que ce lien de causalité était établi. Pour y arriver, elle a mis en évidence l’absence de formation adéquate des soldats du MLC au respect des règles du droit humanitaire. Elle a aussi observé les défaillances du Code de conduite promulgué au sein du MLC où l’interdiction des violences contre la population civile et les pillages n’était pas clairement affirmée. La Chambre III a aussi mis en évidence le fait que les dispositions de ce Code de conduite n’étaient, de toute façon, pas connues de la plupart des soldats du MLC[130] ni appliquées dans la pratique puisque ceux qui se rendaient coupables des actes interdits par le code ne faisaient l’objet d’aucune enquête ni de poursuites au sein du MLC[131]. Elle a aussi mis en avant le fait qu’il régnait au sein du MLC un climat d’impunité qui avait pour effet d’encourager la commission des crimes contre la population civile[132]. Selon la Chambre III, les crimes commis par les soldats du MLC en RCA n’auraient pas été commis, ou en tout cas, pas tel qu’ils l’ont été, si Bemba, en tant que commandant suprême des soldats du MLC, n’avait pas omis de prendre toutes les mesures que la Chambre III lui reproche de n’avoir pas prises. C’est donc sur cette base que la Chambre III a conclu qu’il existait un lien de causalité entre l’omission de Bemba et la survenance des crimes[133].
En y regardant de près, nous pouvons constater que le lien établi par la Chambre III est celui qui existe entre l’omission de prendre des mesures préventives et la perpétration des crimes. Même lorsque la Chambre III invoque l’absence de l’application effective du Code de conduite à travers des enquêtes et des poursuites contre ceux qui le violaient (mesures répressives), cette invocation est faite dans une optique préventive parce que la Chambre III dit aussitôt que si ce Code était effectivement appliqué, les crimes n’auraient pas été commis.
La difficulté dans l’argumentation réside cependant dans la recherche d’un tel lien en l’absence d’une connaissance antérieure du supérieur hiérarchique. Nous avons précédemment vu que pour établir un manquement à l’obligation de prendre des mesures préventives, il faut avoir préalablement établi une connaissance antérieure puisqu’il existe un lien entre la nature du manquement et le type de mesures à prendre; et qu’il est illogique d’établir, comme l’a fait la Chambre III, un manquement à l’obligation de prendre des mesures préventives lorsque nous n’avons établi qu’une connaissance postérieure.
L’obligation de prendre des mesures préventives susceptibles d’engager une responsabilité pénale n’est pas une obligation générale; elle est une obligation spécifique ou particulière par rapport à des crimes précis dont le supérieur avait eu une connaissance antérieure[134]. En d’autres termes, pour établir une responsabilité pénale, il ne suffit pas seulement d’établir que (i) des crimes ont été commis; et (ii) l’absence des mesures préventives a permis la commission de ces crimes. Encore faut-il établir un troisième élément, soit la connaissance antérieure du supérieur hiérarchique par rapport à la commission de ces crimes spécifiques ou, à tout le moins, au risque de leur commission. Sans cette connaissance, il est difficile d’établir un manquement à l’obligation de prévenir ces crimes précis. Et sans un tel manquement, nous ne voyons pas comment nous pourrions établir un lien de cause à effet entre ce qui n’a pas été démontré et la perpétration des crimes.
Comme nous pouvons le voir, il existe deux types de liens qui ont été ignorés par la Chambre III. Le premier lien concerne la nature de la connaissance et le type de manquement à retenir contre un supérieur; tandis que le second lien porte sur le manquement retenu contre le supérieur et la perpétration des crimes. Lorsque le premier lien n’a pas été établi, il devient difficile d’établir le second. Ignorer ces deux liens conduirait à confondre la responsabilité pénale, découlant de l’article 28 du Statut de Rome[135] et la responsabilité morale sans aucune conséquence juridique. C’est en effet par rapport à cette forme de responsabilité qu’une commission parlementaire belge s’était située pour retenir à l’encontre de certains membres du gouvernement belge, une responsabilité morale dans l’assassinat du tout 1er Premier ministre congolais, Patrice Émery Lumumba[136]. Ignorer ces deux liens conduirait également à confondre la responsabilité pénale et la responsabilité civile, sans aucune conséquence pénale, comme celle des maîtres et des commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés[137]. Sur ce point d’ailleurs, nous devons relever qu’à beaucoup d’égards, le raisonnement suivi par la Chambre III est beaucoup plus proche de celui du droit de la responsabilité civile des commettants pour les dommages causés par leurs préposés, que de celui du droit pénal qui exige un certain état d’esprit pour retenir la culpabilité d’un accusé.
En raison de l’attention de la Chambre III tournée beaucoup plus vers la connaissance postérieure de Bemba, c’est logiquement vers un éventuel lien entre l’inaction à prendre des mesures répressives et la perpétration des crimes par ses subordonnés qu’elle aurait dû se tourner. Or, sur ce point précis, la position de la Chambre III reste ambigüe : dire qu’un tel lien est établi dès lors que les crimes n’auraient pas été commis tels qu’ils l’ont été, c’est, encore une fois, se situer dans l’approche d’un manquement par rapport aux mesures préventives et esquiver la question du lien par rapport aux mesures répressives.
Lorsque nous analysons la responsabilité pénale d’un supérieur hiérarchique sur la base de son manquement à prendre des mesures répressives à la lumière de l’article 28 du Statut de Rome[138], il est important de distinguer clairement deux situations. Dans la première, nous avons, d’une part, la série des crimes du passé et, d'autre part, celle des crimes ultérieurs. La responsabilité pénale du supérieur est dans ce cas engagée lorsque, par l’impunité qu’il a accordée aux crimes du passé (et dont il n’a eu connaissance qu’après les faits), il a favorisé, et même contribué, aux crimes ultérieurs. Ici, la répression est envisagée comme une composante de la prévention. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les propos de la décision de confirmation des charges de la Chambre II lorsqu’elle affirme :
[L]orsqu’un supérieur manque à ses devoirs [de réprimer l’exécution des crimes ou d’en référer aux autorités compétentes] pendant et après la commission des crimes, ce comportement peut avoir un lien de cause à effet avec la commission des nouveaux crimes. La punition faisant partie intégrante de la prévention de la criminalité, le fait qu’un chef ait omis par le passé de punir des crimes tend à augmenter le risque de commission de nouveaux crimes[139].
C’est également dans ce sens que plusieurs auteurs se sont exprimés[140].
Une conséquence importante à tirer de ce qui précède est que le supérieur ne peut logiquement être tenu responsable que des crimes ultérieurs. L’invocation des crimes du passé (dont il ne peut pas être tenu responsable) ne sert qu’à établir sa connaissance antérieure de la conduite criminelle de ses subordonnés et surtout, comme une preuve de son manquement à l’obligation de prévenir les crimes commis ultérieurement par ses subordonnés[141].
Dans la seconde situation, nous n'avons que les crimes du passé (et dont le supérieur n’a eu connaissance qu’après les faits), qui sont restés impunis, et aucun crime n’a été ultérieurement commis en dépit de cette impunité. Dans cette situation, où l’obligation de punir est complètement détachée de celle de prévenir[142]), la plupart des auteurs soutiennent que l’article 28 du Statut de Rome ne permet pas de tenir le supérieur hiérarchique pénalement responsable pour les crimes passés, simplement parce qu’il ne serait pas possible de démontrer la contribution du supérieur dans la commission de ces crimes et ainsi d’établir ce fameux lien de cause à effet entre son inaction et la perpétration des crimes par ses subordonnés[143]. Certains auteurs ont proposé d’interpréter largement l’exigence de ce lien de manière à ouvrir aussi toute contribution à l’impunité des crimes des subordonnés[144]. Cette proposition est toutefois peu convaincante parce qu’elle tend à faire revenir un concept déjà abandonné, celui du « complice après l’acte », et à confondre la contribution à la commission d’un crime et les actes d’obstruction à la justice[145]. Que nous soyons choqués que le supérieur ne puisse dans ce cas être tenu responsable des crimes commis par ses subordonnés, en particulier lorsque son inaction est perçue comme une forme d’approbation tacite de la conduite criminelle de ses subordonnés, est une chose que nous pouvons comprendre. Toutefois, comme l’a écrit Darryl Robinson, le sens même de la justice commande que nous ne tenions une personne pénalement responsable que des crimes auxquels il a contribué[146].
Dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux (TPI) ad hoc, les juges se sont généralement appuyés sur la soi-disant nature sui generis de la command responsibility pour tenir pénalement responsable le supérieur pour les crimes du passé commis par ses subordonnés et qui sont restés impunis en dehors de tout lien entre son inaction et la perpétration des crimes par ses subordonnés. La nécessité d’un tel lien a été rejetée au motif que, selon ces juges, ce lien serait illogique[147]. Ce caractère illogique a également été reconnu dans la décision de confirmation des charges relatives à la décision Bemba lorsque la Chambre II a déterminé qu’« il serait illogique de conclure qu’un manquement [au devoir de réprimer ou de transférer l’affaire aux autorités compétentes] pourrait rétroactivement causer les crimes qui vont être commis[148] ».
Cependant, la jurisprudence des TPI ad hoc a été rendue possible par le silence des statuts de ces tribunaux sur la condition du lien entre l’inaction du supérieur et la perpétration des crimes par ses subordonnés. La transposition de cette jurisprudence dans l’interprétation de l’article 28 du Statut de Rome pose des difficultés précisément parce que cet article exige explicitement le lien précité[149]. Ces difficultés sont d’ailleurs visibles dans la décision Bemba lorsque dans sa décision de confirmation des charges, tout en reconnaissant le caractère illogique de l’exigence d’un tel lien, la Chambre II conclut, malgré tout, qu’il faut l’établir tout en tentant de l’interpréter autrement. Elle affirme, en effet, que ce lien peut être établi lorsque l’impunité a favorisé la commission des crimes ultérieurs. Mais, dans cette interprétation, la décision confond, à tort, la première hypothèse (crimes du passé et crimes ultérieurs) et la seconde hypothèse (crimes du passé, sans crimes ultérieurs) et reste ambigüe sur la nécessité d’un tel lien dans le cas d’un manquement à l’obligation de punir, lorsque celle-ci est détachée de l’obligation de prévenir.
Dans le jugement Bemba, nous constatons que la Chambre III a invoqué elle aussi la nature sui generis de la command responsibility; qu’elle n’a pas opéré de distinction claire entre les crimes du passé et les crimes ultérieurs puisqu’elle a tenu Bemba pénalement responsable de tous les crimes[150]. Pourtant, dès lors que cette même Chambre III a reconnu que la formulation de l’article 28 du Statut de Rome[151], contrairement aux statuts des TPI ad hoc, exigeait d’établir un lien de causalité entre l’inaction du supérieur et la perpétration des crimes, il était important (i) qu’elle distinguât clairement les crimes du passé pour lesquels Bemba avait eu une connaissance postérieure et les crimes commis ultérieurement en raison de l’impunité des précédents; (ii) qu’elle n’envisageât la responsabilité pénale de Bemba uniquement par rapport aux crimes commis ultérieurement; et (iii) qu’elle n’invoquât les crimes du passé uniquement en vue d’établir une connaissance antérieure de Bemba par rapport à ces crimes futurs. Suivant cette logique, Bemba n’aurait pas dû être tenu pénalement responsable de la plupart des crimes commis à Bangui et au Point Kilomètre 12 (PK12). Sa responsabilité pénale n’aurait dû être envisagée que par rapport aux crimes commis ultérieurement vers la fin de leur intervention militaire. En confondant les crimes du passé et les crimes ultérieurs, la logique même de l’argumentation de la Chambre III devient fort contestable.
***
Il est sans doute plus facile de juger un jugement que de juger les faits[152]. Toutefois, en analysant de près la manière dont le jugement Bemba[153] a appliqué la théorie de la command responsibility à un rebelle, nous ne pouvons nous empêcher de formuler tout au moins la remarque suivante.
Nous avons relevé les deux piliers distincts de la command responsibility, à savoir l’obligation de prévenir et celle de punir. S’il est incontestable que la qualité de rebelle n’a aucune incidence sur l’obligation de prévenir la commission des crimes dès lors que nous avons établi à la charge du rebelle une connaissance antérieure, il en est autrement de l’obligation de réprimer, lorsque les juges se sont focalisés davantage sur la connaissance postérieure du rebelle. D’un côté, si nous interprétons l’obligation de réprimer comme englobant celle d’enquêter et surtout de renvoyer l’affaire aux autorités compétentes pour les poursuites, nous ne pouvons retenir un manquement à une telle obligation si nous n’avons pas préalablement précisé qui est concrètement cette « autorité compétente ». Le jugement Bemba[154] met en évidence un contexte tout à fait particulier dans lequel l’identification de cette autorité n’est pas évidente lorsqu’il s’agit spécifiquement des rebelles.
De l’autre côté, si nous entendons l’obligation de réprimer comme renvoyant à celle de soumettre l’affaire au système judiciaire répressif institué par les autorités rebelles, là aussi nous ne voyons pas comment nous pourrions retenir à la charge d’un rebelle un manquement à une telle obligation lorsqu’on a omis de se prononcer préalablement sur la légalité et sur la légitimité d’un tel système répressif. Dans le système du Statut de Rome, plus qu’ailleurs, cette question est incontournable puisque l’article 21 du Statut de Rome[155] dispose que « l’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus ».
Dans tous les cas, en s’appuyant sur un potentiel manquement à une obligation de réprimer, lorsqu’une telle obligation est totalement détachée de celle de prévenir, nous aurions forcément du mal à démontrer le lien entre l’inaction du supérieur et la perpétration du crime par les subordonnés. Pourtant, ce lien est clairement exigé par l’article 28 du Statut de Rome[156]. La nature sui generis de la command responsbility n’est pas et ne doit pas être une justification pour ignorer cette exigence.
Le jugement Bemba[157] constitue ainsi une opportunité manquée de résoudre des problèmes précis que pose l’application de la command responsibility aux rebelles. Lorsque la Chambre III prononce une condamnation tout en faisant l’impasse sur ces problèmes de fond, cela ne peut que contribuer très imparfaitement au renforcement de la crédibilité de la CPI qui est destinée à se prononcer sur des affaires politiquement chargées. Le verdict de culpabilité de Bemba aurait sans doute été plus convaincant si les juges s’étaient focalisés sur le manquement à une obligation de prévenir et sur la connaissance antérieure de Bemba par rapport au risque de la conduite criminelle de ses soldats en RCA.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 art 25 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].
-
[2]
Le Procureur c Bemba, ICC-01/05-01/08-3343, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut (21 mars 2016) (Cour pénale internationale, Chambre de première instance III), en ligne : CPI <http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_08547.PDF> [Jugement Bemba].
-
[3]
Le Procureur c Bemba, ICC-01/05-01/08-3399, Décision relative à la peine rendue en application de l’article 76 du Statut (21 juin 2016) au para 94 (Cour pénale internationale, Chambre de première instance III), en ligne : CPI <http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_24792.PDF> [Décision Bemba (peine)].
-
[4]
Le Procureur c Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61‐7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean‐Pierre Bemba Gombo (15 juin 2009) (Cour pénale internationale, Chambre préliminaire II), en ligne : CPI <http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_05978.PDF> [Décision Bemba].
-
[5]
Jacques B Mbokani, « La CPI à l’épreuve de la doctrine de la command responsibility » (2010) Rev b dr Intern 2 [Mbokani].
-
[6]
Ibid, art 28.
-
[7]
Jugement Bemba, supra note 1 au para 173.
-
[8]
Voir Kai Ambos, « Chapter 4.21: Superior Responsibility » [Ambos], dans Antonio Cassese, Paola Gaeta et John RWD Jones, dir, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford, Oxford Universty Press, 2002, à la p 850 [Cassese]; John RW Jones et Steven Powler, International Criminal Practice, 3e éd, Oxford, Oxford University Press, 2003, aux pp 432—433 [Jones & Powler]; Salvatore Zàppala, « Chapitre 42 : Crimes d’omission », dans Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, dir, Droit international pénal, 2e éd, Paris, Pedone, 2012, aux pp 523-524 [Ascensio]; Roger O’keefe, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, à la p 203; William Schabas, The International Criminal Court : A Commentary on the Rome Statute, 2e éd, Oxford, Oxford University Press, 2015, à la p 610 [Schabas].
-
[9]
Le Procureur c Delalic et consorts, IT-96-21-T, Jugement (16 novembre 1998) aux paras 331-343 (Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance) [Jugement Delalic].
-
[10]
Le Procureur c Halilovic, IT-01-48-T, Jugement (16 novembre 2005) (Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, Chambre 1ère Inst), [Jugement Halilovic], au para 54; sur cette affaire, voir le commentaire de H. van der Wilt, dans A. Klip et G. Sluiter, dir, Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, vol XXVII: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2005, Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland, 2011, aux paras 694-700.
-
[11]
Kononov c Lettonie, 36376/04, Arrêt (17 mai 2010) au para 211 (Cour européenne des droits de l'homme).
-
[12]
Statut de Rome, supra note 1, art 25.
-
[13]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 174.
-
[14]
Ibid aux paras 147 et 168.
-
[15]
Darryl Robinson, « How command responsibility got so complicated: a culpability contradiction, its obfuscation, and a simple solution » (2012) 13 Melb J Intl L 39 [Robinson].
-
[16]
Décision Bemba, supra note 4.
-
[17]
Statut de Rome, supra note 1, art 28(a).
-
[18]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 170.
-
[19]
Statut de Rome, supra note 1, art 25.
-
[20]
Jean Pradel, Droit pénal comparé, 4e éd, Paris, Dalloz, 2016, à la p 133.
-
[21]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 658.
-
[22]
Ibid au para 659.
-
[23]
Voir par exemple la Haute Cour militaire de la RDC dans l’affaire Ministère public et parties civiles c Kakwavu, RPN 004/2010, Arrêt (7 novembre 2014). Sur cette jurisprudence, voir Jacques B Mbokani, La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international, New York, Open Society Foundations, 2016 aux pp 115-204.
-
[24]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 162.
-
[25]
Ibid au para 689.
-
[26]
Ibid au para 163.
-
[27]
Ibid au para 549.
-
[28]
Ibid. À ce sujet, trois meurtres dont un contre un musulman inconnu dont le corps n’a pas été retrouvé, vingt-huit viols dont une douzaine se rapporte à des victimes inconnues dont nous avons perdu les traces.
-
[29]
Voir Situation en République Démocratique du Congo, ICC-01/04 OA4 OA5 OA6, Arrêt relatif à la participation des victimes au stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense contre la décision rendue le 7 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I et de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la décision rendue le 24 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I, (19 décembre 2008) au para 45 (Cour pénale internationale, Chambre d'appel); Hervé Ascensio, « Les droits des victimes devant les juridictions pénales internationales » dans Jean-François Flauss, dir, La protection internationale des droits de l’homme et les droits des victimes/International Protection of Human Rights and Victim’s Rights, Bruxelles, Bruylant, 2009, à la p 91; Salvatore Zappalà, « The Rights of Victims v the Rights of the Accused » (2010) 8 JICJ 137; Sergey Vasiliev, « Chapter 45 : Victim Participation Revisited - What the ICC is Learning about Itself », dans Carsten Stahn, dir, The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford, Oxford University Press, 2015, à la p 1148 [Stahn].
-
[30]
Jugement Bemba, supra note 2. À ce sujet, voir énumération précédente : trois meurtres, vingt-huit viols et vingt-et-un actes de pillage, et commis d’ailleurs à intervalles séparés et dans des lieux différents tout au long du conflit armé centrafricain.
-
[31]
Jugement Bemba, supra note 2 aux paras 461, 486, 520, 525, 527, 531, 534 et 563.
-
[32]
Ibid aux paras 162-165 et 688-690; Décision Bemba, supra note 4 au para 134.
-
[33]
Le Procureur c Akayesu, ICTR-96-4-T, Jugement (2 septembre 1998) au para 280 (Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambre 1), en ligne : TPIR <http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/fr/980902-1.pdf>: « [Witness K] testified she saw many people being brought to the bureau communal and killed, some of the victims only making it as far as the front of the entrance of the bureau communal before being killed. According to the witness, amongst those killed were professors from Remera school. She said the bodies of the victims, even those still alive, were put into wheelbarrows and taken for burial ». Le Procureur c Stakic, IT-97-24-T, Jugement (31 juillet 2003) (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance II), en ligne : TPIY <http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/fr/sta-tj030731-f.pdf>. Dans cette affaire, même si la Chambre a constaté que « même sans connaître le nombre exact de victimes, des meurtres ont été commis à un moment et en un endroit précis » (au para 201), la suite de son argumentation indique que pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur des massacres à grande échelle. Il s’agit notamment d’un massacre commis dans la pièce 3 du camp de Keraterm, le 24 juillet 1992 (au para 203); de l’exécution des prisonniers au camp de Keraterm, le 24 juillet 1992 et un autre massacre survenu le lendemain dans la pièce 3 du même camps (au para 207), l’exécution de plus de 100 prisonniers au camp d’Omarska, en juillet 1992 (au para 208), le meurtre de 44 hommes et femmes dans un autocar en provenance du camp d’Omarska en juillet 1992 (au para 210); le meurtre de 120 personnes au camp d’Omarska le 5 août 1992 (au para 211); le meurtre d’environ 200 personnes faisant partie du convoi du mont Vlašić, le 21 août 1992 (au para 214), etc.
Le Procureur c Kamuhanda, ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence (22 janvier 2004) (Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambre de première instance II), en ligne : TPIR <http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-99-54a/trial-judgements/fr/040122.pdf>. Dans l’affaire Kamuhanda, même si le témoin GEA avait déclaré ne pas connaître le nombre exact des morts, « car ils étaient très nombreux » (au para 345), nous ne devons pas oublier qu’un autre témoin, le témoin GEE, avait précédemment indiqué, par rapport à ce même massacre survenu à Gikomero le douze avril 1994, qu’ « il y avait environ 400 personnes dans les salles de classe de la paroisse de Gikomero » (au para 336); et que ce même témoin (GEE) avait eu la vie sauve parce qu’il a fait le mort parmi les cadavres jusqu’au lendemain à quatre heures du matin (au para 339). Par ailleurs, le témoin GEA avait dit qu’avant d’arriver à Gikomero, il s’était d’abord réfugié à Gishure, où il y avait « trois-mille réfugiés venus de plusieurs localités » (au para 340), et que plusieurs de ces réfugiés l’avaient, par la suite, rejoint à Gikomero (au para 340) où le massacre avait eu lieu. Ces éléments montrent qu’il s’agissait d’une tuerie de masse.
-
[34]
Décision Bemba (peine), supra note 3 au para 94.
-
[35]
Voir l’article 52 de la Loi n° 10.001 du 6 janvier 2010 portant sur le Code pénal centrafricain qui dispose que « tout coupable de meurtre est passible de la peine des travaux forcés à perpétuité », en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cf/cf003fr.pdf>; tandis que l’article 87 du même Code dispose que : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est qualifié de viol. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps […] », en ligne : IPO <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/88116/100661/F1881819351/CAF-88116.pdf>.
-
[36]
« Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à propos de la reconnaissance de la culpabilité de M. Jean-Pierre Bemba » (21 mars 2016), au para 8, en ligne : ICC <http://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-bemba-21-03-2016&ln=fr>.
-
[37]
Décision Bemba, supra note 4 au para 151.
-
[38]
Jugement Bemba, supra note 2 aux paras 164-65.
-
[39]
Cassese, supra note 8 à la p 358; Jones & Powler, supra note 8 à la p 191 au para 4.2.206; Mario Bettati, « Chapitre 8 : le crime contre l’humanité », dans Ascensio, supra note 8 aux pp 15 et 107; Yann Jurovics, « Article 7 : Crimes contre l’humanité », dans Julian Fernandez et Xavier Pacreau, dir, Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, à la p 472; Schabas, supra note 8 aux pp 166-67.
-
[40]
Cassese, supra note 8 à la p 358.
-
[41]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[42]
Statut de Rome, supra note 1, art 7(2).
-
[43]
Cour pénale internationale, Éléments des crimes, en ligne : CPI <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf>.
-
[44]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 159. Sur cette même question, voir Gerhard Werle et Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law, 3e éd, Oxford, Oxford University Press, 2014, à la p 230 au para 901 [Werle & Jessberger]; Darryl Robinson, « Chapter 28: Crimes against Humanity: A Better Policy on ‘Policy’ », dans Stahn, supra note 29 aux pp 709-10.
-
[45]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[46]
Ibid au para 673.
-
[47]
Statut de Rome, supra note 5, art 7(1).
-
[48]
Ibid au para 151.
-
[49]
Nahimana et consorts c Le Procureur, ICTR-99-52-A, Arrêt (28 novembre 2007) au para 692 (Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambre d'appel).
-
[50]
Statut de Rome, supra note 2, art 22(2).
-
[51]
Ibid, art 28(a).
-
[52]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 176.
-
[53]
Ibid au para 177.
-
[54]
Décision Bemba, supra note 4 aux paras 408-10.
-
[55]
Jugement Bemba, supra note 2 aux paras 384 et 697.
-
[56]
Ibid au para 697.
-
[57]
Ibid au para 705.
-
[58]
Ilias Bantekas, « The Contemporary Law of Superior Responsibility » (1999) 93 AJIL 580 [Bantekas]; Sonja Boelaert-Suominen, « Prosecuting Superiors for Crimes Committed by Subordinates: A Discussion of the First Significant Case Law Since the Second World War » (2001) 41 Va J Intl L 765 [Boelaert-Suominen].
-
[59]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 183.
-
[60]
Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[61]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 188.
-
[62]
Ibid aux paras 699-705.
-
[63]
Ibid au para 273.
-
[64]
Décision Bemba, supra note 4 au para 465.
-
[65]
Statut de Rome, supra note 1, art 28(a).
-
[66]
Volker Nerlich, « Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute: For What Exactly is the Superior Held Responsible? » (2007) 5 JICJ 671 [Nerlich].
-
[67]
Statut de Rome, supra note 1, art 30(3).
-
[68]
Décision Bemba, supra note 4 au para 479; Schabas, supra note 8 à la p 617; Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[69]
Voir notamment Bantekas, supra note 58 aux pp 587-90; Michael L Smidt, « Yamashita, Medina and Beyond: Command Responsibility in Contemporary Military Operations » (2000) 164 Mil L Rev; Mirjan Damaška, « The Shadow Side of Command Responsibility » (2001) 49 Am J Comp L 455 [Damaška]; Boelaert-Suominen, supra note 58 aux pp 776-77; Ambos, supra note 8 aux pp 828 et 832; Beatrice I Bonafé, « Finding a Proper Role for Command responsibility » (2007) 5 JICJ 605; Jenny S Martinez, « Understanding Mens Rea in Command Responsibility. From Yamashita to Blaškić and Beyond » (2007) 5 JICJ 638 [Martinez]; Amy J Sepinwall, « Failure to Punish: Command Responsibility in Domestic and International Law » (2009) Mich J Intl L 251.
-
[70]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[71]
Ibid au para 196.
-
[72]
Ibid au para 717.
-
[73]
Ibid aux paras 706-17.
-
[74]
Bantekas, supra note 58 à la p 587.
-
[75]
Martinez, supra note 69 à la p 642; Nerlich, supra note 66 à la p 674.
-
[76]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 708 : « significantly, such intelligence reports referred to various acts by “Banyamulengués” and “MLC troops”, including theft, pillaging, rape, the killing of civilians, harassment of persons, and the transportation of looted goods, including trucks for Colonel Moustapha, back to the DRC through Zongo and Libengue ». Pourtant, il est étrange que les services de renseignement civils et militaires du MLC aient employé le terme « Banyamulengués » qui renvoie à des populations d’origine rwandaise installées dans certains territoires du Sud-Kivu, alors que c’était plutôt les Centrafricains qui désignaient ainsi les soldats du MLC. Par ailleurs, le même passage semble faire une distinction entre les « Banyamulengués » et les « troupes du MLC », alors que, là encore, les services de renseignement du MLC, mieux que quiconque, étaient mieux placés pour établir l’identité entre ces deux entités.
-
[77]
Ibid au para 716.
-
[78]
Ibid au para 536.
-
[79]
Ibid au para 541.
-
[80]
Ibid au para 536.
-
[81]
Décision Bemba, supra note 4 au para 375.
-
[82]
Ibid au para 379.
-
[83]
Ibid au para 401.
-
[84]
Kai Ambos, « Critical Issues in the Bemba Confirmation Decision » (2009) 22 Leiden J Intl L 720: « In casu, the Chamber finds that Bemba does not even fulfil the first subjective requirement–that is, was not aware that the crimes would be committed. While this may be the right decision in the light of the evidentiary standard of Article 61(7) (‘substantial grounds to believe’) and the available facts, and, indeed, it has not been appealed by the Prosecutor, it is difficult to reconcile with the Chamber’s subsequent finding as to command responsibility, namely that Bemba ‘knew’ or even ‘actually knew’ that his troops were committing or about to commit the respective crimes. One wonders how it can be that one and the same person acts, on the one hand (as co-perpetrator), without knowledge and, on the other, with knowledge (as commander) with regard to the very same crimes ».
-
[85]
Mbokani, supra note 5 à la p 307.
-
[86]
Décision Bemba, supra note 4 au para 489. Nous soulignons.
-
[87]
Statut de Rome, supra note 1, art 28(a).
-
[88]
Werle & Jessberger, supra note 44 aux pp 230-31: « The superior is required to prevent the crime if his or her subordinates are ‘about to commit’ such crime […]. Once the crimes has been committed by the subordinates, preventive countermeasures are no longer possible ».
-
[89]
Jugement Bemba, supra note 2 aux paras 200-01.
-
[90]
The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01-/05-01/08, Public Redacted Version of Closing Brief of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo (April 22, 2016) para 64 (International Criminal Court, Trial Chamber III).
-
[91]
Jugement Bemba, supra note 2 aux paras 719-26.
-
[92]
Ibid. Notre traduction de « grossly inadequate response ».
-
[93]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 727.
-
[94]
Ibid au para 729.
-
[95]
Ibid au para 730.
-
[96]
Ibid au para 731.
-
[97]
Otto Triffterer, « Causality, a Separate Element of the Doctrine of Superior Responsibility as Expressed in Article 28 Rome Statute? » (2002) 15 Leiden J Intl L 200 [Triffterer].
-
[98]
Sandesh Sivakumaran, « Command Responsibility in Irregular Groups » (2012) 10 JICJ 1139 [Sivakumaran Command].
-
[99]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[100]
Ibid au para 207: « In the event the commander holds disciplinary power, he is required to exercise it, within the limits of his competence. If he does not hold disciplinary power, measures which may, depending upon the circumstances, satisfy the commander’s duties include proposing a sanction to a superior who has disciplinary power or remitting the case to the judicial authority with such factual evidence as it was possible to find. The ad hoc tribunals have established what has been termed a “minimum standard” for measures that may fulfil the duty to punish, directing that a Trial Chamber “must look at what steps were taken to secure an adequate investigation capable of leading to the criminal prosecution of the perpetrators”. The duty to punish includes, at least, the obligation to investigate possible crimes in order to establish the facts. The commander is required to take an “important step in the disciplinary process” ».
-
[101]
Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 art 87(3) (entrée en vigueur : 7 décembre 1978).
-
[102]
Le Procureur c Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, SCSL-04-16-T, Jugement (20 juin 2007) (Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Chambre de première instance II).
-
[103]
Alejandro Kiss, « Chapter 25: Command Responsibility under Article 25 of the Rome Statute », dans Stahn, supra note 29 à la p 631: « in the context of irregular armed groups, the question as to who is the competent authority has particular features. There is jurisprudence to the effect that if there was a disciplinary system available which could have been employed by the superior, this would provide an appropriate means of repression even in the circumstances where the system is not advanced in the sense of not being properly codified and formally sanctioned by competent authority ».
-
[104]
Le Procureur c Hadžihasanović et Kubura, IT-01-47-A, Arrêt (22 avril 2008) au para 152 (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre d'appel).
-
[105]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 208.
-
[106]
Secrétaire général des Nations Unies, Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, AG, Doc off AG NU, 58e sess, Doc NU A/58/534 (2003) au para 86.
-
[107]
Ibid aux paras 597-600 et 720.
-
[108]
Ibid au para 611.
-
[109]
Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[110]
Ibid, art 21(3).
-
[111]
Jonathan Somer, « Jungle Justice : Passing Sentence on the Equality of Belligerents in Non-international Armed Conflict » (2009), 7 RICR, 671-676 ; Sandesh Sivakumaran, « Courts of Armed Opposition Groups: Fair Trials or Summary Justice? » (2009) 7 JICJ 489 [Sivakumaran Courts]; Sivakumaran Command, supra note 98 aux pp 1129-1150.
-
[112]
The Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-406, Amicus Curiae Observations On Superior responsibility submitted pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence (April 20, 2009) au para 22 (International Criminal Court, Pre-trial Chamber II), voir Amnesty International : « the Statute requires the Chamber to interpret and apply the law in a manner “consistent with internationally recognized human rights”. Thus, in interpreting the term “competent authorities” the Chamber should have regard to international human rights law, which requires that individuals suspected of a crime be given “a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”. The term “established by law” is interpreted strictly to mean only by “a parliamentary statute or equivalent unwritten norm of common law” ». Voir aussi Mbokani, supra note 5 aux pp 312 et ss.
-
[113]
Sivakumaran Courts, supra note 111 à la p 509.
-
[114]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 199: « It is not determinative that the commander had the “explicit legal capacity” to take such measures; what matters is his material ability to act. In other words, what constitutes “all reasonable and necessary measures within his or her power” shall be assessed on the basis of the de jure and/or de facto power of the commander and the exercise he or she makes of this power ».
-
[115]
Voir sur cette question Antonio Cassese, « The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts » (1981) 30 ICLQ 416; Sandesh Sivakumaran, « Binding Armed Opposition Groups » (2006) 55 ICLQ 369.
-
[116]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 724.
-
[117]
Cour pénale internationale, "Annexe, Liste des documents", ICC-ASP/1/1/Add.1, en ligne : CPI <http://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/english/add1/annex_listofdocs_e.pdf>.
-
[118]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 208: « referral to a non-functionning authority or an authority likely to conduct an inadequate investigation or prosecution may not be sufficient to fulfil the commander’s obligation ».
-
[119]
Ibid.
-
[120]
Sivakumaran Command, supra note 98 à la p 1147.
-
[121]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 723.
-
[122]
Sivakumaran Courts, supra note 111 à la p 510 : « Although the possibility exists of a trial within the judicial system of the state, it is both impractical and unrealistic to require the armed group to have recourse to it. An armed group is simply not going to be willing to transfer those of its members suspected of having committed violations of international humanitarian law to the state against which it is in conflict for prosecution. It is equally untenable to suppose that state personnel captured by the armed group will be transferred to the state to stand trial for any alleged violation. Though such transfer is sometimes required, realism dictates otherwise ».
-
[123]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[124]
Ibid au para 723.
-
[125]
Statut de Rome, supra note 2, art 28(a)ii.
-
[126]
Ibid, art 28.
-
[127]
Ibid.
-
[128]
Jugement Bemba, supra note 2 au para 213.
-
[129]
Ibid.
-
[130]
Ibid au para 736.
-
[131]
Ibid au para 737.
-
[132]
Ibid au para 738 : « Such measures would have deterred the commission of crimes, and generally diminished, if not eliminated, the climate of acquiescence – which is inherent where troops have inadequate training, receive unclear orders, and/or observe their commanders committing or collaborating in crimes – surrounding and facilitating the crimes committed during the 2002-2003 CAR Operation. Mr Bemba’s failures in this regard directly contributed to, inter alia, the continuation and further commission of crimes ».
-
[133]
Ibid au para 741 : « In light of the above, the Chamber finds that, had Mr Bemba taken, inter alia, the measures identified above, the crimes would have been prevented or would not have been committed in the circumstances in which they were. The Chamber therefore finds beyond reasonable doubt that the crimes against humanity of murder and rape, and the war crimes of murder, rape, and pillaging committed by the MLC forces in the course of the 2002-2003 CAR Operation were a result of Mr Bemba’s failure to exercise control properly ».
-
[134]
Jugement Halilovic, supra note 10 au para 80; Chantal Meloni, « Command Responsibility: Mode of Liability for the Crimes of Subordinates or Separate Offence of the Superior? » (2007) 5 JICJ 628 : « The superior’s general failure to control his troops does not entail criminal responsibility per se in international law. The superior’s criminal responsibility flows from the neglect of a specific duty to take the measures that are necessary and reasonable in the given circumstances, in order to prevent those specific crimes or to punish the perpetrators thereof ». Voir aussi Sivakumaran Command, supra note 98 à la p 1139.
-
[135]
Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[136]
Chambre des représentants de Belgique, Rapport fait au nom de la commission d’enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci, Doc n° 50 0312/007, volume II (16 novembre 2001) à la p 839. Selon le rapport de la commission parlementaire belge chargée de déterminer les circonstances de cet assassinat, « certains membres du gouvernement belge et d’autres acteurs belges (ont eu) une responsabilité morale dans les circonstances (ayant) conduit à (cet assassinat) ».
-
[137]
Voir notamment : Code civil congolais, livre III, art 260(3); Code civil belge, art 1384(5).
-
[138]
Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[139]
Décision Bemba, supra note 4 au para 424.
-
[140]
Damaška, supra note 69 à la p 490; Robinson, supra note 15 à la p 17.
-
[141]
Damaška, supra note 69 à la p 490, citant notamment l’affaire des Otages.
-
[142]
Ibid à la p 468, voir hypothèse de la « failure to punish tout court ».
-
[143]
Ibid.
-
[144]
Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2009 aux pp 43 et 80 [Mettraux].
-
[145]
Damaška, supra note 69 à la p 469.
-
[146]
Robinson, supra note 15 à la p 17.
-
[147]
Le Procureur c Delalic, Mucic, Delic et Landzo, IT-96-21-A, Arrêt (20 février 2001) au para 400 (Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Chambre d’appel); Le Procureur c Blaškić, IT-95-14-A, Arrêt (29 juillet 2004) aux paras 76 et 83 (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre d'appel); Le Procureur c Oric, IT-03-68-T, Jugement (30 juin 2006) au para 338 (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de première instance II).
-
[148]
Décision Bemba, supra note 4 au para 424.
-
[149]
Triffterer, supra note 97 à la p 189; Mettraux, supra note 144 à la p 33; Schabas, supra note 8 à la p 615.
-
[150]
Jugement Bemba, supra note 2 : Aussi bien les crimes qui ont été commis au début de l’intervention militaire du MLC dans le conflit armé centrafricain, et notamment à Bangui et au Point Kilomètre 12 ou « PK12 », que ceux qui sont survenus ultérieurement vers la fin de cette intervention militaire, notamment à Mongumba.
-
[151]
Statut de Rome, supra note 1, art 28.
-
[152]
Paul de Visscher, « Cours général de droit international public », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol 131, La Haye, 1972, à la p 183.
-
[153]
Jugement Bemba, supra note 2.
-
[154]
Ibid.
-
[155]
Statut de Rome, supra note 1, art 21.
-
[156]
Ibid, art 28.
-
[157]
Jugement Bemba, supra note 2.