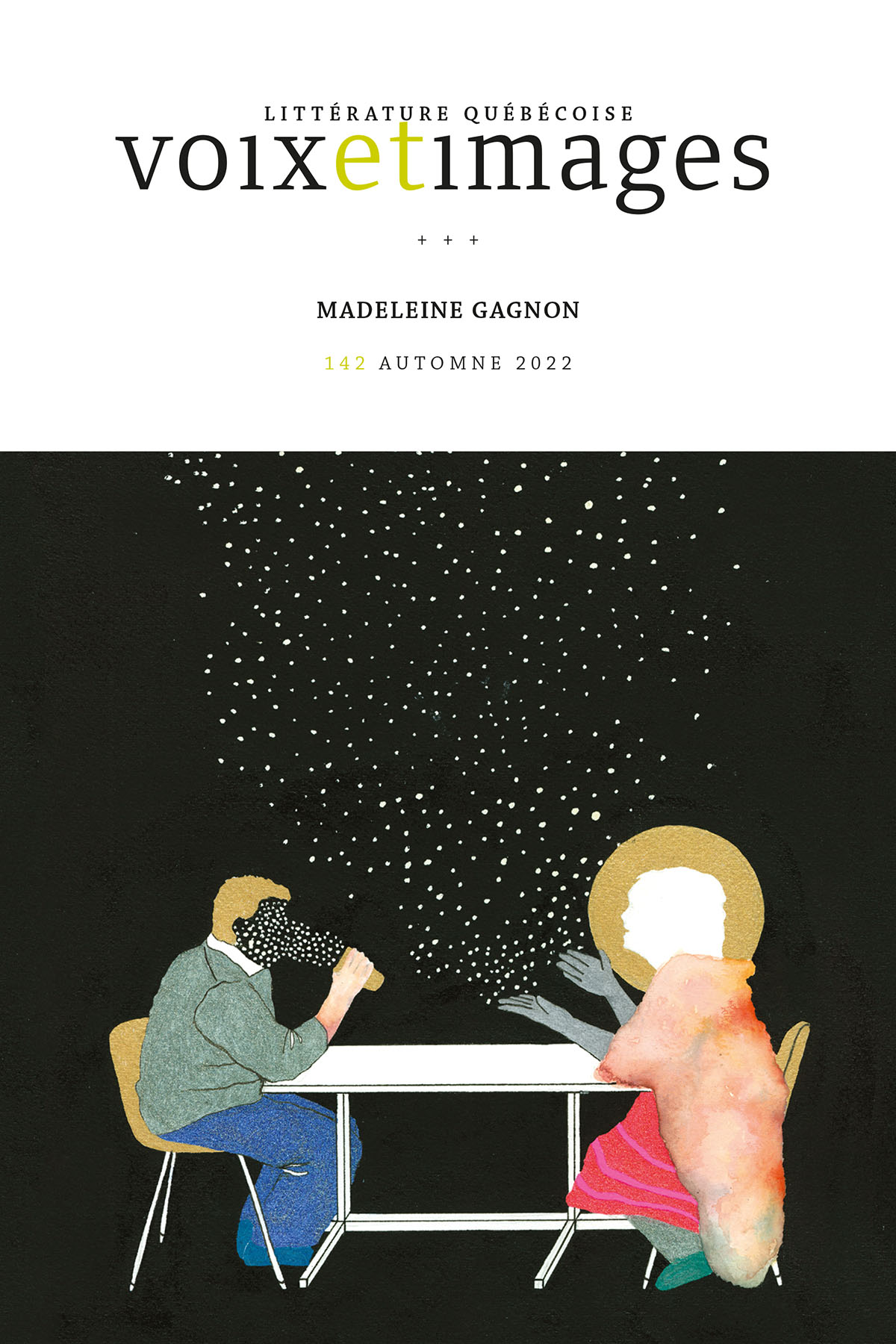Résumés
Résumé
Cet article se penche sur le travail de l’écriture de Gagnon, envisagé dans sa dimension subjective où se trouve mis à découvert le vide qui habite toute parole. S’y trouvent analysés les textes théoriques de Gagnon publiés au sein de périodiques et son premier texte poétique, où la quête d’atteindre ce vide – que Gagnon décline à travers l’image de « l’interstice signifiant » – est manifeste, voire explicitée : le recueil Antre (1978). Il s’agit dès lors de cerner, avec les écrits de Gagnon et en déployant certaines notions psychanalytiques qui impulsent son écriture (jouissance, réel, pulsion de mort), la nature de cet interstice, de même que ses potentialités poétiques et politiques. Car l’écriture, chez Gagnon, est à la fois ce qui permet d’explorer cet interstice et de ne pas y sombrer, un tel lieu étant conçu comme un espace de disparition, où les repères sont amenés à être dissous, mais aussi, et par là même, comme un espace à investir. L’article s’intéresse également aux conséquences institutionnelles de cette proposition poétique de Gagnon, dans son propre parcours et au sein de certains discours critiques ayant suivi ses publications.
Abstract
This article focuses on Gagnon’s writing process, viewed from its subjective dimension where the gaps intrinsic to all speech are exposed. It analyses Gagnon’s theoretical texts published in periodicals and her first poetic text, where the quest to enter this void - which Gagnon describes through the image of the “signifying interstice” - is evident, even explained: the Antre collection (1978). Hence, it is a question of defining the nature of these intervening spaces as well as their poetic and political potential through the writings of Gagnon and by applying certain psychoanalytic notions that drive her writing (jouissance, reality, death wish). For Gagnon, writing is that which allows an exploration of this void without sinking into it, such a location having been conceived as a space in which to disappear, where points of reference are introduced in order to be dissolved, and at the same time, as a space in which to invest. The article also examines institutional consequences of Gagnon’s poetic proposition on her own journey and on certain critical discourse subsequent to her publications.
Resumen
Este artículo examina la escritura de Gagnon en su dimensión subjetiva, que revela el vacío que habita toda palabra. En él se analizan los textos teóricos de Gagnon publicados en periódicos y su primer texto poético, en el que la búsqueda de alcanzar ese vacío -que Gagnon revela mediante la imagen del "intersticio significante"- se pone de manifiesto, incluso se explícita: la recopilación Antre (Antro) (1978), Se trata por lo tanto de identificar, a partir de los escritos de Gagnon y de ciertas nociones psicoanalíticas que animan su escritura (el goce, lo real, la pulsión de muerte), la naturaleza de este intersticio, así como su potencial poético y político. Para Gagnon, la escritura es lo que permite explorar este intersticio y, a la vez, el medio de evitar hundirse en él, un lugar concebido como un espacio de desaparición, donde las referencias están destinadas a disolverse, pero también, y por la misma razón, como un espacio en el que hay que enfocarse. El artículo aborda también las consecuencias institucionales de esta propuesta poética de Gagnon, en su propia trayectoria y en ciertos discursos críticos que han seguido a sus publicaciones.
Corps de l’article
Elle serait devenue le coeur même de la pierre sur laquelle reposait sa tête, ayant consenti, s’étant donnée entière au piège parfait de la mémoire, n’ayant pas refusé ses blancs, s’y étant même collée, jusqu’à ce que la pénombre revenue, la barre opposant noir et blanc, lignes et interlignes, inscriptions et marges, se fut dissoute dans l’interstice signifiant[1].
« Ne trouvant pas de lieu pour situer politiquement notre travail[2] », écrit Gagnon en ouverture de son premier article savant, publié dans Voix et Images du pays, « nous admettrons tout de même au départ, avec Julia Kristeva, les propriétés destructives/constructives du langage poétique, le pouvoir, non plus d’ornementation ou de transposition de la métaphore […], mais celui de transformation[3] ». Dans cet article datant de 1972 consacré à Angéline de Montbrun et précédé de deux épigraphes sur la métaphore – une de Jacques Lacan et une de Jacques Derrida[4] –, Gagnon, l’air de rien, participe à échafauder un pont entre les études littéraires et la psychanalyse lacanienne au Québec. Son objectif : aborder l’arrimage entre le sujet et le langage, « sortir du langage et aborder le travail de l’écriture[5] » en affirmant au passage la difficulté à situer épistémologiquement ce projet nouveau. Il s’agissait alors de se tailler une place dans l’institution universitaire en bousculant l’ordre établi, de s’inscrire dans une tradition interprétative en l’écorchant au passage, ce dont témoigne la réticence avouée de Gagnon à utiliser le nous de modestie : « je dis nous pour ceux qu’on appelle les “gens de lettres”, critiques, professeurs ou poètes, tous écrivains de ces discours que l’on distingue faussement par ce doublet d’opposition théorique/métaphorique[6] ». Dès lors que l’on s’intéresse à ce que le langage fait au sujet – ce qu’il transforme, construit, détruit en lui – et que l’on prend en écharpe la dimension exclusivement esthétique des oeuvres – l’ornementation –, l’opposition entre écriture théorique et écriture littéraire n’a en effet plus lieu d’être.
Alors qu’elle dirige à la même époque la rédaction d’un rapport d’orientation du Département d’études littéraires de l’UQAM, Gagnon, de même que tous ses collègues en poste depuis la fondation du Département en 1969, est amenée à fournir une « analyse critique » de son apport aux études littéraires. Abordant les rapports entre « idéologie littéraire et psychanalyse », elle y affirme que réfléchir conjointement aux théories littéraires et aux théories du sujet « a eu comme conséquence […] de proposer une définition beaucoup plus concrète et opératoire du symbole pour le travail de déchiffrement du texte littéraire » : « la linguistique demeurera une science positiviste tant qu’elle ne tiendra pas compte des recherches opérées sur le langage par la psychanalyse freudienne[7] ». Ce qu’il s’agit ici de considérer, pour elle, c’est la dimension du vide au coeur de la parole. « [P]arler signifie que je consens au vide, à la perte, à la négativité[8] », écrit le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, la subjectivité étant selon cette perspective « ce qui résulte de [la] discontinu[ité] imposé[e] par le système du langage[9] » – nous y reviendrons. Enfin, Gagnon signale dans cette analyse critique avoir tenté depuis son entrée en poste « d’effectuer un travail d’écriture [littéraire] qui creuserait, avec les moyens propres au langage poétique, plusieurs de ces intuitions [théoriques][10] ». Pour le dire avec Paul Chanel Malenfant, qui remarque l’intrication chez Gagnon de ces deux langages, « l’auteure détient, quant à l’art de lire, une compétence à la fois passionnelle et théorique qui sans cesse irrigue, par ubiquité, son art d’écrire et de faire le poème[11] ».
Cet article se penchera précisément sur ce travail de l’écriture de Gagnon, envisagé dans sa dimension subjective où se trouve mis à découvert le vide qui habite toute parole. On se tournera alors simultanément vers les textes théoriques de Gagnon publiés au sein de périodiques et vers son premier texte poétique où la quête d’atteindre ce vide – que Gagnon décline à travers l’image de « l’interstice signifiant » – est manifeste, voire explicitée : le recueil Antre (1978), auquel s’ajouteront ponctuellement des références à d’autres recueils travaillés par cette même quête : Pensées du poème (1983), La lettre infinie (1984) et Les fleurs du Catalpa (1986). Il s’agira dès lors de cerner, avec les écrits de Gagnon et en déployant certaines notions psychanalytiques qui impulsent son écriture (jouissance, réel, pulsion de mort), la nature de cet interstice, de même que ses potentialités poétiques et politiques. Car l’écriture, chez Gagnon, est à la fois ce qui permet d’explorer cet interstice et de ne pas y sombrer, un tel lieu étant conçu comme un espace de disparition, où les repères sont amenés à être dissous[12], mais aussi et par là même comme un espace à investir, en tant qu’il est capable de mettre fin à « l’illusion du connu » (A, 243). « J’écris pour raconter les […] interstices d’où l’on aurait bien pu ne jamais revenir et n’en jamais parler » (A, 199), lit-on dans Antre. Nous serons ainsi menés à analyser sa poétique en investissant les deux lieux qui aimantent son écriture et dans lesquels ce vide est approché : le vide duquel la subjectivité est issue et celui dans lequel elle s’abolit, ou plus précisément le temps de l’infans et celui de la mort. Nous aborderons au passage quelques conséquences institutionnelles de cette proposition poétique de Gagnon, dans son propre parcours et au sein de certains discours critiques ayant suivi ses publications. Finalement, nous proposerons une analyse du poème inédit publié dans les pages de ce dossier de Voix et Images à la lumière de notre itinéraire théorique, opposant ainsi les premiers et derniers écrits de Gagnon à l’égard du vide en question.
LE VIDE AU FONDEMENT DE LA PAROLE
« Sans mots, le vide[13] ». C’est par cette formule que Gagnon ouvre son article « Des mots plein la bouche », par cette courte phrase, simple en apparence, mais plus complexe qu’elle n’en a l’air. Gagnon se réfère ici à la préhistoire du sujet, au contact premier avec le corps parental, ce moment où le nourrisson n’était pas encore séparé de sa « terre montagne généreuse », où des « mots d’amour et de jouissance » lui parvenaient directement « par succion » (TEA, 77). Les mots dont il est question ici sont encore en deçà du langage. Ils sont profondément organiques, immédiats, ancrés dans le corps : il s’agit là, suivant la formule de Louise Dupré, d’une « langue d’avant la langue[14] », ou pour reprendre une image créée par Gagnon elle-même, d’une « langue ombilicale » (TEA, 17). Le vide, dès lors, apparaît dans le moment de séparation, il est produit par l’absence soudaine de ces mots « d’amour et de jouissance », par la distance physique qui s’instaure entre l’infans et cette langue ombilicale « à jamais perdue » (TEA, 17), entre l’infans et cet état de symbiose originelle.
À travers le surgissement de ce vide, Gagnon décrit en fait le moment charnière de l’entrée dans le langage, de l’avènement du sujet parlant tel que la psychanalyse est amenée à le concevoir. En créant un écart entre le sujet et le monde, le langage relègue en effet l’état de plénitude originel à un espace à jamais perdu, à un espace de jouissance désormais inaccessible au sujet, que Jacques Lacan nomme « le réel » et qui n’est d’ailleurs pas sans rapport avec l’ombilic[15]. Le désir est alors la tension qui lie le sujet à cet espace inaccessible, une tension qui a à voir avec le langage, lequel crée l’écart en même temps que l’unique moyen de le suturer. Autrement dit, le langage empêche la complétude, mais permet le fantasme, celui qui consiste à tenter (toujours vainement) de « saisir […] la distance » (TEA, 77) instaurée entre le sujet parlant et l’état de jouissance premier[16]. Cette volonté de chercher à combler la distance est pour Gagnon ce sur quoi se fonde une certaine idée du travail d’écriture. Dans l’article intitulé « Tu tourneras ta langue », elle propose ainsi d’appréhender l’écriture au prisme de cet écart, de cette perte fondatrice :
Avec les mots de la patrie, ton écriture parlera de cette origine, comme d’un paradis perdu et retrouvé seulement dans le chant de ta langue quand celle-ci, à travers la mémoire perdue de sa propre chair, invente de toutes pièces, comme à partir de rien, une immémoriale présence.
TEA, 18
Gagnon assigne à l’écriture, avec « les mots de la patrie » (c’est-à-dire les mots appris, ceux du langage courant[17]), la mission de dire, ou de faire résonner, ce qui se situe en amont de la perte, dans ces temps premiers où le langage et le sujet n’étaient pas constitués. Pour ce faire, elle évoque alors une « seconde langue ombilicale, la tienne[18] » (TEA, 17), singulière à chaque sujet, directement connectée à la langue commune, mais aussi et surtout à la perte originelle : « ta langue à toi s’est séparée de la langue maternelle en même temps que ton corps se défaisait [de celui de ta mère] » (TEA, 17). Cette seconde langue ombilicale est ainsi ontologiquement liée au vide, elle s’abreuve à la source du manque sur lequel elle s’édifie. Par conséquent, elle devient pour Gagnon le médium permettant l’élaboration poétique dont le but avoué est celui de dire « l’immémoriale présence » (TEA, 18) des premiers temps. Cette tension entre les deux langues ombilicales (l’une tentant de dire l’absence de l’autre) représente une manière de situer, voire de résoudre l’apparente contradiction que Gagnon a, en d’autres occasions, formulée en ces termes : comment écrire une « parole littéralement pré-alphabétique » qui doit pourtant « traverser tous les codes des alphabets pour se dire, s’énoncer[19] » ?
On touche ici au coeur du paradoxe sur lequel s’élabore la poétique de Madeleine Gagnon, un paradoxe qui intéresse aussi la théorie psychanalytique. Comme le montre Lacan, la perspective de ressaisir cette distance entre en effet en contradiction logique avec la constitution du sujet parlant, pour qui « l’immémoriale présence » et sa « langue pré-alphabétique », conçues comme lieux de jouissance, demeurent au premier abord indicibles. La jouissance est alors désirée et marquée au sceau de l’impossible, elle est ce point au-delà du plaisir où le sujet se dissoudrait dans l’indifférenciation présymbolique : « Ce à quoi il faut se tenir, c’est que la jouissance est interdite à qui parle comme tel, ou encore qu’elle ne puisse être dite qu’entre les lignes pour quiconque est sujet de la Loi, puisque la Loi se fonde de cette interdiction même[20] », écrit Lacan. La psychanalyste Christiane Lacôte-Destribats précise cette dimension dans cette efficace formule : « La jouissance est interdite, non pas au sens facile où elle serait barrée par des censeurs, elle est inter-dite, c’est-à-dire qu’elle est faite de l’étoffe même du langage où le désir trouve son impact et ses règles[21]. » Nous prendrons plus loin la mesure de cette proposition qui consiste à situer la jouissance entre les mots. Il faut d’abord distinguer la jouissance du plaisir en ce qui a trait à l’écriture. La perspective de Gagnon est en fait très proche de celle de Roland Barthes, pour qui le plaisir du texte « est lié à une pratique confortable de la lecture », alors que le texte de jouissance, de son côté, « met en état de perte, […] déconforte […], fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage[22] ». La jouissance, chez Gagnon, « c’est ce qui ne craint pas de faire passer la blessure dans le plaisir » (TEA, 166). Prôner une telle écriture a des conséquences à la fois poétiques et politiques. Car pour Gagnon, l’injonction au simple plaisir du texte n’est pas neutre, mais idéologique ; elle a une valeur prescriptive, neutralisante, qui suspend de facto toute possibilité de parole « [e]xcentrique ou [a]normale » (TEA, 40-41). Vue au prisme de la jouissance, l’écriture devient au contraire une manière de faire « l’expérience des limites » fixées par le plaisir d’écrire, de le subvertir en venant inquiéter les assises d’un sujet qui, en se risquant à errer au sein d’une « expérience matricielle, donc archaïque, archéologique […] » (TEA, 39), parlerait d’une « voix qui se signerait étrangère et exilée » (TEA, 41), seule voix capable de faire taire le « babillage de la doxa » (TEA, 42), seule voix capable de produire de l’inouï. Une écriture prenant le parti de la jouissance suppose ainsi de chercher à s’énoncer depuis un lieu différent de celui qui serait placé sous le signe du plaisir, un lieu envisagé comme éminemment subjectif et personnel, mais également comme terrain privilégié d’une lutte discursive et donc politique. La suite de l’article mettra en évidence les conséquences poétiques de cette posture.
ÉCRIRE DANS SON ANTRE
« [J]e suis devenue translucidité, une épilepsie douce en pleine lumière jouissance et n’ai eu qu’à détruire ce que j’ai aimé en me détruisant » (A, 227), écrit Gagnon dans Antre, elle pour qui l’idée de la jouissance comme destruction est familière. Dans son premier entretien à Voix et Images en 1982, elle déclarait : « Il faut être très fort pour parvenir, au-delà du désert des mots, à la jouissance », laquelle était d’ailleurs opposée au « plaisir à écrire[23] ». Atteindre le vide au coeur des mots est posé comme une éthique de l’écriture qui nécessite une difficile plongée en soi, dans son antre. Dans l’entretien, le « plaisir à écrire » est quant à lui associé par Gagnon – à l’échelle de son oeuvre – à la pratique littéraire collective, ouvertement militante et pétrie d’intertextualité marxiste, qui aura donné lieu à ses premiers textes poétiques (Poélitique et Pour les femmes et tous les autres), lesquels sont relativement reniés par l’autrice. À propos de ces deux recueils qui précèdent Antre et qui n’ont pas été repris dans son anthologie À l’ombre des mots en 2004, elle écrit en note liminaire : « J’ai choisi de les laisser dormir là en paix[24] », « là » désignant leurs lieux de publication précédents. Antre a donc le statut particulier d’être le premier texte poétique assumé par Gagnon, d’abord publié aux Herbes rouges et ensuite presque entièrement repris, en fragments, dans son « roman archéologique » Lueur paru chez VLB l’année suivante, où elle publiera, à quelques exceptions près, l’ensemble de son oeuvre ultérieure. Dans l’entretien, Gagnon signale la difficulté à exprimer sa voix au sein des Herbes rouges, où l’esprit de communauté des écrivains de la maison – « un groupe relativement homogène, avec beaucoup de cohésion[25] », dit-elle – aurait engendré un certain climat dans lequel il lui semblait impossible de poursuivre sa quête poétique :
[J]’ai découvert, malgré moi et malheureusement, que dans tout collectif sont mises en place des finalités de pouvoir nuisibles à l’écriture et somme toute, à l’acte créateur. Si on se met à voir et à nommer les structures hiérarchiques aliénantes d’un collectif, on s’aperçoit que cette parole n’a pas sa place. La parole qui dit, qui montre le pouvoir est une parole qui ne peut pas avoir sa place dans un collectif ou dans une organisation, qui doit se dire seule d’une certaine façon. Cette parole, isolée, devient irrecevable[26].
L’antre, ce lieu de retrait, de solitude, s’oppose à la « chapelle » où s’exprime « un fantasme du collectif[27] ». Enfin, cette parenthèse vise à signaler que sur le plan institutionnel, le sort de ce recueil témoigne de cette plongée en soi, vers une sensibilité accrue à la logique du désir. Plongée en soi dont il faut peut-être dire qu’elle ne nie pas la portée politique de l’écriture, seulement vient un moment où elle se manifeste moins en amont de l’écriture de Gagnon qu’en son sein et en son aval, une telle plongée ayant pour ambition de produire un « dérèglement discursif[,] [un] (dé)lire » (TEA, 126), auquel Gagnon, dans une perspective politique, appelle à adhérer collectivement. Du reste, Gagnon rejette la dichotomie entre désir et politique, qui doivent selon elle être tous deux pensés ensemble ; fidèle à une volonté d’embrasser une certaine forme de négativité, elle fait le choix de l’« impouvoir », disposition qu’elle décrit ainsi : « II s’agit tout simplement d’une absence, comme d’un vide intérieur, d’une disponibilité qui laisserait très grande la place du désir, pour soi, pour les siens et pour sa propre littérature […]. » (TEA, 178) Si le désir de chacun s’efface dans le groupe et engendre la domination – comme il en va du patriarcat –, la posture du retrait permet au sujet d’apercevoir le pouvoir, de le décrire, de le combattre. C’est à partir de l’antre que l’on peut apercevoir au-dehors la lumière-lueur. C’est « assis[e] calmement dans le creux de la jouissance » que l’on peut accéder à « l’inondation du sens » (A, 243), puis le partager par ailleurs sous la forme d’une « parole déréglée » (TEA, 126) et subversive.
« ENTRE LA NUIT D’HIER ET CELLE DE DEMAIN[28] »
Revenons à l’« inter-dit », où la psychanalyse situe la jouissance, expression qui permet de penser l’oeuvre de Gagnon dans sa tentative de représenter, par les mots, un état ou un temps en deçà du langage. Du point de vue d’un sujet fondamentalement appréhendé comme être de langage, cet en deçà s’apparente de facto à celui de la mort, puisque le sujet ne saurait exister hors de l’ordre symbolique qui le constitue. On retrouve bien là une proposition centrale de la théorie freudienne : la mort est assurément ce qui attend le sujet, mais aussi ce qui le précède, c’est « le rien de l’origine[29] » vers lequel il tend. Il s’agit là d’une conception de la mort en deux versants, à laquelle Gagnon fait elle-même écho dans son travail poétique, en convoquant conjointement « la nuit d’hier et celle de demain », ou en soulignant que le langage naît « dans ces lieux, où la jouissance et la souffrance ne se mesurent plus » : c’est « à la fois son origine et sa fin » (A, 199).
La pulsion de mort est le nom que Freud donne à cette condition qui trouve d’abord chez lui une explication naturaliste (la nécessité d’un abaissement de la tension libidinale) et lui permet d’appréhender la logique selon laquelle le sujet répète à son corps défendant non pas ce qui lui apporte du plaisir, mais ce qui lui est familier, en l’occurrence ici : une complétude, conceptuellement associée à un retour à l’origine, avant l’apparition du langage, et conséquemment, du désir et du manque. Gagnon écrit à partir de cette perspective de la mort comme absence, voire comme fin du désir : « Le jour où je serai satiable/sera celui de ma mort/je serai rassasiée/quand je ne serai plus[30] », peut-on lire dans ses Pensées du poème. La mort et la jouissance sont présentées comme point d’aboutissement du désir, là où le sujet disparaît à lui-même. On reconnaît là la conception lacanienne du désir comme « volonté de jouissance[31] » : « Le chemin vers la mort n’est rien d’autre que ce qui s’appelle la jouissance[32] », écrit Lacan. Mais la mort, dans cette logique qui concerne tout sujet parlant, n’est évidemment pas l’objet du désir conscient, sans quoi il n’y aurait pas de vie possible : « la pulsion cherche [aussi] à empêcher le point d’arrivée d’être atteint, elle le pousse en avant à l’infini, sans le faire disparaître[33] », écrit la psychanalyste Silvia Lippi. La pulsion de mort, c’est également ce qui pousse en avant le point d’arrivée. Par le mouvement de retour qu’elle engage, elle oppose une force contradictoire à celle qui tend linéairement vers la fin de la vie, vers l’abolition du sujet : c’est de ces mouvements contradictoires qu’un équilibre vital est possible.
Avec le langage, le vide est approché, il est effleuré tout en étant maintenu à distance sécuritaire, et de ce mouvement, de ce presque-contact, naît une certaine satisfaction, à l’image du « je » du poème que l’on imagine « rassasié », alors que c’est là une impossibilité logique : on n’est jamais rassasié du lieu de son « je », puisque dans la complétude « je » ne suis pas sujet. Dans la mort, je ne serai pas rassasié, puisque je ne serai plus : il faut le poème pour lever la barre entre l’être et le néant, pour occuper l’espace du vide sans pour autant y disparaître. On ne peut être à la fois vivant et mort, Gagnon le sait, elle qui dans le même recueil avance que « dans la mort/aucun être-de-moi/ne pourrait subsister » (P, 33). Pourtant, il s’agit pour elle, d’une oeuvre à l’autre, de résoudre cette aporie par l’écriture, ce que semble annoncer le titre de son premier livre de fiction, Les morts-vivants, qui place côte à côte ces deux termes que Gagnon ne cesse de vouloir arrimer en niant (poétiquement) que l’un signe la fin de l’autre. « La poésie seule conduit vive à la mort/poésie vive mort/outre vie[34] », écrit-elle ailleurs.
Ainsi, dans une perspective psychanalytique, le vide vers lequel tend le sujet est à la fois le rien de l’origine et celui de la mort, mais également celui qui se loge au creux du langage, dans « l’inter-dit », « au coeur de la lettre », pour citer le recueil du même nom. Ces deux versants de la mort auxquels l’écriture de Gagnon est aimantée sont perçus par elle comme détenteurs d’une vérité poétique. « [À] proximité de la mort/l’oreille est touchée/par de l’inouï » (P, 13), écrit-elle, tandis que l’autre versant, celui de la « mort précédente » (A, 214), est appréhendé comme « un temps de l’inédit[35] », signalant qu’il y a une pointe de jouissance, en même temps qu’un savoir à aller chercher, dans le fait de border le trou, celui de l’en deçà, de la mort, du vide. La démarche de Gagnon est vertigineuse : la poète tente d’occuper le lieu de son absence première et d’anticiper sa propre disparition, avec le langage comme écran entre soi et l’abîme. C’est là un risque à prendre, un risque que Gagnon évoque dans un des fragments d’Antre : la perspective de « grimper sur le garde-fou du langage risque de [lui] donner le vertige et de [la] happer au vide d’eau d’en bas très loin » (A, 237). C’est précisément parce que le langage est là comme « garde-fou » que la mort peut être bordée, voire « accomplie », sans pour autant qu’on s’y abîme, comme Gagnon semble du reste le suggérer dans cette énigmatique formule par laquelle elle tente d’expliciter la dialectique qui s’instaure entre l’écriture et la mort : « Devant une oeuvre créée la mort s’efface. J’écris pour accomplir la mienne. » (TEA, 21) Alors que l’énoncé propose que l’écriture efface la mort, il donne aussi à lire que Gagnon écrit pour accomplir « la [s]ienne », sa mort. À moins que « la sienne » ne désigne « l’oeuvre » ? Posons pour l’instant que l’ambiguïté de la formulation est voulue et ajoutons que l’oeuvre littéraire l’assume, la rejoue – notamment dans Lueur, conçu comme un « projet fou d’écriture […] ayant fait le pari d’émerger de la mort même, de raconter ce qui vient de l’absence, [un] projet fomenté à même la démesure du rien[36] ».
UN LIEU « BLANCHI PAR LES ANS »
Comment, alors, accomplir sa propre mort, tel que le suggère Gagnon ? En quoi l’écriture peut-elle permettre d’occuper le lieu de la mort, sans pour autant qu’on s’y anéantisse ? Et de quelle mort parle-t-on, au juste ? Ce retour à un temps d’absence premier, vers un espace oublié, au sein duquel le sujet n’était pas encore constitué, Gagnon le désigne par l’image d’un lieu « blanchi par les ans » (TEA, 78, 166 et 172).
Chez Gagnon, la mention d’un tel lieu apparaît pour la première fois dans son article « Des mots plein la bouche », publié en 1977. L’expression est empruntée à Freud, qui dans une lettre de 1897 affirmait se heurter à l’énigme de « cette première liaison à la mère […] difficile à saisir psychanalytiquement, blanchi[e] par les ans, […] comme si cela avait succombé à un refoulement inexorable[37] ». Un tel lieu pose alors le paradoxe d’un socle sur lequel s’édifie notre subjectivité, mais dont nous ne pouvons pas porter la mémoire ; il s’agit d’un souvenir « qui se livrait senti sans éprouver […], vu sans le voir, […] bu sans le boire » (A, 228), c’est-à-dire : en notre absence. Paru une année après son article théorique, Antre reprend alors l’image d’un tel lieu d’absence, en le plaçant comme l’enjeu du processus d’écriture : « l’écriture reconstruit ce qui fut grugé par l’érosion du temps, redécore ce qui fut blanchi par les ans » (A, 225). L’écriture permettrait de (ré)habiter le lieu « blanchi par les ans » en la présence du sujet, cette fois-ci, dans le but revendiqué de se réapproprier « [s]a plus lointaine étrangeté » (A, 200).
L’antre, que la trajectoire du recueil cherche à « retrouver » (A, 220), peut dès lors être lu comme la déclinaison esthétique d’un tel projet de retour, où il s’agit de revenir sur une scène originelle dont on a été expulsé ; « j’écris […] pour dévaster ce qui m’abstrait des premières images constitutives » (A, 226). Comme souvent chez Gagnon, et conformément à son ambition de dénouer l’opposition « théorique/métaphorique », la poésie prend le relais de la théorie (ou plutôt, s’en mêle), en se proposant d’explorer un « lieu où le discours n’a pas osé descendre » (A, 209). Cet antre est alors présenté comme le lieu d’une mort paradoxalement « vivante » (A, 198), témoignant ainsi de l’ambiguïté d’un espace où le mortifère et le jouissif sont indissociables, d’un espace « d’antre les morts » (A, 210) au sein duquel la poète affirme pourtant que « ça coulait de bien-être sur [s]es cuisses chaudes » (A, 202). L’enjeu est de pouvoir saisir et « dire encore ce qui vient de ce lieu blanchi par les ans » (TEA 78), quand bien même cette entreprise se heurterait à l’indicible, un tel lieu renvoyant d’abord « au vide[,] à l’absence[,] à la perte de ce qui ne peut se transcrire » (A, 206). Mais Gagnon ne renonce pas pour autant à occuper ce vide, à le dire, ni même à l’entendre, et elle insiste alors dans un entêtement qui caractérise sa démarche : « j’élirai des contrées pour m’en approcher, je collerai l’oreille au marbre de son nom, résonneront en moi ses fibres sonores » (A, 207).
Ainsi, l’antre résonne, tandis que le vide, l’absence et la perte sont des éléments qui s’entendent, par l’intermédiaire notamment d’une « troisième oreille ou [d’une] oreille flottante » (A, 209) que Gagnon a, dans ses écrits théoriques, explicitement liée à l’écoute analytique (TEA, 123). Ce qu’il s’agit d’écouter dans cet antre, dans ce lieu prélangagier d’« où revient pourtant le langage » (A, 199), c’est le « bruissement de toutes choses vivantes » (A, 203), situées sur le plan d’un réel asymbolique, que Gagnon, par sa démarche poétique, cherche paradoxalement à percevoir aussi dans le « bruissement des mots » (A, 204). Par la coïncidence d’un tel bruissement de la chose vivante et du mot, c’est en fait l’écart entre (antre ?) le mot et la chose qui se trouve remis en cause. Car le mot est avant tout « meurtre de la chose[38] », c’est-à-dire que le mot ne peut pas dire la chose elle-même, mais ne peut qu’en tenir lieu, en son absence. Entre la chose et le mot existe donc un écart nécessaire pour que le langage soit, et c’est cet écart, cet espace vide, cet « interstice », que Gagnon cherche à habiter en « persist[ant] à ne pas vouloir vider le coeur des mots[39] ». Ainsi, en renouant avec l’antre, conçu comme lieu de l’origine, en ne refusant pas ses « blancs » ou son défaut de « mémoire », il serait possible de toucher du doigt « l’interstice signifiant », ce creux situé au coeur du langage et à l’origine de la séparation d’avec la chose, au sein duquel, dans une perspective poétique révolutionnaire, tous les repères pourraient être amenés à être dissous et reconfigurés.
Pour Gagnon, il s’agit d’assigner à l’écriture le rôle de se situer de part et d’autre de cet interstice, c’est-à-dire du côté du mot et de la chose, du côté de la « machine lexicale » (A, 199) et « des mots […] qui se tètent et s’avalent avec le premier lait » (A, 212). C’est là le rôle assigné à la seconde langue ombilicale imaginée par Gagnon, à savoir celui d’élaborer poétiquement sur la perte de la langue originelle, avec les « mots de la patrie ». Cette position, ce grand écart sont par ailleurs envisagés comme un clair-obscur, au sein duquel il s’agirait de faire en sorte que « l’ombrant se glisse sous les mots appris […] pour les parsemer de quelques éclats : étincelles archaïques, interstices primitifs » (TEA, 78).
Quelles sont, alors, les conséquences d’une telle entreprise sur le plan poétique ? La question est clairement posée par Gagnon, consciente de la radicalité de sa proposition : « [À] s’y risquer, les mots entreront-ils en convulsion, en hallucination ? Ou en inanition ? » (A, 239) Le mouvement de retour vers le lieu « blanchi par les ans » n’est pourtant pas une entreprise destructrice, et encore moins nihiliste : il ne débouche par conséquent sur aucun effondrement du langage. Au contraire, dans Antre, cette trajectoire aboutit à la mention de « nos mots hiéroglyphes » (A, 243), une image quasi oxymorique désignant à la fois, au sein du mot, l’absence de la chose et la persistance de sa trace, par son inscription hiéroglyphique. Surtout, avec cette expression, quelque chose de commun apparaît enfin, à travers ce « nous » qui figure l’union du « je » et du corps parental premier, désormais fondateurs, ensemble, d’un langage inédit, d’une langue de la patrie enrichie du savoir qui se loge au creux d’une « mémoire matrie[40] » originelle : un langage permettant une « parol[e] enfin signifiant[e] » (A, 234).
« ELLE ÉTAIT UNE FOIS, MA MÈRE »
« Dans ta coupure sanglante, je me suis glissée » (A, 234), écrit Gagnon dans Antre, associant l’antre et son savoir inédit au ventre maternel : « On ne peut pas parler sans antre d’elle » (A, 235). Dans un entretien avec Jean Royer au Devoir à la suite de la parution de Lueur, Gagnon évoque ce lieu originaire à partir d’une question posée en classe par ses étudiant·es tenté·es de le situer en amont même de la naissance. Le propos étonne : « [M]es étudiants me demandent […] si je me souviens d’avoir été dans l’utérus de ma mère. Je réponds oui et non. Ce n’est pas clair. […] Ce livre m’a permis de remonter très loin. Il m’a permis de revivre ma naissance[41]. » Elle donne alors à entendre que c’est dans l’écriture du livre qu’un certain retour au corps premier a lieu ; on y retourne et on n’y retourne pas : « oui et non ». La question et sa réponse mettent en évidence la dimension corporelle de ce lieu présymbolique, lequel trouve chez Julia Kristeva et sa « chora sémiotique » une élaboration théorique étoffée[42]. Si la psychanalyse n’entrevoit aucun retour possible à un temps présymbolique, encore moins intra-utérin, elle en remarque toutefois la trace au présent, une trace corporelle.
Le corps du sujet est un « corps matériel gravé de signes matériels » (A, 240), pour citer Gagnon, c’est-à-dire un corps qui jouit à partir des premières motions pulsionnelles déposées sur lui. Pour le sujet, il s’agit de retrouver le « rien d’où je suis venu », selon l’heureuse formule d’Anne Élaine Cliche : « se balancer, sauter, être porté, creuser, se cacher, resurgir, être bercé, s’enfouir, ces motions d’enfance ont laissé sur mon corps les traces qui creusent une érotique complexe où mon sexe, ma sexuation, trouve sa grammaire et ses noms[43] ». Ce qui est perdu, dans l’accession du sujet au langage, c’est d’abord un rapport privilégié au corps parental, mais qui n’est pas un rapport entre un sujet et un autre : c’est un rapport entre soi et l’Autre, aussi bien dire entre soi et soi, puisque l’Autre qui me précède et me fonde ne m’est pas d’abord étranger ; je suis à l’origine fondu dans ce corps que je ne distingue pas du mien. Avant que la parole donne au sujet un contour qui le différencie de son semblable[44], il n’y a pas entre lui et le monde de franche coupure. Ce premier rapport corporel passe notamment par le regard, la voix et la succion ; le corps du sujet en devenir est lié au corps parental dont il est absolument dépendant. C’est le temps d’une « chaleur éphémère » (A, 197), d’un « amour […] volcanique » (A, 198) où l’enfant ne parle pas. « [S]ourde à mes propres cris, des vocables signifiants[45] se mirent à me dépasser, hurlements » (A, 197), écrit Gagnon en ouverture d’Antre, cherchant à rejoindre dans l’écriture ce temps d’avant la constitution imaginaire du corps propre, un temps où l’on ne reconnaît pas comme siens ses propres cris, où les mots des autres, « vocables signifiants », ne sont pas encore intelligibles pour l’enfant : « Je sus qu’à les transcrire ne serait plus ma perte. » (A, 197) Ce temps est celui d’un premier corps à corps dont le sujet ne peut conserver le souvenir. Cette mère-là, première, qui est à la fois Autre et soi, « meurt » avec l’acquisition du langage : « [L]a mère morte en [s]oi » (A, 234 et 242), la « mère muette » (A, 242), est porteuse d’une voix perdue, à retrouver. Le défi devient alors de « l’écrire sans mourir » (A, 197), c’est-à-dire, encore une fois, de réinvestir ce temps premier avec le langage comme écran entre soi et la mort qu’il suppose. La « marque chaude et liquide de ta langue maternelle a été, de ton corps, arrachée » (TEA, 18), écrit Gagnon. Antre cherche à dire que c’est une part de la mère qui meurt, mais aussi une part de soi, celles-ci étant liées phonétiquement dans le poème : « Me meurs d’elle qui. De celle qui s’allonge en moi. […] Ma mort précoce, mon ombre gravée, cette plaie vive, mais refermée. Ma mie si belle, ma mi-pleine, mon abyssale peine, mamour de toi. » (A, 234) Et dans l’optique dégagée plus haut, la mort potentielle est aussi située dans la jouissance à rejoindre ce lieu maternel premier où le sujet s’abolit ; on y meurt « quasiment », mais l’écriture, la « présente ascèse », maintient le « je » du poème en équilibre sur la jouissance : « y eut un petit instant où pour me sentir vivante j’ai dû me brûler et que dans cet amas de mort vivante mon corpulsion ne bougeait plus, quasiment ; cette présente ascèse m’a fait jouir tout autant que la plus grande orgie, de mémoire d’homme, comme on dit » (A, 198).
À travers ce mouvement de retour, cette « grande orgie », Gagnon se livre ainsi non seulement à une réhabilitation du maternel, mais également à son réinvestissement sur le plan politique. Réinvestir une langue intimement liée à ce lieu « blanchi par les ans », c’est en effet rétablir un contact avec un langage dont les racines touchent à l’en deçà de l’ordre symbolique, perçu comme un ordre d’oppression patriarcale ; c’est toucher au rapport initial avec la mère, avec l’origine, appréhendé comme un temps « où [les femmes] n’avaient pas encore été aliénées comme sujets d’une histoire d’oppression d’elles » (TEA, 78 ; l’autrice souligne). Il s’agit de rejoindre « le silence de celles qui me précèdent » (A, 214), écrit Gagnon, renouant avec un autre savoir : « je le sais de mon ventre » (A, 214). Cette parole « inédite », réengendrée par un mouvement de retour vers « l’interstice signifiant », où le langage prend sa source, la poète la reçoit et la lègue à ses fils, c’est son « ensaignement » (A, 222) : « Je les ai bercés au rythme des récits mauves de mes aïeules en moi. » (A, 219) La transmission passe par le corps : « Ils ont tété à ma révolte, sucé le sein d’une vieille sorcière assassinée, partagé le banquet d’une Xanthippe coriace, bu l’étang de lait d’une Ophélie noire […]. » (A, 219) Cette langue poétique « dira ce qui de l’instinct au politique fut raturé » (A, 217). Ainsi, le paradoxe exploré depuis le début de cet article prend ici une portée féministe : il faut tenter de dire avec les mots de la langue des hommes ce qu’elle refoule, le féminin. Le programme est annoncé en ouverture du recueil : « Rien ne m’indiquait que tout cela pouvait s’écrire au féminin, pourtant. Je suivais la syntaxe apprise, comme aveuglément, je ne m’y retrouvais plus, de mes yeux du dedans, seulement. » (A, 197)
L’enjeu est de donner une place au sujet féminin dans un ordre symbolique intrinsèquement patriarcal, et par là même, de subvertir ce dernier. Cette dimension concerne par ailleurs un vaste mouvement d’écriture des femmes au Québec dans les années 1970-1980 :
Il faut dire que la littérature féministe des années 1970 dénonce l’aliénation dans laquelle les femmes vivent la maternité. En ce sens, elle ne pratique pas que la mise à mort de la mère patriarcale : elle affiche aussi une forte volonté de renouer avec la figure maternelle. L’approche de plusieurs auteures témoigne de la difficulté pour une femme d’écrire dans une langue qui dévalorise le féminin. Les écrits de Louky Bersianik, de Nicole Brossard, de Madeleine Gagnon et de Jovette Marchessault cherchent à retracer l’existence d’une langue et d’une mère originelles, oubliées par l’histoire, voire sacrifiées sur l’autel du patriarcat[46].
Même constat pour Louise Dupré : « [C]réer un féminin du langage qui permette à la femme de se constituer comme un sujet dans le symbolique restera le grand fantasme des écrivaines et théoriciennes “féministes”, durant les années 1970[47]. » La lutte politique se joue ainsi sur le terrain d’un rapport renouvelé au symbolique et au langage. L’oeuvre de Gagnon est portée par la croyance que le « discours logocentrique » (TEA, 30) s’est constitué dans la répression du sexuel et reconnaît à la psychanalyse d’avoir fait entrer la vérité du sexe dans le champ du savoir. Elle est peut-être celle parmi ses contemporaines qui s’engagera le plus fidèlement dans cette quête où féminisme et psychanalyse s’arriment dans un désir d’émancipation par « le jeu sur le signifiant », quête qu’elle déploie au-delà des années 1970 – d’autres, comme France Théoret, ont d’abord adopté cette perspective pour la délaisser par la suite au profit de perspectives davantage sociologiques[48]. Gagnon écrit, dans un texte intitulé « Entre folie et vérité », que « [t]out ce qui s’articule au désir, y compris dans le corps même du discours scientifique, redonne au discours le réalisme qu’il avait gardé jusque-là évincé : la réalité du sexe » (TEA, 29). Elle écrit à une époque où se manifeste une certaine urgence pour les femmes d’accéder à l’écriture de soi. Son texte Pour les femmes et tous les autres affirme par exemple « que la poésie, jeu sur le signifiant, n’est ni mystérieuse ni individualiste ni innocente […] et suggère que la prise de parole, pour toutes les catégories d’opprimés, est essentielle[49] ». Dans Antre, la filiation psychanalytique est sans équivoque : « Sans Lacan, je n’aurais jamais vu le grand trou noir où les femmes n’existaient pas[50]. » (A, 239) Cela mène Gagnon à pratiquer une certaine négativité dans l’écriture ; l’écriture « au féminin » est une langue qui, pour faire advenir ce que le patriarcat refoulait de son discours, demande à en passer par un désordre assumé : « Et puisque la linéarité et l’exclusion de l’autre donnaient sa mesure à l’ordonné et à la raison, il ne faudrait pas se surprendre que le retour du refoulé – le sexe féminin – au texte apporte à celui-ci une allure de folie. » (TEA, 30) Il a fallu « faire feu de tous mots, pour que surgissent les paroles de jouissance qui devenaient, par-delà le long mur des refoulés historiques, inédites et inouïes » (TEA, 164-165). Ou, suivant les mots que Josée Yvon emprunte à un périodique féministe des années 1970 pour les inclure dans un texte par ailleurs publié aux côtés de celui de Madeleine Gagnon dans le numéro de La Barre du jour intitulé « Les femmes et le langage » : « NOUS SOMMES DES TROUS MAIS LE VIDE EST POLITIQUE[51] ». Les reproches adressés par une certaine critique au courant dans lequel s’inscrit l’écriture de Gagnon, nous le verrons plus loin, viendront des deux côtés : reproche de l’illisibilité liée à un usage du langage appartenant à un certain formalisme, reproche du narcissisme lié à l’écriture de soi, celui-là prévu en quelque sorte dans Antre où les instances critiques sont respectivement incarnées par les figures oniriques de « l’homme-loi » et de « la femme-loi » : « tu penses trop à toi, tu t’aimes trop », « tu n’as pas le droit de jouir, d’être belle, d’écrire de beaux livres, d’être reconnue, aimée. D’être jouie » (A, 205).
UN ÉCART ENTRE SOI ET SOI
Posons que le bagage savant avec lequel Gagnon écrit gêne certains lecteurs. Dans une critique somme toute positive, Jacques Ferron parle du premier recueil de nouvelles de Gagnon comme d’une « fantaisie très ingénieuse, peut-être très savante », qu’il se garde de trop louanger : « [L]’intellectualisme a quelque chose de très fragile. Dans l’almanach des bergers, on conseille de ne pas accorder sa confiance aux p’tits nez retroussés[52]. » Gagnon, qui paraphrase cette critique dans un entretien avec Monique Roy, voit là une manifestation de sexisme[53]. Plus largement, avec un regard rétrospectif, elle avance dans son autobiographie qu’« [ê]tre un intellectuel au Québec est souvent une tare. Et si vous êtes une femme, une maladie honteuse[54] ». La vaste majorité des critiques adressées à l’oeuvre de Gagnon dans les quotidiens et les revues culturelles sont positives, voire élogieuses. Cela dit, en situant sa démarche poétique dans une recherche de l’en deçà du langage, Gagnon se retrouve en proie à certains critiques plus conservateurs. « Pas de modèle pour qui cherche ce qui ne fut jamais trouvé » (A, 200), pourrait-on dire en citant Antre. « Comment [le critique] perçoit-il cette pratique signifiante du féminisme dans une écriture qui obéit à une nouvelle logique du signifiant et utilise un nouveau langage symbolique [55] ? » : c’est la question que pose Louky Bersianik en ouverture de sa contribution au célèbre La théorie, un dimanche, où elle regrette les analyses dans lesquelles on « clôture, verrouille, cadenasse[56] » le sens des oeuvres à partir de grilles de lecture préalables. Or, il s’avère que la critique citée par Bersianik pour illustrer la résistance à ce langage nouveau issu de l’écriture des femmes concerne partiellement le recueil La lettre infinie de Gagnon, critique rédigée par Pierre Nepveu – qui a, en d’autres lieux, après coup, louangé l’écriture de Gagnon[57]. En 1985 dans la revue Spirale, donc, Pierre Nepveu déclare l’ennui ressenti à la lecture de La lettre infinie. Devant ce passage, par exemple, il ne voit qu’une « laborieuse traversée » de l’écriture : « Écrire, encore, malgré le désert blanc dans lequel vont fondre tous mes livres[58]. » Selon lui, l’écriture de Gagnon refuse de jouer le jeu des codes poétiques établis : « avant que se pose le dilemme de la clarté et de l’obscurité, il faudrait que l’écriture se soit avancée autrement qu’en se retirant et en refusant de jouer la partie[59] », propose-t-il. On pourrait alors se demander, dans une perspective intersectionnelle, qui établit les règles auxquelles il faut se soumettre pour être légitimée par l’institution? La réponse va de soi. On retrouve une critique similaire chez André Vanasse qui écrit, à propos de Lueur publié en 1979 : « Trop de trous, trop de lieux minés pour ne pas perdre pied[60]. » Même s’il suppose que c’est là un moyen pour Gagnon de nous entraîner dans « l’interstice signifiant », sa conclusion est sévère : « Ce roman perdu se doit d’être réécrit mais les mots pour le dire ont été égarés avec lui[61]. »
Finalement, devant Les fleurs du Catalpa, où Gagnon poursuit sa quête métapoétique[62], Gilles Toupin ne perçoit que le narcissisme de l’écrivaine : « L’écriture complaisante du recueil est trop souvent un long verbiage creux, répétitif, assommant. […] Madeleine Gagnon a entrepris, à la manière d’un Narcisse grossièrement magnifié, de redire encore [sic] ce qu’est l’écriture[63]. » Or, cette figure de Narcisse est investie la même année par Gagnon de manière particulièrement éloquente dans un texte intitulé « La tentation biographique », qui a d’abord été prononcé lors de la 14e Rencontre québécoise internationale des écrivains :
L’écriture est l’antidote contre le délire narcissique. Quand Narcisse contemple son image, il est virtuellement appelé à l’acte créateur. La contemplation de soi est la condition essentielle à toute création d’oeuvre. Mais quand Narcisse veut saisir cette image, s’en emparer comme le réel de lui, comme s’il n’y avait entre elle et lui aucune distance, aucun leurre, aucune fiction, aucune écriture, il entre en symbiose, y colle et s’y rive, il en meurt. Si Narcisse avait accédé à l’écriture de sa vision, il ne se serait pas engouffré en elle.
TEA, 168
Dans les mots de Gagnon, le mythe de Narcisse devient le mythe d’un accès au réel par l’image, un accès mortifère parce que le langage n’y opère pas comme « garde-fou », comme écran. Narcisse jouit de se perdre dans son reflet, il en meurt. Gagnon nous dit que le langage fait écran entre soi et soi, que l’altérité fait écran entre soi et soi – ce qui revient au même, puisque « l’altérité est dans la langue[64] », pour reprendre une heureuse formulation de Jean-Pierre Lebrun : la langue que je parle, je ne l’ai pas inventée, elle vient de l’autre ; parler, c’est m’arracher à moi. Sans la langue pour faire écran entre moi et moi, donc, je me perds, c’est la fin du désir, je meurs.
Gagnon cherche dans ce texte à battre en brèche un discours courant qui argue que l’écriture de soi se situe dans le registre de la complaisance. Ce discours, toujours actuel, on le trouve parfois chez ceux-là mêmes qui, comme Gagnon, se réclament de l’enseignement de Lacan. Nous pensons par exemple au psychanalyste Dany-Robert Dufour ; à propos d’une certaine littérature contemporaine – l’exemple qu’il convoque ici est celui de Christine Angot –, il écrit notamment : « [U]n culte, aussi naïf qu’enniaisant, de la spontanéité qui suppose un moi ayant pour seule tâche de raconter sa vie à d’autres afin de devenir lui-même est en train d’envahir la littérature et de suspendre la grande fiction[65]. » Dans le même élan, Dufour fait de Samuel Beckett moins un génie poétique que l’annonciateur, dans la postmodernité, des difficultés de subjectivations et des personnalités multiples[66]. Si le discours de Dufour est en d’autres lieux d’une grande aide pour penser la subjectivité en régime postmoderne[67], il fait ici fausse route, notamment parce que « Je est un autre » est le mot d’ordre d’Angot qui refuse systématiquement d’être assimilée au « je » de son écriture, de ne faire qu’une avec le texte comme Narcisse avec son reflet[68]. Cela dit, ce passage de Dufour offre une belle illustration du discours auquel Gagnon s’oppose avec les mêmes outils conceptuels que lui[69]. Gagnon conçoit la poésie comme « une effraction », et « l’intelligence poétique » doit aussi être pensée selon elle à partir de la formulation « Je est un autre » : « Entre ce JE individualisé que je suis et l’Autre, en moi, qui est langage, il y a ce désir d’instauration d’une langue qui, si elle est poétique, assumera qu’il n’est aucune adéquation possible entre ce JE et cet AUTRE[70]. » Avec cette mise en garde – « si elle est poétique » –, on conçoit que l’écriture peut elle aussi être le lieu de la complaisance et qu’éviter celle-ci nécessite de se soumettre à « l’exigence de la forme[71] », pour utiliser une expression de René Lapierre. Il en va comme d’une posture éthique assignée par Gagnon à l’écriture, une « éthique de l’ouverture[72] », celle de « sortir de soi » : « Et je lirai toute écriture qui me déroute et signifie ma perte, je lirai toute écriture qui me rend étrangère à moi-même et de moi-même exilée. » (TEA, 150) C’est précisément ceux qui pratiquent une autobiographie « d’exposition simple » (TEA, 172) qui se situent hors du geste poétique selon Gagnon, ceux qui répugnent à s’intéresser à ce fameux lieu « blanchi par les ans », qui refusent de consentir à la perte, à la négativité, à l’impossibilité de se saisir comme une totalité, et qui se mirent dans le leurre de l’image : « [Leurs] biographies marchent, ont du succès, parce qu’il est beaucoup plus rassurant de concevoir une réalité objectivement la même et vraie pour tous que d’oser penser un sujet scripteur pris entre ses vérités fictives et un réel barré, troué, blanchi par les ans. » (TEA, 172)
+
Je ne suis pas dans le grand trou de la mort qui happe et gèle. Je bouge[73].
Ce que signale le petit mythe théorique de Narcisse, c’est que l’écriture repousse « le blanc de l’asymbolie[74] », autrement dit la mort, comprise comme repli sur soi, comme mutisme. Certains psychanalystes contemporains prennent la mesure de cette proposition, Clotilde Leguil, notamment, qui suggère que dans l’ère de narcissisme où nous serions plongé·es, ce n’est pas le « je » qui triomphe, mais le « moi ». L’ère de narcissisme n’est pas une ère de parole, mais d’images[75]. Même son de cloche chez le philosophe Byung-Chul Han : « Aujourd’hui, c’est avant tout dans le moi que l’on investit les énergies libidineuses. […] Faute de lien à l’objet, le moi est renvoyé à lui-même. Il se brise contre lui-même[76]. » Han perçoit, en régime contemporain, une « expulsion de l’autre » concomitante à une « narcissification de la société[77] » : « Narcisse ne répond pas à la voix aimante de la nymphe qui serait à proprement parler la voix de l’autre », écrit-il ; il faudrait selon lui inventer « un métier auquel on donnera[it] le nom d’écouteur[78] » pour dépasser le narcissisme généralisé. Pour Leguil, le lieu par excellence où un « je » peut exprimer sa singularité sans se dissoudre dans le collectif est le divan de l’analyste ; pour Gagnon, ce lieu est celui de l’écriture poétique. La parole poétique empêche le « je » de sombrer dans le tout, elle prévient chez Gagnon la collusion du monde : « Sans ce qui est, littéralement, dans le dit de son chant […], le monde pourrait bien s’écrouler[79]. »
Or, nous avons vu que l’oeuvre de Gagnon est également pétrie d’une grande lucidité à l’endroit des « infinies possibilités des vocables[80] », dont elle est amenée à percevoir les limites. Une lucidité que certains poèmes portent en creux, poèmes qui annoncent qu’« une explosion/peut bien se produire/et tout effacer » (P, 39). « Je suis de ce siècle/où toute la vie sur terre et mer peut mourir/Je suis du temps de la totale destruction/prévue préparée consentie imaginée fabriquée[81] », écrit-elle. « [J]e veux vivre longtemps » (FC, 120), laisse-t-elle simplement tomber à la fin d’un poème des Fleurs du Catalpa, se résignant devant l’impossibilité de « vaincre/le temps » (FC, 124). La lucidité en question s’exprime finalement dans les poèmes qui accompagnent ce dossier, les « Poèmes du temps perdu » ; elle s’accroît alors que la mort anticipée est perçue comme plus proche que lointaine. Seule dans son antre – « Elle est seule. Elle vit parmi les autres. Elle ne les connaît pas. Dans l’ascenseur ou les couloirs, elle les salue poliment » –, la voix poétique désire l’écriture : « Elle a juste ces désirs soudains. Le désir de l’écriture. L’écriture et ses raisons obscures ». Le premier poème d’Antre annonce le projet de rejoindre par l’écriture une part de soi, celle dont nous avons dit qu’elle meurt en nous avec l’acquisition du langage. Il s’agit d’un « rêve de livre » et de renaissance à soi : « Nous étions deux à naître et plus personne à nier » (A, 197). Or, la marche vers la vie de ce « nous » bascule dans les poèmes « du temps perdu », alors que le nous (constitué d’un « Elle et moi » où on lit qu’« Elle, c’est moi ») s’achemine vers la mort : « C’est la mort. Elle y va. » Il faut écrire malgré tout, dans un mouvement d’émancipation que l’on pourrait dire « sans lendemain[82] ». Dès lors, le « je » du poème, de ce dernier poème, renverse la formule prônée autrefois. Ici, « [j]e […] n’est pas une autre » :
Elle et moi. Elle, c’est moi./Je n’est pas une autre./Autrui est venu dedans./Comment ? C’est le ça de l’écriture./Je ne peux l’expliquer./Il faudrait sortir de soi./C’est la mort. Elle y va./Si lentement, elle y va./Soi devient l’autre./Ça s’appelle la mort./Je ne vaux pas la mort./C’est plus fort que moi./Elle y va. Malgré moi./Moi, c’est elle quand j’écris./J’y vais. Si lentement./Trop lentement. Trop. Seule[83].
Encore, le poème cherche à atteindre ce qui « ne peut s’expliquer » et qui se loge en creux des mots, « le ça de l’écriture ». Tout se passe comme si les frontières tombaient entre soi et soi – « soi devient l’autre » – entre soi et l’autre – « autrui est venu dedans ». Même si « Elle, c’est moi », autrement dit, même si « Elle » et « je » semblent se confondre, l’écriture fait valser ces deux instances au lieu de les gommer : « Moi, c’est elle quand j’écris. » Ces « Poèmes du temps perdu » pourraient être lus comme une réponse à un précédent « Poème du temps présent », paru en 1985, où l’on veut « vaincre la mort/avec les outils de la mort même/Entrer sur son propre terrain/en face l’affronter Bête de silence[84] ». Dans les « Poèmes du temps perdu », la poète n’exprime plus le souhait explicite de vaincre la mort, mais des ruses de langage et l’existence même de ce texte témoignent d’un désir d’écrire malgré la mort qui appelle et emporte. Dans ce « C’est plus fort que moi », on peut lire conjointement : la mort, l’écriture.
Parties annexes
Notes biographiques
JULIAN BALLESTER est étudiant à la maîtrise en études littéraires à l’UQAM. Son mémoire en recherche-création porte sur la question de la disparition de soi, qu’il aborde notamment à travers la perspective psychanalytique. Il est également titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en études cinématographiques. En tant que cinéaste, il a réalisé les films documentaires Rue Curiol (2013) et Midnight Ramblers (2017).
LOUIS-DANIEL GODIN est professeur au Département d’études littéraires de l’UQAM et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Privilégiant une approche psychanalytique, il consacre ses recherches actuelles à la littérature québécoise contemporaine, et particulièrement à la question du nom propre. Son essai Les père-mutations. La paternité en question chez Hervé Bouchard et Michael Delisle est paru en 2021 aux Presses de l’Université de Montréal. Son premier roman, Le compte est bon, paraîtra aux éditions La Peuplade à l’été 2023.
Notes
-
[1]
Madeleine Gagnon, « Antre », Les Herbes rouges, nos 65-66, juillet-août 1978, p. 50, repris dans Autographie, t. I : Fictions, Montréal, VLB éditeur, 1982, p. 244, et À l’ombre des mots. Poèmes, 1964-2006, Montréal, l’Hexagone, coll. « Rétrospectives », 2007, p. 52. Désormais, nous nous référerons à la version d’Autographie, laquelle reprend à l’identique la première version du texte – qui n’a jamais été réimprimée ni rééditée aux Herbes rouges. La version publiée dans l’anthologie préparée par les éditions de l’Hexagone contient quant à elle plusieurs modifications à l’égard de la version originale (mots coupés, poème retiré, strophes placées sur une même page, etc.). Les références seront indiquées par le sigle A suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[2]
Madeleine Gagnon-Mahony, « Angéline de Montbrun : le mensonge historique et la subversion de la métaphore blanche », Voix et Images du pays, vol. V, no 1, 1972, p. 58.
-
[3]
Ibid.
-
[4]
« L’étincelle créatrice de la métaphore ne jaillit pas de la mise en présence de deux images, c’est-à-dire de deux signifiants également actualisés. Elle jaillit entre deux signifiants dont l’un s’est substitué à l’autre en prenant sa place dans la chaîne signifiante, le signifiant occulté restant présent de sa connexion (métonymique) au reste de la chaîne. » Jacques Lacan, « L’instance de la lettre dans l’inconscient », Écrits, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Champ freudien », 1966, p. 507. « La métaphore serait le propre de l’homme. Et plus proprement de chaque homme, selon la mesure du génie – de la nature – qui en lui domine. Qu’en est-il de cette domination ? Et que veut dire ici le “propre de l’homme”, s’agissant d’un tel pouvoir ? » Jacques Derrida, « La mythologie blanche », Poétique, no 5, 1971, p. 31. Cités dans Madeleine Gagnon-Mahony, « Angéline de Montbrun : le mensonge historique et la subversion de la métaphore blanche », p. 57.
-
[5]
Ibid., p. 58.
-
[6]
Ibid. ; nous soulignons.
-
[7]
Madeleine Gagnon, « Analyse critique », Madeleine Gagnon, André Belleau et Maurice Poteet, « Rapport du comité d’orientation du Département d’études littéraires », Montréal, Université du Québec à Montréal, 1975, p. 115 ; nous soulignons.
-
[8]
Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire. Vivre ensemble sans autrui, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2015 [2009], p. 53 ; nous soulignons.
-
[9]
Ibid., p. 56.
-
[10]
Madeleine Gagnon, « Analyse critique », p. 116.
-
[11]
Paul Chanel Malenfant, « Préface », Madeleine Gagnon, Le chant de la terre. Poèmes choisis 1978-2002, anthologie préparée par Paul Chanel Malenfant, Montréal, Typo, coll. « Typo », 2002, p. 9.
-
[12]
La dissolution se retrouve dans la citation en exergue, mais aussi quelques pages plus tôt dans Antre, où le « je » du poème se présente comme « [a]llongée dans le pré de blé, dans l’espace calme de cette dissolution » (A, 240). On peut imaginer qu’il y a là une référence au personnage de Lol V. Stein de Marguerite Duras, allongé dans « une vaste prairie », dans un « calme monumental » où « [t]out a été enseveli. Lol avec le tout ». Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1964, p. 181.
-
[13]
Madeleine Gagnon, « Des mots plein la bouche », Autographie, t. II : Toute écriture est amour, textes réunis et présentés par Jeanne Maranda et Maïr Verthuy, Montréal, VLB éditeur, 1989, p. 77. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle TEA suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[14]
Louise Dupré, « Une langue d’avant la langue », Stratégies du vertige. Trois poètes : Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, France Théoret, Montréal, Les éditions du remue-ménage, coll. « Itinéraires féministes », 1989, p. 13-29.
-
[15]
L’image de l’ombilic est d’ailleurs investie par Freud dans L’interprétation des rêves pour désigner ce qui résiste à la symbolisation : « Les rêves les mieux interprétés gardent souvent un point d’obscur […]. C’est l’ombilic du rêve, le point où il se rattache à l’inconnu. » Sigmund Freud, L’interprétation des rêves, traduit de l’allemand par Janine Altounian, Pierre Cotet, René Lainé, Alain Rauzy et François Robert, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 2012, p. 446. L’ombilic, c’est donc l’impensable, ce qui rejoint la notion lacanienne de réel. À ce sujet, voir Jacques Lacan, « L’ombilic du rêve est un trou. Jacques Lacan répond à une question de Michel Ritter », La cause du désir, no 102, 2019, p. 35-43, originalement paru dans Les lettres de l’EFP, no 18, avril 1974, p. 7-12. Voir aussi : Catherine Delarue, « De l’ombilic du rêve au réel », Analyse freudienne presse, no 16, 2009, p. 175-183.
-
[16]
« Tout fantasme est né de l’absence de l’Autre quand le sujet soudain s’éprouve seul. Le fantasme est la conséquence d’une épreuve de solitude » (TEA, 75), écrit Gagnon.
-
[17]
À d’autres moments, elle parle de la « doxa » : « [E]lle vole, mais traîne toujours avec elle, la voix de l’autre, l’empêcheuse, la doxa. » (A, 225)
-
[18]
On comprend que dans ce texte intitulé « Tu tourneras ta langue », l’autrice s’adresse à elle-même et à toutes celles en mesure de se reconnaître dans la lignée féminine de filles et de « mères accoucheuses » (TEA, 18).
-
[19]
Madeleine Gagnon, « Parler l’écriture ou écrire la parole », Madeleine Frédéric et Jacques Allard (dir.), Modernité/postmodernité du roman contemporain. Actes du colloque international organisé par le Centre d’études canadiennes de l’Université libre de Bruxelles (27-29 novembre 1985), Montréal, Service des publications de l’Université du Québec à Montréal, coll. « Les Cahiers du Département d’études littéraires », 1987, p. 17.
-
[20]
Jacques Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, p. 821. La Loi marquée d’une majuscule est ici à entendre comme diminutif de la « loi symbolique », le principe selon lequel l’aliénation au langage fonde la subjectivité.
-
[21]
Christiane Lacôte-Destribats, « Jouissance », Roland Chemama et Bernard Vandermersch (dir.), Dictionnaire de la psychanalyse, 4e édition, Paris, Larousse, coll. « In extenso », 2009, p. 295.
-
[22]
Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel quel », 1973, p. 25-26.
-
[23]
Propos de Madeleine Gagnon dans Lucie Robert et Ruth Major, « Percer le mur du son du sens, une entrevue avec Madeleine Gagnon », Voix et Images, vol. VIII, no 1, automne 1982, p. 19.
-
[24]
Madeleine Gagnon, « Note liminaire », À l’ombre des mots, p. 11.
-
[25]
Propos de Madeleine Gagnon recueillis dans Lucie Robert et Ruth Major, « Percer le mur du son du sens, une entrevue avec Madeleine Gagnon », p. 6.
-
[26]
Ibid., p. 19.
-
[27]
Ibid., p. 6-7.
-
[28]
Madeleine Gagnon, Lueur. Roman archéologique, Montréal, VLB éditeur, 1979, p. 60.
-
[29]
Érik Porge, Les noms du père chez Jacques Lacan. Ponctuations et problématiques, Paris, Érès, coll. « Point hors ligne », 2006, p. 72.
-
[30]
Madeleine Gagnon, Pensées du poème, Montréal, VLB éditeur, 1983, p. 43. Désormais, les références à ce texte seront indiquées par le sigle P suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[31]
Jacques Lacan, « Kant avec Sade », Écrits, p. 773.
-
[32]
Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse [1959-1960], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Champ freudien », 1986, p. 18.
-
[33]
Silvia Lippi, La décision du désir, Paris, Érès, coll. « Point hors ligne », 2013, p. 182.
-
[34]
Madeleine Gagnon, Chant pour un Québec lointain, Montréal/Cesson, VLB éditeur/La Table rase, 1990, repris dans À l’ombre des mots, p. 335.
-
[35]
Madeleine Gagnon, Au coeur de la lettre, Montréal, VLB éditeur, 1981, p. 31.
-
[36]
Madeleine Gagnon, Lueur, p. 77.
-
[37]
Sigmund Freud, « Lettre 70. 3 octobre 1897 », Naissance de la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 1956, p. 194 ; nous soulignons.
-
[38]
Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, p. 319.
-
[39]
Madeleine Gagnon, Lueur, p. 14.
-
[40]
Madeleine Gagnon, Au coeur de la lettre, p. 23.
-
[41]
Jean Royer, « Madeleine Gagnon. Explorer les premières traces du langage », Le Devoir, 26 mai 1979, p. 18.
-
[42]
Julia Kristeva, Polylogue, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel quel », 1977, 537 p.
-
[43]
Anne Élaine Cliche, « Cette enfance que j’ai encore. Que j’aurai toujours », Postures, no 21, 2015, en ligne : http://revuepostures.com/fr/articles/cliche-21 (page consultée le 3 avril 2023).
-
[44]
Voir Jacques Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », Écrits, p. 93-100.
-
[45]
« Des morphèmes, des sèmes, sans paroles. » (A, 240)
-
[46]
Valérie Caron, « Le bruit des choses vivantes et Tableaux : voix et représentations inédites de la maternité dans la littérature québécoise », Voix et Images, vol. XXVIII, no 1, automne 2002, p. 130.
-
[47]
Louise Dupré, « Une langue d’avant la langue », p. 22.
-
[48]
C’est à tout le moins ce que donne à lire le récent La forêt des signes, où Théoret revient sur son parcours d’écrivaine et d’intellectuelle : « Je désirais inventer une écriture au féminin. Repenser ce que peut une femme en tant que sujet ne tenait pas de l’être femme, plutôt de ce que peut une femme en mouvement, devant la pensée et devant l’action de la société » ; « Je me suis éloignée de la psychanalyse, tout en me rappelant que l’inconscient existe, que le surmoi existe, que la transparence est une fiction de l’autorité, une régression. […] Avec mes contemporains, souvent des femmes, je citais Freud, Lacan et leurs disciples. » France Théoret, La forêt des signes, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2021, p. 39 et p. 46.
-
[49]
Madeleine Gagnon, Pour les femmes et tous les autres, Montréal, Les Herbes rouges, coll. « Lecture en vélocipède », 1974, quatrième de couverture.
-
[50]
À noter que la référence à Lacan a été supprimée de la version que l’on retrouve dans l’anthologie À l’ombre des mots, où l’on peut lire plutôt : « Je vois le grand trou noir où les femmes n’existent pas », p. 48.
-
[51]
Josée Yvon, « La poche des autres », La Barre du jour, no 50, hiver 1975, p. 84. Selon la note d’Yvon, la phrase provient du périodique féministe Le torchon brûle (journal « menstruel » du Mouvement de libération des femmes [MLF], Paris, août 1974).
-
[52]
Jacques Ferron, « Thériault et Gagnon-Mahony », Le Petit Journal, 30 novembre 1969, p. 79.
-
[53]
« J’étais très vulnérable à cette époque, très fragile. On attaque toujours les femmes dans leur physique, soit pour en dire du bien ou du mal. Les hommes sont à l’abri de ces tracasseries. Ils sont. Un de nos grands écrivains avait également fait une critique positive de mon livre, mais en ajoutant : “méfions-nous des femmes intelligentes, et surtout des nez retroussés”. Une femme intelligente qui écrit bien et qui en plus a le nez retroussé ? Subversion. » Propos de Madeleine Gagnon recueillis dans Monique Roy, « Pour les femmes et les autres », Le Devoir, 28 mai 1977, p. 13.
-
[54]
Madeleine Gagnon, Depuis toujours. Récit autobiographique, Montréal, Boréal, 2013, p. 296.
-
[55]
Louky Bersianik, « La lanterne d’Aristote. Essai sur la critique », Louky Bersianik, Nicole Brossard, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret, La théorie, un dimanche, nouvelle édition, préface de Martine Delvaux, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2018 [1988], p. 100.
-
[56]
Ibid., p. 102.
-
[57]
Voir entre autres : Pierre Nepveu, « Gagnon : repenser le poème », Le Devoir, 26 novembre 1983, p. 19 ; Pierre Nepveu, « Nouveau lyrisme », Spirale, no 65, novembre 1986, p. 6.
-
[58]
Madeleine Gagnon, La lettre infinie, Montréal, VLB éditeur, 1984, p. 44, citée dans Pierre Nepveu, « L’essentiel et le frivole », Spirale, no 52, mai 1985, p. 6. Voici la suite du poème où Gagnon assume le « bonheur » de cette traversée : « Aveuglément, à la folie, poursuivre sur cette route, avancer sans autre but que la découverte de la suite du trajet. Avec de l’innocence, un travail d’ogre aux bottes de sept lieues, un bonheur hallucinant. »
-
[59]
Pierre Nepveu, « L’essentiel et le frivole », p. 6.
-
[60]
André Vanasse, « Nouveaux romans ? », Lettres québécoises, no 15, août-septembre 1979, p. 15.
-
[61]
Ibid.
-
[62]
Madeleine Gagnon, Les fleurs du Catalpa, Montréal, VLB éditeur, 1986, 129 p. Désormais, les références à ce texte seront indiquées par le sigle FC suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. « Pour n’avoir pas vu le continent réel, l’écriture crée un lieu-dit de cette absence » (FC, 90) ; « la poésie se crée aussi dans les blancs, dans les fragments d’absence » (FC, 97), pour n’en citer que deux manifestations.
-
[63]
Gilles Toupin, « Un Madeleine Gagnon qui n’en est pas un », Le Devoir, 15 novembre 1986, p. E2.
-
[64]
Jean-Pierre Lebrun et Nicole Malinconi, L’altérité est dans la langue. Psychanalyse et écriture. Paris, Érès, coll. « Humus », 2017 [2015], 261 p.
-
[65]
Dany-Robert Dufour, L’art de réduire les têtes. Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme total, Paris, Denoël, coll. « Médiations », 2003, p. 117.
-
[66]
Ibid., p. 117-118.
-
[67]
Voir Louis-Daniel Godin, « Entre catastrophisme et euphorie : L’évasion d’Arthur ou la commune d’Hochelaga de Simon Leduc », Voix et Images, vol. XLVI, no 1, automne 2020, p. 69-83.
-
[68]
« Quand des romans remettaient le couvert avec Je est un autre, ça énervait la société. Elle gueulait comme un putois dès qu’un écrivain recommençait avec ça de manière trop claire, comme c’était mon cas. » Christine Angot, Une partie du coeur, Paris, Stock, 2004, p. 40.
-
[69]
Dufour oppose ici « la grande fiction » et l’oeuvre d’Angot. Cette dernière est en effet une oeuvre qui ne cherche ni à rendre le réel par la représentation ni à se déployer de façon linéaire à partir d’une intrigue romanesque. Chez Angot, « l’exposition de sa vie intime », conçue par Dufour comme le « grand standard postmoderne de la littérature » (L’art de réduire les têtes, p. 117-118), se déploie toutefois à travers une exigence formelle complètement inaperçue par le philosophe – qui d’ailleurs ne cite pas l’oeuvre d’Angot, mais seulement ses propos dans une entrevue télévisée. Chez Angot, c’est bien le rythme saccadé qui prime, de même que les phrases courtes, la répétition, le ressassement et l’association libre, autant de dimensions auxquelles un psychanalyste pourrait être sensible. Voir notamment Francesca Forcolin, Christine Angot, une écriture de l’altérité, préface de Tiphaine Samoyault, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Autofictions, etc. », 2021, 186 p.
-
[70]
Madeleine Gagnon, « La poésie, une effraction », Donner ma langue au chant, Montréal, Éditions du Noroît, coll. « Chemins de traverse », 2011, p. 73.
-
[71]
René Lapierre, « L’exigence de la forme », René Lapierre, Paul Bélanger, Joël Pourbaix et Louise Lachapelle, Dans l’écriture, Montréal, XYZ éditeur, 1994, coll. « Travaux de l’atelier », p. 9-13.
-
[72]
Madeleine Gagnon, La lettre infinie, p. 13.
-
[73]
Madeleine Gagnon, Lueur, p. 13.
-
[74]
Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Paris, Gallimard, 1987, p. 45.
-
[75]
Clotilde Leguil, « Je ». Une traversée des identités, Paris, Presses universitaires de France, 2018, 214 p.
-
[76]
Byung-Chul Han, L’expulsion de l’autre. Société, perception et communication contemporaines, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Paris, Presses universitaires de France, 2020, p. 41.
-
[77]
Ibid., p. 114.
-
[78]
Ibid.
-
[79]
Madeleine Gagnon, Donner ma langue au chant, p. 154.
-
[80]
Ibid., p. 151.
-
[81]
Madeleine Gagnon, « Poème du temps présent », Estuaire, no 42, automne 1986, p. 47.
-
[82]
Nous renvoyons ici à l’ouvrage de philosophie morale du psychanalyste Pierre-Henri Castel consacré à la fin des temps : « En somme, devant l’idée angoissante et dangereusement démoralisante de vivre sans avenir, nous nous trouvons devant la tâche curieuse d’imaginer à quoi ressemblerait une vie bonne et cependant sans lendemain. » Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient. Essai hâtif sur la fin des temps, Paris, Éditions du Cerf, 2018, p. 80.
-
[83]
Voir ces poèmes inédits dans le présent dossier : Madeleine Gagnon, « Poèmes du temps perdu », Voix et Images, vol. XLVIII, no 1, automne 2023, p. 37.
-
[84]
Madeleine Gagnon, « Poème du temps présent », p. 44.