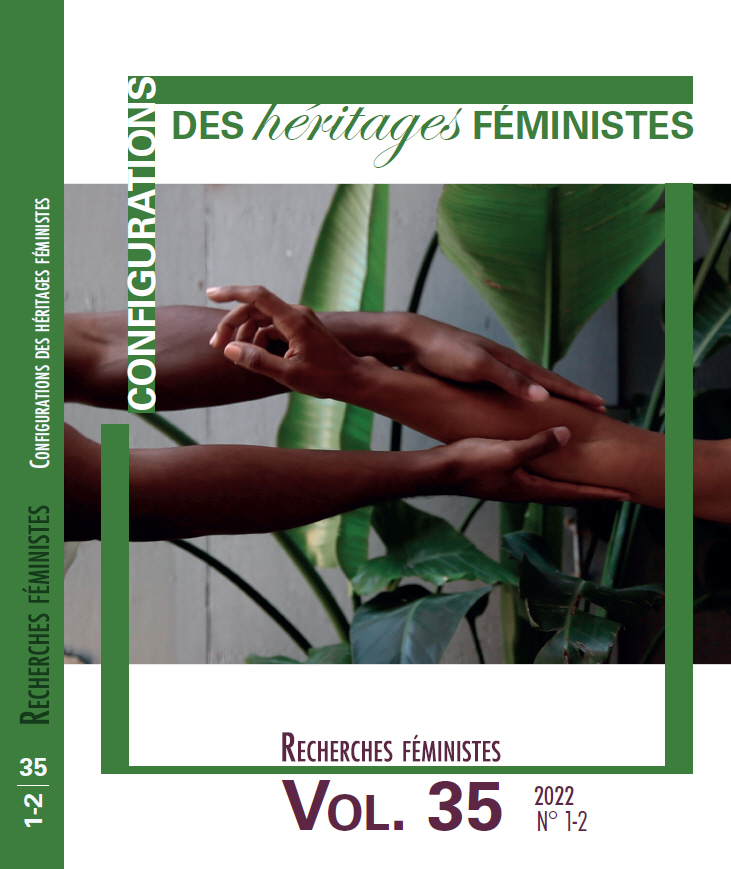L’ouvrage de Laurence Hansen-Løve, Planète en ébullition. Écologie, féminisme, responsabilité, publié en 2022 aux éditions Écosociété, apparaît au moment clé où les dialogues entre humanités environnementales, écologie politique et féminisme se multiplient sur la scène universitaire. L’autrice propose, en 248 pages, une traversée philosophique de la révolution écologiste en cours selon elle et de ses implications socio-politiques. Dans l’introduction, Laurence Hansen-Løve révise l’acception classique du terme « révolution » en soulignant le caractère multiple et progressif de celle que nous serions en train de vivre. L’objet de cette révolution est historiquement inédit (la sauvegarde de la planète), tout autant que le sont ses protagonistes (une génération « jeune » ainsi que des femmes). Cette révolution se trouve au noeud de bouleversements sociétaux qui ont « trait aux domaines les plus variés : le mouvement des droits civiques, la révolution féministe, le désordre écologique, le dérèglement climatique, mais aussi les révolutions technologiques » (p. 13). L’objectif du livre est donc pour le moins ambitieux : d’une part, défendre et analyser philosophiquement l’existence de cette révolution et, d’autre part, montrer à quoi elle « nous oblige sous l’angle de la liberté. » Cette liberté est, pour l’autrice, « indissociable d’une volonté d’éclairer la beauté, la rationalité et la majesté de la Nature tout en assumant la dignité de notre propre nature » (p. 23). Redéfinir la liberté comme une responsabilité écologique envers le monde et notre propre humanité, voilà en quelques mots la direction de cet ouvrage. La première partie, nommée « Philosophie et écologie : l’autre voie », nous emmène vers une généalogie de l’écologie, de la philosophie antique à Spinoza. L’autrice s’attarde particulièrement sur ce dernier et sa célèbre formule « Deus sive Natura » dans laquelle elle décèle une critique majeure de l’anthropocentrisme, annonçant « une réconciliation de l’être humain et une Nature qui ne lui sera plus subordonnée ni soumise » (p. 43). L’histoire de la philosophie écologiste que propose Laurence Hansen-Løve passe ensuite en revue Jean-Jacques Rousseau sur la question des animaux, Claude Lévi-Strauss sur l’humanisme, et Hans Jonas sur la responsabilité. Ces derniers, nommés « lanceurs d’alerte », seraient à l’origine d’une profonde mutation de nos obligations morales vis-à-vis de la nature. La « nouvelle vague » décrit la naissance du mouvement écologiste en tant que tel dans les années 70 et les débats qui l’animent, de l’écosophie à l’éthique animale. La deuxième partie, « 2020-2021. Répétition générale », établit un parallèle entre la COVID-19 et la crise climatique, afin de nous faire comprendre que « la révolution globale, cosmopolitique, écologique et sociale impliquerait des mesures extrêmement ambitieuses demandant une remise à plat complète des règles habituelles de l’économie ». La crise climatique serait ce « fait social total » qui nous oblige à tout repenser, en particulier les fonctionnements destructeurs du capitalisme et de la mondialisation. Le dernier chapitre traite quant à lui de la place de la désobéissance civile, de la responsabilité et des nouvelles façons de faire de l’écologie : le mouvement climat en est un exemple édifiant, mais il serait aux prises avec une constante « tentation de la violence » (p. 132). Là, Laurence Hansen-Løve s’intéresse à l’épineuse question de la violence dans le militantisme écologique, ayant pourtant statué dès les premières pages sur la non-violence qui caractériserait la révolution actuelle. La philosophe revient ici sur cette question en expliquant que, stratégiquement, la non-violence permettrait d’atteindre plus efficacement des objectifs politiques. La troisième partie, « Points de bascule », se concentre sur les implications juridiques de la révolution. On voit apparaître pour la première fois dans le livre des initiatives …
Laurence Hansen-Løve, Planète en ébullition. Écologie, féminisme, responsabilité, Montréal, Écosociété, 2022, 248 p.[Notice]
…plus d’informations
Myriam Bahaffou
Université de Picardie Jules Verne Amiens/Université d’Ottawa