Abstracts
Résumé
Malgré des appels répétés dans les campagnes de prévention du suicide pour que les personnes suicidaires s’expriment, plusieurs ne se sentent pas en sécurité de le faire. Puisque briser le silence est capital pour prévenir les suicides, la peur de parler est contreproductive. Comment expliquer ces silences ? La thèse défendue est qu’en dépit d’une laïcisation, d’une décriminalisation et même d’une certaine dépathologisation du suicide, les personnes suicidaires, leurs gestes et leurs discours demeurent inintelligibles en fonction d’une injonction à la vie et à la futurité. Des mécanismes sont en place pour culpabiliser, surveiller/punir et pathologiser les personnes suicidaires, les empêchant de parler. Je soutiens l’idée que l’injonction à la vie et à la futurité est promue par l’ensemble des discours actuels sur le suicide. Qu’il s’agisse de l’approche médicale, sociale ou biopsychosociale, les divers modèles sur le suicide aboutissent tous à la même conclusion : le suicide n’est jamais une option. Dans leur condamnation univoque du suicide, ces modèles n’écoutent les personnes suicidaires que dans une logique de surveillance, créant des espaces peu sécuritaires pour s’exprimer. M’inspirant des théories crip et des études du handicap qui critiquent le modèle médical et social du handicap et développent d’autres modèles, je propose l’adoption d’un modèle sociosubjectif du handicap pour interpréter le suicide.
Mots-clés :
- Suicide,
- études critiques du handicap,
- santé mentale,
- oppression des personnes suicidaires (suicidisme),
- injonction à vivre
Abstract
Despite repeated calls in suicide prevention campaigns for suicidal people to express themselves, many do not feel safe to do so. Because breaking the silence is crucial in preventing suicides, fear of speaking is counterproductive. How can we explain these silences ? The thesis herein states that, despite the secularization, decriminalization, and even depathologization of suicide, injunctions to live and to futurity render suicidal people, their acts, and their discourse unintelligible. Mechanisms are in place to blame, control/punish, and pathologize suicidal people, preventing them from speaking. I support the notion that the injunctions to live and to futurity are promoted by the totality of current discourse on suicide. Whether using a medical, social, or biopsychosocial model, these various approaches to suicide arrive at the same conclusion : suicide is never an option. In their unequivocal condemnation of suicide, these approaches only listen to suicidal people’s voices through a logic of surveillance, creating spaces that are unsafe for expression. Inspired by crip theories and disability studies, which critique the medical and social models of disability and develop other models, I recommend adopting a socio-subjective model of disability to interpret suicide.
Keywords:
- Suicide,
- critical disability studies,
- mental health,
- suicidal people’s oppression (suicidism),
- injunction to live
Resumen
A pesar de que las campañas de prevención del suicidio invitan a las personas suicidas a expresarse, varias no se sienten seguras de hacerlo. Romper el silencio es fundamental para prevenir los suicidios y el miedo a hablar es contraproducente. ¿Cómo explicar este silencio ? La tesis defendida es que, a pesar de la existencia de una secularización, de una descriminalización y hasta de una cierta “despatologización” del suicidio, las personas suicidas, sus gestos y discursos siguen siendo incomprendidos en función de un mandato a la vida y al futuro. Existen mecanismos puestos en marcha para culpabilizar, vigilar o castigar y “patologizar” a las personas suicidas, impidiéndoles hablar. Sostengo la idea que el mandato a la vida y al futuro es promovida por el conjunto de los discursos actuales sobre el suicidio. Ya sea que se trate de la aproximación médica, social o biopsicosocial, los diversos modelos del suicidio llegan a la misma conclusión : El suicidio no es nunca una opción. En su condena inequívoca del suicidio, estos modelos no atienden a las personas suicidas sino dentro de una lógica de vigilancia, creando espacios poco seguros para expresarse. Inspirándome de las teorías crip y de los estudios sobre la discapacidad que critican el modelo médico y social de la discapacidad, y desarrollan otros modelos, propongo la adopción de un modelo socio-subjetivo de la discapacidad para interpretar el suicidio.
Palabras clave:
- Suicidio,
- estudios críticos de la discapacidad,
- salud mental,
- opresión de las personas suicidas (suicidismo),
- mandato a la vida
Article body
Les personnes suicidaires peuvent-elles parler ?
In the current environment… talking about your suicidal feelings runs the very real risk of finding yourself being judged, locked up and drugged. Suicidal people know this and… will do their best to prevent it happening to them. We hide our feelings from others, go underground. And the deadly cycle of silence, taboo and prejudice is reinforced… There is a fundamental flaw at the core of contemporary thinking about suicide ; which is the failure to understand suicidality as it is lived by those who experience it.
Webb, 2011, p. 5
David Webb est le premier spécialiste de la suicidologie qui puise à même son expérience comme personne ayant un passé suicidaire dans une discipline dominée par des chercheurs et chercheures qui ne sont pas (ou ne déclarent pas être ou avoir été) suicidaires. Ses propos trouvent écho dans des témoignages de personnes suicidaires que l’on retrouve dans des autobiographies, autofictions et essais (Arcan, 2004a, 2004b, 2008), des courts métrages (Shraya, 2017 ; The Economist, 2015), des discussions publiques (Bayliss, 2016 ; CBC Radio, 2016 ; Maier-Clayton, 2016) et des témoignages de participants et participantes dans des recherches (Stefan, 2016). Les personnes suicidaires sentent qu’elles ne peuvent pas parler ou qu’il est dangereux de le faire. Puisque « briser le silence » est capital pour prévenir les suicides, cette impossibilité de parler et la peur de le faire sont contreproductives. Comme Susan Stefan (2016) le note : « [t]he people I interviewed were unanimous in saying that the more determined they were to kill themselves, the more they concealed their intentions » (p. 107-108). Les statistiques confirment cette triste réalité : les personnes suicidaires se cachent pour mourir (Beattie et Devitt, 2015 ; Organisation mondiale de la santé, 2014 ; Peck, 2003).
Comment expliquer les silences qui précèdent les gestes suicidaires qui, s’ils avaient été brisés, auraient peut-être sauvé des vies ? Comment, dans nos contextes contemporains, comme dans la société canadienne dans laquelle le suicide n’est plus considéré unilatéralement comme un péché, un crime ou une pathologie, peut-on comprendre les résistances des personnes suicidaires[3] à parler de leur désir de mort ? Ces questions sont au coeur du présent essai. La thèse défendue est qu’en dépit d’une laïcisation, d’une décriminalisation et même d’une certaine dépathologisation eu égard au suicide, les gestes et les personnes suicidaires de même que leurs discours demeurent inintelligibles en fonction des normes dominantes et de ce que je nomme une « injonction à la vie et à la futurité [4] ». Des mécanismes à la fois matériels et idéologiques sont en place pour « remoraliser »/culpabiliser, surveiller/criminaliser/punir et pathologiser/paternaliser les personnes suicidaires, les empêchant de parler ou de passer à l’acte, tout en les stigmatisant, les marginalisant et les discriminant. Comme les études empiriques le montrent, les personnes suicidaires sont institutionnalisées et médicamentées contre leur gré, se voient refuser la garde de leurs enfants, exclues de programmes d’assurances, congédiées, expulsées des universités, traitées d’irrationnelles, vues comme incapables de jugement ou de consentement[5] et comme des dangers pour elles-mêmes, ou perçues comme lâches et égoïstes, pour ne nommer que ces violences (Beattie et Devitt, 2015 ; Hewitt, 2013 ; Joiner, 2005 ; Stefan, 2016 ; Szasz, 1999 ; Wallace, 1999 ; Webb, 2011). Il n’est pas surprenant, dans un tel contexte de culpabilisation, de criminalisation[6] et de pathologisation, que les personnes suicidaires se tapissent dans le secret, les conduisant parfois à accomplir leur suicide sans avoir pu explorer ce désir de mort avec des professionnels et professionnelles de la santé, leurs proches et leur famille. Je défends ici l’idée que l’injonction à la vie et à la futurité est promue par l’ensemble des discours qui dominent les champs de la suicidologie et de la suicidologie critique. Qu’il s’agisse de l’approche médicale/psychiatrique qui conçoit les idéations suicidaires comme résultant de problèmes individuels de santé mentale, de l’approche sociale/structurelle qui les perçoit comme émanant de problèmes sociaux (pauvreté, racisme, capacitisme, hétérosexisme, transphobie/cisgenrisme, etc.), ou encore d’approches mixtes, comme l’approche biopsychosociale adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (2014), qui mentionne à la fois des « facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et culturels dans le déterminisme des comportements suicidaires » (p. 8), les divers modèles pour théoriser le suicide aboutissent tous à la même conclusion : le suicide n’est jamais une option[7].
Dans leur condamnation univoque et unanime du suicide comme étant une mauvaise solution à la souffrance humaine, ces modèles d’interprétation du suicide n’écoutent les personnes suicidaires que dans une logique de surveillance, de régulation et de prévention : identifier les personnes « à risque », les convaincre qu’elles ont tort de vouloir mourir et les faire changer d’idée, invalidant leurs discours sur le suicide. Autrement dit, à travers cette vision homogène et négative du suicide (comme solution à éviter dans tous les contextes), les différents modèles de conceptualisation du suicide et les stratégies de prévention qu’ils promeuvent, les personnes suicidaires ne sentent pas qu’elles peuvent parler ou qu’il est sécuritaire de le faire, craignant l’échec de leurs plans, les conséquences du dévoilement et la délégitimation de leur voix. Or les formes de délégitimation, de marginalisation et d’exclusion qu’elles vivent ont été peu, voire pas du tout problématisées sous l’angle des études antioppressions[8], qui ont pourtant théorisé les réalités de la plupart des groupes marginalisés. Les études antioppressions, lorsqu’elles se penchent sur la question du suicide, adoptent le modèle social, reconduisant l’idée selon laquelle le suicide n’est jamais une option qui devrait être poursuivie et tentent plutôt d’amener les personnes suicidaires à comprendre les motifs structurels à la source de leur détresse. Les personnes suicidaires ne sont pas ainsi écoutées, contrairement aux autres groupes marginalisés, mais plutôt réduites au silence et perçues comme des victimes d’oppressions structurelles dont les désirs de mort doivent être éradiqués à travers des luttes politiques et sociales. Autrement dit, les perspectives antioppressions reproduisent une oppression suicidiste. J’ai créé en 2017 le néologisme « suicidisme » pour désigner un système d’oppression (construit à partir des perspectives non suicidaires) sur le plan normatif, discursif, médical, légal, social, politique, économique et épistémique, dans lequel les personnes suicidaires vivent de multiples formes d’injustice et de violence (discrimination, stigmatisation, exclusion, pathologisation, criminalisation, etc.) (Baril, 2018). Si les modèles sociaux mis de l’avant par les études antioppressions visent à libérer les groupes qui sont opprimés, notamment à travers les modèles médicaux qui pathologisent et réduisent des problèmes sociaux à des troubles individuels, force est de constater que les modèles sociaux produisent leurs propres formes d’exclusion et de marginalisation. L’oppression suicidiste que vivent les personnes suicidaires demeure non problématisée, non seulement à partir des modèles médical et biopsychosocial, mais aussi à partir du modèle social, un modèle qui excelle pourtant habituellement à mettre en lumière les rapports de pouvoir. Or, les rapports de pouvoir entre personnes suicidaires et non suicidaires demeurent ici, même à partir du modèle social, sous-théorisés, une lacune que cet essai vise à combler.
En m’inspirant des théories crip[9] et des études critiques du handicap qui soulignent les limites du modèle médical et social du handicap et qui développent d’autres modèles, je propose l’adoption d’un modèle de troisième voie que je nomme le « modèle sociosubjectif du handicap » pour interpréter les idéations et gestes suicidaires. Ce dernier vise à pallier les limites des modèles dominants afin de permettre aux personnes suicidaires de s’exprimer librement. J’aimerais faire deux remarques à propos des idées défendues ici : 1) je n’encourage pas le suicide ; 2) je soutiens la prévention du suicide. Néanmoins, comme je le démontrerai, je crois que des discussions franches sur le suicide nous permettront de prévenir davantage de suicides, permettant aux personnes suicidaires de s’exprimer sans crainte. Mon approche renouvelle ainsi les approches préventives en vigueur. Toutefois, lorsque des personnes ressentent un besoin profond et stable de mourir, je propose également que nous accompagnions ces personnes dans une démarche de suicide assisté[10], à partir d’une approche fondée sur la compassion et la réduction des méfaits. Mon approche se distingue ainsi de celles promues par Stefan (2016), Webb (2011) ou Werth (1998), qui soulignent l’importance de laisser parler librement les personnes suicidaires, mais uniquement pour renforcer les stratégies de prévention et non pas pour assister celles déterminées à mourir dans leur suicide.
La première section de cet essai présente trois modèles de conceptualisation du handicap. La deuxième montre que certains de ces modèles (médical et social) ont aussi dominé le champ de la suicidologie (critique ou non) et comment, en dépit d’approches visant à dépasser leurs limites comme l’approche biopsychosociale, tous ces modèles aboutissent à la même conclusion selon laquelle le suicide est une mauvaise solution. La troisième section applique le modèle sociosubjectif du handicap au suicide et met en lumière son potentiel heuristique pour renouveler les approches dominantes du suicide et leurs stratégies d’intervention. Cette dernière section, faisant office de conclusion, insiste aussi sur l’importance de reconnaître l’oppression suicidiste vécue par les personnes suicidaires et d’être à l’écoute de leurs voix et de leurs besoins.
Les différents modèles de conceptualisation du handicap
The disability rights movement, like other social change movements, names systems of oppression as the problem, not individual bodies. In short it is ableism that needs the cure, not our bodies.
Clare, 2009, p. 122
Bien qu’il existe plusieurs modèles pour théoriser le handicap[11], ce dernier a été, au cours des dernières décennies, appréhendé principalement à partir de deux modèles : médical et social. Le modèle médical conceptualise les handicaps comme des pathologies individuelles à traiter et guérir. À partir de ce point de vue, les handicaps sont en eux-mêmes sources de difficultés et souffrances et c’est la raison pour laquelle ce modèle souhaite corriger les conditions corporelles/mentales affectant les personnes handicapées (Fougeyrollas, 2006). Critiqué pour l’accent qu’il met sur la prévention et l’élimination des handicaps et l’assimilation des personnes handicapées aux structures dominantes, le modèle médical est considéré comme capacitiste et réducteur par plusieurs puisqu’il ne prend pas en considération l’oppression structurelle des personnes handicapées (Clare, 2009, 2017 ; Lewis, 2010 ; Shakespeare, 2010 ; Siebers, 2008 ; Wendell, 1996). Le modèle social du handicap a été développé au cours des années 1970 par des activistes en réaction au modèle médical et les problèmes qu’il soulève. Ce modèle fait la distinction entre l’incapacité, définie comme une condition physique ou mentale, et le handicap, qui se construit dans l’interaction entre l’incapacité et un environnement donné (architectural, communicationnel, etc.) (Crow, 1996 ; Fougeyrollas, 2006 ; Lanoix, 2005 ; Shakespeare, 2010 ; Siebers, 2008 ; Wendell, 1996). Selon ce modèle, les handicaps résultent des structures et de l’organisation des sociétés qui offrent des environnements peu ou pas adaptés pour les personnes ayant diverses incapacités et conditions. Les avantages du modèle social sont nombreux et ont été cruciaux dans l’activisme des personnes handicapées et le développement des études critiques du handicap, notamment pour rendre visible l’oppression capacitiste et pour fournir aux personnes des outils d’autonomisation (Clare, 2009 ; Crow, 1996 ; Shakespeare, 2010 ; Siebers, 2008).
Cependant, quelques auteurs et auteures critiques du modèle médical ont commencé également à relever des limites du modèle social du handicap (Crow, 1996 ; Kafer, 2013 ; Mollow, 2006 ; Siebers, 2008). Tout comme le modèle médical, il semble que le modèle social produise ses propres formes de violence, notamment en ignorant les expériences vécues de certaines personnes handicapées ou jugeant leur désir d’un traitement ou d’une cure (Baril, 2015 ; Clare, 2017 ; Kafer, 2013 ; Wendell, 1996). En effet, ce modèle a tendance à négliger l’expérience subjective à partir de la croyance selon laquelle une société qui serait adaptée aux diverses (in)capacités éliminerait toutes les formes de handicap (Baril, 2015 ; Shakespeare, 2010). Étant donné que dans le modèle social, l’incapacité est vue comme un élément neutre et non comme causant des souffrances ou des difficultés en soi, l’élimination du capacitisme est perçue comme suffisante pour libérer les personnes handicapées de leur souffrance (Crow, 1996). De plus, le modèle social est critiqué pour mettre davantage l’accent sur les handicaps dits typiques (personnes à mobilité réduite, aveugles, sourdes, etc.). Pour les personnes dont les handicaps sont cognitifs, mentaux, émotifs, invisibles, ou dont la santé est précaire, les solutions proposées par le modèle social qui visent le démantèlement des structures capacitistes sont incomplètes (Baril, 2015 ; Crow, 1996 ; Mollow, 2006 ; Nicki, 2001 ; Wendell, 1996). Alison Kafer (2013) écrit :
[T]he social model with its impairment/disability distinction erases the lived realities of impairment ; in its well-intentioned focus on the disabling effects of society, it overlooks the often-disabling effects of our bodies. People with chronic illness, pain, and fatigue have been among the most critical of this aspect of the social model, rightly noting that social and structural changes will do little to make one’s joints stop aching or to alleviate back pain.
p. 7
En somme, le modèle social a tendance à conceptualiser le handicap de manière désincarnée, empêchant de prendre au sérieux les difficultés et les souffrances vécues par plusieurs personnes handicapées en fonction de leurs conditions physiques, mentales ou émotives.
Dans l’objectif d’éviter à la fois les écueils des modèles médical et social, quelques auteurs et auteures en études critiques du handicap et crip ont adopté un troisième modèle qui permet de théoriser simultanément le capacitisme et les expériences subjectives liées à certaines conditions physiques, mentales et émotives (Crow, 1996 ; Kafer, 2013 ; Mollow, 2006 ; Nicki, 2001 ; Price, 2015 ; Siebers 2008). Comme je le mentionne ailleurs (Baril, 2015), cette troisième voie permet de « escape the quandary of explanations and solutions anchored either entirely in individual pathologies or entirely in social structures [emphase ajoutée] » (p. 65). Alors que certaines personnes, comme Crow (1996, p. 70), se réfèrent à cette troisième voie comme un modèle social « renouvelé », d’autres nomment autrement ce modèle qui reconnaît la complexité inhérente du handicap et prend en considération la dimension subjective/personnelle et sociale/politique de cette réalité (Baril, 2015 ; Kafer, 2013 ; Siebers, 2008 ; Wendell, 1996). J’utilise pour ma part l’expression « modèle sociosubjectif du handicap ».
Alors que la valeur heuristique de ce modèle sociosubjectif est considérable et que ce dernier a joué un rôle clé dans l’évolution récente des études critiques du handicap et crip, il demeure inexploré dans d’autres champs d’études antioppressions (Baril, 2015). Je soutiens qu’il demeure également inexploré en suicidologie (critique), alors qu’il m’apparaît particulièrement pertinent pour analyser les idéations et gestes suicidaires qui résultent à la fois de souffrances psychologiques/émotives individuelles et s’inscrivent dans des contextes sociaux qu’on ne peut ignorer. Malgré les limites évidentes des modèles médical et social pour théoriser la souffrance des personnes suicidaires, que je démontrerai dans la prochaine section, il semble que les travaux en suicidologie (critique) continuent d’interpréter le suicide à l’aulne de ces deux modèles, qui, en plus d’être lacunaires, reposent sur une injonction à la vie et à la futurité qui réduit les sujets suicidaires au silence. Bref, ces deux modèles reconduisent l’oppression suicidiste.
Les modèles médical et social d’interprétation du suicide[12]
Le suicide a historiquement été considéré comme un péché et un crime avant d’être appréhendé à travers deux modèles d’interprétation : médical et social (Cellard, Chapdelaine et Corriveau, 2013 ; Corriveau, Perreault, Cauchie et Lyonnais, 2016 ; Szasz, 1999). Le modèle médical/psychiatrique, qui a émergé au cours du 19e siècle, conçoit les idéations suicidaires comme des pathologies individuelles guérissables à l’aide de médicaments ou thérapies. Il a tendance à effacer le rôle des facteurs sociaux et environnementaux intervenant dans le désir suicidaire (Bayatrizi, 2008 ; Marsh, 2016 ; Stefan, 2016). Szasz (1999, p. 31), qui critique le modèle médical, indique qu’il repose sur trois présomptions[13] : 1) les gestes suicidaires résultent de la maladie mentale ; 2) les personnes suicidaires sont déresponsabilisées et la faute est attribuée à leur maladie[14] ; 3) les professionnels et professionnelles de la santé doivent traiter ces patients et patientes, même contre leur gré. Le modèle social, lui, perçoit les idéations suicidaires comme résultant de problèmes sociaux appelant des transformations sociales et politiques collectives plutôt que des interventions individuelles (Amundson et Taira, 2005 ; Cover, 2012 ; Longmore, 2003 ; Mäkinen, 2016 ; McDermott et Roen, 2016 ; Taylor, 2014 ; White, Marsh, Kral et Morris, 2016). Le modèle social poursuit néanmoins le travail de pathologisation du suicide entamé par le modèle médical, mais situe cette pathologie dans le social plutôt que le biologique :
[T]he medical camp insists that suicide is a result of mental maladies, while the sociological camp stresses social and cultural malaise. Suicide is a disease either of the individual or of civilization ; its pathology afflicts either the individual body or the body politic. What was not put in question is the assumption that suicide is, indeed, pathological and nothing more.
Bayatrizi, 2008, p. 102
Alors que les auteurs et les auteures reconnaissent que le modèle médical/psychiatrique a dominé les réflexions des dernières décennies sur le suicide, ce qui a donné lieu à d’excellentes critiques du modèle médical (Marsh, 2016 ; McDermott et Roen, 2016 ; Taylor, 2014 ; Szasz, 1999 ; Webb, 2011 ; White et al., 2016), la dominance du modèle social au sein des sciences humaines et sociales et des études antioppressions n’est jamais remise en question, du moins à partir d’une perspective interne à ces champs[15]. Puisque la thèse défendue dans cet essai veut que les principaux modèles du suicide aboutissent à la même conclusion, soit que le suicide est anormal et ne constitue pas une option, créant ainsi un environnement non sécuritaire pour les personnes suicidaires afin d’explorer leur désir de mourir, j’aimerais examiner les conséquences négatives du modèle social qui demeurent sous-théorisées.
Le modèle social du suicide est fondé sur deux principales présomptions : 1) le suicide ne résulte pas d’une maladie mentale ; 2) le suicide est un problème social et structurel (Cover, 2012 ; Dorais et Lajeunesse, 2005 ; Marsh, 2016 ; Reynolds, 2016 ; Smith et Jaffer, 2012 ; Webb, 2011 ; White et al., 2016). En opposition au modèle médical, le modèle social offre une « historicisation et politisation » (Taylor, 2014, p. 19-20) des subjectivités suicidaires pour mettre en lumière les normes et les structures dominantes, telles que l’hétérosexisme, le capacitisme, le cisgenrisme, le racisme ou l’âgisme, qui pousseraient certains groupes marginalisés au suicide. Les personnes qui adhèrent au modèle social soutiennent que la « haine tue » et que les analyses sociales permettent de politiser ces morts (Dorais et Lajeunesse, 2004 ; Reynolds, 2016). Malgré le fait qu’il comporte plusieurs avantages, comme de prendre en considération certaines oppressions, le modèle social n’est pas sans faille. J’aimerais ainsi soulever les interrogations suivantes : qui et qu’est-ce qui est absent ou oublié à travers cette interprétation du suicide ? Que pouvons-nous apprendre de ces absences et oublis ? Comment la mise en lumière de lacunes du modèle social permettrait-elle de forger de nouvelles alliances entre groupes marginalisés et éviter la remarginalisation de certains d’entre eux, comme celui des personnes suicidaires ?
J’argumente que les voix des personnes suicidaires sont absentes du modèle social. Cette absence permet aux divers groupes marginalisés qui adoptent le modèle social de se désolidariser des personnes suicidaires. Une des conséquences négatives du modèle social est de réduire les personnes suicidaires au silence, à travers une injonction à la vie et à la futurité en entretenant des tabous et de la stigmatisation au regard du suicide[16]. D’un côté, les personnes qui désirent mourir doivent garder le silence ; affirmer leur plan mènerait au sabotage de celui-ci, à travers une pléthore de mesures de prévention qui justifient l’institutionnalisation, consentie ou non, pour recevoir des soins (Stefan, 2016 ; Szasz, 1999 ; Webb, 2011). D’un autre côté, si elles expriment leurs idéations suicidaires, leurs voix sont invalidées à partir de deux perspectives. Premièrement, leur désir de mourir est perçu comme irrationnel à partir d’une forme de capacitisme mental (ou mentalism/sanism[17]) (Burstow, 2016 ; Hewitt, 2010, 2013). On présuppose ainsi que les personnes suicidaires souffrent de maladies mentales qui brouillent leur jugement, invalidant leur capacité de consentir à une mort provoquée. Certaines personnes qui critiquent la pathologisation et adoptent le modèle social se rabattent paradoxalement sur cet argument de l’irrationalité et du jugement altéré des personnes suicidaires lorsque vient le temps d’intervenir auprès d’elles (par ex. : Roen, Scourfield et McDermott, 2008 ; Shakespeare, 2006). Deuxièmement, le désir de mourir des personnes suicidaires est délégitimé à partir de perspectives paternalistes qui interprètent la solution suicidaire comme illégitime au regard de la souffrance sociale et politique (McDermott et Roen, 2016 ; Reynolds, 2016 ; Taylor 2014). Autrement dit, la mort par suicide ne peut pas être une option valable face aux oppressions ; seules les luttes politiques le sont. En somme, le désir de mort et les discours suicidaires ne peuvent être entendus, tant à partir du modèle médical que social, qu’à partir d’une logique préventive. Pour être intelligibles, ces discours doivent suivre les scripts dominants de prévention, en reconnaissant que le suicide est une mauvaise solution, qu’il affectera les proches et qu’il ne sera pas poursuivi ou accompli.
Même dans le champ de la suicidologie critique, dont les fondements questionnent l’accent mis, dans la suicidologie traditionnelle, sur l’objectivité, les données quantitatives et les perspectives externes (plutôt que situées), les chercheurs et chercheures qui promeuvent les approches qualitatives et le travail avec les communautés marginalisées continuent de parler pour les personnes suicidaires. Un exemple se trouve dans la section « Insider Perspectives » de l’ouvrage Critical Suicidology (White et al., 2016). Alors que l’on pourrait s’attendre, dans cette section, à retrouver une majorité de chapitres rédigés par des personnes suicidaires (ou des travaux d’analyses de notes de suicides), ce n’est pas le cas : un chapitre examine les perceptions des familles « survivantes », un autre est rédigé par deux travailleuses sociales et deux ex-suicidaires et un dernier est écrit par une personne ex-suicidaire. Bien que j’apprécie l’inclusion de discours d’ex-suicidaires dans cette section, seulement deux des six auteurs et auteures (une d’elles a participé à l’écriture de deux chapitres) proposent des récits à la première personne (perspectives situées). Qui plus est, donner la voix à des personnes ex-suicidaires plutôt qu’à des personnes suicidaires (ou qui ont laissé des témoignages avant leur mort) constitue un choix épistémologique influençant le contenu de l’ouvrage. Un autre exemple de cette réticence des chercheurs et chercheures à inclure les voix des personnes suicidaires est le choix méthodologique de Dorais et Lajeunesse (2004), dans leur étude sur les jeunes de la diversité sexuelle et le suicide, qui exclut les personnes dont la tentative date de moins de 24 mois. Bref, au sein des perspectives antioppressions qui se réclament du modèle social, les chercheurs et chercheures préfèrent donner priorité aux voix des professionnels et professionnelles de la santé, aux activistes, aux familles, aux amis et amies et aux personnes ex-suicidaires plutôt qu’à celles des personnes suicidaires. Je ne soutiens pas que les personnes non suicidaires ne devraient pas s’exprimer sur la question du suicide et je demeure conscient des limites des politiques identitaires. Néanmoins, en analysant les travaux réalisés par les personnes qui adhèrent au modèle social du suicide, il est clair que les rapports de pouvoir qui existent entre les personnes suicidaires et non suicidaires, contrairement à plusieurs autres rapports de pouvoir reconnus à partir de perspectives sociales, sont non reconnus au sein de ce modèle.
Je me demande quelles possibilités émergent lorsqu’on remet en question les conceptualisations dominantes du suicide et quelles stratégies d’intervention et solidarités entre groupes marginalisés apparaissent lorsqu’on pense le suicide à partir de modèles différents. L’une des possibilités qu’ouvrent de nouvelles interprétations est de reconnaître l’oppression suicidiste que vivent les personnes suicidaires, reconduite par les modèles du suicide qui sont mobilisés pour leur venir en aide. Nous devons ainsi, je crois, commencer à théoriser l’injonction à la vie et à la futurité pour ce qu’elle est : un système d’intelligibilité dominant, similaire à d’autres systèmes d’oppression, dont la construction et les mécanismes demeurent invisibles. Inspiré par des auteurs et auteures queers s’intéressant aux affects négatifs et leur potentiel politique (Cvetkovich, 2012) ou qui dénoncent, comme Sara Ahmed (2010), les effets marginalisants de l’injonction au bonheur pour les groupes marginalisés, je soutiens que l’injonction à la vie et à la futurité inhérente à ces modèles dominants nous propulse vers une politique du suicide qui n’est ni responsable, imputable, respectueuse ou compatissante envers les personnes suicidaires. L’injonction à la vie et à la futurité promue dans les modèles d’interprétation du suicide en vigueur et leurs stratégies d’intervention force les personnes déterminées à mourir à le faire seules dans des conditions difficiles. Cette injonction les pousse à se suicider sans avoir eu la chance d’explorer leurs idéations suicidaires franchement avec d’autres par peur des conséquences qui en découleraient. À partir de cette injonction, nous (ré)écrivons les vies et les morts des personnes suicidaires à travers les scripts dominants du suicide, refusant d’écouter leurs discours ou délégitimant leurs voix en assumant que les personnes non suicidaires (ou ex-suicidaires) détiennent la vérité sur le suicide. Il s’agit d’attitudes qui relèvent de formes de paternalisme. Malgré les similarités entre les expériences vécues par les personnes suicidaires et d’autres groupes marginalisés, comme des formes d’exclusion, marginalisation, stigmatisation, criminalisation, pathologisation et appropriation paternaliste de leurs voix/agentivité, les chercheurs et chercheures qui adhèrent au modèle social du suicide, même à partir de perspectives antioppressions, continuent trop souvent de parler pour les personnes suicidaires et de reproduire ces violences. Le modèle sociosubjectif du handicap, appliqué au suicide, permettrait de cultiver une attitude plus respectueuse vis-à-vis des personnes suicidaires.
Le modèle sociosubjectif du suicide : les personnes suicidaires voudraient parler, pouvons-nous les écouter ?
I asked, “If you could tell suicide prevention policymakers and mental health professionals three things, what would they be ? ” There was one message that was by far the most common. […] “DON’T…. treat them as if they are annoying and difficult, and pump them full of drugs. LISTEN for God’s sake.” [Survey 40] “Don’t come from a place of preventing–come from a place of connecting…” [Survey 75] “Listen, listen, listen. Listen with your whole being.” [Survey 93] “Be kind. Be understanding. Listen with your heart.” [Survey 209]
Stefan, 2016, p. xxvi
Une conclusion des travaux de Stefan avec les personnes suicidaires est que celles-ci voudraient s’exprimer librement, mais qu’il existe peu d’espaces accueillants et sécuritaires pour le faire. Comme le souligne Webb (2011), « In order to tell our stories… we need a space that is safe… All of me cannot be present when the biggest issue on my mind at the time, my suicidal thoughts, are denied, rejected, or avoided » (p. 59). L’adoption d’un modèle sociosubjectif du handicap pour penser le suicide pourrait nous aider à créer des espaces accueillants et sécuritaires. Ces espaces doivent être exempts (le plus possible) de formes de jugements, de stigmatisation, de paternalisme, d’oppressions et doivent favoriser un climat accueillant pour que les groupes marginalisés puissent exprimer leur vécu, leurs expériences, réflexions et revendications. Comme montré plus haut, à travers l’injonction à la vie et à la futurité, ni le modèle médical ni le modèle social du suicide ne permettent la création de tels espaces sécuritaires. En plus d’entretenir une vision négative et stigmatisante du suicide, les modèles médical et social ont pour conséquence de proposer des solutions qui ne répondent pas aux besoins des personnes suicidaires, du moins pas de toutes, particulièrement celles qui choisissent de se donner la mort.
Mon travail, influencé par les études critiques du handicap et crip, vise à instaurer des espaces sécuritaires pour les personnes suicidaires dans lesquels leurs voix peuvent être écoutées, légitimées et « désassujetties » (Foucault, 1997), à travers l’adoption d’un modèle sociosubjectif du handicap appliqué au suicide. Ce modèle considère, de façon similaire au modèle biopyschosocial, un ensemble de facteurs (biologiques, environnementaux, sociaux, etc.) contribuant aux idéations et gestes suicidaires, mais parvient à une conclusion différente et peut entrevoir le suicide comme une possibilité pour certaines personnes. Le modèle sociosubjectif reconnaît la souffrance subjective causée par la maladie physique ou mentale (dépression, anxiété, etc.), tout en évitant des formes de capacitisme mental qui invalideraient la capacité des personnes suicidaires de choisir le suicide sur la base de leurs maladies mentales. Il reconnaît simultanément que les expériences subjectives ne peuvent être vécues en dehors de contextes sociaux qui peuvent accroître ou alléger les idéations suicidaires. Ce modèle évite un réductionnisme des explications et solutions en termes uniquement médical ou social. Il propose également de travailler à de multiples niveaux simultanément ; si l’on doit agir pour transformer les oppressions (pauvreté, racisme, hétérosexisme, cisgenrisme, capacitisme, etc.) pouvant créer ou intensifier les idéations suicidaires, on doit aussi être à l’écoute de la souffrance individuelle que vivent les personnes suicidaires et respecter leur désir de mourir. Le modèle sociosubjectif accepte la possibilité, pour les personnes suicidaires, de mettre fin à leurs jours, non pas de façon isolée en fonction d’une vision libérale de l’autonomie où chaque personne a le droit de se suicider, comme Szasz (1999), Tappolet (2003) ou Stefan (2016) le soutiennent, mais bien de manière accompagnée (suicide assisté), basée sur la reconnaissance que dans le contexte actuel, la liberté et l’autonomie des personnes suicidaires sont diminuées par l’oppression suicidiste et des formes de capacitisme mental qui invalident leur agentivité. Bref, lutter pour des transformations sociopolitiques et une plus grande justice sociale n’est pas antithétique avec une plus grande imputabilité envers les personnes suicidaires et la reconnaissance des violences qu’elles vivent et qui sont reproduites au sein même des modèles d’intervention actuels.
L’approche fondée sur la réduction des méfaits proposée dans mon modèle sociosubjectif du suicide a été mobilisée dans une variété de contextes pour soutenir divers groupes marginalisés. Cette approche ne relève pas d’une logique d’interdiction, comme c’est le cas dans le modèle médical et social par rapport au suicide. Line Beauchesne (2010) affirme que l’approche de réduction des méfaits est plutôt basée sur une philosophie humaniste et traversée par deux objectifs : 1) augmenter le bien-être des groupes marginalisés ; 2) faciliter leur inclusion sociale. Comme Marlatt, Larimer et Witkiewitz (2012) le rappellent, la réduction des méfaits est davantage une « attitude » au regard des problèmes sociaux :
This overarching attitude has given rise to a set of compassionate and pragmatic approaches that span various fields… These approaches aim to reduce harm stemming from health-related behaviors… that are considered to put the affected individuals… at risk for negative consequences … These approaches also seek to improve QoL [quality of life] for affected individuals… [which] grew out of a recognition that some people will continue to engage in high-risk behaviors even as they experience associated harms.
p. 6
Dans le contexte actuel, nos lois, politiques de santé publique, stratégies d’intervention, modèles et discours sur le suicide ne représentent pas des réponses compatissantes, pragmatiques et imputables envers les personnes suicidaires. Comme plusieurs autres problèmes sociaux pour lesquels l’approche de réduction des méfaits est déployée, je pense qu’il y a une valeur heuristique à mobiliser celle-ci pour réagir aux idéations et gestes suicidaires. Comme le montrent les recherches, malgré les campagnes de prévention et les efforts déployés pour éviter les suicides, les personnes suicidaires continuent de se suicider (Arcan, 2004a, 2008 ; Beattie et Devitt, 2015 ; Organisation mondiale de la santé, 2014 ; Peck, 2003 ; Stefan, 2016 ; Szasz, 1999 ; Wallace, 1999). Je suggère donc d’adopter une politique fondée sur la compassion, le respect et l’imputabilité envers les personnes suicidaires qui vise à adopter des « approches de prévention non coercitives » (Szasz, 1999), tout en accompagnant dans une mort assistée, à travers une approche de réduction des méfaits, les personnes suicidaires avec un désir de mourir profond et stable qui auraient été accompagnées par des proches et des professionnels et professionnelles dans leur processus décisionnel[18].
Ne semble-t-il pas cruel de forcer l’envie de vivre ou la vie au nom d’une injonction à la vie et à la futurité parce que les personnes non suicidaires pensent qu’elles savent mieux que les personnes suicidaires ce qui est bon ou mauvais pour elles ? Quand des personnes aux prises avec des souffrances psychologiques et mentales qui réclament le suicide assisté, comme Graeme Bayliss, sont délégitimées sur les ondes publiques (CBC Radio, 2016) par des psychologues, sociologues et spécialistes qui prétendent savoir mieux qu’elles ce dont elles ont besoin, ou encore comme Adam Maier-Clayton qui a été poussé, malgré ses appels répétés pour une aide médicale à mourir, à accomplir son suicide dans l’isolement total (BBC News, 2017 ; Chiose, 2017 ; Maier-Clayton, 2016), il me semble urgent de se poser la question, en paraphrasant Spivak (1988), « les personnes suicidaires peuvent-elles parler » ? La réponse, dans le contexte actuel, est non. Pour être précis, certaines personnes, en dépit des préjugés, de la stigmatisation, de la pathologisation et de l’incompréhension osent s’exprimer, et d’autres ont essayé de le faire avant de s’enlever la vie, mais la véritable question est plutôt : pouvons-nous les écouter ? Le modèle sociosubjectif vise à créer un espace sécuritaire pour que les personnes suicidaires puissent parler librement, être écoutées et, ultimement, être accompagnées dans cette étape de la vie qu’est la mort.
Pour conclure, bien qu’il me soit impossible de prouver empiriquement cette idée, j’émets l’hypothèse qu’une telle approche pourrait sauver davantage de vies que les modèles actuels du suicide et les stratégies qu’ils proposent[19]. Dans les quelques pays qui ont décidé d’inclure dans leurs législations sur l’aide médicale à mourir les personnes dont les requêtes sont fondées sur des souffrances psychologiques et émotives (Appel, 2007 ; Stefan 2016 ; The Economist, 2015), plusieurs candidats et candidates changent d’idée en cours de route ; la préparation de leur mort est un processus cathartique qui leur donne parfois l’envie de vivre. Surtout, ce processus leur permet de discuter avec leurs proches et avec des professionnels et professionnelles de leur désir de mort, leur évitant ainsi de se replier dans le silence et de se suicider sans explorer d’autres avenues. Autrement dit, donner l’accès au suicide assisté aux personnes suicidaires peut s’avérer une méthode de prévention efficace, comme le rapporte Émily, cette jeune femme belge qui avait reçu l’autorisation pour une mort assistée basée sur ses souffrances psychologiques et qui a choisi de vivre à travers son processus préparatoire. Quand un journaliste lui demande ce qu’il serait arrivé si ce processus n’avait pas été disponible, elle répond : « Without the option of euthanasia, years of suffering would have been compounded by a gruesome, lonely death. I would have killed myself » (The Economist, 2015). C’est le cas aussi, dans une certaine mesure, de l’artiste Vivek Shraya, qui dans un court métrage intitulé I Want to Kill Myself (2017), relate comment, en brisant le silence et l’isolement, elle a réussi à survivre à son désir de mort, un silence qui demeure difficile à briser à partir des modèles du suicide et stratégie d’intervention en vigueur. Je lui laisserai donc la parole pour conclure :
Shraya, 2017I have long known the freedom and necessity of naming
but until this year I had never said I want to kill myself aloud. […]
Saying I want to kill myself felt like the first time I wasn’t lying to myself or to you.
Or pretending. For myself or for you.
Saying I want to kill myself made my pain explicit.
Saying I want to kill myself to the people who love me
meant I was shown an immediate and specific kind of care that I desperately needed.
Saying I want to kill myself kept me alive.
Appendices
Notes
-
[1]
École de service social, Université d’Ottawa, 120, rue Université, Ottawa (Ontario), Canada, K1N 6N5.
-
[2]
Cette recherche a été généreusement soutenue par la bourse postdoctorale Izaak Walton Killam offerte par le département de science politique de l’Université Dalhousie. Des versions préliminaires de cet article ont été présentées à Vienne, en mai 2016, au forum du 3e congrès de l’International Sociological Association, à Toronto, en mai 2017, lors des conférences annuelles de l’Association canadienne des études sur le handicap et des Women’s and Gender Studies et Recherches Féministes, ainsi qu’au colloque du Canadian Literature Centre of the University of Alberta au Banff Centre en octobre 2018. J’aimerais remercier les participants et les participantes de ces conférences pour leurs questions et commentaires. J’aimerais également remercier les responsables de ce numéro spécial pour leur précieuse collaboration, ainsi que les personnes ayant évalué de façon anonyme cet article pour leurs suggestions.
-
[3]
En faisant appel à la notion de « personnes suicidaires », je ne souhaite pas réduire ce groupe hétérogène à un tout homogène. Par exemple, la situation des personnes suicidaires canadiennes autochtones ou non autochtones est très différente et les analyses dans cet article ne sont pas universellement applicables à toutes les communautés.
-
[4]
Cette injonction à la vie et à la futurité s’inscrit dans des formes de biopouvoir et de biopolitique. Foucault (1997) soutient que le biopouvoir repose sur la logique « de « faire » vivre et de « laisser » mourir » (p. 214). C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons au Canada. D’un côté, nous adoptons des mesures de prévention du suicide pour les sujets considérés par l’État « récupérables » et, de l’autre, nous fournissons une aide médicale à mourir pour les sujets considérés « abjects » et « irrécupérables ». Par ailleurs, il serait intéressant dans des travaux futurs de considérer les implications de la mise en place de la Loi canadienne sur l’aide médicale à mourir sur les conceptualisations et les approches envers le suicide. Pour plus de détails sur ces sujets dont je ne peux traiter ici, voir Baril (2017a).
-
[5]
Cholbi (2002), Joiner (2005) et Shneidman (1993) endossent une posture selon laquelle le jugement des personnes suicidaires est altéré.
-
[6]
On peut penser à la criminalisation indirecte du suicide à travers celle des proches qui aident au suicide ou ne l’empêchent pas (Hunter, 2017).
-
[7]
Les campagnes de prévention fondées sur « l’approche zéro » (Usborne, 2017), visant à éradiquer tous les suicides, constituent des exemples de cette vision extrêmement négative du suicide.
-
[8]
L’expression « études antioppressions » réfère ici à un ensemble de disciplines (études féministes, de genre, des sexualités, de l’ethnicité, du handicap, trans, etc.) et englobe les mouvements sociaux qui leur sont liés puisque ces disciplines revendiquent des perspectives politiques et entretiennent des liens avec les groupes militants.
-
[9]
Robert McRuer (2006) est le père fondateur de la crip theory, en anglais. Les écrits en français sur le sujet sont quasi inexistants et à ma connaissance, je suis parmi les premiers universitaires à avoir défini le terme crip en français : « Le terme « crip » provient de l’adjectif anglais « crippled » et du nom « cripple » qui réfèrent à une personne dont la mobilité est réduite et sont utilisés comme termes dérogatoires pour désigner toute personne handicapée. Le terme « crip » a fait l’objet d’un détournement comparable à celui du terme « queer », qui a été resignifié positivement … Tout comme les théories/études queers se distinguent des théories/études gaies et lesbiennes par leur forte teneur anti-normative et anti-assimilationniste et sont perçues comme la faction transgressive et subversive des théories/études sur la diversité sexuelle, les théories/études crip se distinguent de façon similaire des théories/études sur le handicap… Autrement dit, les théories crip sont aux théories sur le handicap ce que les théories queers sont aux théories gaies et lesbiennes. » (Baril, 2017b, p. 6-7)
-
[10]
J’utilise l’expression « suicide assisté » pour désigner toute forme de soutien social, politique, légal et médical pour mettre fin à ses jours de façon volontaire et rationnelle. Nous retrouvons au Canada des formes de cette pratique sous l’appellation « d’aide médicale à mourir ». Je préfère l’expression « suicide assisté » puisque comme le montre Stefan (2016), la notion « d’aide médicale à mourir » s’est développée en excluant le suicide. Comme je théorise ici le droit des personnes suicidaires à obtenir une telle aide et que je crois que les demandes d’aide médicale à mourir constituent des formes de suicide, je préfère donc la notion plus inclusive de suicide assisté.
-
[11]
Melinda C. Hall (2016, p. 35-56) propose une typologie incluant six modèles : moral, caritatif, médical, social, minoritaire et culturel. Bien qu’intéressante, cette typologie ne se retrouve pas dans la majorité des travaux en études (critiques) du handicap, qui ne distinguent souvent que deux ou trois modèles (médical, social et troisième voie), d’où mon analyse de ces trois modèles. Précisons que tout travail de typologie, surtout dans l’espace limité d’un article, ne peut faire honneur aux nuances de même qu’aux débats et conflits internes de chaque modèle et sert davantage à établir les caractéristiques les plus importantes de ces modèles. Enfin, les deux sections suivantes sont inspirées de ces textes : Baril (2015, 2017a, 2018).
-
[12]
Les contraintes d’espace m’empêchent d’inclure une analyse du modèle biopsychosocial. J’ai choisi de me concentrer sur les modèles médical et social pour montrer les continuités entre les modèles pour théoriser le handicap et le suicide. De plus, le modèle biopsychosocial arrive aux mêmes conclusions que ces deux modèles. Sur ce modèle, voir Beattie et Devitt (2015, p. 46-49), Cover (2012), Joiner (2005) et Organisation mondiale de la santé (2014).
-
[13]
Marsh (2016, p. 16-22) et Bayatrizi (2008) analysent ces présomptions.
-
[14]
Au sujet de la responsabilisation criminelle et la déresponsabilisation en lien avec la maladie mentale, voir Perreault, Corriveau et Cauchie (2016).
-
[15]
Il existe des critiques du modèle social du suicide, mais elles sont effectuées à partir d’une perspective externe, c’est-à-dire à partir du modèle médical.
-
[16]
Il serait intéressant, dans des travaux ultérieurs, d’explorer la tension entre l’absence de futurité que vivent les personnes handicapées en fonction des normes capacitistes comme le théorise Kafer (2013) et l’imposition d’une futurité aux personnes dont le handicap est mental ou émotif, comme les personnes suicidaires. Je remercie l’une des personnes ayant évalué cet article pour cette remarque.
-
[17]
À propos du sanism, voir LeFrançois, Menzies et Reaume (2013), Lewis (2010) et Nicki (2001).
-
[18]
Les formes concrètes que prendrait cet accompagnement devront être discutées dans des travaux ultérieurs (par exemple : quelles professionnelles et professionnels de la santé sont autorisés à accompagner les personnes suicidaires ? Quelle est la durée minimale de la présence d’un désir de mourir pour le qualifier de stable ?). L’espace limité de cet article, combiné à son objectif de théoriser l’oppression suicidiste et les potentielles pistes d’action pour y remédier, ne permettent pas d’investiguer les modalités spécifiques d’un tel accompagnement.
-
[19]
Certains auteurs et auteures évoquent cette possibilité à partir d’approches différentes de la mienne. À ce sujet, voir Webb (2011) et Werth (1998).
Références
- Ahmed, S. (2010). The promise of happiness. Durham, NC : Duke University Press.
- Amundson, R. et Taira, G. (2005). Our lives and ideologies : The effect of life experience on the perceived morality of the policy of physician-assisted suicide. Journal of Disability Policy Studies, 16(1), 53-57.
- Appel, J. M. (2007). A suicide right for the mentally ill ? : A Swiss case opens a new debate. The Hastings Center Report, 37(3), 21-23.
- Arcan, N. (2004a). Se tuer peut nuire à la santé. P45, 1-2. Repéré à http://nellyarcan.com/pdf/P45_2004_corpus_chroniques.pdf
- Arcan, N. (2004b). Folle. Paris, France : Seuil.
- Arcand, N. (2008). Pour un pet… Repéré à http://fr.canoe.ca/divertissement/chroniques/nelly-arcan/2008/05/15/5577551-ici.html
- Baril, A. (2015). Transness as debility : Rethinking intersections between trans and disabled embodiments. Feminist Review, 111(1), 59-74.
- Baril, A. (2017a). The somatechnologies of Canada’s medical assistance in dying law : LGBTQ discourses on suicide and the injunction to live. Somatechnics, 7(2), 201-217.
- Baril, A. (2017b). Temporalité trans : identité de genre, temps transitoire et éthique médiatique. Enfances, Familles, Générations, 27. Repéré à https://journals.openedition.org/efg/1359
- Baril, A. (2018). « Fix Society. Please. » Suicidalité trans et modèles d’interprétation du suicide : repenser le suicide à partir des voix des personnes suicidaires. Manuscrit soumis pour publication.
- Bayatrizi, Z. (2008). Life sentences. The modern ordering of mortality. Toronto, Ontario : University of Toronto Press.
- Bayliss, G. (2016). It doesn’t get better. The mentally ill deserve the right to die with dignity. The Walrus. Repéré à https://thewalrus.ca/suicide-is-not-painless/
- BBC News. (2017). Adam Maier-Clayton [Vidéo en ligne]. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=XmW_1P3rBUs.
- Beattie, D. et Devitt, P. (2015). Suicide : A modern obsession. Dublin, Irlande : Liberties Press.
- Beauchesne, L. (2010). L’approche de réduction des méfaits : sa récupération politique. Dans V. Strimelle et F. Vanhamme (dir.), Rights and voices : Criminology at the University of Ottawa (p. 177-195). Ottawa, Ontario : Les Presses de l’Université d’Ottawa.
- Burstow, B. (2016). The Liberals’ assisted dying bill : Reflections on a cop-out. Repéré à http://bizomadness.blogspot.ca/2016/04/the-liberals-assisted-dying-bill.html
- CBC Radio. (2016). An open, ‘uncomfortable’ conversation on mental health, suicide and doctor-assisted death [Baladodiffusion]. Repéré à http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-25-2016-1.3551316/an-open-uncomfortable-conversation-on-mental-health-suicide-and-doctor-assisted-death-1.3551346
- Cellard, A., Chapdelaine, E. et Corriveau, P. (2013). « Des menottes sur des pansements » : la décriminalisation de la tentative de suicide dans les tribunaux du Québec entre 1892 et 1972. Canadian Journal of Law and Society, 28(1), 83-98.
- Cellard, A. et Corriveau, P. (2010). Éléments pour une sociologie historique du suicide au Québec, 1763-2000. Dans V. Strimelle et F. Vanhamme (dir.), Rights and voices : Criminology at the University of Ottawa (p. 255-269). Ottawa, Ontario : Les Presses de l’Université d’Ottawa.
- Chiose, S. (2017). Adam Maier-Clayton’s death renews debate on assisted-dying access for those with mental illness. The Globe and Mail. Repéré à https://www.theglobeandmail.com/news/national/adam-maier-claytons-death-renews-debate-on-assisted-dying-access-for-those-with-mental-illness/article34718194/
- Cholbi, M. J. (2002). Suicide intervention and non-ideal Kantian theory. Journal of Applied Philosophy, 19(2), 245-259.
- Clare, E. (2009). Exile & pride : Disability, queerness and liberation (2e éd.). New York, NY : South End Press.
- Clare, E. (2017). Brilliant imperfection : Grappling with cure. Durham, NC : Duke University Press.
- Corriveau, P., Cauchie, J.-F. et Perreault, I. (2014). Enjeux autour de la responsabilité du geste suicidaire en institution carcérale. Analyse des enquêtes du coroner de Montréal entre 1892 et 1950. Champ Pénal/Penal Field, 11, 1-21.
- Corriveau, P., Perreault, I., Cauchie, J.-F. et Lyonnais, A. (2016). Le suicide dans les enquêtes du coroner au Québec entre 1763 et 1986 : un projet de recherche inédit. Revue d’histoire de l’Amérique française, 69(4), 71-86.
- Cover, R. (2012). Queer youth suicide, culture, and identity : Unlievables lives ? New York, NY : Routledge.
- Crow, L. (1996). Including all of our lives : Renewing the social model of disability. Dans C. Barnes et G. Mercer (dir.), Exploring the divide (p. 55-72). Leeds, Royaume-Uni : The Disability Press.
- Cvetkovich, A. (2012). Depression : A public feeling. Durham, NC : Duke University Press.
- Dorais, M. et Lajeunesse, S. L. (2004). Dead boys can’t dance. Sexual orientation, masculinity, and suicide (traduit par P. Tremblay). Montréal, Québec et Kingston, Ontario : McGill-Queen’s University Press.
- Foucault, M. (1997). « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France 1976. Paris, France : Seuil/Gallimard.
- Fougeyrollas, P. (2006). La définition du handicap, Évaluation – Réadaptation – Réparation médico-légale. Repéré à http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/Ha2DefHandi.pdf
- Hall, M. (2016). The bioethics of enhancement. Lanham, MD : Lexington Books.
- Hewitt, J. (2010). Schizophrenia, mental capacity, and rational suicide. Theoretical Medicine and Bioethics, 31(1), 63-77.
- Hewitt, J. (2013). Why are people with mental illness excluded from the rational suicide debate ? International Journal of Law and Psychiatry, 36(5-6), 358-365.
- Hunter, B. (2017). Temptress who encouraged boyfriend’s suicide found guilty of manslaughter. Toronto Sun. Repéré à http://www.torontosun.com/2017/06/16/woman-who-sent-texts-urging-boyfriends-suicide-guilty-of-manslaughter
- Joiner, T. (2005). Why people die by suicide. Cambridge, Royaume-Uni : Harvard University Press.
- Kafer, A. (2013). Feminist, queer, crip. Bloomington, IN : Indiana University Press.
- Lanoix, M. (2005). Autonomie et inclusion. Dans M. N. Mensah (dir.), Dialogues sur la troisième vague féministe (p. 135-143). Montréal, Québec : Les Éditions du remue-ménage.
- LeFrançois, B. A., Menzies, R. et Reaume, G. (2013). Mad matters : A critical reader in Canadian mad studies. Toronto, Ontario : Canadian Scholars’ Press.
- Lewis, B. (2010). A mad fight : Psychiatry and disability activism. Dans L. J. Davis (dir.), The disability studies reader (3e éd., p. 160-176). New York, NY : Routledge.
- Longmore, P. K. (2003). Why I burned my book and other essays on disability. Philadelphia, PA : Temple University Press.
- Maier-Clayton, A. (2016). As a person with mental illness, here’s why I support medically assisted death. The Globe and Mail. Repéré à https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/as-a-person-with-mental-illness-heres-why-i-support-medically-assisted-death/article29912835/
- Mäkinen, I. H. (2016). Social dimensions of suicide. Dans D. Wasserman (dir.), Suicide : An unnecessary death (p. 47-61). Oxford, Royaume-Uni : Oxford University Press.
- Marlatt, G. A., Larimer, M. E. et Witkiewitz, K. (dir.). (2012). Harm reduction pragmatic strategies for managing high-risk behaviors (2e éd.). New York, NY : The Guilford Press.
- Marsh, I. (2016). Critiquing contemporary suicidology. Dans J. White, I. Marsh, M. J. Kral et J. Morris (dir.), Critical suicidology : Transforming suicide research and prevention for the 21st century (p. 15-30). Vancouver, Colombie-Britannique : UBC Press.
- McDermott, E. et Roen, K. (2016). Queer youth, suicide and self-harm : Troubled subjects, troubling norms. Londres, Royaume-Uni : Palgrave MacMillan.
- McRuer, R. (2006). Crip theory : Cultural signs of queerness and disability. New York, NY : New York University Press.
- Mollow, A. (2006). “When black women start going on Prozac…” : The politics of race, gender, and emotional distress in Meri Nana-Ama Danquah’s Willow weep for me. MELUS, 31(3), 67-99.
- Nicki, A. (2001). The abused mind : Feminist theory, psychiatric disability, and trauma. Hypatia, 16(4), 80-104.
- Organisation mondiale de la santé. (2014). Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial. Genève, Suisse : Organisation mondiale de la santé.
- Peck, D. L. (2003). Suicide and suicide trends in the United States, 1900-1999. Dans C. D. Bryant (dir.), Handbook of death & dying (p. 319-338). New York, NY : Sage Publications.
- Perreault, I., Corriveau, P. et Cauchie, J.-F. (2016). While of unsound mind ? Narratives of responsibility in suicide notes from the twentieth century. Histoire sociale, 49(98), 155-170.
- Price, M. (2011). Mad at school : Rhetorics of mental disability and academic life. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press.
- Price, M. (2015). The bodymind problem and the possibilities of pain. Hypatia, 30(1), 268-284.
- Reynolds, V. (2016). Hate kills : A social justice response to “suicide”. Dans J. White, I. Marsh, M. J. Kral et J. Morris (dir.), Critical suicidology : Transforming suicide research and prevention for the 21st century (p. 169-187). Vancouver, Colombie-Britannique : UBC Press.
- Roen, K., Scourfield, J. et McDermott, E. (2008). Making sense of suicide : A discourse analysis of young people’s talk about suicidal subjecthood. Social Science & Medicine, 67, 1-9.
- Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. New York, NY : Routledge.
- Shakespeare, T. (2010). The social model of disability. Dans L. J. Davis (dir.), The disability studies reader (3e éd., p. 266-273). New York, NY : Routledge.
- Shneidman, E. (1993). Suicide as psychache : A clinical approach to self-destructive behavior. Northvale, NJ : Jason Aronson.
- Shraya, V. (2017). I want to kill myself [Vidéo en ligne]. Repéré à https://vivekshraya.com/visual/i-want-to-kill-myself/
- Siebers, T. (2008). Disability theory. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press.
- Smith, M. et Jaffer, F. (dir.) (2012). Beyond the queer alphabet : Conversations on gender, sexuality and intersectionality. Edmonton, Alberta : University of Alberta.
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak ? Dans C. Nelson et L. Grossberg (dir.), Marxism and the interpretation of culture (p. 271-313). Champaign, IL : University of Illinois Press.
- Stefan, S. (2016). Rational suicide, irrational laws. Examining current approaches to suicide in policy and law. Oxford, Royaume-Uni : Oxford University Press.
- Szasz, T. (1999). Fatal freedom : The ethics and politics of suicide. Westport, CT : Praeger.
- Tappolet, C. (2003). Le droit au suicide assisté et à l’euthanasie : une question de respect de l’autonomie ? Revue philosophique de Louvain, 101(1), 43-57.
- Taylor, C. (2014). Birth of the suicidal subject : Nelly Arcan, Michel Foucault, and voluntary death. Culture, Theory and Critique, 56(2), 187-207.
- The Economist. (2015). 24 & ready to die [Vidéo en ligne]. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=SWWkUzkfJ4M
- Usborne, S. (2017). The bold new fight to eradicate suicide. The Guardian. Repéré à https://www.theguardian.com/society/2017/aug/01/zero-suicide-the-bold-new-fight-to-eradicate-suicide?CMP=fb_gu
- Wallace, S. E. (1999). The moral imperative to suicide. Dans J. L. J. Werth (dir.), Contemporary perspectives on rational suicide (p. 48-53). Philadelphia, PA : Brunner/Mazel.
- Webb, D. (2011). Thinking about suicide. Contemplating and comprehending the urge to die. Herefordshire, Royaume-Uni : PCCS Books.
- Wendell, S. (1996). The rejected body : Feminist philosophical reflections on disability. New York, NY : Routledge.
- Werth, J. L. (1998). Using rational suicide as an intervention to prevent irrational suicide. Crisis, 19(4), 185-192.
- White, J., Marsh, I., Kral, M. J. et Morris, J. (dir.). (2016). Critical suicidology : Transforming suicide research and prevention for the 21st century. Vancouver, Colombie-Britannique : UBC Press.

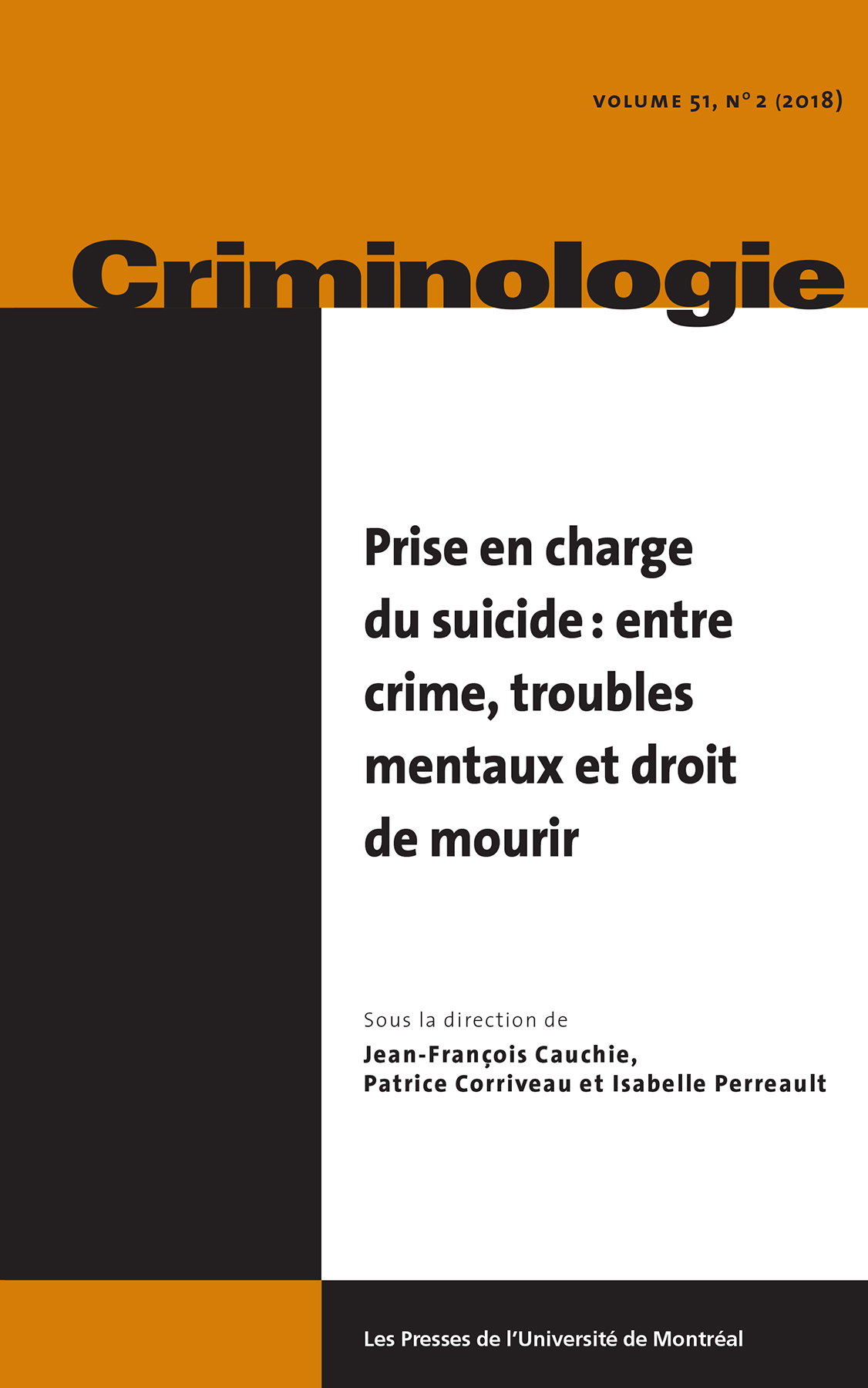
 10.7202/1045076ar
10.7202/1045076ar