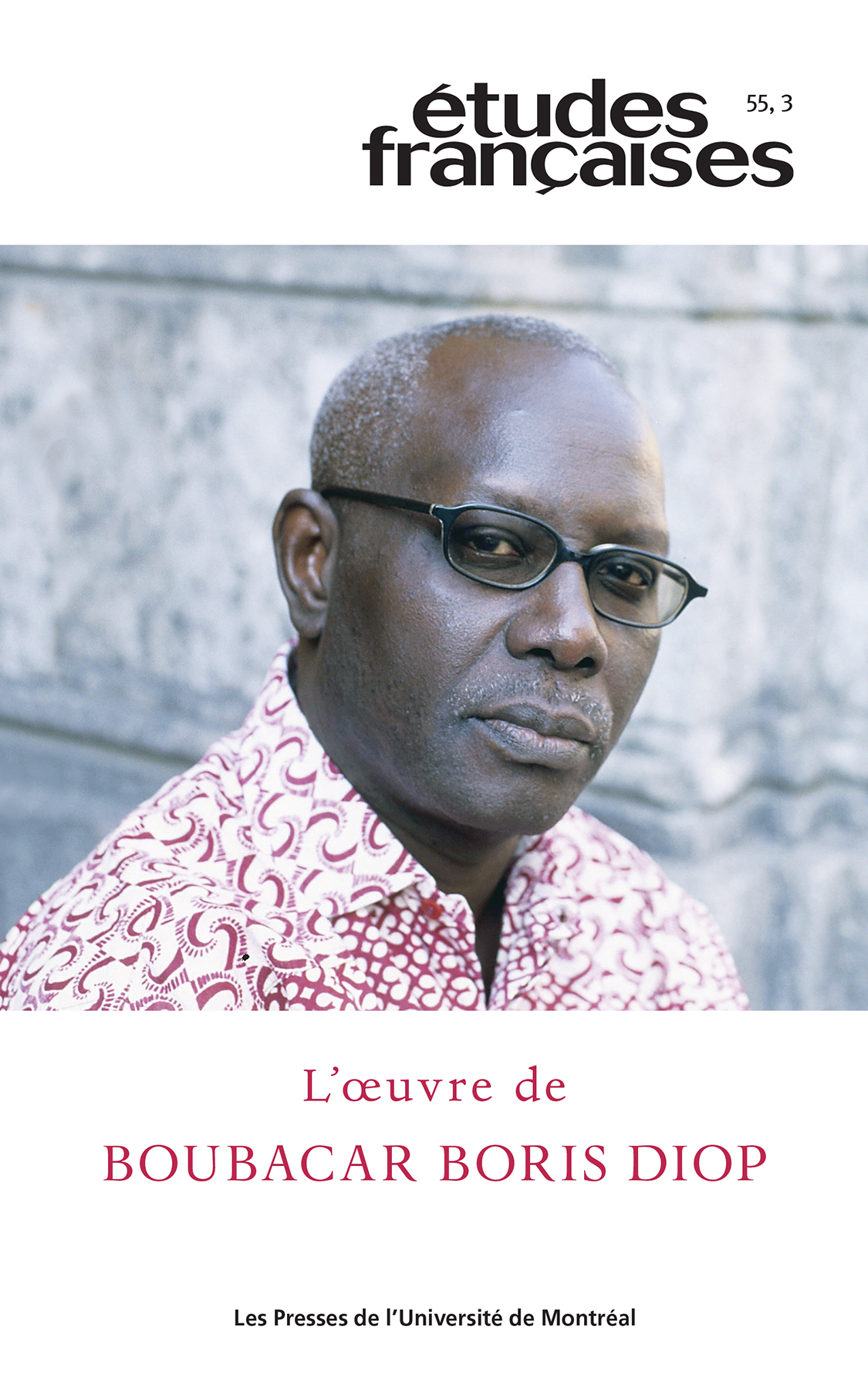Abstracts
Résumé
Cet article propose une analyse des techniques d’écriture du roman Les petits de la guenon de Boubacar Boris Diop, ou plutôt de son architecture rhétorique, qui recourt très souvent à des énigmes, des fables, des apologues, des paraboles, bref à des genres s’ordonnant autour de la figure majeure de l’allégorie. En choisissant pour guide les réseaux thématiques du miroir et du singe, le roman s’avère un fascinant enchevêtrement de récits et de figures allégoriques qui, d’une part, exemplifient l’esthétique et la vision du monde de l’auteur et, d’autre part, attestent l’innovation profonde et convaincante du roman africain.
Abstract
This article proposes an analysis of the narrative techniques of the novel Les petits de la guenon by Boubacar Boris Diop, or rather, of its rhetorical architecture, often resorting to enigmas, fables, apologues, parables, in short, to genres organizing themselves around the major figure of allegory. Choosing to follow the thematic networks of the mirror and the monkey, the novel reveals itself a fascinating entanglement of stories and allegorical figures, which, on the one hand, exemplifies the author’s aesthetics and world view, and, on the other hand, bear witness of the deep and convincing innovation of the African novel.
Article body
« [N]ous accédons à la vérité profonde des êtres par les chemins les plus inattendus. »
B. B. Diop, Les petits de la guenon (p. 228-229)
Les petits de la guenon est une réécriture de Doomi Golo[1], premier roman de Boris Diop en wolof, sa langue maternelle, qui soulignait le nouveau positionnement de l’auteur au sein de la littérature africaine, car, jusqu’à cette publication, il n’écrivait qu’en français depuis son premier roman, Le temps de Tamango[2]. Écrivant désormais en français et dans sa langue maternelle, il s’adresse à un double lectorat – local et dans la diaspora wolof – et national et international, ce qui exige évidemment d’investir des esthétiques et des stratégies de diffusion différentes. Cette question du positionnement de l’auteur dans le champ littéraire africain, pour importante qu’elle soit, ne fera pas l’objet de notre article, qui vise à analyser les structures narratives et esthétiques du roman Les petits de la guenon sans le comparer avec sa version en wolof.
Les petits de la guenon ou le jeu sur les méandres des genres
Dans une série de neuf « Carnets », qui constitue la première et la plus longue partie du roman, le narrateur, Nguirane Faye, raconte sa vie à son petit-fils, Badou, qui a immigré à l’étranger dans un pays non nommé, probablement au Maghreb. À cause de son âge avancé et de son angoisse entretenue par le manque de nouvelles, il pense qu’il ne le reverra plus.
Rien qu’en abordant les pages d’ouverture du troisième de ces carnets, « Les invisibles », dans lesquelles le personnage-scripteur annonce « l’heure de [ses] plus obscurs récits » (PG, 67), le lecteur est tout d’un coup saisi par la belle structure narrative de ce roman. Car non seulement le réseau thématique qui en constitue la charpente est complexe, mais aussi les stratégies narratives qui l’imprègnent et le substantifient. Il est vrai que, déjà, dans les deux premiers carnets, qui offraient les points de repère de l’ouvrage, certaines pages dépassaient, par des bonds inattendus, les genres de la chronique et de l’autobiographie dont se réclame le scripteur. Mais c’est à l’ouverture du troisième carnet que la poétique foisonnante des Petits de la guenon se révèle aussi bien dans sa complexité structurale que dans la profondeur de sa vision du monde.
En effet, apparemment fatigué par son travail de scripteur alors qu’il ne se considère que comme « un petit besogneux de l’écriture » (PG, 43) qui aurait préféré parler « de vive voix, comme tout conteur digne de ce nom » (PG, 19), à son aimé petit-fils Badou parti à l’étranger, le vieux Nguirane ouvre son troisième carnet. Il fait semblant de joindre Badou et de dialoguer avec lui en démasquant de cette manière tous les enjeux de l’oralité feinte de tant de romans africains[3]. En somme, c’est dans un exercice d’écriture déclaré comme tel que le vieux grand-père s’offre cet acte de parole :
PG, 67— Où es-tu Badou ? Je te cherche partout.
— Me voici, Nguirane.
— C’est l’heure de nos trois petits verres de thé à la menthe.
— Je m’en charge.
[…]
— […] Mais dis-moi Badou… ?
— Oui.
— Écoutes-tu seulement les histoires que je te raconte ?
— N’en doute pas un instant, Nguirane.
— Eh bien, c’est l’heure de mes plus obscurs récits.
Ce dialogue feint, qui est en même temps une méditation métalittéraire, est séparé par un astérisque du passage suivant dans lequel, en ayant recours aux structures de la fable, Nguirane imagine le long et difficile chemin qu’il a dû parcourir pendant la nuit au coeur de la forêt pour rejoindre son petit-fils. Il est suivi pas à pas par les bêtes sauvages qui proposent une morale sévère au point que la fable devient une parabole[4] :
PG, 68-69Des milliers de fauves suivent chacun de mes pas en retenant leur souffle. Leurs yeux brillent parfois derrière les buissons et les hautes herbes.
Le petit de la panthère s’impatiente et dit tout bas :
« Il est bien téméraire, celui-là. Qu’attendons-nous donc pour lui sauter à la gorge ? »
Sa mère le réprimande :
« Méfie-toi du Fils de l’Homme, mon enfant. C’est un être si étrange qu’il ne marche que sur deux pattes et, pour ce qui est des armes, il en invente chaque jour de nouvelles contre nous. Ce passant solitaire est peut-être en train de nous tendre un piège. L’homme est un être qui aime tuer. Nous ne savons pas pourquoi et lui non plus ne le sait pas. »
Sur la même page, après l’arrivée de Nguirane « sain et sauf » (PG, 69) chez Badou, le dialogue feint reprend entre le grand-père et le petit-fils. Il ouvre une profonde méditation métalittéraire sous forme de programmation de tout le roman, proposant des règles nécessaires au travail de l’écrivain[5] :
PG, 69Assis sur une natte au milieu de la cour, nous parlons de tout et de rien […]. Même si tu te donnes bien du mal pour me le cacher, je te sens nerveux. [… J]e reste silencieux pour éprouver ta patience. Tu n’en peux plus […] mais tu es bien trop fier pour me supplier de parler. […] Après le troisième verre [de thé], tu n’y tiens plus, tu me conjures de te dire tout ce que je sais. Je t’avoue, non sans malice, que je n’ai en vérité rien vu ni entendu quand je marchais tout seul au coeur de la forêt. Tu me lances alors sur un ton si décidé que j’en suis moi-même surpris :
« Cela importe peu. Raconte-moi quand même.
— Te raconter quoi, Badou ?
— Toutes les choses que tu n’as ni vues ni entendues là-bas. Et, Nguirane, si les mots sont trop lourds sur ta langue, donne-leur des ailes, fais-en des oiseaux pareils à ceux qui planent dans le ciel. »
Les thèmes de la narration (raconter des choses ni vues ni entendues) et les techniques nécessaires pour la créer sont ainsi définis par Badou (hypostase du lecteur) s’adressant à Nguirane (hypostase de l’auteur) ; et celui-ci, en effet, comme le fera aussi son successeur Ali Kaboye, n’arrêtera plus de raconter des choses ni vues ni entendues, tout en n’arrêtant jamais de faire « sentir le poids du monde matériel[6] ». Comment les deux narrateurs s’évertuent-ils à donner « des ailes » à leurs mots, si ceux-ci s’avèrent « trop lourds sur [leur] langue » ?
Beaucoup de critiques ont étudié la production romanesque de Boubacar Boris Diop en mettant en relief sa « densité structurelle sur le plan narratologique[7] », « le caractère extrêmement sophistiqué des structures narratives[8] », « l’adaptation […] des structures narratives à une oralité qui se fait écriture[9] ». Plusieurs autres ont montré comment ces procédés narratifs donnent lieu à une transculturalité et à une transgénéricité[10] étendues et variées assumant des traits formels généralement étrangers aux conventions du roman. Une telle technique permet d’innover en créant une oeuvre littéraire plus dense, riche et complexe sur les plans thématique, générique, narratif et énonciatif. Il s’agit surtout d’énigmes, de fables, d’apologues et de paraboles qui forment la constellation rhétorique s’ordonnant autour de la grande figure de l’allégorie. Ce mode d’engendrement textuel invite à une double lecture car il dégage deux niveaux de signification : une signification littérale, liée à la présence d’un référent concret, et une signification symbolique, liée à la première par l’analogie.
Dans son analyse de la littérature africaine après la rupture de l’année 1968[11], Jacques Chevrier inclut l’énigme et la parabole parmi « [l]es principaux ressorts de la littérature orale[12] » ainsi que « la fable [et] l’allégorie[13] ». Ces formes n’étaient pas absentes des romans de Boubacar Boris Diop qui ont précédé Les petits de la guenon. À propos des Traces de la meute, Susanne Gehrmann, par exemple, note que l’histoire de Dunya « se lit comme une allégorie pour l’état de la société, voire le monde[14] » ; et Lilyan Kesteloot, dans son compte rendu du Cavalier et son ombre, souligne que Tunde, l’enfant qui n’est pas né, est une allégorie « transparente », si bien que ce roman « se termin[e] en une longue et allégorique quête du salut[15] ». J’ai moi-même parlé d’allégorie à propos de certains personnages de Murambi, le livre des ossements, comme le père de l’Interahamwe Faustin Gasana qui, croupissant dans sa propre interminable pourriture, sa puanteur, sa mauvaise haleine, est « l’allégorie de la haine insensée et obtuse[16] ». Il en est de même pour la jeune mère qui, chaque jour à l’École technique de Murambi, prie sur les corps mutilés de son mari et de son enfant, et dont le geste est « allégorie de la douleur inconsolable et de la pitié indéfectible[17] ». Virginie Brinker, pour sa part, analyse Kaveena « comme un apologue, une fable politique » et voit dans le meurtre de la fillette « une allégorie […] de l’innocence sacrifiée sur l’autel de la perversité du pouvoir. [… U]ne figure du continent africain, dépecée par les intérêts politiques et économiques étrangers[18] ». Mais il ne s’agit que de quelques notations marginales par rapport aux grandes problématiques expérimentales de l’ensemble de l’oeuvre car, s’il est vrai, comme le souligne Francesca Paraboschi, que tous les ouvrages de l’écrivain peuvent être lus comme l’« allégorie de la condition humaine[19] », c’est dans Les petits de la guenon que ces figures acquièrent le rôle structurant de tout le roman et témoignent d’une plus grande innovation esthétique[20] de l’auteur.
Les petits de la guenon dans le trouble jeu du miroir narratif
Revenons aux premières pages du troisième carnet : un nouvel astérisque sépare le dialogue métanarratif que nous venons d’étudier du passage suivant, qui met en pratique les requêtes esthétiques de Badou (du lecteur) car il se présente comme une vraie parabole ayant pour interlocuteurs l’homme et le miroir. Il s’agit du troisième texte métanarratif qui complète l’explicitation des composantes littéraires (thématiques et formelles) nécessaires au roman. L’homme voit dans le vaste miroir qui « couvre toute la surface du mur » (PG, 70) des images, des lieux et des personnes de son enfance, qui l’émeuvent et le bouleversent à tel point que, tout énervé, il « se met à pester contre ce miroir prompt à ressusciter les défunts et les adolescents » (PG, 71). Agacé, le miroir prend alors la parole, en reprochant à l’homme de se plaindre « de ces reflets d’éternité qu’[il lui] offre » (PG, 71) :
Pour toi j’ai déroulé le temps à l’envers et […] tu es redevenu l’enfant aimé et tu as poussé des cris joyeux sous la pluie. Que te faut-il donc, à la fin, pour être heureux ? Prends garde à toi, ne me mets pas en colère ! Si je me brise en mille morceaux, il n’y aura autour de toi ni ruines ni désolation, mais bien pire : le vide et le silence. Est-ce cela que tu veux ?
PG, 71
L’homme comprend le discours du miroir, la valeur et l’importance de la mémoire ainsi que la nécessité de se sauver du « vide » et du « silence ». Sa réponse, qui est un petit mais lapidaire manifeste esthétique, le prouve lorsqu’il dit que le roman doit être un « refle[t] d’éternité » victorieux du « vide » et du « silence ». Au miroir, qui terminait son admonestation par une question (« Est-ce cela que tu veux ? »), l’homme répond : « Non, je ne le veux pas. Je veux rêver. Fais-moi visiter le lieu où le temps ne peut ni aller de l’avant ni revenir sur ses pas » (PG, 71).
Qui est cet homme qui veut rêver[21] ? Qui rêve de visiter le lieu où il n’y a plus les lois tyranniques du temps ? Dans une entrevue, Boris Diop a dit : « Le maître-mot pour tout vrai créateur est d’atteindre à l’infini[22] ». Ainsi, par un renversement des techniques romanesques, le scripteur Nguirane, qui est personnage dans le roman, se fait l’auteur du récit que nous lisons en évoquant quelques lieux et personnes de son enfance et de son adolescence – dont la mère de l’écrivain Boubacar Boris Diop, comme celui-ci l’a reconnu dans un entretien[23].
Mais c’est sur l’autre figure allégorique de cette page, celle du miroir, qu’on doit s’arrêter car elle constitue une constante essentielle de l’imaginaire de Boubacar Boris Diop. « Je te tends le miroir – dit par exemple le Passeur au protagoniste du Cavalier et son ombre –, et l’autre nom du miroir est l’abîme » (CO, 287). Dans Les tambours de la mémoire, Ismaïla, qui a été capable de briser le miroir qu’il s’était fabriqué, en est si épouvanté qu’il cherche à échapper « aux tentacules du Moi ; [de s’] arrach[er] à la contemplation des espaces intérieurs » (TM, 221). On connaît également la fonction capitale du miroir dans Les traces de la meute, où « Le Miroir » est le surnom du sosie et porte-parole du Maître du Pays. Celui-ci est toujours silencieux et ne se montre à son peuple qu’une fois tous les sept ans. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Boubacar Boris Diop a intitulé l’un de ses essais L’Afrique au-delà du miroir et si la présence obsessionnelle du miroir dans Les petits de la guenon a poussé différents critiques à associer pertinemment les deux ouvrages dans leurs analyses[24], ou, comme le fait Ousmane Ngom, à lier les deux oeuvres pour « mieux disséquer l’idéologie identitaire construite autour de l’imagerie du miroir[25] ». Ces quelques rappels suffisent pour mettre au jour la complexité du réseau thématique que tisse la figure du miroir, figure qui rassemble des significations allégoriques multiples et même opposées.
La première, qui est aussi la plus évidente et que nous avons rencontrée dans la parabole de l’homme et du miroir, permet à celui qui se regarde dans la glace de prendre conscience de lui-même, « de se connaître et de s’accepter[26] », d’assumer son vrai moi, sa propre histoire, et de retrouver sa mémoire – ce qui peut devenir difficile et même douloureux : c’est ce qui arrive à Nguirane pendant son voyage à Mbering-Saaj, sa terre d’origine, où il croyait retrouver la gloire de son prestigieux ancêtre. Or, il se révèle que ce dernier était un tyran qui a islamisé la contrée par la violence, un usurpateur sanguinaire haï et finalement chassé par les siens. Ainsi, Mbering-Saaj lui a « tendu un miroir » (PG, 126) et Nguirane souhaite que Badou soit capable de compléter son entreprise de mémoire, car, pense-t-il, « [l]e temps est un cercle et l’aïeul n’est pas encore né. Il t’appartient de le mettre au monde toi-même » (PG, 126)[27].
Le miroir peut encore être l’instrument métaphorique de « l’autosatisfaction narcissique » qu’analyse Ousmane Gnom[28] en évoquant, d’une part, le dictateur Dibi-Dibi qui, « [e]nfermé dans son palais aux murs tapissés d’immenses miroirs, […] avait constamment son image sous les yeux, la seule qu’il pouvait, de toute façon, supporter de voir » (PG, 170), et d’autre part, la pratique de l’auto-imitation, « consistant à se leurrer en s’accrochant sur l’idée d’une identité désuète[29] », comme le constate le personnage d’Ali Kaboye. Celui-ci est le fou errant de Niarela, mais qui, clairvoyant et moralisateur, devient peu à peu la voix la plus écoutée du quartier. Troublé par des jeunes aux « cheveux tressés à la manière d’autrefois, [… aux] longs colliers de perles et [aux] bracelets de cuivre » (PG, 328-329), qui croient se « regarder sans honte dans le miroir » (PG, 329), il leur demande : « De quoi avez-vous peur, fils ? Pourquoi vous imitez-vous vous-mêmes ? » (PG, 329) Mais le ton poignant et paternel d’Ali Kaboye (du romancier ?) envers ces jeunes « victimes d’auto-duperies inconscientes[30] » n’est pas celui qu’il emploie habituellement pour fustiger « la débauche généralisée subséquente à la perte de valeurs et de modèles politiques et religieux[31] ». Ici, il est sarcastique et subversif en prétendant voir la véritable histoire de tout un chacun dans le miroir caché dans la paume de sa main :
PG, 272Fou, Ali Kaboye ? Peut-être bien. Mais ce fou-là semblait toujours agir avec précision et méthode, selon un plan mûrement réfléchi. […]
Ali Kaboye se plantait au centre de Niarela et, les yeux rivés sur la paume de sa main droite, disait lentement, d’une voix profonde et pleine de force :
« Voici le miroir. Je les vois tous dans le miroir. Je vois chacun d’eux. »
Or, le « fameux miroir » (PG, 283) d’Ali Kaboye est purement imaginaire, il n’est qu’une métaphore qui fait du fou errant l’allégorie de ceux qui (comme le romancier), par un acte de folie, osent dire librement toute la vérité, ayant l’audace de « forcer [les gens] à voir ce qu’ils ont peur de voir[32] ».
Cependant, la signification la plus saisissante qu’assume le miroir est sans doute celle qui l’associe au singe, figure allégorique capitale, déjà dans le titre, Les petits de la guenon. Après son expérience bouleversante au Rwanda, Boubacar Boris Diop a reconnu : « Le génocide a pour moi un caractère profondément culturel, lié au mépris de soi, à l’incapacité de supporter son image dans le miroir. On pense que le Tutsi et le Hutu se méprisent parce qu’ils sont différents, mais pour moi c’est parce qu’ils sont semblables[33] », et, dans un autre entretien, il a lié cette conviction à une page des Petits de la guenon :
Le passage qui résume le mieux ce livre est celui où l’on voit un immense miroir au milieu de nulle part. Deux gorilles se retrouvent face au miroir et ils y voient leurs propres images. Ils commencent à se battre contre leurs reflets et à force de taper dans le miroir, ils se blessent et meurent. Ce que nous appelons la haine de l’autre est en fait la haine de soi. Il faut pouvoir supporter son image dans le miroir, assumer son identité[34].
C’est encore une fois Ali Kaboye, devenu, après la mort de Nguirane, le narrateur omniscient de la seconde partie du roman, qui raconte « la parabole, sur fond de prosopopée, des deux gorilles se guerroyant devant le miroir pour la protection de leur territoire », comme l’écrit très pertinemment Ousmane Ngom[35]. Son analyse résume le fond de cette fable où les deux gorilles tombent dans le piège que leur a tendu le fonctionnaire colonial en posant au coeur de la Forêt de Kagne un grand miroir, si bien qu’ils attaquent leur moi à travers leur propre image sans le reconnaître. Ousmane Ngom accorde à cette fable le statut d’allégorie[36], lue comme « un miroir qui réfléchit le miroir déformant de l’Européen pour qui l’Africain est un singe enclin au mimétisme et à la violence, [… aux] rébellions, guerres de sécession et autres formes de comportementalisme souvent présentées comme des conflits ethniques[37] ».
Si la diégèse de cette parabole allégorique se situe à l’époque coloniale, au moment du sabotage de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis, celle qui raconte la soirée de Babouin et de Rodrigo Mancera, immigrés au rocher de Gibraltar, paraît se dérouler dans le présent le plus actuel. Babouin, qui « a tout du stéréotype odieux de l’Africain[38] », semble concentrer tous les « préjugés tenaces […] sur l’Afrique » dont parle Boubacar Boris Diop dans sa postface à la nouvelle édition de Murambi, le livre des ossements[39]. J’ai déjà longuement analysé cet « apologue allégorique[40] », mais il nous faut quand même rappeler le « renversement foudroyant[41] » qu’opère le personnage de Babouin, « redevenu maître de son regard [… et] capable de s’emparer du miroir[42] » pour montrer au Blanc les horreurs qu’il a accomplies et tous les méfaits de sa folie.
Ce conte attachant s’inscrit cependant en abyme dans un autre conte, « La fausse histoire de Ninki-Nanka » (formant le carnet IV de Nguirane), qui est à son tour un « récit allégorique[43] » des événements (tous pleins de singes et de miroirs) qui ont troublé la vie du vieux scripteur. Ces événements s’ordonnent encore une fois selon une forme allégorique si bien que, avec la parabole de Babouin, nous sommes en présence d’une vertigineuse structure de mise en abyme : l’allégorie-cadre se réfléchit dans l’histoire allégorique de Ninki-Nanka (qui trace le destin figuré de Nguirane), englobant l’histoire allégorique de Babouin, qui configure sans doute le destin de Badou selon l’imaginaire de son grand-père.
Voyons comment ces événements traumatiques de la diégèse, qui ont perturbé la vie de Nguirane, de Badou et du quartier de Niarela, sont arrivés. Tout commence avec les funérailles d’Assane Tall, fils de Nguirane et père de Badou, qui est engagé en France comme footballeur. Tall avait arrêté depuis des années de donner de ses nouvelles et interrompu tout rapport avec sa terre, sa femme Bigué Samb et sa famille d’origine. L’annonce de sa mort, l’arrivée à Dakar de sa dépouille et de sa nouvelle famille, sa femme Yacine Ndiaye et ses deux enfants Mbissine et Mbissane, sont un choc terrible au point de provoquer le départ de Badou pour une destination inconnue, et le désarroi de Nguirane face aux deux enfants très mal élevés et très insolents – surtout face à leur mère. Celle-ci est considérée comme arrogante, vulgaire et despotique car elle se croit supérieure à tout le monde parce qu’elle vit en France alors qu’elle a perdu tous les repères de sa culture d’origine. Les gens du quartier de Niarela sont scandalisés par sa conduite impudente, éhontée, et sont, en même temps, amusés par ses airs dédaigneux, n’y voyant qu’une mauvaise imitation des Blancs. Aussi ont-ils tôt fait de trouver la comparaison qui va déclencher la prolifération des singes dans le roman (et leur valeur allégorique dès le titre) : Yacine Ndiaye est « [p]lus moche qu’une guenon » (PG, 130).
S’il est vrai que dans la culture wolof, comme le souligne Papa Samba Diop, « l’image du singe est loin d’être négative[44] », il est tout aussi vrai que « ni vraiment repoussant ni réellement attrayant, il est […] l’allégorie du mimétisme, physiquement et spirituellement[45] », et c’est cette allégorie que le lecteur trouve dans « la fausse histoire de Ninki-Nanka », qui n’est pas aussi fausse que le voudrait ce titre. Cette histoire s’avère être, avant tout, du point de vue métalittéraire, le moyen par lequel l’auteur montre comment, en partant de la réalité, naît un texte fictionnel. En effet, cette « fable […] répète l’histoire de Nguirane Faye incarné par le vieux Atou Seck, […] le président Dibi-Dibi [est le] double de Daour Diagne[46] », à savoir le président-dictateur du récit-cadre, qui n’arrête pas, écrit Nguirane, « avec une patience et une abnégation quasi infernales, [de] pousser notre pays vers l’abîme » (PG, 144). L’idée de Nguirane, en écrivant cette fable grâce à laquelle il est devenu désormais un vrai écrivain, est de « dire […] cette peur du désastre » (PG, 144), la peur de la guerre civile qui, dans sa création littéraire, ravage la république de Diafouné (imaginaire, mais si semblable à son Sénégal), car, dit-il, « le vrai sage avertit de l’imminence du désastre pour l’empêcher d’avoir lieu. Par la parole. Ou même par un modeste récit de fiction » (PG, 145). Toujours est-il que Nguirane ne peut s’empêcher de mêler aux terrifiants ravages provoqués par la guerre civile ses angoisses personnelles, lesquelles sont aussi poétiquement transfigurées : c’est de la simple comparaison caractérisant Yacine Ndiaye, « l’étrangère […] moche comme une guenon » (PG, 248), que surgit, dans le conte, une véritable guenon avec ses deux petits qu’elle laisse dans la cour d’Atou Seck.
Aussi, Nguirane, qui invente une histoire allégorique destinée à exorciser les catastrophes provoquées par la folie du pouvoir politique, éprouve-t-il le désir d’exorciser ses catastrophes familiales par les figures allégoriques de la guenon et de ses deux petits. Ceux-ci, en effet, se transforment bien rapidement en deux adolescents haineux et cruels qui s’emparent du vieux Atou Seck malgré son accueil hospitalier et affectueux, le lient à un arbre, en font l’esclave qu’on peut mépriser et torturer à loisir. En même temps, en bons singes, ils imitent la langue étrangère, les modes et la conduite des personnages qu’ils voient dans les programmes qui passent à la télévision, jusqu’à en devenir une reproduction parfaite, et si parfaite que, à la fin de la guerre civile gagnée par le dictateur grâce à ses alliés étrangers, l’officier des Blancs reconnaît les deux singes comme étant des siens, pendant que la guenon, revenue sur la scène, « sort un pistolet de sous son pagne et vise sans hâte le front d’Atou Seck » (PG, 208).
Si les singes de cette « fable cauchemardesque[47] », tout en restant des singes, s’humanisent au point de disposer de pagne et de pistolet, ou d’être considérés comme des Blancs, qu’en est-il des humains qui singent les Blancs, qu’en est-il de Yacine Ndiaye et de ses enfants ? Par un énième renversement, parallèle au genre de la fable dans laquelle les animaux s’humanisent, dans la réalité (dont la fable est l’allégorie) les humains s’animalisent : c’est le destin des deux petits de la guenon, des deux enfants de Yacine Ndiaye, après que celle-ci est tombée à pieds joints dans le piège que lui ont tendu Bigué Samb (la mère de Badou) et son acolyte, le féticheur Sinkoun Tiguidé Camara. Bigué Samb, qui feint d’être la meilleure amie de Yacine, mais qui n’est animée que par le désir de se venger de la trahison d’Assane Tall, a fait disparaître le passeport de Yacine et l’accompagne chez son féticheur, en la convainquant qu’il saura non seulement retrouver ses documents, mais aussi exaucer tous ses désirs. Or, les « rêves secrets » (PG, 380) de Yacine vont bien au-delà des documents disparus, et les souhaits qu’elle a silencieusement exprimés aux puissances invisibles alliées du féticheur, pendant des cérémonies inquiétantes et mystérieuses, sont apparemment tout à fait chimériques : elle veut « être transformée en une autre personne » (PG, 381), « en une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux verts » (PG, 383). En effet, comme le rappelle Ali Chibani, « Yacine vit un grave malaise identitaire et elle est la meilleure incarnation de la schizophrénie des dominés[48] ». Tout à coup, dans la pièce du féticheur, un grand miroir apparaît, devant lequel notre pauvre guenon doit aller se regarder, et ses pensées attestent « le degré de la haine de soi de cette femme[49] » :
Elle vit dans le grand miroir son visage affreusement brûlé par le xeesal. [… E]lle avait essayé, faute de mieux, de rendre sa peau au moins un peu plus claire. Un vrai désastre, au final. […] Ah ! Si Sinkoun Tiguidé pouvait exaucer son voeu ! Elle ne voulait plus être noire. […] Elle, Yacine Ndiaye, n’avait pas peur de la vérité : il y a une couleur pour la crasse et jusqu’à la fin des temps ce sera la couleur noire.
PG, 385
Yacine Ndiaye n’est pas capable de regarder au-delà du miroir, elle est de ceux qui n’arrêtent pas d’« être fasciné[s] par le vainqueur », qui n’arrivent pas à « refuser de se définir par rapport à lui, de se reconnaître dans l’image souvent avilissante que renvoie le miroir qu’il [leur] tend[50] », miroir qui a le pouvoir de transformer en singe ceux qui succombent, comme Yacine, la guenon qui imitait le Blanc. À ce point du roman, le récit-cadre se construit selon deux principes narratifs déterminants, l’un thématique, l’autre plus proprement structural.
Le thème qui s’impose est la signification du miroir grâce auquel la sorcellerie du féticheur peut se réaliser : par un déplacement transgénérique vers le merveilleux, Yacine Ndiaye se transforme, selon ses voeux, en la très blanche et très raffinée Marie-Gabrielle von Bolkowsky. Le miroir se manifeste maintenant comme un objet magique « suppos[é] posséder le don de transpercer le caché[51] », mais aussi comme le lien entre l’ici et l’au-delà, entre les vivants et les morts, capable de « combler le gouffre entre les deux dimensions[52] ». Yacine, au moment de sa transformation, le perçoit vaguement, par des sensations étranges et confuses :
Son corps fut parcouru de frissons. La terre s’ouvrit sous ses pieds. […] Franchir l’abîme. Passer de l’autre côté. L’abîme était là, tout près, si tentant. Mais elle le sentait : après le premier pas, son pied gauche ne rejoindrait jamais son pied droit. Le néant : une sorte de puits sans fond. [… E]lle se verrait en train de glisser dans le vide, seconde après seconde, jusqu’à la fin des temps […]. Vers où son corps serait-il ainsi aspiré sans cesse ? De cela, elle n’avait aucune idée. Elle savait juste que ce lieu, toujours proche et jamais accessible, elle devait l’appeler, faute de mieux, Ailleurs.
PG, 387-388
« Abîme », « néant », « vide » et « ailleurs », tel est le réseau thématique de tant d’oeuvres fantastiques qui, non seulement se trouve ainsi tracé, mais qui sert de révélateur au principe structural que j’annonçais et qui marque la conclusion de l’histoire de Yacine Ndiaye en la transformant en une vaste allégorie. J’ai rappelé, au commencement de ma réflexion, que l’allégorie se construit selon une double représentation : la première est littérale et directe, et la seconde, qui est indirecte, propose une signification symbolique, abstraite et idéale, liée à la première par l’analogie. La transfiguration de Yacine est l’allégorie de l’aliénation anéantissant celui qui est victime du mépris de soi jusqu’au reniement de son identité. Yacine, dit le roman, a « osé le traverser [« le lac de l’oubli »] », elle « es[t] passée de l’autre côté de la vie » (PG, 390), si bien que Bigué Samb pourra affirmer qu’elle « n’est pas encore morte, mais […] n’est plus vivante non plus » (PG, 409).
Les conséquences de ce reniement seront catastrophiques pour Yacine, qui sera frappée dans ce qu’elle pense aimer profondément : ses deux enfants. Certes, elle a refusé de céder l’un d’eux à Sinkoun Tiguidé qui l’exigeait en payement pour « ses mystérieux Amis » (PG, 392) qui ont permis ses opérations magiques. Le féticheur lui avait bien dit : « Si tu ne me donnes pas un de tes enfants, mes Amis te les prendront tous les deux » (PG, 394) ; et c’est ce qui arrive, en effet, puisque depuis « que leur mère, devenue complètement folle, prétend s’appeler Marie-Gabrielle von Bolkowsky, les deux enfants de Yacine Ndiaye ne sont plus les mêmes. Personne ne peut les approcher, car ils s’enfuient aussitôt avec des cris de terreur et montent se cacher dans les arbres » (PG, 397). On le perçoit dans ces quelques lignes : à partir de ce moment, la narration se poursuit comme sur le fil d’un rasoir, en gardant constamment la forme de l’énigme selon une possible mais indécidable double signification. D’une part, la rumeur se répand qu’une femme blanche, « apparemment très riche et très chic » (PG, 401), se propose de « voler deux enfants [du] pays et les emmener chez elle […], pour les vendre là-bas » (PG, 416), et on s’indigne, on se scandalise : « Ces gens ne doutent vraiment de rien […] : verrouiller leurs frontières puis venir voler les enfants de notre patrie ! » (PG, 423) ; d’autre part, on dit que « deux petits enfants ont été transformés en singes ! » (PG, 400) et un homme qui « a toujours haï Nguirane » (PG, 403) décrète que « [c]eux qu’il veut punir, Dieu les transforme en singes avant même de les faire griller dans les flammes de l’Enfer » (PG, 403). Par cette délégation de l’évaluation des faits diégétiques à la rumeur, le lecteur n’arrive pas à savoir ce qui est en train de se passer vraiment. Tout en restant fidèle au réalisme de la chronique, la narration garde intacte l’énigme de la guenon-femme blanche et des enfants-singes.
Dans la scène finale, quand des militaires blancs arrivent dans la maison de Nguirane pour « récupérer Madame von Bolkowsky » (PG, 426) qui s’y serait réfugiée pour fuir la colère populaire, Yacine se présente au capitaine Préval « avec ses deux enfants […] qui vivaient depuis quelque temps dans un état de terreur permanente » (PG, 427) ; mais Préval s’irrite de la prétention de la femme qui voudrait lui faire croire qu’il s’agit de ses propres enfants. Il lui dit sèchement : « Ces deux-là ? Vous les avez bien vus ? […] Madame, j’ai reçu l’ordre de vous faire sortir d’ici saine et sauve et je le ferai. Quand vous serez à l’ambassade, racontez-leur vos salades, je vous promets qu’ils vont rigoler ! » (PG, 428-429) Elle est ainsi obligée d’abandonner ses deux petits pour toujours. Préval a vu une dame blanche et deux enfants noirs. Cependant, peu de temps après, les gens de Niarela voient apparaître dans le quartier deux petits singes qui suscitent « un mélange de peur et de stupéfaction » (PG, 437). Bigué Samb les prend « sous sa protection » et ils vivront désormais « sagement perchés sur [ses] épaules » (PG, 437). C’est que Bigué Samb tient de cette manière la promesse qu’elle a faite à Nguirane dans leur dernier colloque, page capitale parce qu’ici seulement le sens de l’allégorie est clairement énoncé. Au moment où, bouleversé par tout ce qui est en train de se passer chez lui, Nguirane demande à Bigué Samb qui est la mystérieuse femme blanche présente dans sa maison, et lorsqu’il obtient une explication de ce qui est arrivé à Yacine Ndiaye, apparemment disparue, il échange avec Bigué des paroles très solennelles :
PG, 412-413« Bigué, […] ces enfants ne t’ont fait aucun mal.
— Quels enfants, Nguirane ? Les deux petits de cette guenon ?
— Ressaisis-toi, Bigué Samb […]. Ressaisis-toi, Mbissine et Mbissane sont mes petits-enfants. »
Ils se taisent. Nguirane Faye ne lui a jamais parlé avec une telle intensité. […] Bigué Samb comprend, submergée par l’émotion, qu’il est en train de lui faire ses adieux.
« Je t’ai entendu, Nguirane, dit-elle.
— Ce sont aussi tes enfants, Bigué. Prends bien soin d’eux. Fais-en des êtres humains.
— Je t’ai entendu, Faye.
— Oui. Personne ne peut être à la fois un enfant et un singe. »
Cette dernière phrase, « personne ne peut être à la fois un enfant et un singe », est la clé qui permet de comprendre, au-delà du miroir de l’énigme qui reste pourtant entière, toute la valeur allégorique de l’histoire de Yacine Ndiaye et de ses enfants : ils ne sont que des singes, car elle, elle ne fait que singer les Blancs, en subissant le charme de leur supposée supériorité, et les enfants, eux, ne font que singer leur mère. Aussi la redoutable sorcellerie du féticheur n’a-t-elle rien fait d’autre que laisser émerger leur vraie nature : ils sont à la fois des humains et des singes.
Dans un article consacré aux problèmes de l’écriture littéraire en Afrique et à l’emploi des langues nationales, Boubacar Boris Diop affirme : « Puissamment travaillées par le souffle de l’oralité, elles [les langues nationales] pourraient avoir du mal à se couler dans le moule du roman traditionnel et devraient dès lors s’inventer des normes spécifiques. La question des techniques narratives reste entière[53] ». C’est ce que j’ai tenté de montrer : par le recours, entre autres, à la fable, à l’énigme et à la parabole, qui « constituent comme la “suite” de ce trope royal » qu’est l’allégorie[54], Boubacar Boris Diop a approfondi la question des techniques narratives du « nouveau roman africain »[55]. C’est par la parole, et même par la création littéraire de la fable, que Bigué Samb – fidèle, nous l’avons dit, à sa promesse faite à Nguirane – s’affaire à éduquer les deux singes : « Bigué Samb […] s’adresse, avec de grands éclats de rire, à ceux qu’elle appelle ses petits. […] Eux, ne comprenant rien à ses propos, se contentent de la regarder de cet air malicieux et triste propre à leur espèce. Mais [… e]lle tient à leur parler, peut-être même à leur raconter de jolies fables de son invention » (PG, 438). Réussira-t-elle dans son entreprise ? Les deux petits singes redeviendront-ils de vrais enfants ? Nous ne le saurons jamais, puisque le roman se ferme une page après ces mots. Mais le lecteur se souvient que le narrateur Ali Kaboye lui a confié, en revenant sur la parabole des deux gorilles, qu’il n’a jamais pu oublier « ce jour où, dans la Forêt de Kagne, l’agonie d’un gorille [lui] a chuchoté, mine de rien, les mille et une fables de la vie et de la mort » (PG, 433).
Ce sont quelques-unes de ces fables que nous avons lues, dans lesquelles les personnes sont des singes mais où il peut arriver que les singes (babouins ou gorilles) soient meilleurs que les humains.
Appendices
Note biographique
Liana Nissim est professeure émérite de littérature française et de littératures francophones à l’Università degli Studi de Milan. Elle est officier dans l’ordre des Palmes académiques et docteur honoris causa de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Elle a créé en 2001 la revue Ponti / Ponts consacrée aux cultures et aux littératures francophones. Dans le domaine des littératures africaines, elle a publié plusieurs essais consacrés au roman, en approfondissant plus particulièrement la production de Boubacar Boris Diop.
Notes
-
[1]
Boubacar Boris Diop, Les petits de la guenon (version française par l’auteur de son roman écrit en wolof, Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003), Paris, Philippe Rey, 2009.
-
[2]
Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango suivi de Thiaroye terre rouge, Paris, L’Harmattan, 1981.
-
[3]
Voir, sur ce sujet vaste et complexe de l’oralité feinte dans le roman africain, le précieux ouvrage collectif dirigé par Ursula Baumgardt et Jean Derive, Littérature africaine et oralité, Paris, Karthala, « Lettres du Sud », 2013, 168 p.
-
[4]
Sur la distinction entre ces figures littéraires – fable, parabole et allégorie –, on se réfèrera, entre autres, à Jean-Charles Darmon, Philosophies de la fable : poésie et pensée dans l’oeuvre de La Fontaine, Paris, Hermann, « Philosophie », 2011, et surtout à Jean Delorme (dir.), Parole, figure, parabole : recherches autour du discours parabolique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, « Linguistique et sémiologie », 1987. La distinction fondamentale entre ces figures est que la fable et la parabole contiennent une forme d’allégorie en tant que représentation indirecte qui emploie une chose comme signe d’une autre. Les trois sont des sous-catégories de l’apologue, genre caractérisé par une histoire dotée d’une morale courte. Cependant, il convient de noter que si la fable procède par illustration, la parabole est davantage didactique.
-
[5]
Des romanciers de la génération de Boris Diop usent couramment de cette technique narrative et discursive du commentaire métacritique par laquelle les figures de l’écrivain en train d’écrire abondent dans leurs oeuvres. Voir le récent numéro de Présence francophone, no 91 (« Les figures de l’écrivain et de l’écrit dans le roman africain », dir. Kodjo Attikpoé et Josias Semujanga), 2018.
-
[6]
Boubacar Boris Diop, « Quand la mémoire va ramasser du bois mort… », dans Nasrin Qader et Souleyman Bachir Diagne (dir.), Des mondes et des langues. L’écriture de Boubacar Boris Diop, Paris, Présence Africaine, 2014, p. 26.
-
[7]
Susanne Gehrmann, « Face à la meute. Narration et folie dans les romans de Boubacar Boris Diop », Présence francophone, no 63 (« Chaos, absurdité, folie dans le roman africain et antillais contemporain », dir. Justin Bisanswa et Isaac Bazié), 2004, p. 146.
-
[8]
Hamidou Dia, « Boubacar Boris Diop : le mendiant du souvenir. Parcours subjectif des Tambours de la mémoire », Éthiopiques, no 52, 1er trimestre 1989 (vol. 6, no 1) (disponible en ligne : ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1152, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[9]
Francesca Paraboschi, « Quand les narrateurs ne racontent pas. Mécanismes d’écriture de l’oralité dans Les traces de la meute », Interculturel Francophonies, no 18 (« Boubacar Boris Diop », dir. Liana Nissim), novembre-décembre 2010, p. 181.
-
[10]
Sur ces concepts, voir Josias Semujanga, Dynamique des genres dans le roman africain. Éléments de poétique transculturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 28-29, et Jonathan Russel Nsangou, « L’intertexte oral et le refus de l’Histoire dans Le cavalier et son ombre de Boubacar Boris Diop », dans Luc Fotsing Fondjo et Moustapha Fall (dir.), Traditions orales postcoloniales. Discours d’ouverture de Boubacar Boris Diop, Paris, L’Harmattan, « Racines du présent », 2014, p. 77-90. Jonathan Russel Nsangou note que « [l]es romans de Diop se démarquent […] par l’hybridité générique : la plupart des récits sont traversés par des contes et des mythes » (p. 77).
-
[11]
Cette rupture est celle des « romanciers de la nouvelle génération » ou du « nouveau roman » (voir Séwanou Dabla, Nouvelles écritures africaines. Romanciers de la Seconde Génération, Paris, L’Harmattan, 1986). Cette génération commence à écrire après la publication de deux romans emblématiques, celui d’Ahmadou Kourouma (Les soleils des indépendances, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1968 ; prix de la revue Études françaises 1968) et celui de Yambo Ouologuem (Le devoir de violence, Paris, Seuil, 1968 ; prix Renaudot 1968). Les deux romans se démarquent de ceux des années 1950, qui se caractérisaient surtout par leur dénonciation des abus coloniaux et leur usage, en général, au plan de l’écriture, du réalisme, avec une narration simple, proche de celle de l’autobiographie, et une langue classique et conventionnelle. Dans son roman, Kourouma opère une double innovation, par la parodie des discours dominants – aussi bien ceux de la colonisation que ceux de la négritude en tant que mouvement anticolonial – et par un français teinté de sa langue maternelle, le malinké. (Voir Makhily Gassama, La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d’Afrique, Paris, ACCT / Karthala, 1995.) Ouologuem introduit une nouvelle forme de narration complexe, et son récit conteste, par la parodie et l’ironie, les figures emblématiques de l’époque coloniale autant que celles de la négritude qui font de l’Afrique précoloniale une sorte d’Eldorado mythique, sans oublier de déconstruire le récit colonial fondé sur l’idéologie de la colonisation comme oeuvre de civilisation. (Voir Josias Semujanga : « De l’histoire à sa métaphore dans Le devoir de violence de Yambo Ouologuem », Études françaises, vol. 31, no 1, été 1995, p. 71-83.)
-
[12]
Jacques Chevrier, Littératures d’Afrique noire de langue française, Paris, Nathan, « 128 », 1999, p. 100.
-
[13]
Ibid., p. 111.
-
[14]
Susanne Gehrmann, loc. cit., p. 149.
-
[15]
Lilyan Kesteloot, « Note de lecture. Boubacar Boris Diop : Le cavalier et son ombre », Notre Librairie. Revue des littératures du Sud, no 136 (« Nouveaux paysages littéraires »), janvier-avril 1999, p. 74 (disponible en ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6499317r/f74.image, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[16]
Liana Nissim, « Vivre et écrire dans l’odeur de la mort (L’Afrique au-delà du miroir et Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop) », Altre modernità, no 4 (« La morte e i suoi riti nella cultura contemporanea »), octobre 2010, p. 211 (disponible en ligne : riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/702/923, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[17]
Ibid, p. 214.
-
[18]
Virginie Brinker, « Boubacar Boris Diop, Kaveena. Jeu de piste pour une oeuvre caméléon », La Plume francophone, 5 août 2008 (disponible en ligne : la-plume-francophone.com/2008/08/05/boubacar-boris-diop-kaveena/, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[19]
Francesca Paraboschi, « Folie d’ici et de l’ailleurs. Les tambours de la mémoire, Le cavalier et son ombre », dans Nasrin Qader et Souleyman Bachir Diagne (dir.), op. cit., p. 132.
-
[20]
C’est Mongo Beti qui, le premier, a relevé les « audaces techniques » de Boubacar Boris Diop dans sa célèbre « Préface » à Le temps de Tamango, Paris, L’Harmattan, 1981, p. 9 [rééd. Paris, Le Serpent à Plumes, 2002, p. 16].
-
[21]
« À mes yeux – dit Boubacar Boris Diop –, la vie réelle est un enchevêtrement de récits et de rêves », dans « Entretien exclusif avec Boubacar Boris Diop : le processus de déculturation n’est pas achevé au Sénégal », Xalima.com , 15 février 2018 (disponible en ligne : xalimasn.com/entretien-exclusif-avec-boubacar-boris-diop-le-processus-deculturation-nest-pas-acheve-au-senegal/, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[22]
« À l’écoute de Boubacar Boris Diop, écrivain », entretien de Jean-Marie Volet avec Boubacar Boris Diop, Mots Pluriels, no 9, 1999 (disponible en ligne : motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP999bbd.html, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[23]
À la question : « Dans une page assez mystérieuse des Petits de la guenon tu parles de la Médina de Dakar et de la figure d’une mère […] ; peux-tu nous dire quelque chose de cette page ? », Boubacar Boris Diop a répondu : « C’est ma mère. Elle est omniprésente dans ce texte […,] je l’ai sans cesse sentie à mes côtés et entendue pendant les deux années où j’ai écrit Doomi Golo » (« Aller au coeur du réel. Entretien avec Liana Nissim », Interculturel Francophonies, no 18 (« Boubacar Boris Diop »), novembre-décembre 2010, p. 34).
-
[24]
Voir Silvia Riva, « L’Afrique au-delà du miroir : droits et devoirs de l’imaginaire », et Ali Chibani, « De l’émergence du thanatophore au retour du fondateur dans L’Afrique au-delà du miroir et Les petits de la guenon », dans Interculturel Francophonies, no 18 (« Boubacar Boris Diop »), novembre-décembre 2010, p. 51-87 et p. 297-322.
-
[25]
Ousmane Ngom, « Métaphores obsédantes du seetu et reflets identitaires dans Doomi Golo et L’Afrique au-delà du miroir de Boubacar Boris Diop », Langues et Littératures (revue du Groupe d’Études Linguistiques et Littéraires, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal), no 17, janvier 2013, p. 121 (disponible en ligne : gellugb.over-blog.com/2014/07/metaphores-obsedantes-du-seetu-et-reflets-identitaires-dans-doomi-golo-et-l-afrique-au-dela-du-miroir-de-boubacar-boris-diop-par-ous, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[26]
Cullen Goldblatt, « Lëndëmtu : réflexions sur Doomi Golo et Les petits de la guenon », dans Nasrin Qader et Souleyman Bachir Diagne (dir.), op. cit., p. 68.
-
[27]
Comme le rappelle Ali Chibani, « l’aïeul […] sera toujours en train de naître car […, a]u sein du groupe social, l’aïeul est une figure de sens qui ne s’arrête jamais de se construire puisque, pour continuer d’exister, elle doit s’adapter au présent » (loc. cit., p. 313-314).
-
[28]
Ousmane Ngom, loc. cit., p. 127.
-
[29]
Ibid.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Ibid., p. 123.
-
[32]
Ali Chibani, loc. cit., p. 317.
-
[33]
« Le français n’est pas mon destin », entretien de Taina Tervonen avec Boubacar Boris Diop, Africultures, no 57 (« Où va le livre en Afrique ? »), 2003-4, p. 109-112 (disponible en ligne : africultures.com/le-francais-nest-pas-mon-destin-3197/, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[34]
« Prêcher dans le désert ou miser sur l’avenir ? », entretien de Jasmina Sopova avec Boubacar Boris Diop, Le Courrier de l’unesco, 2008, no 1, p. 3-5 (disponible en ligne : unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158396_fre?posInSet=1&queryId=0f968f7d-9ee7-4321-91db-66508655e2d7, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[35]
Ousmane Ngom, loc. cit., p. 128.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Ibid.
-
[38]
Virginie Brinker, « Boubacar Boris Diop, Les petits de la guenon. “Je ne suis quand même pas de ces vieillards qui parlent à tort et à travers” », La Plume francophone, 5 août 2008 (disponible en ligne : la-plume-francophone.com/2008/08/05/boubacar-boris-diop-les-petits-de-la-guenon/, page consultée le 22 octobre 2019).
-
[39]
Boubacar Boris Diop, « Postface » à Murambi, le livre des ossements, Paris, Zulma, 2011 [Stock, 2000], p. 260.
-
[40]
Liana Nissim, « Le vent et le creuset ou les ailleurs des Petits de la guenon », dans Nasrin Qader et Souleyman Bachir Diagne (dir.), op. cit. p. 127.
-
[41]
Ibid., p. 129.
-
[42]
Ibid.
-
[43]
Ali Chibani, loc. cit., p. 316.
-
[44]
Papa Samba Diop, « Doomi Golo de Bubakar Bóris Jóob. De la traduction littéraire à la traduction française de l’auteur lui-même », Interculturel Francophonies, no 18 (« Boubacar Boris Diop »), novembre-décembre 2010, p. 268.
-
[45]
Ibid.
-
[46]
Ali Chibani, loc. cit., p. 306.
-
[47]
Virginie Brinker, « Boubacar Boris Diop, Les petits de la guenon. “Je ne suis quand même pas de ces vieillards qui parlent à tort et à travers” », loc. cit.
-
[48]
Ibid., p. 309.
-
[49]
Ousmane Ngom, loc. cit., p. 126.
-
[50]
Boubacar Boris Diop, « Aller au coeur du réel. Entretien avec Liana Nissim », loc. cit., p. 45.
-
[51]
Ousmane Ngom, loc. cit., p. 124.
-
[52]
Ibid., p. 132.
-
[53]
Boubacar Boris Diop, « Écrire aujourd’hui en Afrique : les mots contre les choses », Wal Fadjri, no 614, 2-3 avril 1994, p. 4.
-
[54]
Patrick Labarthe, Baudelaire et la tradition de l’allégorie, Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire », 1999, p. 22.
-
[55]
Voir ci-dessus note 11.