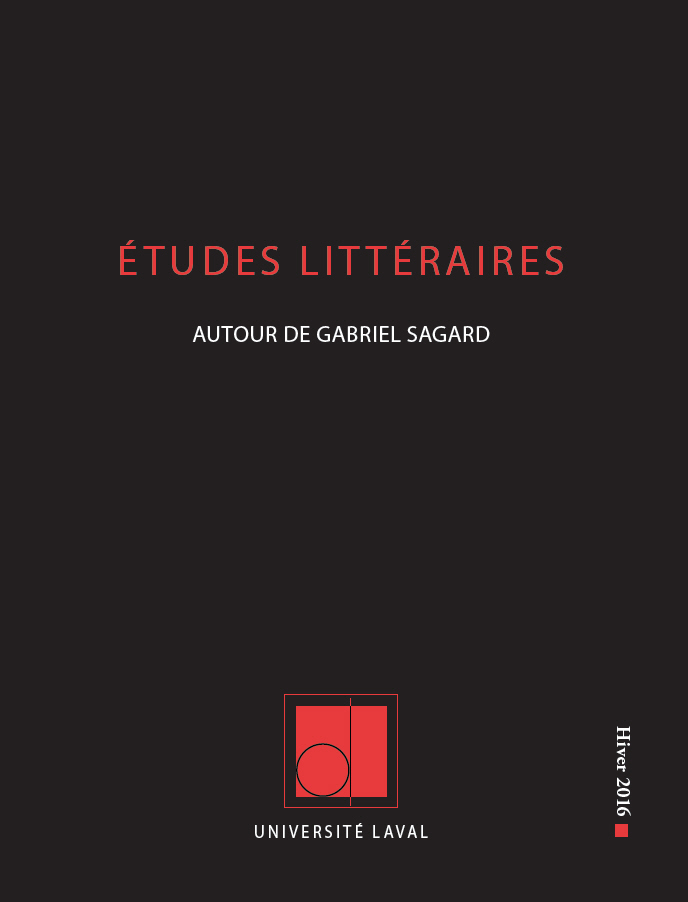Abstracts
Résumé
Notre propos est de traiter de l’inscription des discours amérindiens dans l’Histoire du Canada de Gabriel Sagard. Le principal enjeu de cette étude est de fournir une analyse des exemples de ré-énonciation de la parole « sauvage » qui zèbrent le texte du récollet, en prenant en compte leur dimension thématique et pragmatique et en posant la question de leur authenticité. Un autre enjeu de l’analyse vise les rapports entre la maîtrise discursive et le gouvernement des Autochtones.
Abstract
Our purpose is to address the representation of Amerindian discourse in Gabriel Sagard’s Histoire du Canada. The main focus of this study is to provide an analysis of the examples of re-enunciation of “sauvage” speech peppered throughout the text of the Recollect, taking into account their thematic and pragmatic dimension, and questioning their authenticity. A secondary focus of this study is the relationship between the mastery of discourse and the Indigenous Peoples’ government.
Article body
L’univers de la parole « sauvage[1] » dans l’Histoire du Canada[2] de Gabriel Sagard est circonscrit par deux types de renvois : la transcription des mots hurons et montagnais d’une part et l’insertion des paroles attribuées aux locuteurs autochtones d’autre part. Cette configuration soulève la question, sans doute naïve, mais incontournable, du statut documentaire du témoignage. Malgré quelques approximations inhérentes à la nature pionnière de l’entreprise, l’authenticité des mots autochtones cités dans l’Histoire du Canada ne saurait être mise en doute et, bien qu’ils ne soient souvent cités que pour leur effet rhétorique[3], ces termes constituent, avec le Dictionaire de la langue huronne[4], une de nos sources fondamentales sur cette langue. Mais il n’en va pas de même pour les discours autochtones reproduits en français dans l’Histoire du Canada, qui soulèvent la question fondamentale de l’appropriation de la parole de l’Autre par les Récollets. S’agit-il, dans ces exemples, de ce qu’on pourrait appeler un détournement monologique de la parole de l’Amérindien qui sera mise au service de l’entreprise missionnaire ? Ou bien assiste-t-on à l’émergence d’une véritable « hétérologie », pour reprendre le terme de Michel de Certeau qui désignait ainsi la constitution d’une scénographie discursive réversible où le dernier mot n’appartient pas nécessairement à l’énonciateur principal[5] ? Autrement dit, a-t-on affaire à une instrumentalisation de la parole amérindienne dont l’exhibition ne sert qu’au goût naissant pour l’exotisme et pour la couleur locale ou sommes-nous mis devant une transcription qui révèle l’altérité du « Sauvage » ?
Or, comme le rappelle Michèle Duchet, l’Amérindien représente une catégorie thématiquement stable, quoique ambivalente sur le plan connotatif, dans laquelle « un seul changement de signe suffit à inverser tout le sens du discours », car « ce sont moins ses éléments qui varient que leur distribution dans un système où ils sont affectés tantôt du signe plus, tantôt du signe moins[6] ». Le discours sur ce qu’on appelle à l’époque classique le « Sauvage[7] » est ainsi double, celui-ci étant conçu à la fois comme un être de nature dont l’existence même représente une critique implicite des maux de la civilisation et comme un être en manque, qui n’attend qu’à être converti et policé. Ce type de rapport ressort très clairement chez Paul Lejeune qui ne dresse la liste des défauts et des qualités des « Sauvages » que pour mieux justifier la nécessité de sa mission. Pour les besoins de la cause, il s’agit de représenter l’Autochtone comme un être à la fois naturellement bon (donc essentiellement récupérable par la grâce) et déchu de son état originaire, corrompu par la chute. Ce double postulat permet au missionnaire de mettre en scène le personnage de l’Amérindien suppliant, qui ne demande pas mieux que d’être évangélisé : les « Sauvages », nous assure Lejeune, « sont las de leurs miseres et nous tendent le bras pour être assistés[8] ».
L’opinion généralement partagée par bien des commentateurs est que l’approche de Sagard envers les Amérindiens est plus empathique que celle du jésuite[9], lecture qui permet de construire un argumentaire fondé sur l’opposition entre la tolérance sereine du récollet et la vision plus agressive, voire belliqueuse, de Paul Lejeune. Confronté à l’altérité amérindienne, ce dernier se livre, selon Yvon Le Bras, « à un tri on ne peut plus partial et rudimentaire[10] », attitude qui contraste avec la tolérance envers les Autochtones dont fait preuve Sagard[11]. En effet, à la différence de Lejeune qui ne s’embarrasse point de précautions oratoires lorsqu’il s’agit de décrire la misère de la condition des « Sauvages », le récollet en édulcore les détails peu amènes, processus qui passe par un véritable travail d’euphémisation. Et pourtant, sans trahir l’esprit des textes, loin s’en faut, cette grille de lecture semble parfois faire l’impasse sur l’ambiguïté des positionnements de l’auteur de l’Histoire du Canada. C’est vrai, Sagard fait souvent l’éloge de la « bonté naturelle » des Amérindiens[12] qu’il qualifie de « doux & courtois » (HC, p. 216) et dont la compagnie lui est préférable à celle de certains chrétiens[13]. Cependant, le récollet ne se fait pas moins le champion de l’assimilation coloniale intégrale. Cela devient évident lorsque, en évoquant l’éventualité de la conversion des indigènes, Sagard ajoute qu’« il leur faudra changer de vie, de Loix, de maximes, qui sont pour la pluspart autant sauvages que brutale[s] & impertinentes » (HC, p. 419-420). Comme bien des voyageurs avant et après lui, le récollet tient donc un double discours sur l’Amérindien, ce qui lui permet de contribuer à la constitution du type du « bon Sauvage » tout en portant un regard sans concession sur les Autochtones qui, « brutaux & enclins à la vengeance » (HC, p. 439), « vivent presque en bestes, sans adoration, sans Religion & sans vaine superstition sous l’ombre d’icelle » (HC, p. 485-486).
Si on se tourne maintenant vers la question de la parole amérindienne, on remarque une ambivalence similaire de l’attitude du missionnaire relative à la question de la langue des Autochtones. Il faudrait rappeler que pour les Européens, en tant que représentant de l’état de nature, le « Sauvage » s’identifie à l’enfant. Ainsi, la tentation est grande de le voir également, suivant l’étymologie, comme un infans, c’est-à-dire comme un être presque dépourvu de parole. Or, la confrontation avec la réalité amérindienne renverse tous ces présupposés.
Premièrement, de manière assez paradoxale, ce sont les bons Pères qui se voient traiter de « neveux » (,enh8aten ou Hiuoitan selon la transcription du Dictionaire[14]), terme utilisé par un homme pour s’adresser aux enfants de sa soeur ou bien, plus généralement, à des jeunes mâles en situation de dépendance[15]. Sagard semble d’ailleurs accepter cette forme d’adresse, au moins dans l’échange suivant : « Il en fist aussi un particulier à mon intention par le commandement du Capitaine, lequel me disoit aprés, hé, mon nepveu, voyla-il pas qui est bien ? ouy, mon oncle, à ce que tu dis, luy respondis-je […] » (HC, p. 642-643).
D’autre part, en dépit du fait que, de l’aveu de Sagard lui-même, ses préjugés sur la pauvreté intrinsèque de ces langues primitives ont été démentis sur le terrain[16], il n’en reste pas moins que ses impressions sur les langues amérindiennes restent plutôt mitigées. À la différence des missionnaires jésuites dont la formation les incline à comparer ces langues au moule latin[17], le récollet, en accord avec l’orientation plutôt gallicane de son ordre et de sa propre culture, les confronte à la rigueur de la langue française[18]. Bien qu’il reconnaisse la richesse du huron, caractéristique due notamment à ses propriétés polysynthétiques, il insiste sur l’imperfection de cette langue qui lui apparaît comme presque dépourvue de règles et structurellement désordonnée[19]. Cependant, en dépit de ces remarques de Sagard sur la nature supposément rudimentaire de l’outil langagier amérindien, l’Histoire du Canada ne fournit pas moins une illustration exemplaire du paradoxe, bien connu des voyageurs, de l’excellence de la rhétorique « barbare » (on se rappellera que pour les Grecs anciens, le « barbare » est celui qui bégaie, dont la langue ressemble au charabia).
Les discours rapportés dans l’Histoire du Canada
En vue de mener une étude contrastive des dialogues, nous avons procédé au prélèvement, dans l’Histoire du Canada, des passages qui correspondent au discours rapporté et à ses contextes immédiats[20]. La proportion relativement réduite du discours rapporté confirme la nature descriptive de l’oeuvre qui reste assez peu polyphonique dans son ensemble, bien qu’on y trouve des portions dialoguées importantes, surtout lorsqu’il s’agit de reproduire les propos de divers catéchumènes et les négociations entre les bons pères et les chefs hurons. Ainsi, lorsqu’au fil du texte, et entrecoupant celui-ci, on peut lire des scènes dramatisées ayant l’air d’être prises sur le vif, et cet usage de l’hypotypose fournit un contraste mémorable avec la dominante descriptive ou narrative de l’oeuvre.
Lorsqu’on aborde l’analyse du discours « sauvage » dans ce texte, il faudrait commencer par mettre en avant l’opposition entre les modes de représentation du discours des Autochtones en tant que tels (c’est-à-dire les modes inventoriables dans une grammaire française des discours rapportés) et les modes de citation des termes hurons et montagnais (qui sont parfois insérés dans ces discours). Dans ce dernier cas, l’hétérogénéité énonciative rejoint l’intertextualité dans la mesure où il s’agit notamment de termes repris du Dictionaire que Sagard avait publié en 1632.
Mais ces cas sont assez rares : on n’a pu identifier qu’une dizaine de petites phrases en huron ou en montagnais insérées dans les discours attribués aux Amérindiens. Comme le fait remarquer Jack Warwick[21], ces exemples ont pour fonction principale la promotion de l’image des Récollets en général et de celle de l’auteur en particulier :
[T]ous les vieillards, qui se mirent en peine pour nous & crioient par tout contre les Moyenti, comment veut on tuer nos Nepveux, veut on faire mourir nos Capitaines François, ennon, ennon Moyenti, non, non jeunes gens, il ne leur faut point faire de desplaisir, ils sont nos bons amys […].
HC, p. 427
En effet, un peu plus loin, on assiste à la glorification du frère Gabriel par les Hurons : « [C]omme j’allois criant à nos François, (un peu trop eschauffez) de se retirer & ne blesser personne, il y en eut qui coururent aussi-tost au village, publians par tout Onianné Aviel, Onianné Aviel. Gabriel est bon, Gabriel est bon, tant ils sont amis des amateurs de la paix » (HC, p. 428). En rappelant cette reconnaissance de ses qualités par les Autochtones, Sagard savoure sans doute le souvenir de ces petits triomphes d’autant plus délectables qu’ils contrastent avec les circonstances beaucoup plus sombres de la rédaction de l’Histoire.
Pour ce qui est des discours reproduits en français, on a distingué dans le texte les occurrences relevant du discours direct, et les exemples de discours indirect dans lesquels le locuteur principal incorpore l’énonciation du locuteur second dans son propre énoncé. Certains passages, plus difficiles à identifier, semblent relever d’un discours narrativisé, c’est-à-dire d’un récit de parole qui est traité comme un récit d’évènements. Cette distinction est pertinente sur le plan énonciatif : dans le discours direct, le locuteur principal fait semblant de montrer le discours de l’autre dans sa forme littérale ; dans le discours indirect, l’énonciateur principal opte pour une présentation médiatisée, qui met en exergue les conditions de production de cet énoncé. Dans les deux cas, il s’agit de construire des énoncés seconds, mais ce qui diffère est le statut de ceux-ci par rapport aux critères historiquement admis de la vraisemblance.
À l’époque classique, le discours indirect était plutôt rare[22], étant surtout utilisé dans la narration historique comme discours du vrai, alors que le discours direct était plus courant et était généralement associé à la fiction dialoguée[23]. Cette distribution est bien présente chez Sagard sous la forme de l’opposition contextuelle entre les deux types discursifs, qui correspond, de manière générale, à celle entre de longues harangues épurées de nature politique et religieuse et des répliques succinctes en style indirect.
Malgré une certaine confusion due aux balbutiements relatifs aux conventions typographiques qui se traduisent, chez Sagard, soit par l’absence des marqueurs, soit par leur grande hétérogénéité[24], et malgré le mélange constant de discours direct et de discours indirect, on observe facilement que c’est le premier qui l’emporte dans l’Histoire du Canada, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en scène la parole édifiante des catéchumènes ou de reproduire les discours rituels ou politiques.
Dans la scénographie discursive mise en place par Sagard, l’usage du discours indirect est réservé, comme on l’a déjà dit, surtout aux passages narratifs et aux tours de parole rapides caractérisés par un certain réalisme qui cadre mieux avec le goût des Autochtones pour l’ironie et la malice, qui ressort de nombreux passages de l’Histoire du Canada :
Mais nos Hurons qui sçavent bien dissimuler & qui tenoient bonne mine en cette action, estans de retour dans leur pays, tournerent toute cette ceremonie en risée, & s’en mocquerent disans que toute la cholere des François avoit esté noyée en ceste espée, & que pour tuer un François on en seroit doresnavant quite pour une douzaine de castors, en quoy ils se trompoient bien fort […].
HC, p. 237, je souligne[25]
La menace implicite contenue dans ce passage transcrit en style indirect en dit long sur la précarité de la position des Français. Fidèle à son projet d’euphémisation des réalités coloniales, Sagard met rarement en épingle la nature parfois tendue des rapports avec les Autochtones ; ainsi, ce n’est souvent qu’au détour d’une phrase que s’exposent les failles susceptibles de mettre en question le projet missionnaire.
Par contre, les grands passages édifiants dans lesquels les convertis témoignent de leur foi ou les capitaines plaident auprès des Français sont donnés en discours direct. Le style de ces interventions est presque toujours pompeux et il ne fait pas illusion − il s’agit de passages donnés comme des scènes dialogiques et qui confèrent une certaine théâtralité au récit historique.
Par ailleurs, d’autres transcriptions trahissent le paternalisme de Sagard, par exemple lorsqu’il reproduit (ou bien crée de toutes pièces) une forme de français tirailleur réservé aux interventions des Amérindiens[26] : « Moy pourquoy point Chrestien, moy pourquoy point Baptisé », demande un candidat au baptême[27], alors qu’un autre mélange les codes en produisant une des premières formes attestées du franco-huron : « [I]l repetoit souvent comme s’il eut parlé à quelqu’un Nema, qui veut dire nom, & quelquefois Niouy baptisé, toutaganiouy, je veux estre baptizé » (HC, p. 553-554).
La représentation de la parole amérindienne obéit ainsi à la même logique ambivalente qui gouverne les rapports entre voyageurs et Autochtones : on aura donc affaire, d’une part, à des ré-énonciations « euphémistiques » (surtout lorsqu’il s’agit des harangues officielles) et, d’autre part, à des « transcriptions » dévalorisantes, qui trahissent leur inspiration primitiviste.
Éléments d’une rhétorique amérindienne
Comme bien d’autres voyageurs et missionnaires, Sagard met lui aussi en évidence l’importance de l’éloquence pour la société amérindienne : c’est un lieu commun des récits de voyage, le fonctionnement de toutes les institutions autochtones passe par la harangue. S’il fallait en croire le père Biard, « [c]es gens [les Sauvages], sont les plus grands harangueurs de toute la terre ; ils ne font rien sans cela [28] ».
Les discours d’oraison, de prière, d’exhortation semblent jouer des rôles sociaux et politiques fondamentaux, de sorte que le monde des Autochtones est presque entièrement circonscrit par leur univers discursif. Cette diversité situationnelle est bien représentée dans l’Histoire du Canada, si bien que l’on peut, à partir de cette oeuvre, établir un inventaire de contextes pragmatiques de la parole amérindienne qui font ressortir, presque à l’insu de l’auteur, une certaine typologie des discours.
En premier lieu, on retrouve la prééminence de la rhétorique politique dans les sociétés américaines et le lien intrinsèque entre autorité politique et maîtrise du discours, la parole étant en pratique la seule forme de légitimation du pouvoir dévolu aux chefs autochtones :
Ces Capitaines n’ont point entr’eux autorité absoluë, bien qu’on leur ait quelque respect, & conduisent le peuple plustost par prieres, exhortations & remonstrances, qu’ils sçavent dextrement & rhetoriquement ajancer, que par rigueur de commandement, c’est pourquoy ils s’y exercent, & y apprennent leurs enfans, car qui harangue le mieux est le mieux obey.
HC, p. 419
Ce lien étroit entre pouvoir politique et compétence discursive sera synthétisé de manière lapidaire par Lejeune qui fait remarquer, dans un passage célèbre, que « [t] oute l’autorité de leur chef est au bout de ses lèvres, il est aussi puissant qu’il est éloquent[29] ». Dans le contexte idéologique français qui voit déjà l’émergence de la théorie de l’absolutisme, l’absence d’une structure étatique amérindienne est généralement interprétée par les voyageurs comme le signe d’un manque, d’une privation. Cette impossibilité de concevoir une société sans État, ou, selon la formule de Pierre Clastres, « une société contre l’État », n’est pas pour autant une donnée absolue de la littérature viatique du siècle. Dans le chapitre « Des Capitaines, Superieurs, & anciens, de leurs maximes en general, & comme ils se gouvernent en leur conseil & assemblées », Sagard a non seulement l’audace de comparer le gouvernement des « Sauvages » aux démocraties antiques, mais aussi de recommander aux princes chrétiens de suivre l’exemple des capitaines amérindiens (HC, p. 421) ainsi que de rapporter, avec une indignation un peu jouée, l’histoire burlesque d’un chef qui se met sur un pied d’égalité avec le roi de France[30]. Aussi Sagard nous fournit-il une description des conseils généraux qui sont présentés comme une admirable illustration de ce qu’on appellerait aujourd’hui une démocratie directe dans laquelle les interlocuteurs parlent posément et expriment leur voix en toute liberté :
Estans tous assemblez, & la cabane fermée, ils font tous une longue pose avant parler, pour ne se precipiter point, tenans cependant tousjours leur calumet en bouche, puis le Capitaine commence à haranguer en terme & parole haute & intelligible, un assez long-temps, sur la matiere qu’ils ont à traicter en ce Conseil : ayant finy son discours, ceux qui ont à dire quelque chose, les uns apres les autres, sans bruit, sans s’interrompre, & en peu de mots, opinent & disent leurs advis, qui sont par apres colligez avec des pailles, ou petits joncs, & là dessus est conclud ce qui est jugé expedient par la pluralité des voix, non criminellement, mais civilement […].
HC, p. 424-425
L’idéalisation de la parole « sauvage » est particulièrement évidente dans la reproduction des harangues politiques (en principe favorables aux Récollets) qui semblent calquées sur les meilleurs modèles de l’art oratoire. De la sorte, le discours que le chef Avoindaon doit donner pour apaiser les orgueils blessés à la suite de quelques rixes entre Hurons et Récollets n’a rien à envier aux maîtres de l’éloquence de la Cour :
Le conseil assemblé, le grand Capitaine nous fit soir auprés de lui, puis ayant imposé silence, il s’addressa à nous & nous parla en sorte que toute l’assemblée le pû entendre. Mes Nepveux ; à vostre requeste j’ay faict assembler ce conseil general, afin de vous estre faict droict sur les plaintes que vous m’avez faictes, de quelque malicieux qui vous ont voulu offencer, mais d’autant que ces gens icy sont ignorans du faict, proposez vous mesme vos plaintes & declarez hautement en leur presence ce qui est de vos griefs, & en quoy & comment vous avez esté offencez, & sur ce je bastiray ma harangue & vous ferons justice, car nous ne desirons pas qu’aucun vous fasse de desplaisir, mais au contraire que l’on vous rende tout le service que l’on pourra, pendant que nous aurons ce bien de jouïr de vostre presence.
HC, p. 428-429
Évidemment, les discours amérindiens n’ont pas uniquement une fonction politique, loin s’en faut ; ainsi, Sagard passe en revue les oraisons funèbres[31], les harangues qui accompagnent les festins, les paroles de vengeance[32], sans oublier les cas particuliers, comme celui du prédicateur de la pêche dont l’éloquence cicéronienne est censée attirer les poissons[33]. Mais l’insistance des missionnaires sur les harangues politico-juridiques montre que les bons Pères ont compris très tôt que la question du gouvernement des « Sauvages » (corps et âmes) passe par la maîtrise des outils linguistiques et des conventions rhétoriques. L’acquisition des langues et la réappropriation − ne fût-ce que sur le plan imaginaire ou littéraire − des discours autochtones constituent une véritable propédeutique à la conversion.
Les dominantes thématiques de la parole « sauvage »
Au niveau de l’analyse du contenu sémantique des discours rapportés, on ne retrouve plus cette belle diversité de contextes : si un thème est surinvesti dans les discours des « Sauvages », il s’agit, on pouvait s’en douter, de celui de la religion qui l’emporte sur tous les autres aspects de la socialité. Le tropisme théologique est encore plus frappant si l’on comprend que sur les quarante-trois occurrences de « père », les vingt-huit occurrences de « frère », les quatorze de « fils » dans les discours rapportés, presque trois quarts environ relèvent de l’emploi religieux de ces termes (ces mots apparaissent donc dans des expressions du type « le Frère Gervais », « le Père Joseph », etc.).
Cette importance du signifiant religieux nous montre que le discours des « Sauvages » est presque entièrement instrumentalisé, mis au service de l’entreprise missionnaire. Qui plus est, malgré la difficulté notoire de traduire les théologèmes catholiques en huron ou en montagnais, le lexique de ces harangues autochtones reste précis, technique, presque professionnel ; il est beaucoup question du baptême, de la foi, de la mission rédemptrice de Jésus, du rachat des hommes par le Christ et de la vie éternelle. L’exactitude de ces traductions est des plus douteuses. Que l’on prenne simplement l’exemple d’un discours dans lequel un « Sauvage » mourant exige le baptême. On observe facilement que ses paroles sont soumises à un traitement de reformulation stylistique ne les rendant conformes à la théologie naturelle de la plus pure extraction franciscaine qu’au prix du complet effacement de leur couleur locale :
[S]e tournant du costé du frere il luy dit avec un accent plein de devotion. Mon Frere, il y a long-temps que je t’atendois pour estre fait enfant de Dieu, je te prie baptiser celuy qui preferant les interests du Ciel, à ceux de la terre, ne veut que ce que ton Dieu veut, qui est la grace de le loüer à jamais. […] Et le bon Religieux continuant ses interrogations, luy demanda […] s’il cognoissoit nostre Dieu duquel il parloit, ouy dit il aux effets de sa toute puissance & bonté, laquelle nous experimentons, & voyons tous les jours devant nos yeux, & quand bien nous ne le cognoistrions qu’en cet univers, le Ciel, la terre, & la mer qu’il a creée, & tout ce qu’ils contiennent pour nostre service, comme nous pour sa gloire ainsi que nous a eu dit le P. Joseph, cela suffiroit pour le confesser ce qu’il est, tout puissant & Dieu par dessus toutes choses, qui a envoyé son fils unique en ce monde, mourir pour le rachapt des humains.
HC, p. 570-571
Par contre, bien qu’on puisse remarquer la quasi-absence du lexique de la peur[34], le discours des catéchumènes reste marqué chez Sagard, on dirait presque fatalement, par des allers-retours constants entre les thèmes de la foi et ceux de la maladie et de la mort. D’ailleurs, ce ne sont que ces deux dernières catégories sémantiques qui peuvent rivaliser, sur le plan de l’importance quantitative, avec le lexique familial et religieux[35].
L’association textuelle entre religion et mort est si puissante que Sagard sent le besoin de réfuter, à travers le discours d’un candidat à la conversion, la rumeur qui circulait parmi les « Sauvages » et qui faisait le lien entre le baptême et l’imminent trépas des catéchumènes (inférence déclenchée sans doute par le nombre de convertis in articulo mortis[36]). La parole de conversion n’est donc pas caractérisée par l’affrontement dramatisé des forces du bien et des forces du mal, mais plutôt par l’intériorisation d’un lexique de la transformation spirituelle, de la métanoia, qui se remarque par son haut degré d’abstraction et par son caractère noble et conventionnel.
La mise en évidence de ces phénomènes de cohérence statistique risque de ne donner que l’image sans nuances d’une emprise monologique de l’auteur de l’Histoire du Canada sur la parole de l’Autre. Il n’en reste pas moins que la scène énonciative mise en place par Sagard est parfaitement réversible. En effet, nombreux sont les exemples dans lesquels Hurons et Montagnais se gaussent ouvertement des Européens. En l’occurrence, l’expression « tu n’as pas d’esprit » (Téondion ou Tescaondion) revient comme un refrain qui trahit l’impression peu flatteuse qu’ils se font des Français, comme l’illustre également la mésaventure du truchement de Jean Richer, auquel on dit qu’il ne lui restait qu’à perdre sa barbe pour avoir presque autant d’esprit « qu’une telle nation, luy en nommant une qu’ils estimoient avoir beaucoup moins d’esprit qu’eux […] » (HC, p. 378). Et à Sagard de conclure amèrement : « [V]oyla l’estime qu’il[s] font de nos gens […] » (id.).
***
Si la cohérence textuelle remarquable des discours amérindiens fournit une sorte de preuve a posteriori du succès de l’entreprise missionnaire, elle nous dit peu sur l’authenticité des propos autochtones tels qu’ils apparaissent dans l’Histoire de Sagard. En effet, il suffit de comparer la diversité terminologique enregistrée dans le Dictionaire de la langue huronne à la relative pauvreté thématique des discours rapportés dans l’Histoire du Canada pour avoir une représentation assez claire de l’ampleur des découpages opérés par Sagard.
D’autre part, sa connaissance plutôt rudimentaire des subtilités syntaxiques et pragmatiques des langues autochtones à laquelle s’ajoute l’inconstance notoire de truchements fournissent des raisons suffisantes pour douter de la fidélité des transcriptions proposées par le récollet. Que les propos recueillis se rejoignent en aval, dans le montage textuel proposé par l’auteur dans le contexte apologétique de la rédaction de l’Histoire du Canada, ne nous apprend pas beaucoup sur leur possible diversité en amont, au moment de l’énonciation première. Aussi l’insertion d’un discours de résistance amérindien, qui peut aller du registre de la moquerie légère à la violence implicite, ne modifie-t-elle pas essentiellement la donne, ne mettant pas en question la stratégie bien huilée d’héroïsation des missionnaires.
Appendices
Note biographique
Peter Murvai est titulaire d’un doctorat en études françaises de l’École normale supérieure de Lyon. Ses recherches portent essentiellement sur la notion de discours ainsi que sur l’articulation entre politique et littérature dans la littérature française du XVIIe et du XXe siècles. Il prépare actuellement une thèse à l’Université York consacrée aux utopies australes de la période louis-quatorzienne. Ses publications portent sur le discours littéraire et médiatique, les utopies classiques, et l’engagement politique des écrivains français modernes.
Notes
-
[1]
Bien entendu, notre utilisation du mot « sauvage » renvoie à l’emploi, en général non péjoratif, de ce terme à l’époque classique. D’après le Dictionaire de Furetière, « Sauvage se dit aussi des hommes errans, qui sont sans habitations reglées, sans Religion, sans Loix, & sans Police. Presque toute l’Amérique s’est trouvée peuplée de Sauvages » (Antoine Furetière, Dictionaire universel […], Paris, Société du nouveau Littré, vol. 3, 1984 [1690], t. III, p. 491).
-
[2]
Gabriel Sagard, Histoire du Canada et voyages que les frères Mineurs Recollects y ont faicts pour la conversion des Infidelles, Paris, Claude Sonnius, 1636. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées, dans le présent texte, par le sigle HC, suivi de la pagination.
-
[3]
Jack Warwick, « Du Huron au Petit-Nègre », dans Michèle Duchet (dir.), L’Inscription des langues dans les relations de voyage : XVIe-XVIIIe siècles, Actes de colloque (Fontenay aux Roses, décembre 1988), Cahiers de l’ENS, Fontenay / Saint Cloud, 1992, p. 79-87.
-
[4]
Gabriel Sagard, Dictionaire de la langue huronne […], Paris, Denis Moreau, 1632.
-
[5]
Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1984, p. 8 et passim.
-
[6]
Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Flammarion, 1977, p. 13.
-
[7]
Voir, par exemple, l’ouvrage de Gordon Sayre, « Les Sauvages Américains » : Representations of Native Americans in French and English Colonial Literature, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997.
-
[8]
Reuben Gold Thwaites (éd.), The Jesuit Relations and Allied Documents, Cleveland, Burrows Bros., 1898, vol. 6, p. 33-34.
-
[9]
Ainsi, selon Réal Ouellet et Jack Warwick, « contrairement à Champlain et au jésuite Lejeune des premières Relations, Sagard ne perçoit pas les Amérindiens comme des créatures radicalement différentes des civilisés » (« Introduction », Le Grand Voyage du pays des Hurons, édition critique établie par Jack Warwick et Réal Ouellet, Montréal, Leméac [Bibliothèque québécoise], 1990, p. 23-24).
-
[10]
Yvon Le Bras, « Les relations de Paul Lejeune : aux frontières de l’historiographie », dans Réal Ouellet (dir.), Rhétorique et conquête missionnaire : le jésuite Paul Lejeune, Québec, Septentrion, 1993, p. 53-65.
-
[11]
Marie-Christine Pioffet et Réal Ouellet, « La figure du voyageur-missionnaire en Nouvelle-France dans les relations de Sagard et de Lejeune (1632) », Revue des sciences humaines, no 245 (1997), p. 101 : « Alors que Sagard retrouve Dieu au Canada, Lejeune décrit la Nouvelle-France comme un lieu maudit dénué de tout. Entre le Grand Voyage et les Relations, l’écart paraît quasi total […]. » La même interprétation est mise en avant par Martin Fournier dans son article « Paul Lejeune et Gabriel Sagard : deux visions du monde et des Amérindiens », Canadian Folklore, vol. 17, no 1 (1995), p. 85-101. Selon l’auteur, « Sagard témoigne pleinement qu’un Européen du XVIIe siècle − même éduqué − pouvait vivre avec bonheur parmi les Amérindiens et apprécier au moins en partie leur mode de vie » (ibid., p. 101).
-
[12]
HC, p. 108 : « Voyez un peu je vous prie le bon naturel de ce Sauvage, & combien nous serons blasmables devant Dieu de nostre peu de charité. »
-
[13]
Id. : « Je ne sçay ce que vous en penserez, mais j’ay receu tant de secours d’aucuns, que je ferois plus volontiers le tour du monde avec eux, qu’avec beaucoup de Chrestiens & d’Ecclesiastiques mesmes. »
-
[14]
Gabriel Sagard, Dictionaire de la langue huronne […],op. cit., s.p. : « Mon nepveu, ma niepce. Hiuoitan. »
-
[15]
John Steckley, « Huron Kinship Terminology », Ontario Archeology, no 55 (1993), p. 41-42.
-
[16]
HC, p. 364-365 : « Avant que je fusse passé dans les Indes Canadiennes, & aucunement recognu la façon de parler de ses habitans, je croyois leur langue dans l’exces de pauvreté, comme elle est en effet de beaucoup de mots, pour autant que n’ayans point de cognoissance de beaucoup de choses qui sont en nostre Europe ; ils n’ont point de noms pour les signifier, mais j’ay recognu du depuis qu’és choses dont ils ont cognoissance, leurs langues sont en quelque chose plus fecondes & nombreuses, […] c’est à dire qu’ils ont une infinité de mots composez, lesquels sont des sentences entieres, comme les caracteres des Chinois. »
-
[17]
Le penchant des Jésuites pour la comparaison entre les langues autochtones et le latin a été mis en lumière par Victor Egon Hanzeli dans son ouvrage fondateur Missionary Linguistics in New France, La Haye, De Gruyter Mouton, 1969.
-
[18]
Brian Brazeau, Writing a New France, 1604-1632 : Empire and Early Modern French Identity, Farnham, Ashgate, 2009.
-
[19]
Ainsi, dans la préface du Dictionaire de 1632, op. cit., p. 10 et suiv., Sagard en parle comme d’une « langue sauvage, presque sans règle, & tellement imparfaicte » et il répète, un peu plus loin, que dans la langue huronne « tout y est tellement confondu & imparfaict, comme j’ay desja dict, qu’il n’y a que la pratique & le long usage qui y peut perfectionner les negligens & peu studieux ».
-
[20]
Sans prétendre à l’exhaustivité, on en a compté un peu moins de dix mille mots. Sur les quelque deux cent cinquante mille mots de l’ouvrage, ces occurrences ne représentent donc qu’environ 5 % de la totalité du texte.
-
[21]
Jack Warwick, « Du Huron au Petit-Nègre », dans Michel Duchet (dir.), L’Inscription des langues dans les relations de voyage : XVIe-XVIIIe siècles, op. cit., p. 82.
-
[22]
Alexandra Floirat, « Quel discours indirect libre au XVIe siècle ? », Linx, no 43 (2000), p. 77-86.
-
[23]
Comme le montre, par exemple, Laurence Rosier, Le Discours rapporté. Histoire, théories, pratiques, Paris / Bruxelles, De Boeck / Larcier, 1999. Cette généralisation représente moins une règle absolue qu’une configuration particulière de l’horizon d’attente des lecteurs de l’époque classique qui étaient formés à la double tradition du théâtre et du dialogue philosophique.
-
[24]
L’usage des deux-points pour annoncer le discours direct est important, mais on peut trouver beaucoup d’exemples signalés par des virgules, des points, ou même complètement non marqués. De la sorte, chez Sagard, le discours direct peut être signalé par les deux-points, par un point ou par une virgule.
-
[25]
Beaucoup d’autres exemples de discours indirect suivent le même modèle. Ainsi, HC, p. 318 : « [J]e monstré une fille à un Huron & luy demanday si elle estoit sa femme ou sa concubine, lequel me respondit qu’elle n’estoit ny l’une ny l’autre, ouy bien sa cousine & qu’ils n’avoient pas accoustumé de coucher avec celles qui leur estoient si proches parentes […]. »
-
[26]
Jack Warwick, « Du Huron au Petit-Nègre », dans Michel Duchet (dir.), L’Inscription des langues dans les relations de voyage : XVIe-XVIIIe siècles, op. cit., p. 82.
-
[27]
HC, p. 93 : « Le Pere Irenée qui avoit pris soin de luy, l’oyoit souvent plaindre la nuit & s’escrier en son patois François qu’il escorchoit au moins mal : Moy pourquoy point Chrestien, moy pourquoy point Baptisé […]. »
-
[28]
Auguste Carayon (éd.), Première mission des Jésuites au Canada : lettres et documents inédits, Paris, L’Écureux, 1864, p. 70.
-
[29]
Reuben Gold Thwaites (éd.), The Jesuit Relations and Allied Documents, Cleveland, Burrows Bros. Co., 1898, vol. 6, p. 42.
-
[30]
HC, p. 422 : « Et ce Garihoua Andionxra, n’avoit pas si petite estime de luy-mesme, qu’il ne se voulut dire frere & cousin du Roy de France, & de mesme égalité, comme les deux doigts demonstratifs des mains qu’il nous monstroit joints ensemble, en nous faisant cette ridicule & inepte comparaison. »
-
[31]
HC, p. 712 : « [S]’il est mort en guerre le Capitaine fait une harangue comme une oraison funebre devant le corps, où assistent tous ses parens & amis, lesquels il incite & exhorte de prendre promptement vengeance d’une telle meschanceté, & que sans delay on aille faire la guerre à leurs ennemis, afin qu’un si grand mal ne demeure point impuny, & qu’une autre fois on n’aye plus la hardiesse de leur venir courir sus. »
-
[32]
HC, p. 453-454 : « Nos Hurons ayans pris quelqu’un de leurs ennemis, apres l’avoir lié & garotté, luy font une harangue des cruautez, rigueurs, & mauvais traitemens que luy, & les siens, ont exercé à leur endroit, & qu’au semblable il devoit se resoudre d’en endurer autant, & plus s’il se pouvoit, & luy commandent de chanter tout le long du chemin, ce qu’il fait (s’il a du courage assez) mais souvent avec un chant fort triste & lugubre. »
-
[33]
HC, p. 641 : « En chacune des cabanes de la pesche, il y a un Predicateur de poisson, qui a accoustumé de les prescher, s’ils sont habilles gens ils sont fort recherchez, pour ce qu’ils croyent que les exhortations d’un habile homme, ont un grand pouvoir d’attirer les poissons dans leurs rets, comme eux l’eloquence d’un grand Ciceron à sa volonté. »
-
[34]
On ne retrouve ainsi que trois occurrences du mot « enfer » et quatre du mot « diable », contre quatorze mentions du mot « paradis » et vingt-sept de « Dieu ».
-
[35]
La catégorie sémantique de la mort réunit soixante-cinq occurrences et celle de la maladie, vingt-sept occurrences.
-
[36]
HC, p. 573 : « Je ne sçay comme il se peut trouver des personnes de si petit esprit, que de croire qu’un peu d’eau soit capable de nous faire mourir […]. »
Références
- Brazeau, Brian, Writing a New France, 1604-1632 : Empire and Early Modern French Identity, Farnham, Ashgate, 2009.
- Carayon, Auguste (éd.), Première mission des Jésuites au Canada :lettres et documents inédits, Paris, L’Écureux, 1864.
- Certeau, Michel de, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1984.
- Duchet, Michèle, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Flammarion, 1977.
- Floirat, Alexandra, « Quel discours indirect libre au XVIe siècle ? », Linx, no 43 (2000), p. 77-86.
- Fournier, Martin, « Paul Lejeune et Gabriel Sagard : deux visions du monde et des Amérindiens », Canadian Folklore, vol. 17, no 1 (1995), p. 85-101.
- Hanzeli, Victor Egon, Missionary Linguistics in New France : A study of Seventeenth- and Eighteenth-Century Descriptions of American Indian Languages, La Haye, De Gruyter Mouton, 1969.
- LeBras, Yvon, « Les relations de Paul Lejeune : aux frontières de l’historiographie », dans Réal Ouellet (dir.), Rhétorique et conquête missionnaire : le jésuite Paul Lejeune, Québec, Septentrion, 1993.
- Pioffet, Marie-Christine et Réal Ouellet, « La figure du voyageur-missionnaire en Nouvelle-France dans les relations de Sagard et de Lejeune (1632) », Revue des sciences humaines, no 245 (1997), p. 93-110.
- Rosier, Laurence, Le Discours rapporté. Histoire, théories, pratiques, Paris / Bruxelles, De Boeck / Larcier, 1999.
- Sagard, Gabriel, Dictionaire de la langue huronne […], Paris, Denis Moreau, 1632.
- Sagard, Gabriel, Histoire du Canada et voyages que les frères Mineurs Recollects y ont faicts pour la conversion des Infidelles, Paris, Claude Sonnius, 1636.
- Sagard, Gabriel, Le Grand Voyage du pays des Hurons, édition critique établie par Jack Warwick et Réal Ouellet, Montréal, Leméac (Bibliothèque québécoise), 1990.
- Sayre, Gordon, « Les Sauvages Américains » : Representations of Native Americans in French and English Colonial Literature, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997.
- Steckley, John, « Huron Kinship Terminology », Ontario Archeology, no 55 (1993), p. 35-59.
- Thwaites, Reuben Gold (éd.), The Jesuit Relations and Allied Documents, Cleveland, Burrows Bros. Co., 1898, vol. 5-6.
- Warwick, Jack, « Du Huron au Petit-Nègre », dans Michèle Duchet (dir.), L’Inscription des langues dans les relations de voyage : XVIe-XVIIIe siècles, Actes de colloque (Fontenay aux Roses, décembre 1988), Cahiers de l’ENS, Fontenay / Saint Cloud, 1992, p. 79-86.