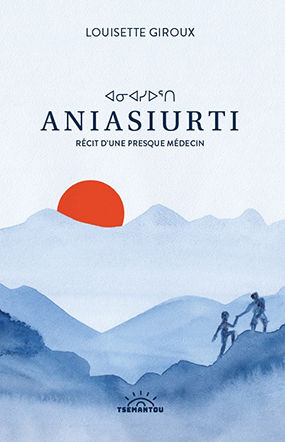Article body
Ce livre de mémoires au féminin raconte le parcours assez exceptionnel d’une Québécoise ayant vécu sept ans auprès des populations autochtones de ce qu’on appelait alors le Nouveau-Québec (maintenant le Nunavik). C’est là qu’elle s’établit avec son mari d’origine alsacienne et leurs jeunes enfants. Pour la population de ces régions nordiques peu fréquentées par des Blancs, l’infirmière Louisette Giroux était surnommée « la presque médecin », une « Aniasiurti » (p. 7), et c’est ainsi qu’on la désignait familièrement : elle soignait, conseillait et quelquefois même procédait seule à des accouchements en l’absence d’un médecin en titre.
Ce livre illustré apporte – rétrospectivement – une description précise de la vie quotidienne dans le Nord québécois, surtout à Port-Nouveau-Québec (Kangiqsualujjuaq, p. 49), qui comptait alors 250 habitants, situé sur la rivière George, dans la Baie d’Ungava, de 1970 à 1980 (p. 50). Juste avant, un autre séjour de quelques semaines avait eu lieu à Fort-Chimo, renommé aujourd’hui Kuujjuaq. La famille y côtoie brièvement le révérend père oblat André Steinmann (1912-1991), considéré comme missionnaire, interprète, catalyseur auprès des Innus, et comme un trait d’union entre les deux communautés (p. 50 et 76). Lors de son arrivée, Louisette Giroux disait à propos de ses conditions de travail rudimentaires : « Je m’initie à nouveau à la médecine de brousse. » (p. 50) La trentaine de maisonnettes habitées exclusivement par les Autochtones, surnommées en anglais « matchbox », lui semblaient « faciles à brûler » (p. 75).
Née en Abitibi, l’auteur évoque son enfance abitibienne, les moments déterminants de sa vie, ses études en nursing, sa vocation d’infirmière et ses longs séjours dans ce que l’on appelait alors des régions isolées. À partir de son propre passé, elle décrit le choc culturel et l’interculturalité vécue au quotidien : « J’ai compris aussi que, pour ces gens vivant près de la nature, le temps et l’heure, connais pas ! » (p. 54) Ainsi, la perception de la promiscuité n’était alors pas la même. Habituellement, les Autochtones entraient chez elle sans frapper et sans parler, même durant les heures de repas, et ils s’installaient au salon sans rien dire. Ces pratiques, inimaginables pour une famille québécoise, étaient courantes et banales : « Pendant que nous étions à table, des gens passaient près de nous et se dirigeaient au salon, sans frapper à la porte. Les visiteurs ouvraient simplement et s’installaient comme bon leur semble. Stupéfaits, nous regardions ces gens, tout à coup propriétaires de notre intimité. » (p. 55)
Le récit des pratiques quotidiennes des Autochtones est très précis (p. 54). C’est l’un des points forts de ce livre, un peu comme un polaroïd du Nouveau-Québec en 1970. La rédaction de ces mémoires remonte à il y a vingt ans, avant que les proches envisagent de les publier (p. 7). En filigrane, on saisit les mentalités et les attitudes de cette époque, du moins dans cette communauté, par exemple la confiance accordée par les Autochtones au savoir des Blancs, du moins en matière de santé. Et parfois. même si les Blancs n’étaient pas diplômés en médecine ou en soins infirmiers; le fait d’être Blancs semblait leur accorder automatiquement une sorte d’expertise en toute chose (p. 83). Dès le début, Louisette Giroux s’étonnait de cette situation.
Ce qui fait d’abord l’intérêt de cet ouvrage, c’est sa valeur documentaire, sous forme de témoignage appuyé par des descriptions précises sur les coutumes, l’artisanat, la couture, les vêtements et les bottes, les soins apportés par les mères envers leurs enfants, la spiritualité autochtone. Par ailleurs, les ressources étaient limitées : il y a cinquante ans, tout était rudimentaire, à inventer. Il n’y avait ni véritable téléphone, ni système d’électrification adéquat, ni même de système organisé de cueillette des ordures. Louisette Giroux relate un accouchement qu’elle a pratiqué seule, la nuit, sans autre éclairage qu’une lampe de poche (p. 82). Cette époque d’isolement semble désormais révolue. Certaines pratiques liées au quotidien des Autochtones sont judicieusement rendues : « Les Inuits font la bannique tous les jours, un pain sans levain, et donc sans poudre chimique. Lorsqu’il est frit dans la poêle, son goût est bon et mes enfants l’apprécient beaucoup. » (p. 54)
Dans les faits, Louisette Giroux était le plus souvent livrée à elle-même sur le plan professionnel, et en cas d’urgence elle ne pouvait communiquer avec un « vrai médecin » que par le truchement de la radio à ondes courtes, et seulement à certains moments précis. Les visites médicales étaient rares. À court terme, elle disposait de ses livres et manuels de premiers soins et pouvait consulter quelques protocoles. Elle raconte qu’elle devait faire face – le plus souvent seule – à toutes les situations imaginables : blessures, infections, maladies, accouchements, problèmes dentaires, empoisonnements, et en tout temps tenter de vaincre la barrière linguistique car pratiquement personne ne comprenait le français au Nouveau-Québec. Dans les situations les plus graves, il fallait appeler d’urgence l’avion du gouvernement du Québec pour évacuer un malade vers un hôpital du Sud ou à Chimo. Les évacuations d’urgence devaient souvent avoir lieu la nuit, ou en pleine tempête, en hydravion ou en hélicoptère; elle louera « l’excellence des pilotes de brousse » (p. 97). Dans ces circonstances, c’est l’infirmière Giroux qui devait contacter elle-même les secours par le truchement du radiotéléphone (p. 96). Et en cas de panne de radio, tout le monde était complètement isolé pendant des jours (p. 51). Louisette Giroux se souvient d’avoir transporté en chaloupe un enfant innu blessé par balle par son père – et qu’elle garda tout contre elle, sous soluté : « … il faut au moins 14 heures pour se rendre à Chimo via la Baie d’Ungava » (p. 99).
Tout n’était pas rose : l’ex-infirmière se remémore ses craintes d’alors et refait sans complaisance ni vantardise le récit de certains drames dont elle a vu les conséquences en tant que soignante, par exemple pour de nombreux enfants innus attaqués par des chiens affamés, nourris une seule fois par semaine : « Enfant éventré par les crocs que le père réussit à défendre in extremis. Enfant à la carotide déchirée » (p. 100). Dans d’autres passages, on évoque les perceptions des Inuits entourant la mort, la maladie, le suicide des aînés qui se sentent trop vieux et qui décident de s’éloigner pour mourir (voir n. 19, p. 93).
En plus de sa valeur humaine et littéraire – car le texte est admirablement bien écrit –, ce livre sera utile aux chercheurs voulant documenter les mentalités et certains modes de vie révolus du monde autochtone du Nord québécois d’il y a un demi-siècle. L’auteur en est pleinement consciente lorsqu’elle date ses expériences et qu’elle souligne les transitions dans les pratiques autochtones : « Faire une randonnée en traîneaux à chiens appartient aux touristes désormais. En 1970, les Inuits partaient encore à la chasse avec eux. » (p. 100) Même si les mentalités ont changé, les chercheurs ont besoin de points de comparaison afin de mesurer le chemin parcouru collectivement.