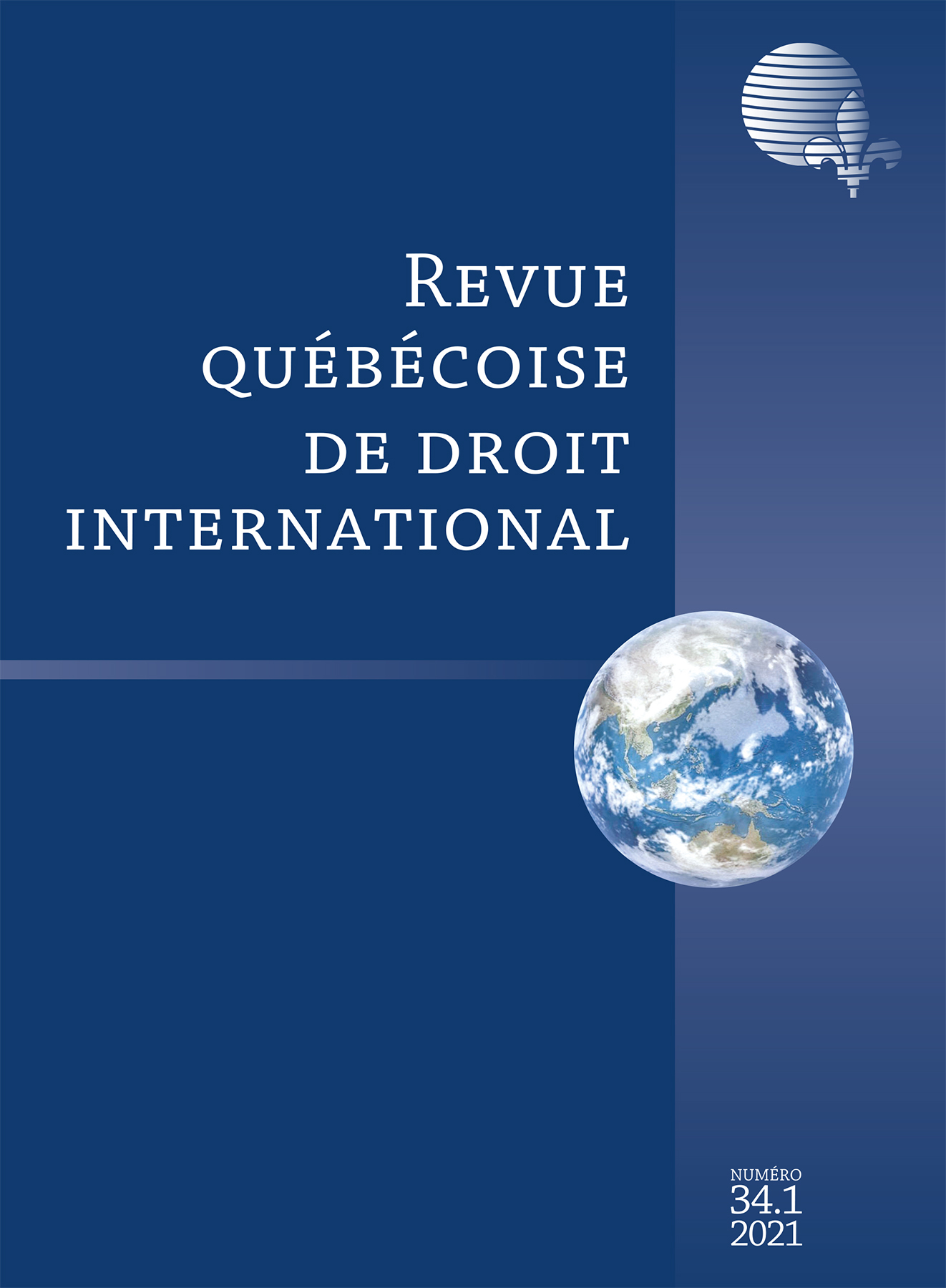Abstracts
Résumé
Les articles 3 et 7 du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole relatif à la Cour africaine, Protocole de Ouagadougou ou Protocole) autorisent cette dernière à interpréter et à appliquer, outre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». Partant, la Cour africaine applique fréquemment la Déclaration universelle des droits de l’homme, soit pour légitimer l’universalisme des droits en cause, soit en tant que source directe des droits subjectifs. Cette dernière hypothèse ne va pas sans poser problème au regard des spécificités du système africain des droits de l’homme. L’audace de la Cour, couplée à un exercice trop zélé des possibilités offertes par les articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou, risque de conduire à une atténuation du contenu matériel de la Charte africaine. La Cour africaine risque de dissoudre dans l’universel les particularités du système régional des droits de l’homme à la base de sa création.
Abstract
Articles 3 and 7 of the Protocol relating to the African Court on Human and Peoples' Rights (African Court Protocol, Ouagadougou Protocol or Protocol) authorize the latter to interpret and apply, in addition to the African Charter on Human and Peoples’ Rights (African Charter), “any other relevant instrument relating to human rights and ratified by the States concerned”. Therefore, the African Court frequently applies the Universal Declaration of Human Rights, either to legitimize the universalism of the rights in question, or as a direct source of subjective rights. This last hypothesis is not exempt from problems regarding the specificities of the African human rights system. The audacity of the Court, coupled with an overzealous exercise of the possibilities offered by Articles 3 and 7 of the Ouagadougou Protocol, risks leading to an attenuation of the material content of the African Charter. The African Court risks dissolving the particularities of the regional human rights system on which it was founded, into the universal.
Resumen
Los artículos 3 y 7 del Protocolo relativo a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Protocolo de la Corte Africana, Protocolo de Uagadugú o Protocolo) autorizan a esta última a interpretar y aplicar, además de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana), “cualquier otro instrumento pertinente relacionado con los derechos humanos y ratificado por los Estados interesados”. Por lo tanto, la Corte Africana aplica con frecuencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya sea para legitimar el universalismo de los derechos en cuestión, o como fuente directa de derechos subjetivos. Esta última hipótesis no está exenta de problemas respecto de las especificidades del sistema africano de derechos humanos. La audacia de la Corte, unida a un ejercicio exagerado de las posibilidades que ofrecen los artículos 3 y 7 del Protocolo de Uagadugú, podría atenuar el contenido material de la Carta Africana. La Corte Africana arriesga disolver en lo universal las particularidades del sistema regional de derechos humanos en el que se fundó.
Article body
Qui trop embrasse mal étreint !
La protection internationale des droits de l’homme voulue par la Charte des Nations[1] est véritablement née avec l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Cette internationalisation s’est concrétisée par l’adoption des textes relatifs aux droits de l’homme et la mise en place d’institutions spécialisées pour assurer la garantie de ces droits tant au niveau universel que régional. L’Afrique n’est pas restée inerte face à ce mouvement : dernier-né, le système africain de protection des droits de l’homme est principalement fondé sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette dernière affirme nettement sa filiation avec la DUDH. Son préambule stipule l’engagement des États africains de favoriser la coopération internationale « en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme » ainsi que « leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments »[2] adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Cet état de choses témoigne de la reconnaissance de l’universalité des droits de l’homme par les États africains. C’est la raison pour laquelle l’article 60 de la Charte africaine autorise la Commission africaine à « s’inspirer du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, en particulier de divers instruments africains des droits de l’homme, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et de la Déclaration universelle des droits de l’homme »[3]. Il s’en infère que la Charte africaine est un instrument universel culturellement incarné : elle opère un travail de métissage entre les normes conformes au système universel et les valeurs culturelles positives de l’Afrique. De ce fait, la Charte africaine a mis en oeuvre une conception des droits de l’homme globale et intégrée ; un équilibre y est observé entre les droits de l’homme et les droits des peuples, ce qui fait du document le propre du continent, l’émanation de sa vision de l’humain[4].
Au cours de l’année 2003, la Charte africaine a été utilement complétée par deux protocoles : le premier portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole de Ouagadougou) et le second est relatif aux droits de la femme en Afrique. Ainsi que le souligne la doctrine, « l’adoption d’un protocole instituant une véritable juridiction présente un intérêt fondamental et s’inscrit dans le prolongement du renforcement progressif du système africain »[5] des droits de l’homme. De ce fait, l’article 3(1) du Protocole dispose que « [l]a Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés »[6]. Si les deux premières bases juridiques de la compétence de la Cour africaine (la Charte et le Protocole) ne surprennent point, tout le contraire est la situation de la troisième base juridique (tous les autres instruments relatifs aux droits de l'homme). Cette formule très originale, extensive et généreuse attribue à la Cour africaine une compétence matérielle large, le but poursuivi étant de lui permettre de s’affirmer pleinement en tant que protecteur de tous les droits de l’homme universellement reconnus[7]. Le caractère libéral de cette disposition est confirmé par l'article 7, intitulé « Droit applicable », qui prévoit que « [l]a Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l’État concerné »[8]. À bien d’égards, ces dispositions, curieuses et inédites, élargissent la compétence de la Cour aux traités relatifs aux droits de l’homme, en même temps et paradoxalement, elles procèdent par une amputation implicite du champ des règles pertinentes applicables par la Cour. Mis en parallèle avec les articles 60 et 61 de la Charte africaine relatifs au droit applicable par la Commission africaine, l’article 7 du Protocole de la Cour africaine se révèle très restrictif. Il prive notamment la Cour de l’application des règles coutumières et des principes généraux du droit. Sous cet angle, il constitue une limitation sévère de la possibilité d’enrichissement prétorien des droits de l’homme à la faveur d’une jurisprudence innovante de la Cour[9].
Le présent article tente d’analyser la mise en oeuvre des dispositions des articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou par la Cour africaine. Prenant appui sur sa pratique jurisprudentielle, nous constatons un recours fréquent à la Déclaration universelle des droits de l’homme en tant qu’« instrument international relatif aux droits de l’homme ». Tout d’abord, la Cour africaine a largement interprété la valeur juridique de la DUDH (I). Ensuite, elle a accueilli des allégations de violations des droits de l’homme sur le fondement de la Déclaration universelle des droits de l’homme (II).
I. L’interprétation de la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Dans quelques-uns de ses arrêts, la Cour africaine a été amenée à interpréter la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme, lui accordant de ce fait une place particulière dans le système africain des droits de l’homme (A). En outre, la Cour africaine a réaffirmé l’universalisme des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (B).
A. La place de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans le système africain de garantie des droits de l’homme : une source directe des droits subjectifs ?
Contrairement aux systèmes européen et interaméricain des droits de l’homme où les dispositions consacrées à l’institution d’une Cour sont contenues dans le même texte que le droit substantiel, l’institution de la Cour africaine par un texte distinct de la Charte africaine n’a pas rendu aisée la désignation des dispositions dont l’application revient à la Cour. Cette dernière a été déclarée garante de l’ensemble des instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme et ratifiés par les États africains. Les articles 3 et 7 du Protocole semblent être inspirés par le modèle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et ce, contrairement à la Cour européenne des droits de l’homme dont la compétence classique ne vise que la Convention et ses protocoles[10]. Des difficultés d’application de cette compétence universelle de la Cour africaine n’ont pas tardé à surgir.
Dans une affaire soumise à sa juridiction, la Cour africaine était appelée à se prononcer sur l’exception d’incompétence ratione materiae. La défenderesse (la République-Unie de Tanzanie) soutenait que les requérants ont fondé leur requête sur les articles 7, 8, 23, 25 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Or, l’article 3(1) du Protocole confère à la Cour la compétence de traiter des affaires concernant les violations des instruments des droits de l’homme qui y sont mentionnés, pour autant qu’ils aient été ratifiés par le gouvernement tanzanien. La défenderesse conclut que cette requête ne relève certainement pas du champ d’application de l’article 3(1) du Protocole et conclut que la Cour devrait se déclarer incompétente ratione materiae. La question de droit qui se pose dans le cas d’espèce est de savoir si la Déclaration universelle des droits de l’homme est un instrument de protection des droits de l’homme à prendre en considération au sens des articles 3 et 7 du Protocole. La Cour prend le soin de rappeler que la DUDH est une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et qu’en dépit du fait qu’elle soit l’un des premiers instruments dont l’objectif est de protéger des droits subjectifs de l’individu, elle n’est pas ratifiée par les États[11]. La Cour ajoute cependant une considération capitale, puisqu’elle se fait le devoir d’interpréter la nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle estime que « même si la Déclaration n’est pas un traité qui nécessite une ratification par les États pour entrer en vigueur, elle a été élevée au statut de droit international coutumier et de norme incontournable »[12] et, par conséquent, « la Cour […] est donc tenue de l’interpréter et de l’appliquer »[13].
La position de la Cour africaine d’après laquelle la DUDH relève du droit coutumier est conforme au droit international. En effet, quoi que se présentant initialement comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », la Déclaration universelle des droits de l’homme a eu une portée imprévisible à la fois pour ses rédacteurs, qui n’ont nullement prévu de mécanisme de mise en oeuvre telle une cour appliquant des sanctions aux contrevenants, et pour les États, ceux-ci n’ayant jamais cru qu’elle contraindrait leur comportement puisqu’il ne s’agissait que d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies[14]. La doctrine majoritaire s’accorde aujourd’hui à penser que les principes énoncés par la DUDH font partie du droit coutumier international[15]. Cette position est justifiée par la considération qu’en dépit du fait que la DUDH ne soit pas un traité, elle est aujourd’hui acceptée par les États comme une interprétation authentique de la Charte des Nations Unies, car celle-ci n’entreprend pas de définir ni de cataloguer les droits de l'homme. En témoigne le consensus juridique international dont une des indications se trouve dans les positions prises et les votes émis par les États au sein des conférences et organisations internationales. De ce point de vue, la DUDH devrait être observée pleinement, strictement et fidèlement[16]. La jurisprudence internationale parait bien assise. La Cour internationale de justice a jugé que « le fait de priver arbitrairement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions pénibles à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme »[17]. Il en résulte qu’aux yeux de la Cour internationale de justice, la DUDH est sans contredit la source matérielle des droits de l’homme sur le plan international et les droits qui y sont énoncés sont obligatoires pour les États. Dans l’affaire Barcelona Traction, la Cour internationale de justice reconnait que les principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine sont des obligations erga omnes et que tous les États ont un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés[18].
Cependant, la Cour africaine pousse très loin la place de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans le système africain des droits de l’homme au point d’en faire non seulement une source directe des droits pour les individus, mais aussi un fondement de sa compétence sur pied des articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou. L’illustration, sans doute la plus prégnante, est faite dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo c République-Unie de Tanzanie. Dans cette cause, le requérant a été déporté au Kenya après que sa nationalité tanzanienne lui ait été retirée. Le Kenya l’a par la suite déporté vers la Tanzanie où il est resté bloqué dans la zone tampon à la frontière. Le requérant a allégué que son droit à la nationalité, garanti par la DUDH, avait été violé. La Cour africaine a estimé que ni la Charte africaine, ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne traitaient explicitement du droit à la nationalité, mais que le retrait de la nationalité qui rend le requérant apatride violait la DUDH, celle-ci ayant acquis le caractère de droit international coutumier. Pour justifier cette position, la Cour note simplement que « la Déclaration universelle des droits de l’homme est reconnue partie intégrante du droit coutumier international » et que « dans certains arrêts de la Cour internationale de justice, il a été fait expressément mention de la Déclaration universelle des droits de l’homme »[19]. Cette justification, à elle seule, est loin d’être convaincante. Pour autant que la violation alléguée du droit à la nationalité reposait exclusivement sur la DUDH, la Cour africaine aurait dû analyser si elle était matériellement compétente d’appliquer la DUDH au regard des articles 3 et 7 du Protocole. Ces dispositions conventionnelles ne lui accordent la compétence de n’appliquer que les dispositions « de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifiés par les États concernés »[20]. Il en résulte qu’une violation des droits de l’homme ne peut être constatée sur le fondement d’un texte juridique international que si ce dernier est un traité international, s’il a été ratifié par l’État défendeur et si ce traité est relatif aux droits de l’homme. Ces trois conditions sont cumulatives. Dans le cas sous examen, s’il est incontestable que la DUDH soit un instrument relatif aux droits de l’homme dans la mesure où elle énonce expressément des droits subjectifs au profit des individus, cette Déclaration, fruit d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, n’est pas un traité international et n’a pas été ratifiée par les États. À l’analyse, les dispositions de l’article 7 du Protocole de 1998 portant création de la Cour africaine sont très restrictives quant au champ du droit applicable par cette dernière. Elles sont en retrait par rapport aux articles 60 et 61 de la Charte africaine, lesquels autorisent la Commission africaine à appliquer « les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine ». Cette restriction du droit applicable par la Cour a pour corollaire de priver cette dernière de l’application primaire du droit coutumier ; que celui-ci soit régional ou universel, il ne saurait être appliqué en tant que source directe et exclusive des droits. La doctrine enseigne à ce sujet que l’utilisation, à l’article 3 du Protocole, des qualificatifs tels que « pertinent », « ratifié », « droits de l’homme » et « par l'État concerné » ont pour vocation de limiter la compétence ratione materiae de la Cour africaine. Le qualificatif le plus important est « ratifié », ce qui implique que les instruments auxquels il est fait référence doivent être des traités et non de simples déclarations ou d'autres textes ou instruments juridiques non contraignants[21]. En ce sens, la Cour africaine a jugé qu’il faut « que les droits dont la violation est alléguée soient protégés par la Charte ou par tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’État concerné pour que la Cour ait la compétence requise pour connaître de la cause »[22], la mention expresse des dispositions du traité violées étant toutefois facultative[23]. Aussi, a-t-elle jugé qu’elle n’a pas compétence, aux termes de l’article 3 du Protocole, de statuer sur une requête qui se fonde exclusivement sur la rupture du contrat de travail en rapport avec l’article 13(a) et (b) du Statut et Règlement du personnel de l’Union africaine[24], pas plus qu’elle ne saurait retenir des violations des droits de l’homme sur la base de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention européenne), de la Convention américaine des droits de l’homme (Convention américaine), de la Constitution ou du Code pénal de l’État défendeur[25]. Il faut en déduire que l’étroitesse des expressions utilisées par les rédacteurs du Protocole de Ouagadougou ne laisse de place à aucun doute : la confiance est limitée aux traités des droits de l’homme. La principale justification gît dans le fait que les États assument des obligations envers tous individus relevant de leur juridiction lorsqu'ils ratifient des traités sur les droits de l'homme, et pas seulement par rapport à d'autres États. Ainsi, des instruments juridiques tels que la DUDH ne sont pas inclus dans la compétence de la Cour africaine en vertu de l’article 3 du Protocole. Bien que la DUDH relève du droit coutumier et contienne des dispositions importantes pour les droits de l’homme, elle ne constitue nullement une source directe des droits subjectifs pour les individus ; tout au plus, elle pourrait servir de support aux droits conventionnellement garantis.
Concernant la question de savoir si un traité particulier peut être considéré comme « un instrument relatif aux droits de l’homme », la jurisprudence de la Cour africaine est assez disparate. Appelée à se prononcer sur la question de l’applicabilité du Traité portant création de la Communauté d’Afrique de l’Est, à la lumière des articles 3(1) et 7 du Protocole, la Cour africaine a brillé par son silence[26]. Pire encore, la Cour africaine qualifie une observation générale du Comité des droits de l’homme d’« instrument adopté par les Nations Unies relatif aux droits de l’homme »[27], suivant en cela la mauvaise voie tracée par la Commission africaine pour qui les décisions et commentaires généraux des organes des Nations Unies constituent des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme[28]. Un début de solution a vu le jour avec l’affaire Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c République de Côte d’Ivoire. Après avoir noté que l’État défendeur a ratifié la Charte africaine sur la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la Cour a tenu à s’assurer également que ces deux instruments juridiques sont des instruments des droits de l’homme au sens de l’article 3 du Protocole. De ce fait, elle a sollicité les avis de la Commission de l’Union africaine et de l’Institut africain de droit international. Cet arrêt est pertinent au regard de son enseignement : pour déterminer si un instrument international est un traité relatif aux droits de l’homme au sens des articles 3 et 7 du Protocole, il convient de se rapporter non seulement à son objet (l’énonciation expresse des droits subjectifs au profit des individus ou groupes d’individus), mais aussi, et surtout à la prescription à l’égard des États d’obligations contraignantes impliquant la jouissance conséquente des mêmes droits (l’existence des mécanismes de contrôle)[29]. Appliqué à la DUDH, cet enseignement de la Cour africaine nous conduit à l’écarter des « instruments relatifs aux droits de l’homme » au sens de l’article 3 du Protocole. Quand bien même elle consacre expressément des droits subjectifs, elle ne comporte aucun mécanisme de mise en oeuvre. En conséquence, la Cour africaine n’a pas compétence pour l’appliquer en tant que source directe des droits. Elle demeure néanmoins fondée à invoquer l’universalisme des droits qui y sont consacrés.
B. La réaffirmation de l’universalisme des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme
Outre le caractère de norme coutumière de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Cour africaine fonde également la référence à cet instrument international sur le caractère universel des droits qui y sont consacrés. Elle s’approprie les arguments des Nations Unies d’après lesquels la Déclaration universelle des droits de l’homme « représente la reconnaissance universelle que les droits et les libertés fondamentales sont inhérents à toute personne humaine et qu’ils sont inaliénables et applicables à tous de la même manière ; que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »[30]. Cette position jurisprudentielle ne peut être qu’approuvée. En effet, « [p]arlant au nom de notre humanité commune, elle [la DUDH] tire ses principes de nombreuses traditions et les établit sur une base solide par une codification uniforme »[31]. Mettant en place une compréhension commune des droits de l’homme mentionnés dans la Charte des Nations Unies, la DUDH représente un changement majeur par rapport au système westphalien : « la relation entre les États et les individus n’est plus une simple question de droit national complètement exemptée d’interférence de pays tiers, ou des institutions de la communauté internationale »[32]. Afin d’ « éviter un retour à la barbarie » et dans le but de créer « un monde où l’homme sera libéré de la terreur et de la misère », la Déclaration universelle des droits de l’homme a le mérite d’avoir consacré des points de repère universellement admis, lesquels ont, par la suite, donné naissance à ce qu’il est convenu d’appeler « le droit de regard » de la communauté internationale[33]. À ce titre, la DUDH apparait comme le « ferment du processus de création du droit international des droits de l’homme »[34]. C’est donc « le premier jalon de la construction d’un véritable système onusien de protection des droits de l’homme » et « la première manifestation concrète du phénomène d’internationalisation des droits de l’homme opéré par la Charte de San Francisco »[35].
L’affirmation de l’universalisme des droits contenus dans la DUDH par la Cour africaine est extrêmement importante à une époque où les droits de l’homme font l’objet d’une double menace. Tout d’abord, l’universalisme des droits de l’homme est menacé par l’irruption d’un « confessionnalisme radical » s’exprimant notamment dans la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de Paris du 19 septembre 1981 qui fait référence à un « ordre islamique » et insiste notamment sur « le caractère religieux de l’individu et de son rapport à la divinité et aux textes et traditions sacrés entraînant des dépendances et obligations d’une essence spéciale »[36]. Ensuite, l’universalisme des droits de l’homme est menacé par la revendication par certains pays d’un « relativisme culturel », entraînant la reconnaissance de droits à géométrie variable[37].
La réponse de la Cour africaine à toutes ces critiques est sans désemparer : la construction de l’édifice international de protection des droits de l’homme a commencé par la DUDH proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cette Déclaration a inspiré l’évolution des instruments des droits de l’homme aux niveaux national, régional et universel. L’un de ces instruments est la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples[38]. La doctrine affirme à cet égard que la Déclaration universelle des droits de l’homme est la « matrice de tout le droit international des droits de l’homme »[39]. Elle en va pour preuve les différentes références à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans toutes les conventions régionales des droits, ce qui laisse à penser qu’il s’agirait de leur principale source d’inspiration. On peut ainsi en déduire que la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples seraient le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adaptées à chaque particularisme régional[40]. Partant, la Cour africaine a retenu certaines allégations de violations des droits de l’homme sur le fondement de la DUDH.
II. L’établissement des violations des droits de l’homme sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a accueilli certaines allégations de violations des droits de l’homme sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme. À cet effet, sa démarche se décline en une double attitude (A). Cette situation serait de nature à porter atteinte à la spécificité du système africain des droits de l’homme (B).
A. La dualité de la démarche de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
La Déclaration universelle des droits de l’homme présente une particularité certaine dans l’herméneutique africaine au regard de différents rôles qu’elle joue dans la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Premièrement, elle a été utilisée pour donner un support idéologique universel aux droits consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Pour comprendre cette assertion, il est utile de rappeler le contexte politique au sein duquel la Cour africaine a vu le jour et continue de fonctionner. En effet, l’adhésion de l’Afrique au courant universel des droits de l’homme fut rendue possible par la mise en oeuvre de la conditionnalité de l’aide au développement par les États occidentaux[41]. Sous cette influence, on a assisté sur le continent africain à la libéralisation de la vie publique par la suppression des États parties, à la tenue des consultations électorales et à l’organisation des conférences nationales[42]. Ayant ratifié la majorité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, tous les États africains ont inscrit ces droits dans leurs constitutions et se sont formellement engagés à les respecter, à les protéger et à les mettre en oeuvre. Paradoxalement et très vite, les transitions démocratiques furent vidées de leur subsistance et l’idéal républicain a été rattrapé par l’esprit conservateur qui s’est redéployé avec une ingéniosité insoupçonnée : l’autoritarisme politique a réussi la prouesse de se faire une nouvelle virginité en se parant du prêt-à-porter institutionnel[43]. Ainsi, la démocratie, qui est une idéologie du respect de la personne humaine dans ses droits et sa dignité, perd tout son potentiel révolutionnaire hérité de la philosophie des lumières pour finalement se dégrader en « démocratisme » ou « démocrature »[44]. Par ailleurs, pour relever, semble-t-il, les défis du développement économique et social ainsi que de la sécurité, les gouvernants africains n’hésitent pas à reléguer au dernier plan la problématique des droits de l’homme[45].
Ce contexte politique particulier a eu un impact négatif sur le système africain de garantie des droits de l’homme. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples fut la première, dès 1989 (date du début de son fonctionnement), à y être confrontée. Elle était tenue à la confidentialité à moins que la Conférence des chefs d’État et de Gouvernements n’en ait décidé autrement, et ce, même en cas de violations graves et massives des droits de l’homme. Son audace interprétative l’amena à se doter de certaines armes dont elle avait été privée par les rédacteurs de la Charte. Ainsi a-t-elle créé de nombreux mécanismes spéciaux dont les groupes de travail, les rapporteurs spéciaux, les comités. Bien plus, elle a mis en place une procédure d’examen des plaintes individuelles qui n’avait pas été expressément prévue par la Charte africaine. Elle dut être « activiste », se libérer de l’autorisation de la Conférence des chefs d’État et de gouvernements pour publier ses décisions dans ses rapports annuels. De la sorte, elle est parvenue tant soi peu à affirmer sa légitimité. Par ailleurs, pour affirmer son autorité, la Commission africaine est passée d’un simple constat de violations des droits de l’homme à l’émission des recommandations aux États, précisant l’ensemble des mesures appropriées à mettre en oeuvre pour rétablir le droit violé[46]. Toutefois, malgré les progrès accomplis, les décisions de la Commission africaine n’ont servi qu’à remplir les annales juridiques. Les États se refusent de les mettre en pratique devant le regard impuissant de la Commission. Au demeurant, « cette Commission, dont l’autonomie est garantie en théorie, n’existe qu’en contrepartie d’une certaine soumission aux États africains »[47].
Venant renforcer la mission de la Commission africaine, la Cour africaine s’est à son tour butée à l’autoritarisme des régimes politiques africains. En témoigne la réticence des gouvernements à lui accorder la place centrale qui est la sienne, dans le système européen par exemple. La Cour africaine se particularise par des restrictions qui sont faites à sa compétence. La reconnaissance du droit des requêtes individuelles n’est pas obligatoire. À cet effet, les États africains, usant de prudence, ont repris de la main gauche ce qu’ils ont donné de la main droite. Les victimes des violations des droits de l’homme ne peuvent saisir la Cour que si l’État défendeur est partie au Protocole de la Cour, mais aussi, et surtout si l’État a de surcroît déclaré reconnaitre la juridiction de la Cour. Il en découle que l’absence d’enthousiasme étatique dans la ratification du Protocole de Ouagadougou et dans la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour africaine quant aux requêtes individuelles constitue indubitablement le talon d’Achille du système africain des droits de l’homme[48]. Bien plus, les États africains, jaloux de leur souveraineté, sont hostiles à l’oeuvre jurisprudentielle de la Cour africaine, surtout lorsque celle-ci s’immisce dans les affaires politiques ou sensibles. À cet égard, la difficile exécution de ses arrêts par les États est illustrative du malaise qui se vit au sein du système africain des droits de l'homme[49]. On observe à cet effet une méfiance structurelle des États africains à l’égard des organes de garantie des droits de l’homme, ces derniers se trouvant généralement sous une pression étatique continue et agressive[50]. En témoignent, les réactions des États aux ordonnances fixant les mesures provisoires dans les affaires Sébatien Ajavon c. Bénin du 17 avril 2020[51] et Guillaume Soro et autres c. Côte d’Ivoire du 20 avril 2020[52]. Demeurée audacieuse dans sa mission, la Cour a tout simplement vu les deux États précités lui tourner le dos à travers le retrait de la déclaration de compétence. Bien plus et désapprouvant ouvertement les deux ordonnances de la Cour africaine, le Bénin et la Côte d’Ivoire ne les ont aucunement respectées[53]. Cette situation conforte la prédiction du juge Fatsah Ouguergouz, lequel voyait dans la Cour africaine « un futur sans avenir » :
La Cour est […] une graine pleine de promesses, qui pourrait donner naissance à un arbre solide et fécond. La latérite dans laquelle cette graine a été plantée est toutefois en friche. Il est à mon avis vain d’arroser cette belle graine si on ne laboure pas et ne fertilise pas en même temps le sol par un renforcement de la culture démocratique et judiciaire dans les États du continent[54].
Éprouvant des difficultés à s’imposer dans ce contexte de démocratie non consolidée, les juges africains ont estimé utile de s’appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l’homme pour légitimer l’existence de certains droits que la Cour se doit de protéger du fait même de leur consécration sur le plan international. Cette pratique est calquée sur celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, lorsqu’elle n’avait pas encore réussi à imposer aux États la légitimité de son existence ; elle a pris le soin d’inscrire l’interprétation de la Convention régionale des droits de l’homme dans le droit international général[55]. À l’instar des Amériques, la Déclaration universelle des droits de l’homme a joué le rôle de référence universelle pour légitimer le système africain de protection des droits de l’homme. Les parties ayant bien compris cette nécessité, elles invoquent très souvent la Déclaration universelle des droits de l’homme pour justifier l’importance du droit dont la violation est alléguée. Parfois, les justiciables invoquent la violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme sans même viser une disposition particulière[56]. Ainsi, la Cour, les États, les individus comme la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont pris l’habitude de faire l’examen de la violation des droits de l’homme tant par rapport à la Charte africaine que par rapport à la Déclaration universelle des droits de l’homme[57].
Deuxièmement, la Cour africaine a utilisé la Déclaration universelle des droits de l’homme comme source directe de la consécration des droits. L’exemple typique est le droit à la nationalité dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo c République-Unie de Tanzanie précitée. Pareille solution semble être empruntée à la Commission africaine. En effet, cette dernière a l’habitude de recourir aux instruments juridiques universels dans l’hypothèse où la Charte africaine serait muette sur un droit dont la violation est alléguée. Dans l’affaire Media Rights Agenda c Nigéria, la Commission africaine a recouru au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, après avoir constaté que « [n]i la Charte africaine, ni la Résolution de la Commission relative au droit de recours à la procédure et à un procès équitable ne contiennent de disposition spécifique sur le droit au procès public »[58].
À l’évidence, si l’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme par la Cour africaine aux fins de légitimation de sa jurisprudence est justifiée, tout le contraire est la consécration de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme source directe des droits. Une idée générale doit être mise en évidence ici : les droits de l’homme sont d’abord des textes juridiques. Ces divers droits (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, etc.) sont contenus dans des « catalogues » : déclarations, conventions, pactes internationaux. Leur justiciabilité est fonction du caractère contraignant du texte qui les codifie. Cet état de choses est d’autant plus justifié que les droits de l’homme sont construits sur une dimension juridique, c’est-à-dire qu’ils reposent sur la théorie du contrat. C’est alors le caractère obligatoire des droits de l’homme qui doit être souligné, car il s’agit d’un impératif que la société internationale se donne. Impératif pour lequel la même société prévoit des sanctions, des modalités de contrôle et d’éventuelles punitions. À ce sujet, madame Véronique Champeil souligne pertinemment que la garantie des droits et libertés est liée à leur « positivation », c’est-à-dire à leur intégration dans les sources textuelles. En conséquence, pour fonder et limiter les pouvoirs de l’État, les droits et libertés doivent devenir des normes juridiques contraignantes, faute de quoi ils ne sont pas opposables aux administrations[59]. Faute de cette architecture, le droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et non repris par un autre instrument juridique contraignant ne saurait être opposable à un État. Le professeur Sudre conforte nos propos lorsqu’il écrit que la DUDH étant un texte déclaratoire, elle ne crée pas d’obligations envers les États ni de droits directement invocables par les individus[60].
Certes, les droits de l’homme sont nés avec l’homme, déduits de sa nature, tirés de son essence, consubstantiels en quelque sorte à son existence ; ils existent indépendamment des États[61]. Mais les droits de l’homme ne deviennent effectifs que du fait d’une place nouvelle et plus importante dans l’ordre juridique positif. En effet, la consécration des droits de l’homme dans les traités internationaux contribue à leur renforcement en leur donnant une portée juridique, et donc plus de force au sein des États parties à ce traité. Ces droits n’ont de sens que lorsqu’ils acquièrent un contenu politique, les faisant passer des droits de l’homme à l’état de la nature aux droits de l’homme en société. Ce ne sont pas seulement des droits de l’homme opposés aux droits divins ou aux droits des animaux ; ce sont des droits qu’ont les hommes, les uns par rapport aux autres et ils exigent la participation active de leurs détenteurs. En ce sens, Hannah Arendt estime que les droits de l’homme ne sont réellement protégés que tant qu’ils sont également les droits des citoyens d’un État donné. En conséquence, le premier droit de l’homme est « le droit d’avoir les droits », c’est-à-dire l’appartenance à une communauté politique donnée[62]. D’ailleurs, le combat en faveur des droits de l’homme a pour finalité la positivisation de ces droits en vue de leur protection juridique. C’est donc à tort que la Cour africaine a sanctionné la violation d’un droit consacré par la DUDH sans pour autant l’être par la Charte africaine, encore moins par un autre traité relatif aux droits de l’homme. Au demeurant, cette oeuvre jurisprudentielle s’analyse en termes de neutralisation de la spécificité africaine des droits de l’homme.
B. Vers une neutralisation de la spécificité du système africain des droits de l’homme ?
En appliquant la DUDH en tant que source directe des droits subjectifs, la Cour africaine court le risque de diluer le contenu matériel de la Charte africaine en sanctionnant la violation d’un droit que les États africains n’ont pas considéré comme fondamental au regard des spécificités propres au continent. En effet, en adoptant la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples plusieurs années après la DUDH et les deux pactes internationaux, le but était de créer un document qui s’inspirât des traditions et des principes moraux de l’Afrique. L’inspiration première de la Charte africaine fut de se démarquer de l’approche individualiste des droits de l’homme telle que consacrée par la DUDH. Abordant à sa manière la problématique de l’universalisme et du particularisme des droits de l’homme, la Charte africaine affirme les spécificités du continent en exaltant certaines valeurs qu’elle revendique comme reflétant ses préoccupations fondamentales en matière des droits de l’homme. Ces valeurs traditionnelles sont celles de la famille, de la solidarité, du devoir envers les personnes et la communauté, auxquelles il convient d’ajouter une valeur idéologique fondée sur la notion de peuple et qui constituent le vecteur du combat de la décolonisation et du développement[63]. Par rapport au système universel, la Charte africaine est animée à la fois de la volonté de complémentarité et de la nécessité de démarcation. Tout en tenant compte du principe de l’universalisme des droits de l’homme, la Charte africaine présente des particularités en raison des réalités spécifiques aux peuples africains. Ses rédacteurs ont pris le soin d’en faire un document original en l’adaptant à son environnement social, politique et économique. Il est habituel de dire de la Charte africaine qu’elle constitue un texte original en ce qu’elle décline une conception spécifiquement africaine des droits de l’homme. Sur le plan des droits proclamés, elle consacre autant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits de la troisième génération (droits à un environnement sain, au développement, à la paix et la sécurité). Ensuite, aux droits individuels, elle ajoute les droits collectifs (droits des peuples) et les devoirs de l’individu[64]. Cela est d’autant plus justifié que l’adoption de la Charte africaine s’inscrivait dans une logique purement régionale, s’écartant, tant soit peu, de la lettre et de l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le panafricanisme avait opté pour la consécration des solutions principalement régionales pour la garantie des droits sur le continent. Autrement dit, il fallait un document spécifique au continent, qui soit l’émanation de sa vision de l’humain et qui tienne compte de la « philosophie africaine des droits de l’homme »[65]. En constitue une preuve l’option de la création de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en tant que mécanisme de contrôle de la Charte africaine. Les rédacteurs de la Charte africaine ont délibérément refusé de créer une « Cour », mais plutôt une institution dont la spécificité est inspirée de « l’arbre à palabre »[66]. Cependant, l’idée d’une Cour africaine a refait surface au vu de l’inefficacité de la Commission due notamment au manque d’impérium judiciaire de l’organe, à la nature déclaratoire de ses constatations et au caractère non contraignant de ses décisions[67]. À ce sujet, le préambule du Protocole de Ouagadougou instituant la Cour africaine est clair : cette juridiction vient « compléter et renforcer la Commission ». À son tour, l’article 2 du même texte dispose que « [l]a Cour […] complète les fonctions de protection que la Charte africaine a confiées à la Commission ». Cette option juridictionnelle ne constitue-t-elle pas une neutralisation du mécanisme de l’arbre à palabre, véritable spécificité du droit africain ?
Si l’on doit admettre que la création d’une Cour chargée de la sanction juridictionnelle des violations des droits de l’homme au niveau régional africain est un événement qui ne marque guère l’abandon de la spécificité africaine que sa rectification[68], il n’en est pas ainsi de l’élan jurisprudentiel de cette Cour. Cette dernière manque à sa mission lorsqu’elle sanctionne la violation d’un droit non protégé par la Charte africaine, mais uniquement énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. En faisant primer les instruments juridiques universels et plus spécifiquement la DUDH sur la Charte africaine, la Cour africaine méconnaît la particularité même du système régional des droits de l’homme. Ce faisant, elle fait prévaloir l’esprit individualiste des droits de l’homme auquel la Charte a entendu remédier. Ici trouve toute sa place la raison de la condamnation des droits de l’homme par Karl Marx : ces droits se présenteraient comme « des droits de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté » et feraient de l’homme « une monade isolée et repliée sur elle-même »[69]. De ce point de vue, les droits de l’homme, « figure de l’horizon politico-culturel de la modernité », désigneraient le sujet occidental dont les droits ont été élevés à la fiction de catégorie universelle[70]. Pour pallier cette partialité culturelle, les États africains ont procédé à une réappropriation des droits de l’homme à travers la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Cette dernière présente une originalité à un double point de vue. Premièrement, « elle confère une place particulière aux droits collectifs dans une démarche complexe d’accommodation du personnalisme et du collectivisme »[71]. En effet et contrairement à la DUDH, le régime de droit qui découle de la Charte africaine vise non seulement à protéger la personne contre certains abus du pouvoir étatique, mais aussi et surtout à assurer fermement le pouvoir contre toute velléité de résistance des individus ou des groupes. Deuxièmement, la Charte africaine consacre un chapitre entier aux devoirs de l’individu, ce qui est une des caractéristiques de la conception africaine des droits de l’homme qui trouve son fondement dans la nature des modes d’organisation sociale de l’Afrique traditionnelle. Ceux-ci reposaient sur une structure communautaire, excluaient tout individualisme exacerbé et plaçaient la personne humaine au centre de tout un faisceau de droits et d’obligations[72]. Il en découle qu’inversement à la DUDH, où le sens de la société est l’épanouissement de la personne, pour la Charte africaine, la personne est tout entière orientée vers la société. Finalement donc, la DUDH entend promouvoir avant tout l’homme universel en maximisant la personne humaine et en minimisant le politique, alors que la Charte africaine défend avant tout la société qu’elle considère comme sujet et source du droit[73]. Il en résulte que la Charte africaine affiche nettement sa spécificité par rapport aux autres instruments universels de droits de l’homme, dont la DUDH. Ses rédacteurs avaient levé l’option de l’« enraciner dans la culture africaine la plus profonde et de la mettre au service des grandes causes africaines qu’étaient hier la décolonisation et l’apartheid et aujourd’hui la lutte pour le développement »[74]. À cet égard, le préambule de la Charte africaine est explicite : il inscrit le fondement philosophique des droits de l’homme dans les valeurs de la civilisation africaine. Ce choix du référentiel culturel de la Charte africaine est clairement affirmé au cinquième paragraphe du préambule : la conception des droits de l’homme en Afrique doit être inspirée et caractérisée par les « traditions historiques » et les « valeurs de la civilisation africaine »[75].
En conséquence, la réception du standard extra-africain, c’est-à-dire universel et européen, ne va pas sans poser problème au regard des spécificités africaines. Les organes africains de protection des droits de l’homme doivent s’écarter de la tentative d’importer un standard étranger aux États africains sans s’assurer de la convergence des conditions sociologiques, au risque de manquer à leur mission de régulation du concret des sociétés africaines[76]. Il en sera autrement si ce standard est codifié dans un instrument international ratifié par l’État africain, auquel cas il s’applique sans difficulté particulière. Cette crainte est fondée au regard notamment du conflit des approches des droits de l’homme par les différentes cours régionales. Alors que la Cour de Strasbourg véhicule une approche universaliste des droits de l’homme, la Cour d’Arusha se doit d’adopter une approche régionale centrée sur l’identité africaine des droits de l’homme. Il n’est donc pas important de reprendre ce qui a été fait au sein des autres systèmes régionaux ni au niveau universel[77]. Cela est d’autant plus évident que l’Afrique présente un certain nombre de particularités et de défis qui lui sont propres. Bien plus, un système de protection des droits de l’homme est, avant tout, un élément identitaire[78]. En ce sens, l’affirmation d’une authenticité normative africaine est d’autant plus présente que le Conseil exécutif de l’Union africaine a demandé à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de retirer le statut d’observateur que celle-ci avait accordé à la Coalition des lesbiennes africaines, en raison de sa non-conformité avec « les valeurs, l’identité et les bonnes traditions fondamentales de l’Afrique »[79].
Pour mieux cerner le risque de dilution de la spécificité du droit africain des droits de l’homme par la Cour africaine, il est important de faire une brève étude comparative de l’articulation entre le régional et l’universel dans la jurisprudence des autres cours régionales. La démarche de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est tout à fait contraire à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme s’analyse en un élément d’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme dont le préambule dispose que celle-ci a pour objet d’« assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ». En conséquence, la Cour européenne des droits de l’homme utilise également la Déclaration universelle des droits de l’homme : « La jurisprudence de la Cour de Strasbourg se situe dans le prolongement de l’esprit même de la Déclaration universelle » et il s’est établi « un lien textuel et matériel, entre la Cour et la Déclaration universelle »[80]. Mais cet usage est limité : la Cour européenne considère que la Déclaration universelle des droits de l’homme ne lui permet pas de se référer à des droits qui ne figurent pas dans la Convention européenne des droits de l’homme. Elle écarte les griefs lorsqu’ils portent sur des droits non-inscrits dans la Convention européenne des droits de l’homme. En témoigne l’affaire Glasenapp du 28 août 1986. Dans cette cause, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit d’accès à la fonction publique n’est pas protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, en dépit de sa consécration par l’article 21(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour européenne a considéré que si on avait omis cette disposition dans la Convention européenne, c’était donc pour des raisons précises. Il ne s’agit pas d’une lacune fortuite et, par conséquent, la Cour ne saurait la combler par une interprétation évolutive de la Convention européenne[81]. Dans une autre affaire, la Cour européenne des droits de l’homme relève que, contrairement à l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme ne contient pas le droit à la dissolution du mariage par le divorce. Elle en déduit qu’elle ne saurait reconnaitre ce droit d’autant plus qu’il n’a pas été garanti par la Convention européenne des droits de l’homme[82]. En définitive, il est permis de conclure que la Cour européenne est animée d’une ferme volonté d’élaborer un ordre juridique autonome. Cela se manifeste par une forte autonomie du contentieux de protection des droits de l’homme par rapport aux règles du contentieux international général. Le juge européen opère peu de renvois extérieurs, le texte et la jurisprudence européenne étant autoréférentiels.
En revanche, la démarche de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est calquée sur celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme au point que l’on a été porté à la considérer comme « une “Cour interaméricaine-bis” pour l’Afrique[83]». La Cour interaméricaine fait une interprétation large de la Convention interaméricaine des droits de l’homme. Elle s’appuie non seulement sur des instruments juridiques de portée universelle, conventionnelle ou simplement déclaratoire, mais aussi sur la jurisprudence d’autres juridictions et quasi-juridictions de droits de l’homme. La Cour de San José perçoit la Déclaration universelle des droits de l’homme comme la véritable source du système international de protection des droits de l’homme et le point de départ du processus juridique d’« humanisation du droit international » [84]. Elle estime que la protection de la dignité humaine est la fin du droit, philosophie dont est issue la Déclaration universelle des droits de l’homme. En ayant proclamé internationalement pour la première fois l’universalité des droits qui découle de la dignité de la personne humaine, la DUDH est ainsi la principale source matérielle de tout droit protégé, et donc des normes qu’une cour régionale dégage d’une convention régionale[85]. En octroyant une universalité certaine aux droits de l’homme, la Cour interaméricaine va plus loin : elle juge que la nature même du concept de « dignité humaine » s’oppose à toute distinction entre régionalisme et universalisme. Si régionalisme il y a, ce n’est que pour faire admettre aux États de la région leurs obligations universelles[86].
Néanmoins et contrairement à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, l’importance de la DUDH au sein du système interaméricain des droits de l’homme est relative. Les références répétées à la DUDH sont une référence à l’universalisme bien plus qu’à un catalogue des droits. Conservant son autonomie, la Cour interaméricaine des droits de l’homme considère que la définition concrète des droits et leur autonomie doivent être régionales[87]. À titre illustratif, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a, dans son cinquième avis, refusé de reconnaitre le droit à la liberté de ne pas s’associer, pourtant consacré par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, faute de sa garantie par la Convention américaine[88]. Il faut en déduire que l’ouverture de la Cour interaméricaine des droits de l’homme à de multiples référents extérieurs a pour objectif principal d’interpréter à la fois le contenu et la portée des droits garantis par la Convention américaine. Plus concrètement, il s’agit pour la juridiction de San José de procéder à la définition des notions « indéfinies », à la découverte de nouvelles « catégories » au sein d’un droit, à l’identification de la portée d’un droit par la considération de certains contextes spécifiques au continent latino-américain[89].
***
Les articles 3 et 7 du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples autorisent cette dernière à interpréter et à appliquer, outre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». Partant, la Cour applique la Déclaration universelle des droits de l’homme, tant pour asseoir la légitimité universelle des droits en cause que pour créer de nouveaux droits non prévus par aucun traité international. Cette dernière hypothèse ne va pas sans poser problème au regard des spécificités du système africain des droits de l’homme. Ce faisant, la Cour risque de dissoudre dans l’universel les spécificités du système régional des droits de l’homme à la base de sa création[90]. L’audace de la Cour couplée à un exercice trop zélé des possibilités offertes par les articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou risque de conduire à une atténuation du contenu matériel de la Charte africaine. Il serait judicieux pour la Cour d’exercer une « tropicalisation » nécessaire, bien entendu en adéquation avec le principe de l’universalité des droits de l’homme. Ainsi, « la Charte doit demeurer, dans sa conception, dans sa formulation et dans son application, le noyau et la principale source des juges » et la Cour africaine doit faire produire à son droit substantiel naturel les effets que le contexte géographique ou sociologique recommande[91]. Il y a lieu de saluer ici la décision de la Commission africaine relative à la place des droits collectifs environnementaux, économiques et sociaux en Afrique : « le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l’homme doivent répondre aux circonstances africaines »[92].
Certes, les articles 3 et 7 du Protocole relatif à la Cour africaine permettent à cette dernière de mobiliser des instruments juridiques extérieurs au continent, sans toutefois lui autoriser de les appliquer en tant que tels. Ces dispositions ont mis en place « une démarche d’ouverture contrôlée et sélective, une logique d'interprétation syncrétique de la Charte, avec une variable directrice, l'africanité, et une variable correctrice, l'universalité »[93]. En définitive, le recours aux autres instruments internationaux par la Cour africaine ayant une base conventionnelle,
les principes contenus dans ces instruments sont « applicables », non pas directement aux cas soumis à l’organe de contrôle, mais à l’effort d’interprétation des textes auquel se livre ce dernier en vue du règlement d'un litige. […] C’est le devoir de s’inspirer, en tant que prescription méthodologique conventionnelle, qui est le « principe applicable » et non les dispositions immédiates des textes dont on s’inspire[94].
Appendices
Notes
-
[1]
La Charte des Nations Unies a conféré à la protection générale des droits de l’homme un statut formel en tant que partie du droit international. Non seulement la Charte de San Francisco internationalise les droits de l’homme qui cessent de relever du domaine réservé des États, mais elle en fait un des principes de base du nouvel ordre public international : Emmanuel Decaux, « Les Nations unies et les droits de l’homme : 60 ans après… » (2009) 7 Cahiers de recherche en droits fondamentaux aux pp 33-34; Thomas Fleiner-Gerster, Théorie générale de l’État, Paris, PUF, 1986 aux pp 90-91; Olivier De Schutter, International Human Rights Law : Cases, Materials, Commentary, New York, Cambridge University Press, 2010 aux pp 12-17; Elvira Domínguez-Redondo, « Role of the UN in the Promotion and Protection of Human Rights » dans Azizur Rahman Chowdhury et Jahid Hossain Bhuiyan, dir, An Introduction to International Human Rights Law, Boston, Leidein, 2010, 119 aux pp 121-41.
-
[2]
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217 au préambule (entrée en vigueur : 27 octobre 1986) [Charte africaine].
-
[3]
Ibid, art 60. À sa suite, l’article 61 dispose : « La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine ». Il s’en infère que le champ d’application de cet instrument régional est large d’autant plus qu’il se compose non seulement des traditions, des pratiques et des valeurs africaines, mais également des principes fondamentaux de droit international, qui en constituent le cadre juridique, et des règles spécifiques qui sont complémentaires de celles qui s'inscrivent dans cet ensemble. On peut ainsi dire que la Charte africaine ne circonscrit pas la compétence d'interprétation de la Commission africaine aux seules dispositions de la Charte, mais lui donne un rôle de dimension universelle : Comparer Hamid Boukrif, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Un organe judiciaire au service des droits de l'homme et des peuples en Afrique » (1998) 10:1 African J Intl & Comparative L aux pp 79-81.
-
[4]
Voir à ce sujet Makau wa Mutua, « The Banjul Charter and the african cultural fingerprint : An evaluation of the language of duties » (1995) 35 Va J Intl L 339 aux pp 359-64; Obinna Okere, « The protection of human rights in Africa and the African Charter on Human and Peoples' Rights : A Comparative Analysis with the European and American systems » (1984) 6:2 Hum Rts Q 141; Josiah A. M. Cobbah, « African Values and the Human Rights Debate : An African Perspective » (1987) 9:3 Hum Rts Q 309; Gino J. Naldi, « The African Union and the Regional Human Rights System » dans Malcolm Evans et Rachel Murray, dir, The African Charter on Human and Peoples’ Rights. The System in Practice 1986–2006, 2e éd, New York, Cambridge University Press, 2008, 20 aux pp 24-25.
-
[5]
Illa Maikassoua, La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Un organe de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013 à la p 14; Markus Löffelmann, « Protection of Human Rights in Theory and Reality: the Case of the African Court on Human and Peoples' Rights » (2010) 85:1-2 Die Friedens-Warte 161. Sur la reconstitution de la genèse de la Cour africaine, voir Marielle Debos, « La création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multicentrée » (2005) 60:Hiver Cultures & Conflits 159; Gina Bekker, « The African Court on Human and Peoples' Rights : Safeguarding the Interests of African States » (2007) 51:1 J Afr L 159.
-
[6]
Protocole de Ouagadougou relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 9 juin 1998, art 3(1) (entrée en vigueur : 25 janvier 2004) [Protocole de Ouagadougou].
-
[7]
Fatsah Ouguergouz, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : Gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale » (2006) 52 Ann fr DH 213 à la p 227; Makau wa Mutua, « The African Human Rights Court : A Two-legged Stool? » (1999) 21 Hum Rts Q 342 à la p 354.
-
[8]
Protocole de Ouagadougou, supra note 6, art 7.
-
[9]
Maurice Kamto, « Article 7 du Protocole relatif à la Charte africaine » dans Maurice Kamto, dir, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme : Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011, 1296 aux pp 1296-98.
-
[10]
Jean-Louis Atangana Amougou, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l’homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » (2003) 3 Droits fondamentaux 175 à la p 176.
-
[11]
Frank David Omary et al c République-Unie de Tanzanie, 001/2012 (28 mars 2014) au para 72 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples). Cette position a été réitérée dans l’arrêt Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo et Baise Ilboudo et Mouvement burkinabé pour la défense des droits des peuples c Burkina Faso, 013/2001 (5 juin 2015) (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples) [Zongo et al c Burkina Faso]. La Cour y déplore le fait que les requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, des dispositions de la Charte africaine, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui n’est pas un traité.
-
[12]
Frank David Omary et al c République-Unie de Tanzanie, supra note 11 au para 73.
-
[13]
Thomas Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya Mango c République-Unie de Tanzanie, 005/2015 (11 mai 2018) au para 33 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples).
-
[14]
L’opinion majoritaire des États signataires de la DUDH était conforme à l’idée que la Déclaration n’avait aucune force obligatoire. Madame Roosevelt, par exemple, a opiné que la Déclaration serait la Magna Carta mondiale des droits de l’homme, mais qu’elle n’était pas un traité et par conséquent, ne lierait pas les États juridiquement. Voir à ce sujet John P. Humphrey, « La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme » (1981) 12:2 RGD 397 à la p 398; Hurst Hannun, « Final Report on the status of the universal Declaration of human rights, in national and international law », Rapport de la 66e Conférence, présentée par The International Law Association à Bueno Aires, 14 au 20 août 1994 à la p 537.
-
[15]
Pour une analyse approfondie des développements doctrinaux sur cette question, voir Marc Gambaraza, Le statut de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Une aventure juridique, Paris, Pedone, 2016 aux pp 111-31; Theodor Meron, Human rights and humanitarian norms as customary law, Oxford, Clarendon Press, 1989 aux pp 79 et s; Louis Henkin, The age of rights, New York, Columbia University Press, 1990 à la p 19; Jochen von Bernstorff, « The Changing Fortunes of the Universal Declaration of Human Rights : Genesis and Symbolic Dimensions of the Turn to Rights in International Law » (2008) 19:5 Eur J Intl L 903 à la p 913; Hurst Hannum, « The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law » (1995) 25 Ga J Intl & Comp L 287 aux pp 323-24.
-
[16]
John P. Humphrey, « History, Impact and Juridical Character of the Universal Declaration of Human Rights » dans Bertrand G. Ramcharan, dir, Human Rights : Thirty years after the Universal Declaration, The Hague, Martinus Nijhoh, 1975, 21; Grégory Corroyer et Valérie Susana, « Communicabilité des droits de l’homme : la Déclaration universelle et sa mise en texte » (2010) 4 Argumentation et Analyse du Discours à la p 2.
-
[17]
Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d'Amérique c Iran), [1980] CIJ Rec 3 au para 91.
-
[18]
Barcelona Traction, Light and Power, Limited (Belgique c Espagne), [1970] CIJ Rec 3 aux pp 32-33; Gilbert Guillaume, « La Cour internationale de justice et les droits de l’homme » (2001) 1 Droits fondamentaux 23 aux pp 27 et s. Sur cet intérêt juridique qu’ont les États de voir les droits de l’homme être protégés, voir Amparo San José Gil, « La responsabilité internationale des États pour les violations des droits de l’homme » dans Mélanges Karel Vasak, dir, Les droits de l’homme à l’aube du XXIe siècle, Bruxelles, Bruylant, 1999, 783; Kobina Egyir Daniel, « A Jus cogens human rights exception to head of state immunity : fact, fiction or wishful thinking? » dans Dire Tladi, dir, Peremptory norms of general international law (Jus cogens) : Disquisitions and disputations, Nijhoff, 2021, 740.
-
[19]
Ochieng Anudo c République-Unie de Tanzanie, 012/2015 (22 mars 2018) au para 76 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples). Pour une étude critique de cet arrêt, voir Patient Mpunga Biayi, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples scie la branche sur laquelle elle est assise : quelques observations à propos de l’arrêt Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie du 22 mars 2018 » (2022) 20 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [à paraître].
-
[20]
Protocole de Ouagadougou, supra note 6, art 3(1).
-
[21]
Frans Viljoen, « A Human Rights Court for Africa, and Africans » (2004) 30:1 Brook J Intl L 1 à la p 44.
-
[22]
Alex Thomas c République-Unie de Tanzanie, 005/2013 (20 novembre 2015) aux para 45-47 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples); Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c Kenya, 012/2015 (26 mai 2017) aux para 51-52 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples); Chrizant John c République-Unie de Tanzanie, 049/2016, Ordonnance portant mesures provisoires (18 novembre 2016) au para 10 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples).
-
[23]
Wilfred Onyango Nganyi et al c République-Unie de Tanzanie, 006/2013 (18 mars 2016) au para 58 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples); Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c République-Unie de Tanzanie, 003/2015 (28 septembre 2017) au para 36 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples); Peter Chacha c République-Unie de Tanzanie, 003/2012 (28 mars 2014) aux para 114-124 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples); Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 007/2013 (3 juin 2016) (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples). Cette position est similaire à celle adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui ne se préoccupe que de savoir s’il est suffisamment prouvé qu’une violation a eu lieu, sans qu’il soit obligatoire que le plaignant mentionne les dispositions spécifiques de la Charte africaine qui ont été violées : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 47e sess ordinaire, Southern Africa Human Rights NGO Network et al c Tanzanie, 28e rapport d'activité, Communication 333/06 (2010).
-
[24]
Efoua Mbozo’o Samuel c Parlement panafricain, 002/2012 (30 septembre 2011) au para 6 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples).
-
[25]
Thomas Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya Mango c République-Unie de Tanzanie, supra note 13 aux para 34-35. En revanche, la pratique de la Cour africaine révèle que cette dernière admet l’application des autres instruments internationaux des droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention américaine des droits de l’homme et la Charte arabe des droits de l’homme, dans l’interprétation de la Charte africaine. Sur l’invocation d’autres traités pour interpréter les droits de la Charte africaine, voir Jamil Ddamulira Mujuzi, « The African Court on Human and Peoples’ Rights and Its Protection of the Right to a Fair Trial » (2017) 16:2 L & Practice Intl Courts & Tribunals 187 aux pp 191-97.
-
[26]
Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c Tanzanie, 009/2011 (14 juin 2013) (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples) et Révérend Christopher R. Mtikila c Tanzanie, 011/2011 (14 juin 2013) (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples), juge Ougergouz, dissidente.
-
[27]
Ibid au para 107.3. Sur les critiques formulées contre cet arrêt, lire utilement Alain Didier Olinga, «La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » (2014) 6:5 La Revue des droits de l’homme 1 aux pp 1-24.
-
[28]
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 29e sess ordinaire, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c Nigeria, Affaire 218/98 (2001) au para 29.
-
[29]
Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c République de Côte d’Ivoire, 001/2014 (18 novembre 2016) (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples).
-
[30]
Frank David Omary et al c République-Unie de Tanzanie, supra note 11 au para 73.
-
[31]
Navanethem Pillay, « Les droits de l’homme sont-ils universels ? » (2008) 45:3 Chronique ONU 4 à la p 5.
-
[32]
Jessica Lawrence, Les droits de l’homme, recueil de cours, Institut de formation aux opérations de paix, University for Peace, 2014 à la p 28.
-
[33]
On fait référence derrière cette expression de « droit de regard » à un contrôle extérieur qui sera organisé pour permettre de dire si oui ou non les conventions internationales et autres normes relatives aux droits de l’homme sont bien respectées. Tel est le droit de regard qui sera organisé à travers des commissions, des comités internationaux, des conseils ou autres organismes. C’est également le rôle de l’opinion publique internationale organisée à travers des organisations non gouvernementales que d’exercer ce droit de regard. Bien plus, le droit de regard de la communauté internationale implique également la sanction des violations des droits de l’homme, ce qui a débouché notamment sur la justice pénale internationale. En ce sens, l’obligation du respect des droits de l’homme constitue un frein à l’oppression que pourraient subir les êtres humains. Les violations des droits de l’homme constituant une atteinte à la conscience de l’humanité, c’est à la communauté internationale, extérieure et supérieure au jeu des intérêts et des passions locaux, qu’incombe la tâche de leur répression. De la même manière que l’État possède naturellement le pouvoir d’établir et d’appliquer des peines à ceux de ses citoyens qui sont criminels, le monde le possède aussi à l’égard de ceux qui sont nuisibles et malfaisants envers le genre humain, étant donné que l’univers entier représente en quelque sorte une seule communauté politique. Henri Donnedieu De Vabres, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international » (1947) 70 Rec des Cours Académie de droit international à la p 521; Jean Graven, « Les crimes contre l’humanité » (1950) 76 Rec des Cours Académie de droit international aux pp 439-41; Mario Bettati, Le droit d’ingérence : Mutation de l’ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996 aux pp 35-37.
-
[34]
Frédéric Sudre, « La dimension internationale et européenne des libertés et des droits fondamentaux », dans Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche et Thierry Revet, dir, Libertés et droits fondamentaux, 9e éd, Paris, Dalloz, 2003, 29 à la p 30.
-
[35]
Jean-Manuel Larralde, « Lorsque René Cassin commentait la Déclaration universelle des droits de l’homme : A propos du Cours publié dans Recueil des cours de l’Académie de droit international de 1951 » (2009) 7 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 23 aux pp 24-25; Danièle Lochak, Les droits de l’homme, Paris, La découverte, 2018 aux pp 44-54.
-
[36]
Paul Tavernier, « L’ONU et l’affirmation de l’universalité des droits de l’homme » (1997) 31 R trimestrielle droits homme 379 à la p 386.
-
[37]
En doctrine, la Déclaration universelle des droits de l’homme a fait l’objet de vives critiques et l’universalité des droits de l’homme a été farouchement récusée. Certains y ont vu un « outil politique » voué à l’échec par le fait de ne pas tenir compte des différences culturelles entre les nations : « dès sa naissance, la Déclaration universelle des droits de l’homme a échoué dans son entreprise : l’universalisme de compromis est un enfant mort-né ». D’autres font valoir que le concept de droits de l’homme est « une notion exogène aux sociétés d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient », que « c'est sous la pression des pays occidentaux qu’il s'impose à elles »; Gilles Lebreton, « Critique de la DUDH » (2009) 7 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 17 à la p 19; Dany Rondeau, « La relation des droits aux devoirs : approche interculturelle » (2008) 1 Aspects 141 à la p 149; Norbet Roulan, Aux conflits du droit : anthropologie juridique de la modernité, Paris, Odile Jacob, 1991 aux pp 199 et s; Geneviève Médevielle, « La difficile question de l’universalité des droits de l’homme » (2008) 107:3 Transversalités 69 à la p 70.
-
[38]
Frank David Omary et al c République-Unie de Tanzanie, supra note 11 au para 73.
-
[39]
Emmanuel Decaux, « Brève histoire de la Déclaration universelle des droits de l’homme » (2018) 116 R trimestrielle droits homme 837 à la p 837.
-
[40]
Emmanuel Decaux, « De la promotion à la protection des droits de l’homme : droit déclaratoire et droit programmatoire », dans Société française pour le droit international, La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, 81 à la p 83; Marie Rota, « La Déclaration universelle des droits de l’homme : source des droits garantis par la Convention américaine relative aux droits de l’homme » (2009) 7 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 63 à la p 64; Sarah Hanffou Nana, La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Étude à la lumière de l’expérience européenne, Paris, Connaissances et Savoirs, 2016 aux pp 72-74; Henri Wembolua Otshudi, Déclaration universelle des droits de l’homme et Charte de Banjul : Appropriation des instruments africains de promotion des droits de l’homme, Paris, L’Harmattan, 2019 à la p 27.
-
[41]
Voir Jean-Louis Atangana Amougou, « Conditionnalité juridique des aides et respect des droits fondamentaux » (2001) 2 Afrilex 1.
-
[42]
« Les premières tentatives de démocratisation en Afrique avaient été accueillies dans l’enthousiasme général. Compte tenu de l’émergence de l’autoritarisme sur le continent, la démocratisation a été présentée comme une seconde indépendance des peuples, après celle des États dans les années soixante. Elle était perçue à la fois comme une réponse aux défis de la gouvernance et un moyen d’assurer le respect des droits civils et politiques, de mettre fin aux pratiques néopatrimoniales et de pacifier la compétition pour le pouvoir » : Mamadou Gazibo, Introduction à la politique africaine, Montréal, Presses Universitaires, 2010 à la p 214. Sur le caractère sublime de cette vague de démocratisation en Afrique et les espoirs suscités chez les peuples, voir Fabien Eboussi Boulaga, Les Conférences nationales en Afrique noire, Paris, Karthala, 1993 à la p 9; Gérard Conac, « Les processus de démocratisation en Afrique » dans Gérard Conac, dir, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, 11 aux pp 19-41.
-
[43]
Alpha Amadou Sy, L’espace politique de l’Afrique francophone en question : vint cinq ans après le Sommet de La Baule, Dakar, L’Harmattan, 2017 aux pp 13-14; Keutcha Tchapnga, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États francophones d’Afrique noire » (2005) 63:3 Rev fr dr constl 451 à la p 473.
-
[44]
En doctrine, il y a une inflation de termes pour tenter de caractériser ces démocraties fragiles en Afrique : autoritarisme électoral, démocratie autoritaire, régimes semi-autoritaires, semi-démocratiques, démocraties en survie, hybrides, etc. Ces habillages démocratiques s’accompagnent des travers désormais bien connus : campagnes électorales truquées, forte marchandisation du vote, liberté de presse rarement garantie, recours à la torture, à l’intimidation et à l’élimination physique des leaders d’opposition. Cette nouvelle forme de « démocratie à l’africaine » est généralement qualifiée de « démocrature » ou « démocratisme », car elle revêt les apparences d’une démocratie qui n’existe que de façade, tout en recourant aux artifices de la dictature pour neutraliser les conflits politiques ou sociaux : Patient Mpunga Biayi, La protection des droits de l’homme en République démocratique du Congo : Quelle effectivité?, Paris, L’Harmattan, 2021 à la p 46; Laurent Fouchard, « Résiliences et ruptures en Afrique » (2006) 2 Transcontinentales 1 aux pp 4-5; Patrick Quantin, « La démocratie en Afrique à la recherche d’un modèle » (2009) 129:2 Pouvoirs 65 à la p 65; Pierre Nzinzi, « La démocratie en Afrique : L’ascendant Platonien » (2000) 77:1 Politique africaine 72 aux pp 72-73; Victor Magnani et Thierry Vircoulon, « Vers un retour de l’autoritarisme en Afrique? » (2019) 2 Politique étrangère 11.
-
[45]
Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2e éd, Paris, A. Pédone, 2002 à la p 79. Il n’est pas rare d’entendre les chefs d’État africains banaliser les droits de l’homme en les considérant comme le cheval de Troie du néocolonialisme et une question accessoire aux priorités socio-économiques. Monsieur Christophe Lutundula relève à ce propos qu’en Afrique, la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux est loin de compter parmi les missions essentielles de l’État. L’on y estime qu’on ne peut permettre à des personnes retranchées derrière des droits individuels égoïstes de freiner et compliquer la tâche de l’État dont les moyens sont déjà insuffisants : Christophe Apala Pen' Apala Lutundula, « Des engagements et devoirs de l’État en matière de protection des droits de l’homme » (1998) 328 Congo-Afrique 453; Seydou Madani Sy, « L'expérience africaine » (2005) 28:3 C de D 675 aux pp 678-79; Philippe Ardant, « Les problèmes posés par les droits fondamentaux dans les pays en voie de développement » dans Louis Favoreu, dir, Droit constitutionnel et droits de l’homme, Paris, Economica, 1987, 107 à la p 119.
-
[46]
Parmi ces mesures, on peut noter celles adressées au gouvernement mauritanien : ordonner l’ouverture d’une enquête indépendante afin de clarifier le sort des personnes disparues, d’identifier et de traduire en justice les auteurs des violations, de prendre des mesures diligentes en vue de la restitution des droits des victimes mauritaniennes : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 27e sess ordinaire, Malawi African Association et al c Mauritanie, 13e rapport d'activité, Communication 61/91 (2000). Des mesures similaires ont également été recommandées au Burkina Faso : d’identifier et de poursuivre en justice les responsables des violations des droits de l’homme et de procéder à l’indemnisation des victimes : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 29e sess ordinaire, Affaire Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c Burkina Faso, 14e rapport d'activité, Communication 204/97 (2001). Pour plus de détails, voir Frans Viljoen et Lirette Louw, « The Status of the findings of the African Commission: From moral persuasion to legal obligation » (2004) 48:1 J Afr L 1.
-
[47]
Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l’homme » (2017) 11 La Revue des droits de l’homme 1 à la p 1.
-
[48]
D’une part, on observe un déphasage entre l’engouement étatique pour la ratification de la Charte africaine et la retenue à l’égard du Protocole créant l’institution judiciaire de protection des droits contenus dans cette même Charte. D’autre part, « la subordination de l’accès direct de l’individu à cette Cour au consentement déclaré de l’État relève d’un anachronisme qui traduit manifestement l’infortune du recours individuel direct devant le prétoire africain des droits de l’homme » : Abdou-Khadre Diop, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou le miroir stendhalien du système africain de protection des droits de l’homme » (2014) 55:2 C de D 529 aux pp 544-51; Sakré Kéké, « L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à l’épreuve de la souveraineté des États » (2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 154 aux pp 158-61; Rostand Banzeu, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à l’épreuve de la clause facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire d’une juridiction internationale par l’État en droit international » dans Makane M. Mbengue et Catherine Maia, dir, Tribunaux régionaux et développement du droit international, Paris, A. Pedone, 2019, 93; Carole Valérie Nouazi Kemkeng, « La déclaration de l’article 34 (6) du Protocole de Ouagadougou dans le système africain des droits de l’homme : entre régressions continentales et progressions régionales » (2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 179 aux pp 181-83; Manisuli Ssenyonjo, « Direct Access to the African Court on Human and Peoples’ Rights by Individuals and Non Governmental Organisations : An Overview of the Emerging Jurisprudence of the African Court 2008-2012 » (2013) 2:1 Intl Human Rights L Rev 17.
-
[49]
Voir à ce sujet Benjamin Kagina, « Le mécanisme de suivi des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : entre tâtonnement et nécessité de s’affirmer » (2021) 19 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 127; Judicaël Elisée Tiehi, « L´exécution minimaliste de l´arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire “Actions pour la protection des droits de l´homme (APDH) c. République de Côte d´Ivoire” : much ado about nothing ? » (2020) 18 R des D de l’homme, en ligne: <http://journals.openedition.org/revdh/9978>.
-
[50]
Laurence Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours régionales des droits de l’homme in context. La justice qui n’allait pas de soi, Paris, A. Pedone, 2020 à la p 458.
-
[51]
Par cette ordonnance, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Bénin et a ordonné le sursis à la tenue des élections du 17 mai 2020 jusqu’à l’adoption d’une décision sur le fond.
-
[52]
Par cette ordonnance, la Cour africaine a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Côte d’Ivoire et a ordonné la suspension de l’exécution du mandat d’arrêt contre les requérants (dont Guillaume Soro) jusqu’à l’adoption d’une décision sur le fond. Véritable pomme de discorde, cette ordonnance – et l'arrêt qui l'a suivie – a eu une implication négative pour la Cour en ce sens que la Côte d'Ivoire a purement et simplement retiré sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples; Koffi Kouame et Elisée Judicaël Tiehi, « Le Civexit ou le retrait par la Côte d’Ivoire de sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : un pas en avant, deux pas en arrière », (2022) 21 R des D de l'homme, en ligne: <http://journals.openedition.org/revdh/13985>.
-
[53]
Pour une analyse détaillée de ces ordonnances, voir Samson Mwim Sôg Mè Dabire, « Les ordonnances de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en indication de mesures provisoires dans les affaires Sébastien Ajavon c. Bénin et Guillaume Soro et autres c. Côte d’Ivoire : Souplesse ou aventure ? » (2020) 4 Annuaire africain des droits de l’homme 476.
-
[54]
Fatsah Ougergouz, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Un futur sans avenir ? » dans Joël Andriantsimbazovina, Laurence Burgorgue-Larsen et Sébastien Touzé, dir, La protection des droits de l’homme par les Cours supranationales, Paris, A. Pedone, 2016, 239 à la p 244. Dans le même sens, Stéphane Doumbé-Billé, « La juridictionnalisation des droits de l'homme en Afrique : much ado about nothing ? », dans Jean-François Akandji-Kombé, dir, L'homme dans la société internationale : mélanges en hommage au professeur Paul Tavernier, Bruxelles, Buylant, 2013 aux pp 693-706. Cet état de choses pousse parfois la Cour africaine à faire preuve d’un rigoureux formalisme pour éviter des questions considérées comme sensibles. Ainsi, « [l]e juge supranational montre de fait une attention particulière à la réaction des États à ses décisions et sait infléchir sa démarche pour éviter une collusion trop frontale avec les États » : Apollin Koagne Zouapet, « Le champ opératoire de l’activisme judiciaire supranational en Afrique. Une tentative de systématisation » (2020) 28 African J Intl & Comparative L 23 aux pp 33-34; Voir également Apollin Koagne Zouapet, « Une si évidente décision…une Cour bien confuse : Quelques observations sur l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en l’affaire Femi Falana c. Union africaine (affaire n° 001/2011) », août 2012 [non publié, en ligne : Academia <www.academia.edu/37443328/Une_si_%C3%A9vidente_d%C3%A9cision_une_Cour_bien_confuse_Quelques_observations_sur_l_arr%C3%AAt_de_la_Cour_africaine_des_Droits_de_l_Homme_et_des_Peuples_en_l_affaire_Femi_Falana_c_Union_Africaine>.
-
[55]
Hélène Tigoudja, « L’autonomie du droit applicable par la Cour interaméricaine des droits de l’homme : en marge d’arrêts et avis consultatifs récents » (2002) 49 R trimestrielle droits homme 69 à la p 76.
-
[56]
Frank David Omary et al c République-Unie de Tanzanie, supra note 11 au para 20.
-
[57]
Dans l’arrêt Zongo et al c Burkina Faso, supra note 11 du 28 mars 2014, la Cour africaine examine l’allégation de violation du droit à ce que sa cause soit entendue par les juridictions nationales compétentes successivement par rapport à l’article 7 de la Charte africaine, aux articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par rapport à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
-
[58]
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Media Rights Agenda c Nigéria, Communication 224/98 (2000) aux para 51 et 66; Civil liberties organization, Legal Defence Center, Legal defence and assistance Project c Nigeria, supra note 28.
-
[59]
Véronique Champeil-Desplats, « La théorie générale de l’État est aussi une théorie des libertés fondamentales » (2012) 8 Jus Politicum 1 aux pp 5-6.
-
[60]
Frederic Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 8e éd, Paris, PUF, 2006 à la p 173.
-
[61]
En ce sens, les droits de l’homme « n'ont pas été posés, ou constitués, par des hommes. Ils ont été déclarés par eux, et cette déclaration, toute de transparence, signifie qu'ils servent à fonder les autres droits; eux-mêmes n'ont pas besoin d'être fondés, puisqu'ils sont ce fondement » : François Vallançon, « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle » dans Jacques-Yvan Morin, dir, Les droits fondamentaux, Actes des 1ères Journées scientifiques du Réseau droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1997, 137 à la p 137.
-
[62]
Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme : Eichmann à Jérusalem par Pierre Bouretz, traduit par Martine Leibovici et al, Paris, Gallimard, 2002 à la p 600 ; Hannah Arendt, Impérialisme, Paris, Fayard, 1982 à la p 281; Roger Koussetogue Koudé, « L’État : une condition sine qua non pour la réalisation des droits de l’homme » (2016) 10 Études interculturelles 121 aux pp 125 et s.
-
[63]
Maurice Kamto, « Charte africaine, Instruments internationaux de protection des droits de l’homme, Constitutions nationales : Articulations et perspectives » dans Jean-François Flauss et Elisabeth Lambert-Abdelgawad, dir, L’application nationale de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, 11 aux pp 11-13.
-
[64]
Habib Ghérari, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : entre espoirs et incertitudes » dans Gilles Lebreton, dir, Valeurs républicaines et droits fondamentaux de la personne humaine, Paris, L’Harmattan, 2006, 171 à la p 172; Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993 à la p 16; Alioune Badara Fall, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme » (2009) 129:2 Pouvoirs 77 aux pp 84-87.
-
[65]
Souleymane Bachir Diagne, « Philosophie africaine et Charte africaine des droits de l'homme et des peuples » (2011) 8-9 :771-772 Critique 664 à la p 667; Roger M. Koudé, « Peut-on, à bon droit, parler d’une conception africaine des droits de l’homme? » (2005) 62 R trimestrielle droits homme 539 aux pp 544 et s.
-
[66]
Voir à ce propos Keba Mbaye, « Rapport introductif sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » dans Commission Internationale des Juristes, dir, Droits de l’homme et des peuples en Afrique et la Charte africaine, Genève, Commission Internationale des Juristes, 1986 aux pp 28-29; Mutoy Mubiala, « La contribution des États africains à la renaissance de la Cour internationale de justice » (1994) 2:1 Annuaire africain de droit international 173 aux pp 174-75; Alain Didier Olinga, « L'Afrique face à la “globalisation” des techniques de protection des droits fondamentaux » (1999) 159:1 Présence africaine 27 à la p 38.
-
[67]
Makau Wa Mutua, « The African Human Rights System in Comparative Perspectives » (1993) 3 Rev African Commission on Human & Peoples Rights 5 à la p 11; Olivier Delas et Eugène Ntaganda, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Mécanisme efficace de protection des droits de l’homme? » (1999) 12:2 RQDI 99 à la p 106; Dandi Gnamou-Petaution, « Les mécanismes régionaux africains de protection des droits de l’homme » dans Paul Tavernier, dir, Regards croisés sur les droits de l’homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, 255 à la p 259.
-
[68]
De l’avis de monsieur Sitsofé Kowouvih, « [l]a spécificité africaine à laquelle est systématiquement rattachée l’institution de l’arbre à palabre n’est pas exclusive de toute sanction de nature contraignante et juridictionnelle. Ainsi, l’institution d’une Cour africaine ne saurait constituer en elle-même une négation de la spécificité africaine, bien au contraire, elle apporte une solution adaptée à la nature des droits en question ». L’auteur renchérit qu’il y aurait lieu de se plaindre de l’institution si elle était devenue l’élément principal du régime de protection des droits de l’homme en Afrique. Or, dans l’état actuel des textes, la Cour, dans sa fonction juridictionnelle, se présente comme un accessoire de la Commission : Sitsofé Kowouvih, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Une rectification institutionnelle du concept de “spécificité africaine” en matière des droits de l’homme » (2004) 59 R trimestrielle droits homme 757 aux pp 765-66. Voir également Koagne Zouapet, « Les institutions judiciaires du système africain de promotion et de protection des droits de l’homme » dans Alain D. Olinga, dir, La protection internationale des droits de l’homme en Afrique dynamique. Enjeux et perspectives trente ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Yaoundé, Éditions Clé, 2012, 115 aux pp 115–17.
-
[69]
Karl Marx, La question juive, 1ère éd, Paris, Editions La Fabrique, 2006 à la p 55. Karl Marx s’est attaché à dévoiler le mythe des droits de l’homme bourgeois. Pour lui, ces supposés droits universels de l’individu abstrait promouvraient en réalité les intérêts de l’individu possessif du capitalisme. Il en conclut que la revendication des droits de l’homme n’exprime qu’une volonté d’asseoir l’intérêt personnel des individus face à la société. Autrement dit, les droits de l’homme transforment les intérêts de la bourgeoisie en principes naturels de l’humanité et à ce titre, ils ne feraient qu’exprimer le souhait des entrepreneurs d’être libres de toute restriction et de toute responsabilité sociale : Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, traduit par François Chatelet, Paris, Bordas, 1986 à la p 19.
-
[70]
Marcelo Raffin, « Pour une généalogie de la question des droits de l'homme » (2008) 1 Aspects 133 aux pp 135-36.
-
[71]
Magali Lafourcade, Les droits de l’homme, Paris, PUF, 2018 à la p 43; Paul-Gérard Pougoué, « Lecture de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » dans Dénis Maugenest et Paul-Gérard Pougoué, dir, Droits de l’homme en Afrique centrale - Colloque régional de Yaoundé (9-11 novembre 1994), Paris-Yaoundé, Karthala-Presses de l’UCAC, 1996, 31 aux pp 36-38.
-
[72]
Ougergouz, supra note 54 à la p 233; Etienne R-Mbaya, « Symétrie entre les droits et devoirs dans la Charte africaine des droits de l’homme » dans Patrice Meyer-Bisch, dir, Les devoirs de l’homme : de la réciprocité dans les droits de l’homme, Fribourg, Éditions Universitaires, 1989, 35 aux pp 42-43; Pierre Sob, « Le principe de l’universalité des droits de l’homme : mythes et limites » (1996) 8:1 R Africaine Dr Intl & Comparé 89 à la p 98.
-
[73]
Sur les rapports entre l’homme et la société dans une perspective comparée entre la DUDH et la Charte africaine, voir Jean-Marie Van Parys, Dignité et droits de l’homme : Recherches en Afrique, Louvain-La-Neuve, Noraf, 1989 aux pp 21-29, 91-103; Raymond Verdier, « Problématique des droits de l’homme dans les droits traditionnels d’Afrique noire » (1983) 5 Dr & cultures 97 à la p 97.
-
[74]
Maurice Kamto, « Préambule » dans Kamto, supra note 9 à la p 65.
-
[75]
Le cinquième paragraphe du préambule de la Charte africaine dispose : « Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ».
-
[76]
Alain Didier Olinga, « Les emprunts normatifs de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples aux systèmes européen et interaméricain de garantie des droits de l’homme », (2005) 62 R Trimestrielle Droits Homme 499 aux pp 530-31. L’auteur écrit qu’« alors qu’il était attendu l’émergence et le développement d’un système africain de protection internationale des droits de l’homme, l’on se retrouve progressivement avec une simple protection internationale des droits de l’homme sur le continent africain, caractérisée du reste par une logique d’extraversion » : Ibid à la p 536.
-
[77]
Patrick Badugue, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans le Forum permanent des Cours régionales des droits de l’homme » (2020) 4 Annuaire africain des droits de l’homme 43 aux pp 46-49 ; Philip Kunig, Wolfgang Benedek et Costa Mahalu, Regional Protection of Human Rights by International Law : The Emerging African System, Baden-Baden, Nomos, 1985 à la p 107.
-
[78]
Abdou-Khadre Diop, « L’influence de la jurisprudence européenne sur le système africain de protection des droits de l’homme » (2020) Hors-série RQDI 593 à la p 610.
-
[79]
Demande d’avis consultatif introduite par le Centre des droits de l’homme de l’Université de Prétoria (CHR) et la Coalition des lesbiennes africaines, 002/2015 (28 septembre 2017) au para 5 (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples).
-
[80]
Paul Tavernier, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l’Homme » (1999) 5 Cahiers du CREDHO à la p 12.
-
[81]
Glasenapp c Allemagne (1986), 104 Cour Eur DH (Sér A) 1 au para 48, 29 Am Conv Eur DH 172; Kosiek c Allemagne, n° 9704/82, Arrêt (28 août 1986) au para 34 (Cour européenne des droits de l'homme). Pour plus de commentaires sur ces arrêts, voir Vincent Coussirat-Coustère, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en 1986 » (1987) 33 AFDI 239 aux pp 251-52.
-
[82]
Johnston et al c Irlande (1986), 112 CEDH (Sér A) 1 au para 52; Paul Tavernier, « La Déclaration universelle des droits de l’Homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme » dans Patrick De Fontbressin et al, Les droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, 859 à la p 869.
-
[83]
Fabienne Quillere-Majzoub, « L’option juridictionnelle de la protection des droits de l’homme en Afrique : Étude comparée autour de la création de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » (2000) 44 R trimestrielle droits homme 729 à la p 739.
-
[84]
Ludovic Hennebel, « L’“humanisation” du droit international des droits de l’homme : Commentaire sur l’Avis consultatif n°18 de la Cour interaméricaine relatif aux droits des travailleurs migrants » (2004) 59 R trimestrielle droits homme 747; Hélène Tigroudja, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de l’humanisation du droit international public : Propos autour des récents arrêts et avis » (2006) 52 AFDI 617; Antonio Cancado Trindade, « Une ère d’avancées jurisprudentielles et institutionnelles : Souvenirs de la Cour interaméricaine des droits de l’homme » dans Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja, dir, Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, 7.
-
[85]
Rota, supra note 40 à la p 70.
-
[86]
Les « autres traités » objets de la fonction consultative de la Cour (art. 64 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme) (1982), Avis consultatif OC-1/82, Inter-Am Ct HR (sér A) n°1, cité par Laurence Burgorgue-Larsen et Amaya Ubeda de Torres, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2008 aux pp 87-115.
-
[87]
Rota, supra note 40 à la p 70.
-
[88]
Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and American Convention on Human Rights) (1985), Avis consultatif OC-5/85, Inter-Am Ct HR (sér A) n°5 au para 64. Dans les mêmes circonstances, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit le droit négatif d’association, « suivant laquelle nul ne peut être forcé à s'associer », de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme quand bien même la Convention européenne ne le mentionne pas : Young, James et Webster c Royaume-Uni (1981), 44 CEDH (Sér A) 1 au para 52, 4 EHRR 38.
-
[89]
Laurence Burgorgue-Larsen, « Les méthodes d’interprétation de la Cour interaméricaine des droits de l’homme » (2014) 97 R trimestrielle droits homme 31 aux pp 48-51.
-
[90]
Au nombre des spécificités codifiées à l’africaine, l’on pourrait citer la primauté de la société sur l’individu. En effet, la manière dont la Charte africaine présente les devoirs des personnes vis-à-vis des peuples et des États montre que les droits de l’homme ne sont pas compris dans le même sens que dans la DUDH. Dans la DUDH, c’est la dignité humaine qui justifie les droits de l’homme, ce qui conduit à soumettre l’ordre politique au service des personnes. En revanche, ce qui justifie les droits de l’homme dans la Charte africaine, c’est la nécessité de les intégrer à l’État. Cette codification constitue un emprunt à la philosophie africaine, laquelle met moins l’accent sur l’individu et davantage sur la collectivité et ne permet pas que l’individu puisse avoir des exigences qui auraient préséance sur celles de la société. Par conséquent, le préambule de la Charte africaine affirme clairement que ce sont « la réalité et le respect des droits du peuple » qui « doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ». Voir à ce sujet Claude Ake, « The African Context of Human Rights » (1987) 34:1-2 Africa Today 5; Valère Eteka Yemet, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, L’Harmattan, 2000 aux pp 181 et s; Ahmed Sékou Touré, L’Afrique et la révolution, Paris, Présence africaine, 1967 aux pp 97-105.
-
[91]
Kowouvih, supra note 68 aux pp 776-78. Une partie de la doctrine préfère même que la Cour procède à une interprétation réductrice des dispositions des articles 3 et 7 du Protocole, autrement dit, que l’expression « tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme » ne fasse référence qu’aux instruments africains de droits de l’homme : Mutoy Mubiala, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? » (1988) 102:3 RGDIP 765 à la p 772.
-
[92]
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Social and economic rights action, Centre for economic and social rights c Nigeria, Communication 155/96 (2001).
-
[93]
Alain Didier Olinga, « La famille en droit international africain des droits de l’homme » dans Jean-Yves Morin, dir, Les défis des droits fondamentaux, Actes des deuxièmes journées scientifiques du Réseau droits fondamentaux de l'Agence Universitaire de la Francophonie tenues à Québec, 29 septembre au 2 octobre 1999, Bruxelles, Bruylant, 2000, 153 à la p 158.
-
[94]
Olinga, ibid à la p 156.