Abstracts
Résumé
Étudier les esthétiques de la citation permet de mettre en lumière différents types d’appropriations de ce procédé, par ailleurs fort ancien, et de distinguer précisément, à partir d’un point de convergence, trois moments des cinquante dernières années, que l’on peut définir par la modernité, la postmodernité et l’hypermodernité et dont les oeuvres évoquées ici forment d’excellents parangons. La citation chez Stockhausen obéit aux logiques propres à la modernité des années 1950-1960 : exploration acoustique, prospection théorique et compositionnelle, âpreté du rendu sonore, fusion organisée entre les différentes citations ainsi qu’entre chaque matériau emprunté et son environnement. Avec Schnittke, la fusion se transforme en forte hétérogénéité, propre au temps postmoderne, en juxtaposition des styles, en exaltation des contrastes sur fond de résurgences tonales-modales particulièrement explicites. Dans l’oeuvre de Campo, la citation se veut objet ludique, léger, plaisant voire comique, tout en s’imprégnant d’une recherche subtile sur les modes de jeu ou sur la polymétrie, attributs plutôt portés par l’avant-garde des décennies antérieures. Ainsi que le constate Bouscant avec l’exemple de Michel Gonneville et Ofer Pelz (Bouscant 2015), la pratique citationnelle montre un désir « de dépassement, de renouvellement du matériau historique », quelle que soit la prégnance de l’emprunt. Elle agit également comme un révélateur particulièrement puissant des grandes lignes régissant les esthétiques de la musique contemporaine.
Abstract
Studying the aesthetics of musical quotation permits light to be shed on different types of appropriations using this process, which has been occurring throughout musical history, and to precisely distinguish, from a single convergence point, three moments in the last 50 years, that modernity, postmodernity and hypermodernity can be defined, and whose works studied here are excellent examples. Stockhausen’s quotations follow the logic of modernity from 1950 to 1960: acoustic exploration, theoretic and compositional prospecting, harshness of the sonic reproduction, and organized fusion between different quotations as well as between the borrowed material and its musical environment. With Schnittke, the fusion transforms into strong heterogeneity, particular to postmodernism, with a juxtaposition of styles, and highlighting the particularly explicit contrast between the tonal-modal resurgences. In Campo’s work, the quotations are intended to be playful, light, and even pleasant to the point of being comical, while being immersed in a subtle research on the playing modes or on polymetry, attributes that are usually favoured by avant-garde artists of recent decades. As noted by Bouscant with the example of Michel Gonneville and Ofer Pelz (Bouscant 2015), the use of quotation shows a desire to “surpass and renew historic material,” no matter how significant the borrowing is. It also acts as a particularly powerful method to reveal the main tendencies that govern the aesthetics of contemporary music.
Article body
Depuis la fin des années 1960, le recours à la citation est un temps devenu un antidote à la crise d’invention et à la saturation des styles et des genres que connut l’avant-garde (Lyotard 1988). Confinant au grotesque comme au tragique, au véhément comme au badin, au cynique comme à l’absurde, l’emploi de la citation renverrait celle-ci à son statut d’« objet trouvé », selon le mot de Pierre Boulez et conditionnerait le sens de l’oeuvre à sa seule faculté de reconnaissance par le public (Boulez 2005, 190). Or, c’est avant tout grâce aux processus de transformation entrepris par le compositeur que la citation nous semble tirer sa signification profonde.
La musique peut déployer quantité de procédés d’altération citationnelle : déformations mélodico-rythmiques, surmodelage, collage, déconstruction, interpolation, etc. Ceux-ci exercent sur les implications esthétiques de l’oeuvre nouvelle une influence probablement supérieure au choix des modèles lui-même. L’altération trahit ainsi l’interprétation personnelle du compositeur et son rapport intime à l’Histoire, révélant également les interactions entre l’oeuvre et la société qui l’entoure. De la confrontation tragique des modèles à la déconstruction ludique, de la caricature grimaçante à la révélation sublimée de leur structure, de nombreuses catégories de la sémantique musicale peuvent être identifiées. Le créateur peut avoir également choisi de rendre ces emprunts totalement ou partiellement méconnaissables, à l’instar des centaines de fragments indétectables de Gruppen de Karlheinz Stockhausen dans Souvenir (1967) de Franco Donatoni ; dans ce cas, le matériau nouveau ne comporterait de traces de son état antérieur que sous forme de scories ténues, parfois purement conceptuelles. D’après Boulez, seule cette métamorphose intégrale aurait quelque chose de véritablement innovant :
Je ne crois pas que la référence puisse jamais mener très loin, car elle implique souvent, sinon toujours, un attachement suspect au passé, et l’invention ne peut que radicalement transformer la référence, au point de la rendre méconnaissable, voire inutile. [...] Les objets dont on se sert ont perdu leur sens profond sans acquérir pour autant autre chose qu’une vertu vainement décorative
Boulez 2005, 192[1]
Depuis le milieu du xxe siècle, l’histoire des musiques à citation(s) montre une large prévalence des morceaux connus du public : la Marche militaire de Schubert dans Circus Polka (1942) d’Igor Stravinsky, l’Ouverture de Guillaume Tell dans la Symphonie no 15 (1971) de Dmitri Chostakovitch, le sujet fugué de la Flûte enchantée dans le Quatuor à cordes no 2 (2006) de Régis Campo, le panel d’hymnes nationaux sélectionnés par Stockhausen dans Hymnen (1967), le Scherzo de la Symphonie no 2 « Résurrection » de Gustav Mahler comme toile de fond au troisième mouvement de la Sinfonia (1968) de Luciano Berio, des fragments beethovéniens dans Ludwig van (1969) de Mauricio Kagel, le premier prélude du Clavier bien tempéré de Bach — objet déjà « altéré » dans l’Ave Maria de Charles Gounod — dans le Credo (1968) d’Arvo Pärt, les souvenirs de Rameau, Schumann, Stravinsky, Offenbach, etc. dans le Grand Macabre (1977) de György Ligeti (Delaplace 2007, 171-172). En miroir à la variété des oeuvres mentionnées ci-dessus, la diversité des contenus et de leurs transformations est à notre avis affectée par trois courants des 50 dernières années : la modernité, la postmodernité et l’hypermodernité. Au sein de chacun d’entre eux, se sont développées des pratiques diverses de la citation dont les procédés et les choix d’agencement permettent de confondre l’esthétique qu’elles véhiculent.
Nous proposons une analyse comparée de trois oeuvres composées autour d’une ou plusieurs citations et dont le rapport qu’entretient le matériau à leur égard symbolise, de notre point de vue, trois esthétiques de la citation qui se sont succédé — et parfois chevauchées — au cours des 40 dernières années : de la transformation électroacoustique du timbre dans Hymnen de Stockhausen jusqu’à la déconstruction ludique dans le Quatuor à cordes no 2 de Régis Campo, en passant par le collage anachronique du Quatuor à cordes no 3 (1984) d’Alfred Schnittke.
Trois esthétiques de la citation
Bien que l’usage délibéré de la citation remonte aux plus anciens temps de notre art[2], il est désormais acquis qu’une tendance notable, chez les compositeurs de la fin des années 1960 jusqu’aux années 2000, s’attache « à reprendre, varier, transformer, manipuler [...] les oeuvres d’un passé proche ou lointain » (Escal 1984, 181), tandis que les musiques des décennies précédentes avaient plutôt connu un reflux des poétiques citationnelles assumées. Le rattachement de ce courant à une forme originelle de la postmodernité musicale, autrefois établie sans distinction, fait aujourd’hui débat. En 1977, le critique d’architecture Charles Jencks affirme que la citation représente « la plus puissante figure postmoderne » ; dix années plus tard, Lyotard voit dans la postmodernité « une sorte de bricolage » dont attesterait « la fréquence élevée de citations d’éléments des périodes ou styles antérieurs » (cité dans Jencks 1985, 6). Béatrice Ramaut-Chevassus poursuit cette réflexion dans la musique des années 1970-1980, au cours desquelles « l’évocation du passé, la citation d’éléments empruntés à celui-ci se font de manière ouverte, non hiérarchisée, non orientée linéairement » (Ramaut-Chevassus 1998, 12). En 2001, Daniel Charles soutient lui aussi l’idée selon laquelle « la postmodernité, pensée de la coprésence temporelle, autorise la libre rencontre des styles » (Charles 2001, 49). Ainsi que le déclarait prosaïquement Berio, ce nouvel appétit pour « se salir les mains de cette histoire [de la musique] » (cité dans Stoïanova 1985, 394) résonne comme une inflexion sensible dans le progressisme porté par le projet moderne.
Ce parangon a été incarné avec une constance remarquable par Schnittke, dont le style polystylistique — terme qu’il a lui-même forgé — tendait à « exprimer l’idée philosophique de continuité » (Schnittke 1998, 133), embrassant la diversité des styles par la juxtaposition d’emprunts à l’histoire de la musique. Souhaitant entrechoquer passé et présent dans une même oeuvre, le compositeur multiplie les hommages croisés, les citations claires, les collages et les stylisations de toutes sortes, leur opposant quelques techniques d’écriture contemporaines, proches parfois des clusters glissés hérités de l’école polonaise ou des litanies archaïsantes des pays baltes.
Cette acception de la postmodernité se voit néanmoins entièrement remise en cause par les récents travaux de Jacques Amblard, qui postule la modernité résolue et fondamentale de certains compositeurs (Berio notamment) dont les oeuvres auraient été hâtivement rangées sous cette étiquette commode, par homologie avec les arts visuels (Amblard 2013, 1388-1390). Selon lui, la postmodernité incarne avant tout un « retour à l’innocence » (Amblard 2013, 1391) et à la sobriété, définissant la musique « friande de complaisantes et commodes lenteurs mineures » (Amblard 2013, 1409) de l’Europe orientale et nordique, ou, au contraire, les minimalismes pulsés de certains Anglo-saxons. L’altération d’une citation clairement identifiée induit au contraire une distance vis-à-vis du modèle, celui-ci étant alors considéré comme un matériau parmi d’autres, support d’une exploration créatrice qui serait le propre des modernes. Il existe donc des démarches d’altération citationnelle indissociables des principaux procédés compositionnels mis en oeuvre par les compositeurs de l’avant-garde qui perpétuent l’esthétique de la complexité, même lorsque semblent s’éroder d’autres marqueurs comme l’atonalité, l’exploration sonore, l’éclatement des lignes mélodiques, l’absence de rythmes pulsés, etc. L’assemblage de citations dans les compositions après les années 1980 pourrait bien avoir cédé du terrain face au retour à une tradition qui favorise une forme d’éclectisme détendu, que la société d’aujourd’hui érigerait en vertu. L’hétérogénéité brute et décomplexée s’est estompée au profit d’un style plus allusif, plus stylisé, dont des compositeurs comme Thierry Escaich et Philippe Hersant en France, Einojuhani Rautavaara et Arvo Pärt en Europe du Nord, John Adams et Philip Glass aux États-Unis, Krzysztof Penderecki en Pologne seraient quelques-uns des nombreux représentants. Selon Luc Ferry, « rien n’est a priori frappé d’illégitimité, tous les styles, toutes les époques bénéficient du “droit à la différence” » (Ferry 1990, 317). Plus récemment Frederic Jameson y voit une situation nouvelle du « pastiche, pratique neutre de l’imitation, de la mimique, sans aucune des arrière-pensées de la parodie » (Jameson 2007, 57), la stylisation plus ou moins dépourvue de sens critique y remplacerait la citation et son regard oblique sur l’histoire.
Une autre théorie pourrait expliquer la permanence d’éléments issus de citations, traité avec cette « ironie vide » dont parle Jameson. Définie par Gilles Lipovetsky comme une surenchère de certains traits de la modernité et de la postmodernité, l’hypermodernité, propre à nos sociétés contemporaines, recouvre quatre aspects principaux : esthétisation du capitalisme mondialisé, développement de l’hédonisme via la consommation de masse de loisirs et de services, autonomisation accrue de l’individu, multiplication des phobies sociales (Lipovetsky 2004, 32-33). Cultivant l’équivoque entre art et divertissement, les temps hypermodernes seraient aussi ceux d’une « nostalgie joyeuse », qui n’a récusé du projet moderne que sa dimension téléologique :
La fièvre consumériste des satisfactions immédiates, les aspirations ludico-hédonistes n’ont certes nullement disparu, elles se déchaînent plus que jamais, mais enveloppées d’un halo de peurs et d’inquiétudes. L’insouciance optimiste qui accompagnait les Trente Glorieuses et le cycle de libération des corps font figure de souvenir du passé : l’hypermodernité désigne moins la focalisation sur l’instant que sa régression liée à un futur devenu incertain et précaire
Lipovetsky 2004, 102
Les stigmates de l’hypermodernité se retrouvent dans les musiques qui envisagent une médiation renforcée avec des éléments rythmiques ou timbriques issus des musiques populaires modernes, des musiques à l’image et des produits de l’actuelle industrie de la culture ; elles adoptent, le plus souvent par dérision, leurs sentiments positifs, une forme d’entrain, des atmosphères non conflictuelles, festives et joyeuses, transgressant l’expression de la tragédie et l’exigence rigoureuse que défendaient l’avant-garde et une partie de la postmodernité. La poétique de la citation est donc plurielle, variant moins selon les modèles choisis que selon le traitement qui leur est infligé. Que la citation absorbe toute l’oeuvre ou qu’elle ne représente qu’une pastille fugace, un clin d’oeil ludique, modifie profondément l’esthétique et la sémantique de la création.
La citation moderne : l’exemple de Hymnen de Stockhausen
L’un des premiers compositeurs résolument d’avant-garde à traiter la citation, en particulier la citation multiple, est probablement Stockhausen, qui composa de 1966 à 1967 Hymnen, une vaste fresque de deux heures pour bande magnétique et instruments ad libitum[3], compilant une quarantaine d’hymnes nationaux, de cris d’animaux, de bruits de foule et de discours. Passées au crible de multiples transformations électroacoustiques, ces citations sont tantôt à peine reconnaissables, tantôt exposées sans altération, avec toute la palette intermédiaire de voilage sonore. Ce jeu de cache-cache avec la perception est capital pour le compositeur, qui a choisi ses hymnes en raison de leur grande popularité :
Les hymnes nationaux sont la musique la plus connue que l’on puisse imaginer. Chacun connaît l’hymne de son pays et peut-être encore quelques autres, du moins leur début. Si on intègre de la musique connue dans une composition de musique nouvelle, inconnue, alors on peut fort bien entendre comment elle a été intégrée : non transformée, plus ou moins transformée, transposée, modulée, etc.
Stockhausen 1971, 98
L’époque de composition coïncide par ailleurs avec la première retransmission internationale des Jeux olympiques, d’abord de manière restreinte en 1960 et plus largement en 1964, ce qui a permis de diffuser auprès d’un public toujours plus nombreux les hymnes des pays vainqueurs des épreuves. La prise en compte de la perception de l’auditeur à travers son vécu musical et culturel révèle d’une préoccupation nouvelle, de la part d’un compositeur dont les oeuvres de la décennie précédente, en particulier Kontra-Punkte (1953), Zeitmasze (1956), Kontakte (1960), Gruppen (1957), ainsi que les premiers Klavierstücke (1952-1955), cultivent une certaine ascèse, dénotent un goût pour l’expurgation de toute référence au passé. Dans Hymnen, l’important travail de création sonore autour de la citation, dont le compositeur tient à rappeler avec insistance qu’il ne s’agit pas d’un collage (Stockhausen 1971, 98), participe d’un changement de paradigme, qui pour autant n’obère en rien l’intensité créatrice.
Par ailleurs, l’assemblage et la succession des hymnes confèrent un sens éminemment politique à l’oeuvre. La première région juxtapose La Marseillaise à l’Internationale, singulièrement admise au rang d’hymne national. Morcelées et entrecoupées par des sons issus de chuchotements et oscillations d’émetteurs radio, ces deux citations couvrant une vaste plage temporelle fusionnent et se mélangent ; oserions-nous y voir une prophétie des éruptions sociales du futur printemps 1968 ? La deuxième section intègre l’hymne de la République fédérale d’Allemagne à plusieurs hymnes africains peu distincts et mixés avec le début de l’hymne soviétique ; c’est une incarnation remarquable de la revanche d’un « humanisme universel » (Wörner 1973, 141) sur la barbarie nazie, qui a rendu orphelin le petit Karlheinz au milieu de la guerre. Dans la troisième partie, les hymnes soviétiques et américains voisinent, avant une brève incursion de l’hymne espagnol ; il s’agit d’une allusion probable à la Guerre froide, en particulier à la récente crise de Cuba où les deux puissances se confrontèrent et menacèrent un temps le monde d’une nouvelle guerre. La dernière région mêle l’hymne suisse, symbole de la neutralité, à celui, imaginaire, d’un pays utopique, « le plus long et le plus poignant de tous » (Stockhausen 1971, 97). Cette fin idéalisée semble découler des aspirations mystiques et universalistes du compositeur, idéaux vers lesquels il tendra quelques années plus tard, dans Mantra. À son sujet, il déclare se « rapprocher d’un vieux rêve qui ne cessait de [le] hanter : aller plus loin, non en écrivant [sa] musique, mais une musique de la terre tout entière, de tous pays, de toutes races » (Stockhausen 1968, 46). S’il y a assez peu similitudes de matériau entre les deux oeuvres, tout porte à croire qu’Hymnen inaugure ce mouvement vers une musique de l’universel, offrant, d’après Ivanka Stoïanova, un équivalent électronique au Finale de la Symphonie no 9 de Beethoven (Stoïanova 2014, 101).
Stockhausen utilise des procédés de fusion et d’intermodulation permettant ainsi d’altérer progressivement le timbre en modulant en série certains paramètres d’un hymne avec un autre, puis du suivant avec les deux précédents. Technique abondamment reprise par la musique électronique et rapidement contrôlée par les logiciels de synthèse sonore apparus dans les années 1980, l’interpolation du timbre est l’exemple le plus probant à nos yeux de la persistance dans Hymnen de topiques liées à la modernité. Loin de se contenter de la simple juxtaposition ou superposition d’hymnes, qui auraient pu offrir des contrastes saisissants, mais imparfaits, le compositeur oriente son travail vers la création d’hybrides où le matériau se transforme en épousant une partie des morphologies sonores d’un autre. L’un des exemples les plus singuliers de ces multiples altérations intervient entre la première et la seconde section de l’oeuvre, lorsqu’un bref fragment de la Marseillaise, progressivement ralenti, se transforme petit à petit en cancanements de canards, jusqu’à sa dernière citation, ralentie huit fois et plus grave, qui développe le procédé déjà mis en oeuvre dans Kontakte (1960), à savoir le passage entre son, bruit, rythme et silence (Decarsin 2013, 1035). Si sa diffusion, particulièrement prégnante pour l’auditeur, contient probablement quelque ironie, sinon témoigne de quelque hétérogénéité subreptice, cette technique met avant tout en lumière la manière dont « le mouvement décrit le temps » (Decarsin 2011) et inscrit l’oeuvre dans une continuité organique, qui porte le sceau inaliénable de la modernité d’alors. De la même manière Deliège remarque le profond ascétisme de la démarche du compositeur, qui souhaite refuser à l’auditeur tout confort et toute séduction provenant de l’écoute de ces musiques familières : « au moment même où des traits d’hédonisme semblent s’offrir, Stockhausen indique qu’ils n’auront pas cours » (Deliège 2003, 456).
Il apparaît que l’usage de la citation multiple n’induit ici aucune exigence de dialogue avec l’Histoire ou de délégitimation de l’acte créateur, tel que la postmodernité, dans ses moments les moins inspirés, a pu parfois véhiculer. L’acte compositionnel, aux techniques fortement enracinées dans son époque, traite le matériau des hymnes comme n’importe quel objet sonore, thème, motif, ou séquence, qu’il s’agit d’altérer jusqu’à ce que l’auditeur puisse parfois en ignorer l’origine. Il en va de même dans le troisième mouvement de la Sinfonia de Berio, le pendant instrumental de Hymnen, où bon nombre des citations demeurent inaudibles, tandis que d’autres sont parfaitement reconnaissables. En postmoderne averti, Schnittke entend dans l’oeuvre de Berio « une mise en scène impressionnante et apocalyptique à propos de la responsabilité de notre génération quant à l’avenir de notre Terre, et ceci est représenté par un collage de citations, de témoignages musicaux de différentes époques » (Schnittke 1998, 134). Écologique, recyclant les matériaux des musiques du passé, ou bien de caractère populaire, et rappelant par le tourbillon qui en ressort la tragédie collective de leur existence, l’oeuvre-collage pourrait être envisagée de prime abord dans un reflux de l’innovation, pointant ses limites philosophiques. Mais les techniques de composition, éminemment modernes, entrent en friction avec cette interprétation, jusqu’à l’exclure, selon Deliège, « du cadre esthétique des oeuvres fondées sur la citation » (Deliège 2003, 458). Reconnaître son caractère citationnel occasionne un certain malaise chez les défenseurs du compositeur, et de l’avant-garde musicale en général, tant cette démarche paraît corrélée à un esprit rétrograde. Pourtant, on ne peut ignorer la forte sémantique des objets trouvés, issue surtout de leur association, auquel on peut trouver un sens très politique ; ces objets trouvés ne sont pas traités comme des matériaux neutralisés ou de simples signaux comme l’avancent certains auteurs (Maconie 1976, 217). Ne serait-ce qu’à travers l’âpreté de ses sonorités, Hymnen illustre enfin le parti-pris anti-hédoniste qui caractérise la modernité de l’après-guerre (Ferry 1990, 305) et dont Stockhausen, davantage encore que Berio, se démarque dans certaines oeuvres des années 1970, qui témoignent d’une simplicité mélodique et d’une orientation mystique éminemment postmoderne (In Freudenschaft, 1997 ; Tierkreis, 1975 ; Harlekin, 1975 ; Amour, 1976), tout à fait dépourvue de matériau exogène explicite.
Le collage postmoderne : l’exemple du Quatuor à cordes no 3 de Schnittke
Si le niveau d’altération du modèle joue un rôle déterminant, le collage de citations, l’écriture « polystylistique », dont Schnittke rappelle qu’elle recouvre des réalités multiples dans des répertoires divers et parfois anciens (Schnittke 1998, 132), offre un croisement fécond de références, parfois assemblées de manière brute. Emblématiques de la postmodernité des plasticiens et des architectes, ces citations et stylisations musicales appartenant à différentes périodes ou différents genres de l’histoire se manifestent à travers le collage et la juxtaposition de modèles. L’oeuvre puise une bonne part de son expressivité dans l’effet saisissant et anachronique que procurent ces mises en scène :
Schnittke, en développant son polystylistisme, a proposé — au bon moment — un équivalent musical historique (contemporain) du postmodernisme des arts plastiques : collages, critiques, citations, ironie, éclectisme
Amblard 2013, 1399
Répandu notamment en Europe de l’Est dès les années 1960, le montage de citations brutes induit également un regard nostalgique, ironique, sinon désabusé sur le passé, tout en réagissant par la satire aux contraintes étroites auxquelles étaient soumis les créateurs sous le régime soviétique. Ainsi l’insertion du premier prélude du Clavier bien tempéré de Bach au milieu de plusieurs espaces chaotiques du Credo (1968) d’Arvo Pärt provoque un tel contraste qu’il donne à entendre cette multiplicité du compositeur nostalgique comme une conséquence du « deuil de la positivité illusoire — englobante et saturante — développée par les grands récits de la modernité » (Labarrière 1989, 7). L’esthétique de Pärt, rétive au progrès artistique ainsi qu’il le reconnaît lui-même[4], donne raison à cette interprétation. Dans un autre esprit, la Symphonie no 15 de Dmitri Chostakovitch (1971), signe les adieux au grand orchestre d’un compositeur déjà affaibli, par un étonnant retour en enfance dans le premier mouvement et de multiples insertions musicales de Gioachino Rossini et de Richard Wagner. Notons en particulier la petite fanfare de l’Ouverture de Guillaume Tell (1829) qui fait irruption subitement, à cinq reprises, toujours d’une manière inattendue au sein de l’Allegretto. D’aspect bigarré, renouant partiellement avec l’esprit mutin du Concerto pour piano no 1 (1933) et de certaines oeuvres de l’entre-deux-guerres, l’oeuvre s’inspire probablement des partitions de ses jeunes confrères, mais ne pousse pas le polystylistisme de Schnittke jusqu’à son acmé.
Un choc anachronique se produit à partir de plusieurs emprunts dans le premier mouvement Quatuor à cordes no 3 (1983) de Schnittke. Trois d’entre eux appartiennent à l’histoire et sont exposés chronologiquement, sans esprit de transition, durant la première minute de l’oeuvre. Un extrait du Stabat Mater (1582) de Roland de Lassus précède ainsi le sujet de la Grande fugue opus 133 (1825) de Beethoven, puis une citation — certes moins audible — du nom de Chostakovitch en transcription allemande (DSCH), déjà entendue dans son propre Quatuor à cordes no 8 (1960). Le deuxième de ces thèmes cités subit d’emblée une première altération, selon un procédé d’instrumentation sophistiqué ; le sujet de la fugue est exposé arco au premier violon, en pizzicato au second violon, afin d’en renforcer la netteté de l’attaque, et il est traité en résonance, comme le ferait une pédale de piano, aux alto et violoncelle. L’ensemble fait appel à une technique instrumentale raffinée, distinguant l’attaque d’un son de sa résonance (Exemple 1). Une telle altération du modèle témoigne d’une volonté d’actualiser le langage beethovénien et d’en révéler instrumentalement la tension profonde, ce que le compositeur romantique avait au contraire mis en relief par un procédé légèrement archaïque à l’époque[5], à savoir l’énonciation à l’unisson fortissimo de tout le quatuor.
La matière musicale qui succède aux trois références au passé est un aperçu iconoclaste de l’état des techniques musicales en Europe centrale et orientale, mélangeant tonalité et sonorisme. Un large accord de do mineur aboutit, par un imposant glissando sur plusieurs cordes, à un cluster dense, puis à nouveau à l’unisson du quatuor, synthétisant un stéréotype on ne peut plus sommaire de la dialectique consonance-dissonance. Le compositeur prend alors tous les moyens possibles pour asséner un choc anachronique à son auditeur, lui qui, s’attendant, dès les premières mesures, à un pastiche du xvie siècle paisible, peut se cabrer ensuite lorsque lui parviennent à l’oreille les premiers chromatismes octaviés de Beethoven, et s’interroger avec perplexité sur la sémantique de ce long accord fortissimo de do mineur, avant de saisir enfin qu’il s’agit du style contemporain de son auteur, à base de glissandos et d’agrégats chromatiques. En moins d’une minute, le récepteur de l’oeuvre parcourt 400 ans d’une histoire musicale présentée de façon chaotique. Les citations ne sont pourtant guère altérées en elles-mêmes, le jeu instrumental se chargeant d’imiter le timbre particulier, relatif à l’oeuvre évoquée ; c’est pourtant leur collage qui crée ce devenir autre et stimule une écoute singulière, réactivée a posteriori, par l’énoncé d’une seconde section du Stabat Mater de de Lassus. Une grande partie du mouvement s’attarde sur un autre thème, traité en canon. Il s’agit d’une mélodie pseudo-populaire en mode de sol accompagnée par des bourdons de quinte à vide et quelques accords parfaits, dans une écriture polyphonique étroitement tissée. Le mouvement mélodique de la cadence à la dominante, tout comme la présence de sensibles brodées en anticipation de la tonique dans les deux dernières cadences encadrées, ainsi que le diatonisme et la souplesse rythmique de l’ensemble de la phrase évoquent la musique de la fin du xvie siècle, sans qu’il soit néanmoins possible de rattacher cette mélodie à une citation précise (Exemple 2).
En somme, la pratique de l’altération chez Schnittke consiste moins à modifier les citations, énoncées avec un purisme déférent, qu’à les corrompre par la superposition ou la juxtaposition d’autres éléments, plus ou moins stylisés, plus ou moins en conflit avec les modèles. La particularité de la citation postmoderne réside donc dans la part congrue attribuée à son altération, au profit d’un ou de plusieurs énoncés réalisés par un compositeur moins soucieux de leur intégration dans la matière sonore que de leur mise en exergue :
Il y a une différence décisive entre les tendances éclectiques et celles fondées sur la citation. Dans le premier cas, il n’existe ni développement traditionnel d’un motif en phrases, ni organisation ; l’unité musicale manque par conséquent souvent. Mais ce manque est perçu par les tenants de l’éclectisme comme un plus, alors que pour ceux qui pratiquent la citation, il est souvent l’indice d’un défaut
Shono 1989, 159
Cette dramaturgie complexe et diffuse, ce postmodernisme de l’hétérogénéité, pourrait rejoindre ce que le compositeur Luca Francesconi (né en 1956) décrit sous l’appellation « contrepoint des codes » (cité dans Bons 1990, 21), le stade ultime atteint par la polyphonie à la fin du xxe siècle. D’après cette lecture, il demeure délicat de réduire le postmodernisme, « insaisissable dans une globalité conceptuelle homogène » (Bouscant 2015), à son prétendu retour à la simplicité ; certaines des oeuvres qui réfèrent à l’un de ces courants développent parfois une nouvelle complexité, nourrie, selon Nicolas Darbon, d’une « essence pluraliste et ambiguë » (Darbon 2007, 50). La complexité des techniques est remplacée par la complexité des références. Certains auteurs relativisent malgré tout l’intérêt autant que l’importance esthétique de ces pratiques citationnelles. D’après Bernard Fournier, « Schnittke nous inonde de références sans laisser aucune chance à l’une ou à l’autre de prendre un sens » (Fournier 2010, 1272). Ainsi mise en scène, la poétique de la citation n’est pour lui qu’une expression pathétique et faussement dramatique de commémoration d’un passé protéiforme. Selon Makis Solomos, qui ne fait pas explicitement référence à cette oeuvre, les penchants commémoratifs de la postmodernité s’expliquent
en partie par le fait que les années 1980-1990, empêtrées dans la crise économique, éprouvent la perte du passé sur le mode de la nostalgie, alors que les années 1950-1960, en pleine expansion économique, saluaient les « lendemains qui chantent »
Solomos 1999, 99
Par la mise en scène de l’histoire qu’il implique, le collage anachronique correspond, de notre point de vue, à la définition « classique » du postmodernisme architectural, mettant en avant principalement des critères de forte hétérogénéité. Il se pourrait donc que cette oeuvre, tant par le moment de sa composition, au moins une décennie après les prémices postmodernes, que par son mélange assez subtil non seulement des citations, mais aussi des procédés de composition, soit l’oeuvre-charnière, reliant les premières décennies postmodernes des décennies suivantes, pour lesquelles Gilles Lipovetsky utilisera le terme « hypermodernité », où les citations sont plus rares, traitées sur un mode ludique.
La déconstruction hypermoderne : l’exemple du Quatuor à cordes no 2 de Campo
La citation peut parfois servir de calque à une autre oeuvre, qui se dégage de sa propre structure déconstruite. Lorsqu’elle prend les contours de la parodie, la citation investirait « une attitude ludique, voire ironique » (Genette 1982, 542), en raison de la faculté pour l’auditeur de percevoir l’écart, sinon le gauchissement, entre l’original et son altération. C’est précisément le traitement de la citation issue de l’Ouverture de la Flûte enchantée dans le Quatuor à cordes no 2 (2006) de Régis Campo (né en 1968). La musique qui l’enveloppe se démarque par l’éclatement et la déconstruction ludique du modèle (Kippelen 2012, 226), intégré à texture dynamique et coruscante, composée de sonorités inattendues. Chaque cellule issue de ce sujet de fugato est ensuite réinjectée, transposée, subissant d’importantes variations de timbre dues aux multiples modes de jeu mis en oeuvre par le compositeur : pizzicato, pizzicato sur le chevalet, flautando, souffle de l’archet sur les cordes bloquées, jeu derrière le chevalet, etc. (Exemples 3 et 4).
Par la distorsion du modèle, cette oeuvre pourrait, à première vue, s’apparenter à Hymnen, accomplissant à l’aide du seul quatuor l’altération multiparamétrique réalisée en studio. Malgré la permanence de techniques d’écriture éminemment modernes, de nombreux éléments témoignent que le paradigme esthétique est ici bien différent. Les sonorités sont tout d’abord plus douces, évitant les timbres stridents, l’atmosphère angoissante des cris de foule, les spéculations issues de nombreuses modulations de timbre. La citation défile ensuite sur une sorte de patron rythmique binaire, immuablement pulsé, ce qui est assez rare dans la musique d’avant-garde. Enfin, d’une manière générale, le Quatuor de Campo est une musique pétillante, nimbée de staccato, de notes répétées dynamiques, de modes de jeu légers, parfois subtilement glissés, à la manière d’un gag, ou effleurés ; la poétique du flautando, effleurement de la corde comme de l’idée, y est particulièrement intéressante. Mesure après mesure, note après note, la citation se dévoile, apparaissant de plus en plus prégnante jusqu’à son exposition quasi intégrale, dans sa tonalité initiale, à la mesure 26. Soigneusement choisi pour son allure vivace, pour son caractère résolument optimiste, lancé par de multiples sauts de quinte et quartes vers l’aigu, le sujet de fugue plaisamment travesti exhale à travers chaque portée ses formules ludiques venues tout droit du xviiie siècle : gammes, notes répétées, sauts d’intervalles idiomatiques, simples et doubles broderies, etc.
Le processus de déconstruction de la citation s’achève à la fin par son effritement, que le compositeur qualifie de « musique de mandolines un peu enfantine » (Campo 2006). À bien des égards, on pourrait le rapprocher d’un jeu de construction, où l’enfant utilise un matériau élémentaire pour bâtir des figures complexes qu’il détruit ensuite, une fois réalisées. Le retour en enfance est clairement assumé par le compositeur qui déclare ouvrir à l’auditeur son « monde personnel [...] proche du rêve, un peu naïf, avec des réminiscences de l’enfance, avec de l’ironie et de l’humour » (Campo 2002, 10). L’un des rares musiciens de notre temps à revendiquer son esthétique ludique (Franco-Rogelio et Denizart 2014, 2), Campo imagine cette réconciliation entre musique contemporaine et tradition classique — une époque où la musique était présumée joyeuse et positive — comme antidote au « pessimisme » exacerbé qu’il perçoit à l’orée de notre millénaire (Campo 2004, 4). C’est pourquoi il souhaite transmettre à son auditoire des affects de joie et de bien-être : « Après avoir écouté ma musique, le public est plutôt souriant, décontracté, se sent concerné par ce qui s’est passé. C’est souvent un état psychologique qui lui plaît » (Campo 2002, 13).
Distincte du polystylistisme tragique ou cynique de Schnittke, indifférente à l’utopie universaliste de Stockhausen, l’altération musicale se veut ludique, plaisante, voire rassurante. Néanmoins, ceci n’obère pas une certaine exploration, notamment rythmique, lors des cinq séquences intermédiaires où le tempo est libre et individualisé. La polyrythmie aléatoire qui en découle agrège à d’autres matériaux des cellules issues de Mozart, notamment des arpèges d’accords parfaits majeurs relevant ici d’une polytonalité qui superpose les tonalités de fa majeur, sol majeur et la majeur (Exemple 5).
Malgré les dissonances harmoniques et le brouillage rythmique, les sonorités volontairement légères du quatuor renvoient à l’image éthérée et rassurante de l’art des sociétés postindustrielles. Avide de bonheur et de divertissements, le public les apprécie d’autant plus qu’elles tranchent avec l’aridité des sons électroniques de Stockhausen et avec l’emphase tragique d’un Schnittke. Au-delà même de son apport mélodique, la citation permet au compositeur de réintégrer un son affiné, fait d’harmonies limpides, et parfois un rythme binaire pulsé, deux caractéristiques peu fréquentes dans la musique d’avant-garde. Cet art impose sa médiation avec le divertissement, qui s’accompagne de l’adoption de certains codes de l’hyperspectacle dont parle Lipovetsky :
[l]a société transesthétique apparaît comme une chaîne ininterrompue de spectacles et de produits sous les auspices du fun, du ludisme, du délassement marchandisé. [...] Ambiance généralisée de loisir qui, diffusant une atmosphère de légèreté et de bonheur, construit l’image d’une espèce de rêve éveillé permanent, de paradis de la consommation
Lipovetsky et Serroy 2013, 278
Sous ses aspects les moins sincères, la création hypermoderne paraît se confondre avec la prophétie adornienne de la fin de l’art, nivelé et absorbé par le marché tout puissant. Abandonnant la nécessité émancipatrice qui fondait l’idéal moderne, et induisant un renouvellement quasi permanent des techniques d’écriture, au risque d’y perdre l’auditeur, l’hypermoderne renoue comme le postmoderne avec le passé, sans y voir toujours une forme de paradis perdu (Schnittke, Adams, etc.) ni se réfugier dans la contemplation (Pärt, Silvestrov, etc.). La musique de l’hypermodernité est au contraire mue par le plaisir immédiat et gourmand que suscitent les sonorités brillantes, les rythmes obstinés, pleins d’entrain, les mouvements brefs, fuyant les longs développements, à l’instar de ceux d’Hymnen, long de près de deux heures. Plusieurs partitions témoignent d’un métissage divertissant avec certaines pratiques issues des musiques actuelles, associées aux choix de titre ludiques, parfois en forme de calembour et souvent de langue anglaise : Disco-toccata (1994) et Techno-parade (1998) de Guillaume Connesson, Jazz Connotation (1998), D’un rêve parti (1999) et On the Dance Floor (2003) de Bruno Mantovani, Pop-Art (2002) de Régis Campo, Bach Panther (1985) de Stéphane Delplace, ainsi que tout le catalogue de Christian Lauba écrit sous le pseudonyme de Jean Matitia. Avec Hungarian Rock et Passacaglia ungherese pour clavecin (1978), deux pièces « ironiques, hongroises et pop » (Ligeti cité dans Montalembert et Abromont 2010, 910) pour clavecin, Ligeti peut être considéré comme un précurseur du genre. Indépendamment du goût pour les sonorités électriques du rock ou du rap, elles aussi très présentes dans la musique d’avant-garde (Castanet 2012), ces différentes partitions témoignent du besoin cher à certains compositeurs des années 1990-2000 de rattacher la musique contemporaine, même de manière distanciée, au mouvement des loisirs musicaux populaires, afin de s’éloigner d’une tour d’ivoire maintes fois dénoncée. Bruno Mantovani, en particulier, ne cache pas son intérêt pour ce type de mélange des genres :
J’éprouve régulièrement le besoin d’écrire des oeuvres ludiques, caractérisées par un discours musical hétéroclite et discontinu. Souvent composées en quelques jours, ces pièces sont des divertissements propices à l’expérimentation, dans lesquelles je laisse agir mon inspiration de façon intuitive, sans tenter de la canaliser très strictement. L’intégration d’éléments issus de répertoires populaires à mon langage musical « naturel » est alors un moyen de créer la diversité, d’accentuer l’atmosphère extravertie de l’oeuvre, de bâtir une dramaturgie jouant sur la référence
Mantovani s.d.
Ce détournement du sérieux et du tragique vers un art plus léger est l’une des caractéristiques majeures de l’esthétique hypermoderne, qui « triomphe dans la démocratisation de masse du loisir culturel, le consumérisme expérientiel, la transformation de la mémoire en divertissement-spectacle » (Lipovetsky 2004, 128). Quelques années plus tôt, Dahlhaus estimait que la postmodernité, tout au moins dans sa branche américaine, proposait déjà une « médiation avec la musique de divertissement », bien que cette nouvelle proximité ne fût pas, selon lui, « une évidence, mais un problème » (Dahlhaus 1998, 129). La pratique de la citation permet de situer à travers l’exemple de Schnittke, puis de Campo, le passage de la postmodernité à l’hypermodernité, frontière ténue, mais qui témoigne de réelles évolutions. Le collage brut disparaît, tout autant que le désir de lui faire subir des processus fortement conceptualisés. Dans le quatuor, l’empreinte du divertissement, surmodelée d’une dose importante de techniques propres à la musique savante, évite l’écueil du premier degré par certaines ambivalences rythmiques et harmoniques : opposition d’un quatre temps binaire strict — celui de Mozart comme celui de la musique pop — à des séquences non mesurées ; opposition des accords (presque) parfaits des premières mesures aux superpositions polytonales et aléatoires des sections au tempo individualisés.
Conclusion
Reprenant les arguments d’Adorno, une large part des compositeurs et musicologues dénoncent, au mieux, « les tendances régressives de cette mode de l’emprunt » (Fournier 2010, 1066), au pire, rangent ces oeuvres dans le grenier poussiéreux de l’infamie, en se posant comme garants d’une musique irrémissiblement attachée à la gravité. Fournier accuse Campo de faire preuve d’un certain « autisme » esthétique, à l’égard de l’histoire du quatuor à cordes, « qui n’a cessé d’être porté [...] par une nécessité de sérieux (au sens beethovénien de serioso) ou de gravité, c’est à dire par une pensée authentique et une véritable problématique musicale » (Fournier 2010, 1064). L’auteur met en garde contre un risque de « relâchement hédoniste » et de mutation en « objet banal » (Fournier 2010, 1064) qui guette son genre favori. Il en est effectivement ainsi de l’hypermodernité, « complexe et paradoxale » selon Sébastien Charles, qui rappelle qu’elle « stimule les plaisirs (l’hédonisme, la consommation, la fête) et produit des comportements anxiogènes et pathologiques » (Charles 2007, 21) que certaines formes d’art et de divertissement tentent d’annihiler. Sous couvert d’un rapport apaisé avec la perception et d’une apparente simplicité de facture, Campo conjure un univers jugé trop pessimiste et dont les manifestations musicales savantes en offrent un reflet excessivement noir à son goût :
Je me suis rendu compte qu’en analysant les choses à froid, en regardant le monde et notre destin dans ce monde, je suis foncièrement pessimiste. Mais s’il y a une chose que je ne supporte pas, ce sont les gens qui pleurnichent. [...] Ma réponse à tous les drames, à toute la noirceur de la vie, est un optimisme démesuré
Campo 2002, 13
Parfaitement intégré à la mondialisation et de plus en plus perméable aux cultures postindustrielles, la musique dite contemporaine adopte au moins depuis la fin des années 1980 certains codes réservés jusqu’alors aux variétés : hyperpersonnalisation d’interprètes de plus en plus jeunes, au physique avantageux, enchaînant les couvertures des magazines spécialisés et effectuant des tournées sur le catalogue de leurs agences artistiques, de plus en plus mondialisées. Architecture, urbanisme et arts plastiques ont précédé la musique dans ces mutations et multiplient séductions, clins d’oeil et souvenirs du passé, mélangés avec un sens plus léger du drame aux techniques de création les plus récentes. Au moment où le matériau se fait rare, certains compositeurs semblent s’attacher à déconstruire les grandes oeuvres du passé, privilégiant une forme d’esthétisme sonore, des sonorités diaphanes, une métrique binaire, contrariée dans les seuls espaces de polytempo. Un passé qu’on encense autant qu’on l’altère, un passé remixé au goût de la technique contemporaine, nimbée de modes de jeux, creusant le sonore, irriguant la matière, opposant son foisonnement luxuriant et amusé à l’ordonnancement linéaire et rationnel de l’avant-garde des décennies précédentes.
Appendices
Note biographique
Étienne Kippelen est agrégé de musique, docteur et compositeur. Titulaire d’un master de culture musicale au Conservatoire national supérieur musique et danse (CNSMD) de Paris et de composition au CNSMD de Lyon, lauréat des concours Dutilleux et Jolivet, il enseigne à l’Université d’Aix-Marseille, dans les Conservatoires à rayonnement régional de Paris et d’Aix-en-Provence. Il publie La mélodie instrumentale après 1945 : Analyse et esthétique des ruptures (Delatour 2015), L’humour en musique et autres légèretés sérieuses depuis 1960 (PUP 2017) et dirige la revue Euterpe, consacrée à l’étude de la musique française de 1870 à nos jours. Les recherches qu’il mène le conduisent vers une approche esthétique et anthropologique des musiques savantes de la fin du xixe siècle aux répertoires contemporains. Son doctorat, sous la direction de François Decarsin, a obtenu le Prix de thèse 2013 de l’Université d’Aix-Marseille.
Notes
-
[1]
L’emphase est dans le texte original.
-
[2]
Si l’on s’en tient strictement à la polycitation, la tradition du quolibet et des genres apparentés (fricassée, amphigouri, potpourri, medley) montre combien l’altération et le collage d’extraits écrits par un ou des tiers, parfois à des fins de virtuosité technique, d’effet humoristique ou d’hommage, constitue un genre majeur dans l’histoire des musiques, occidentale comme extra-européenne, savante comme populaire (de Montalembert et Abromont 2010, 1000-1006).
-
[3]
Une version raccourcie puis retirée du catalogue a été réalisée la même année par Stockhausen pour quatre instrumentistes et sons électroniques.
-
[4]
« Je ne suis pas certain qu’il puisse y avoir du progrès en art. Le progrès en tant que tel, est présent dans la science. L’art présente une situation plus complexe. De nombreux objets d’art du passé semblent plus contemporains que notre art actuel » (cité dans Hillier 1997, 65).
-
[5]
La tradition du « premier coup d’archet », appréciée du public français et de certaines villes allemandes au milieu du xviiie siècle, consistait pour le compositeur à débuter sa symphonie ou son quatuor à l’unisson des cordes dans la nuance forte, pour que l’auditoire puisse apprécier la justesse et la précision des attaques de l’ensemble (Goubault 2009, 76-77).
Bibliographie
- Amblard, Jacques (2013). « Postmodernismes », dans Nicolas Donin, et Laurent Feneyrou (dir.), Théories de la composition musicale au xxe siècle, vol. 2, Lyon, Symétrie, p. 1387-1424.
- Bons, Joël (1990). Complexity in Music ? An Inquiry of its Nature, Motivation and Performability, Amsterdam, Job Press.
- Boulez, Pierre (2005). Leçons de musique, Paris, Christian Bourgois.
- Bouscant, Liouba, avec la collaboration d’Ofer Pelz et de Michel Gonneville (2015). « Matériaux anciens dans la musique contemporaine actuelle. Postmodernisme et modernisme en questions », Revue musicale OICRM, vol. 2, no 2, http://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol2-n2/materiaux-anciens-dans-la-musique-contemporaine-actuelle-postmodernisme-et-modernisme-en-questions/, consulté le 17 avril 2018.
- Campo, Régis (2002). « Propos recueillis par Aleksandra Kroh », La petite musique ou la tentation du silence..., no 12, Manosque, p. 10-14.
- Campo, Régis (2004). Note de CD Autoportraits, Paris, Mardala.
- Campo, Régis (2006). Note de programme du Quatuor à cordes no 2, Paris, Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM), http://brahms.ircam.fr/works/work/26496/, consulté le 12 février 2017.
- Castanet, Pierre Albert (2012). « Le médium mythologique du rock’n roll et la musique contemporaine », Intersections, vol. 32, nos 1 et 2, p. 83-116.
- Charles, Daniel (2001). La fiction de la postmodernité selon l’esprit de la musique, Paris, Presses universitaires de France.
- Charles, Sébastien (2007). L’hypermoderne expliqué aux enfants, Montréal, Liber.
- Dahlhaus, Carl (1998). « La postmodernité et la musique de divertissement », Analyse musicale, no 33, novembre, p. 127-131.
- Darbon, Nicolas (2007). Musica multiplex, Paris, L’Harmattan.
- Decarsin, François (2011). « Karlheinz Stockhausen. Parcours de l’oeuvre », IRCAM-Centre Pompidou, http://brahms.ircam.fr/karlheinz-stockhausen#parcours, consulté le 8 février 2017.
- Decarsin, Franaçois (2013). « Karlheinz Stockhausen », dans Nicolas Donin, et Laurent Feneyrou (dir.), Théories de la composition musicale au xxe siècle, vol. 2, Lyon, Symétrie, p. 1021-1039.
- Delaplace, Joseph (2007). György Ligeti. Un essai d’analyse et d’esthétique musicales, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Escal, Françoise (1984). Le compositeur et ses modèles, Paris, Presses universitaires de France.
- Ferry, Luc (1990). Homo aestheticus, Paris, Grasset.
- Fournier, Bernard (2010). Histoire du quatuor à cordes, vol. 3, Paris, Fayard.
- Franco-Rogelio, Christophe et Jean-Michel Denizart (2014), « Entretien avec Régis Campo, un compositeur “ludique” », Les chantiers de la création, no 7, p. 2-8.
- Genette, Gérard (1982). Palimpsestes, Paris, Seuil.
- Goubault, Christian (2009). Histoire de l’instrumentation, Paris, Minerve.
- Hillier, Paul (1997). Arvo Pärt, Oxford, Oxford University Press.
- Jameson, Frederic (2007). Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts.
- Jencks, Charles (1985). Le langage de l’architecture postmoderne, Paris, Denoël.
- Kippelen, Étienne (2012). « Le ludisme dans la musique des années 2000 », dans Jacques Amblard et Sylvie Coëllier (dir.), L’art des années 2000. Quelles émergences ?, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, p. 219-231.
- Labarrière, Jean (1989). Témoigner du différend, Paris, Osiris.
- Lipovetsky, Gilles (2004). Les temps hypermodernes, Paris, Grasset.
- Lipovetsky, Gilles et Jean Serroy (2013). L’esthétisation du monde, Paris, Gallimard.
- Lyotard, Jean-François (1988). Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée.
- Maconie, Robin (1976). The Works of Karlheinz Stockhausen, Londres, Oxford University Press.
- Mantovani, Bruno (s. d.). Note de programme de D’un rêve parti, Ressources Brahms/IRCAM, http://brahms.ircam.fr/works/work/20089/, consulté le 9 février 2017.
- Montalembert, (de) Eugène et Claude Abromont (2010). Guide des genres de la musique occidentale, Paris, Fayard/Lemoine.
- Ramaut-Chevassus, Béatrice (1998). Musique et postmodernité, Paris, Presses universitaires de France.
- Schnittke, Alfred (1998), « Les tendances polystylistiques dans la musique moderne », Analyse musicale, n° 33, novembre, p. 132-134.
- Shono, Susumu (1989). « La musique post-moderne, produit de la société de consommation », Musiques en création, Paris, Contrechamps.
- Solomos, Makis (1999). « Néoclassicisme et postmodernisme : Deux antimodernismes », Musurgia, vol. v, n° 3-4, mai, p. 91-107.
- Stockhausen, Karlheinz (1971). Text zur Musik, Köln, DuMont Schauberg.
- Stockhausen, Karlheinz (1968). « Cinq textes », Revue d’esthétique, n° 2-3-4, Klincksiek, Paris.
- Stoïanova, Ivanka (1985). « Luciano Berio. Chemins en musique », La revue musicale, nos 375-377.
- Stoïanova, Ivanka (2014). Karlheinz Stockhausen. « Je suis les sons... », Paris, Beauchesne.
- Wörner, Karl (1973). Stockhausen : Life and Work, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.

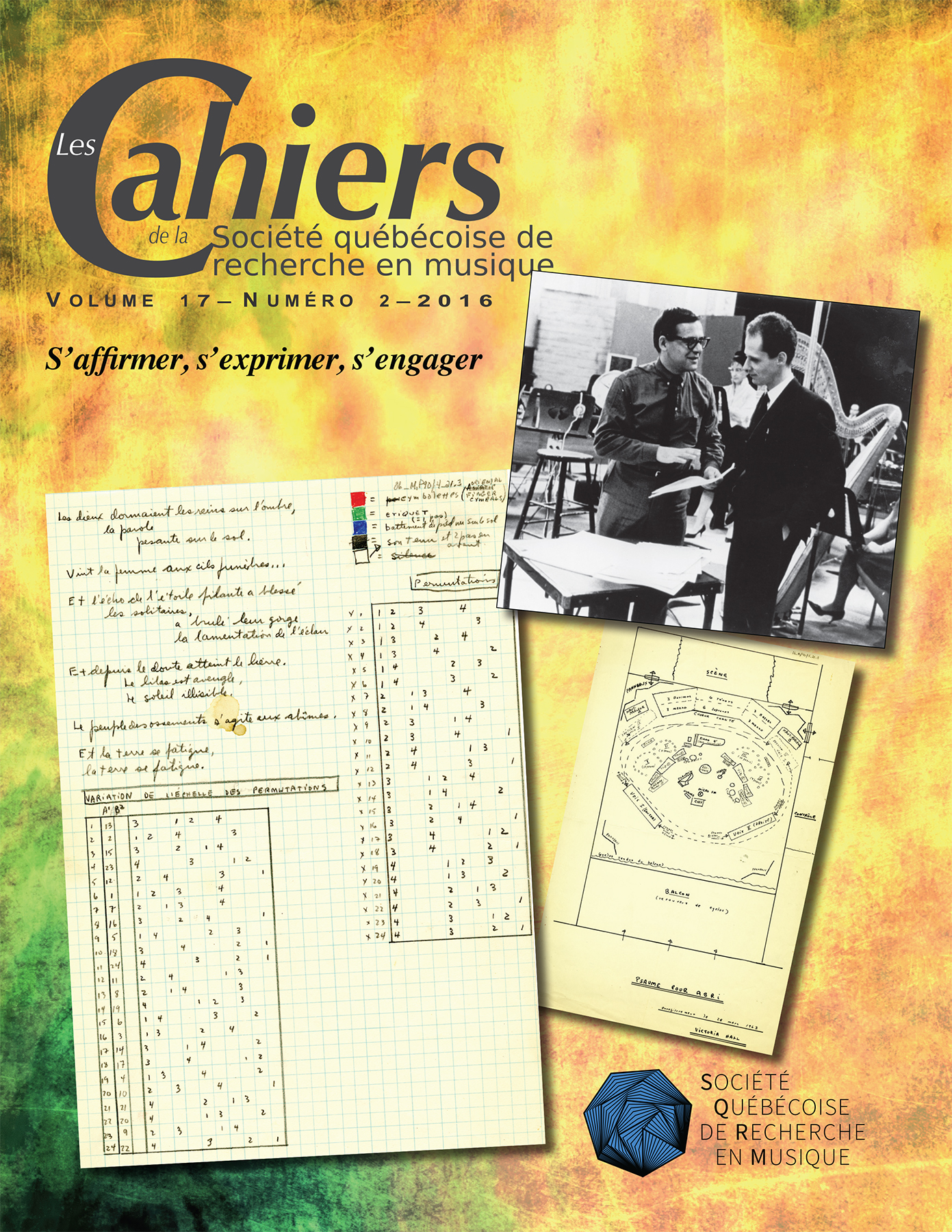
 10.7202/1060129ar
10.7202/1060129ar