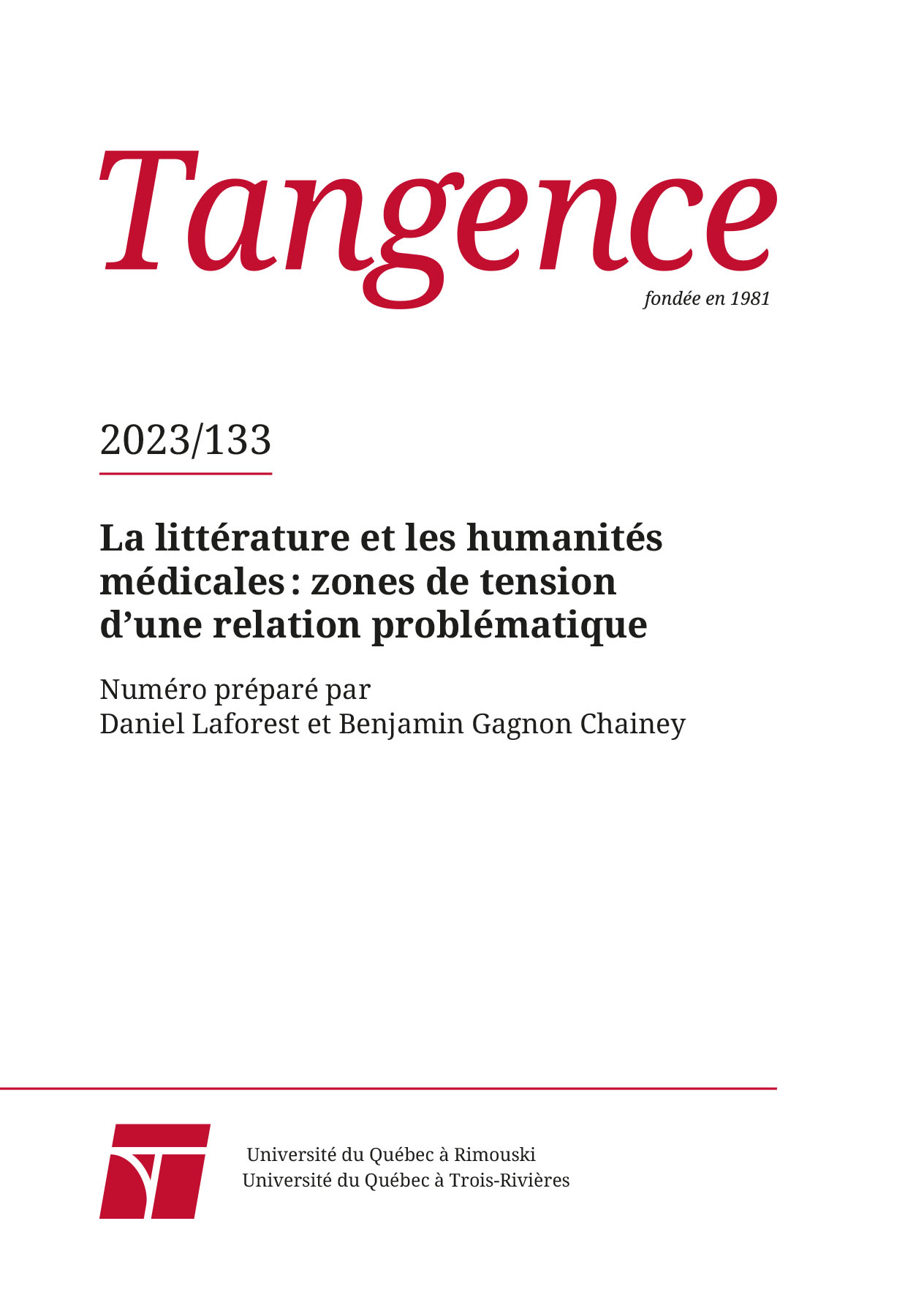Abstracts
Résumé
Originaire de Berthier au Bas-Canada, le voyageur Alexis Saint-Martin (1802-1880), à la suite d’un accident d’arme à feu, a servi de cobaye au chirurgien américain William Beaumont (Lebanon, CT, 1785-1853), dont les travaux sur son estomac blessé ont marqué la médecine et lui ont valu le titre de « Père de la physiologie gastrique ». Malgré le rôle primordial qu’il a joué dans le succès et la renommée de Beaumont, Saint-Martin demeure un personnage marginal, une note infrapaginale dans le grand livre de l’histoire médicale. Cet article analyse la première représentation de Saint-Martin, non seulement en tant qu’individu happé par un hasard de l’histoire qui l’a condamné à se définir en fonction de sa blessure, mais aussi en tant que figure réifiée de coureur des bois.
Abstract
A native of Berthier in Lower Canada, the voyageur Alexis Saint- Martin (1802-1880), following a shotgun accident, served as guinea pig for the American surgeon William Beaumont (Lebanon, CT, 1785-1853), whose work on Saint-Martin’s wounded stomach marked the field of medicine and earned Beaumont the title “Father of Gastric Physiology.” Despite the vital role he played in Beaumont’s success and fame, Saint- Martin remains a marginal figure, a footnote in the great book of medical history. This article analyzes the first representation of Saint-Martin, not only as an individual condemned by an accident of history to be defined by his injury, but also as an objectification of the coureur des bois.
Article body
Le fait divers est bien connu. En 1822, Alexis Bidaguin dit Saint-Martin, né en 1802 à Berthier, au Bas-Canada, un voyageur engagé par la American Fur Company, a été victime d’une tragique bévue qui devait lui être mortelle, mais ne le fut pas et devint un événement historique. Au magasin général de l’île de Mackinac, lieu stratégique de la traite des fourrures à l’intersection des lacs Supérieur, Huron et Michigan, Saint-Martin a reçu à bout portant une décharge accidentelle de carabine, qui lui a perforé l’abdomen. Immédiatement appelé sur les lieux, le docteur William Beaumont, aide-chirurgien de la garnison de l’armée américaine postée au fort de Mackinac, lui a sauvé la vie. Au cours des mois et des années qui ont suivi, voyant la blessure guérir en une fistule donnant directement accès à l’estomac à travers la paroi abdominale, Beaumont a saisi l’occasion de faire de Saint-Martin son cobaye et l’a étudié durant une décennie. Ses découvertes, publiées en 1833, lui ont assuré une renommée internationale et la postérité dans les annales médicales.
De son côté, deux cents ans après son accident et plus de cent quarante après sa mort en 1880, Alexis Saint-Martin attend toujours la reconnaissance qui lui est due. Cet article est le premier pas de mon entreprise visant à remédier à cet oubli, et consiste en l’analyse de la représentation initiale qu’en a faite William Beaumont. On sait peu de choses sur Saint-Martin, alors que les écrits abondent à propos du chirurgien et de son grand destin. Son ouvrage Experiments and Observations on the Gastric Juice and the Physiology of Digestion[1] (1833), qui prouve le processus chimique de la digestion grâce à l’acidité des sucs gastriques, est un important jalon de la connaissance du système digestif humain. Pour ce fils d’une modeste famille d’agriculteurs du Connecticut, être reconnu dans l’histoire médicale en tant que « père de la physiologie gastrique[2] » est un accomplissement emblématique du self-made-man têtu, entièrement voué à la réalisation de son rêve américain. Beaumont a tout du talentueux et brillant opportuniste, du fonceur qui fait tourner chaque occasion à son avantage, et il fournit à l’Histoire un réservoir de récits et d’anecdotes propices à son élévation au rang de héros américain. De fait, il a bel et bien laissé une marque profonde dans l’histoire médicale et militaire : un grand nombre de livres et d’articles scientifiques, biographiques et historiques affirment son importance en tant que « pionnier des physiologistes américains[3] » ou que « premier grand scientifique médical de l’Amérique[4] », ou encore sa débrouillardise en tant que « physiologiste de l’arrière-pays[5] » sur cette fameuse Frontier. Des hôpitaux et des pavillons d’université portent son nom, des écoles secondaires, un prix en gastroentérologie, une autoroute.
Or, Beaumont n’aurait jamais atteint cette renommée sans la participation à la fois volontaire et contrainte de son cobaye Alexis Saint-Martin qui, lui, ne jouit que d’une reconnaissance marginale pour sa contribution à l’avancement des sciences. C’est dû en partie à la nature du portrait qu’en a laissé Beaumont. Il est le premier à avoir écrit à propos de Saint-Martin dans ses journaux où il détaillait ses activités médicales, puis dans deux articles : « A Case of Wounded Stomach » (1825) et « Further Experiments on the Case of Alexis San Martin, Who Was Wounded in the Stomach by a Load of Buckshot » (1826). Il s’opère, dans ces écrits scientifiques, une double déshumanisation : Saint-Martin est à la fois métonymisé – réduit à son seul organe blessé – et mythifié en concordance avec le portrait canonique des voyageurs aux qualités surhumaines engagés par les compagnies de traite. Ce portrait est ensuite assombri dans les textes légaux que signe Beaumont au sujet de Saint-Martin, et dans son abondante correspondance. Son cobaye est alors déprécié, avili, animalisé. Comme l’écrit Gérard Danou, « [l]e discours médical obéit à un ordre variable en fonction de l’état de la science du moment, des maladies en cours, du “dernier langage de la médecine”, des idéologies politiques et des fantasmatiques individuelles et collectives[6] », et les textes de Beaumont sur Saint-Martin, produits entre 1822 et 1853, sont bel et bien représentatifs de l’idéologie américaine de la période de l’Antebellum (d’avant la guerre de Sécession), notamment sur la possession des humains et la possibilité d’en disposer comme bon semblera à leurs propriétaires[7]. La représentation à la fois contradictoire et violente que Beaumont fait de Saint-Martin, une représentation littéraire puisant dans l’imaginaire et les préjugés du médecin, et qui sert à constituer sa propre image de chirurgien dévoué, désintéressé et moralement supérieur, est à la base de toutes celles qui suivront : en raison de la position de pouvoir de Beaumont par rapport à Saint-Martin, son portrait a perduré jusqu’à la deuxième moitié du xxe siècle dans la littérature scientifique et biographique qu’on leur a consacrée.
Le regard prétendument objectif du scientifique
Beaumont crée un personnage textuel du haut de sa position de scientifique qui lui confère l’a priori de la vérité. Pourtant, les premiers mots de Beaumont au sujet de Saint-Martin sont la preuve de l’incompréhension et de l’incommunicabilité qui marqueront leurs relations jusqu’au bout : « Alex Samata [8]», est-il inscrit en lettres démesurées en début d’entrée dans son journal, erreur reconduite en marge supérieure par « San Maten[9] », puis corrigée ultérieurement par « St. Martin[10] ». Preuve de la durabilité de cette incompréhension, Beaumont l’appelle toujours « San Martin » en novembre 1825, lors de la rédaction de son article « Further Experiments… », trois ans et demi après leur rencontre. D’emblée, dans le regard du médecin, cet homme à l’identité fuyante n’est pas lui-même ; il compte parmi la masse des voyageurs anonymes, débaptisé en raison de barrières linguistiques et culturelles que la surdité de Beaumont – il avait été rendu à moitié sourd par une détonation de canon durant son adolescence – n’allait pas aider à lever. Différentes langues, religions et classes sociales séparaient ce militaire et scientifique aux responsabilités considérables et cet analphabète qui n’aurait jamais eu quelque intérêt sans ce coup de feu. Avec l’ouïe en moins, il leur serait d’autant plus difficile de s’entendre.
Ces entrées de journal personnel sur Saint-Martin sont reprises à peu de choses près dans l’article du Medical Recorder de janvier 1825 (rédigé en septembre 1824), où Beaumont explique les soins prodigués à Saint-Martin pour lui sauver la vie, puis faciliter la lente guérison de la plaie et sa résorption en fistule. Cet article initial sera repris dans Experiments and Observations en tant qu’introduction, augmentée de l’évolution du cas jusqu’à la publication du livre en 1833. Les quatre premières expériences effectuées sur Saint-Martin avant sa fuite sont publiées dans le second article du Medical Recorder en 1826, et aussi reprises dans les mêmes termes dans le livre. Comme tous ces textes étoffent la même matière textuelle, je me contente de relever la représentation de Saint-Martin dans Experiments and Observations, ouvrage grâce auquel, avec un rigoureux esprit scientifique et une ironie sans doute accidentelle, Beaumont entend soumettre au monde « un corps de faits[11] ».
La poétique de ce double sens est éclairante. Saint-Martin, dans le livre de Beaumont, n’est pas un homme considéré dans son entière complexité, mais métonymisé, réduit à son corps, à son organe blessé dont on étudie le fonctionnement. Peu de détails concernant Saint-Martin en tant qu’individu sont révélés, et souvent ils ne sont qu’indirects. On doit inférer qui il était, et comment il se sentait et se comportait durant ces années d’expériences invasives. Voici sa première apparition :
Alexis Saint-Martin, qui est le sujet de ces expériences, était un Canadien de descendance française, âgé d’environ dix-huit ans à la période mentionnée [1822], de bonne constitution, robuste et en santé. Il s’était engagé au service de la American Fur Company en tant que voyageur, et a été blessé accidentellement par la décharge d’un mousquet le 6 juin 1822[12].
Après ce paragraphe présentatif, l’identité de Saint-Martin devient facultative, et est le plus souvent escamotée : son nom ne reviendra qu’à la page 18, et ensuite qu’à partir de la page 131, au début de la deuxième ronde d’expériences à Prairie du Chien, au Wisconsin, en 1829, où Saint-Martin rejoint Beaumont avec sa jeune famille. Ailleurs, il n’est qu’un « jeune », un « homme », un « garçon[13] », et on le désigne principalement par les pronoms « he », « him », « his ». Son individualité s’efface derrière les phénomènes physiologiques qui se produisent sur et dans son corps, décrit objectivement et en termes généraux comme s’il n’était pas celui d’un individu à part entière (« La partie saillante de l’estomac était presque aussi grande que celle du poumon » ; « En cinq ou six jours vint s’en détacher un morceau de cartilage d’un pouce de long », etc.[14]). On comprend l’effacement du sujet dans un tel contexte expérimental ; il ne s’agit pas au départ pour Beaumont d’étudier l’impact des émotions et des comportements sur la digestion, bien que, on le verra, émotions et comportements l’influenceront inévitablement. Cet effacement n’est pas dû qu’à la rhétorique objective de l’analyse scientifique. Il est le premier pas d’une mise à distance de Saint-Martin par rapport à lui-même, d’abord réduit à un sujet d’étude[15], ensuite avili, animalisé, infantilisé et insulté dans la correspondance.
Reste que Beaumont, dans cette introduction, n’hésite pas à écrire les aspects de cet homme qui servent à construire sa propre figure de scientifique, et à affirmer leur relation de subordination. Que Beaumont souligne d’emblée la santé et la constitution robuste de Saint-Martin n’a pas qu’une fonction descriptive. Réussir à les lui faire retrouver, malgré une blessure qui aurait dû être mortelle, prouve qu’il est un grand médecin. Il insiste presque obsessionnellement sur cette rémission : « À partir du mois d’avril 1823, alors qu’il avait récupéré suffisamment pour être en mesure de marcher dans les environs et de faire des travaux légers, profitant de son bon appétit et de sa bonne digestion usuels, il demeura avec moi et regagna rapidement sa santé et ses forces[16] » ; « Au printemps 1824, il avait parfaitement retrouvé sa santé et sa force naturelles[17] » ; et encore[18], jusqu’à conclure ainsi sa présentation en insistant sur sa vigueur, qui semble désormais supérieure à celle dont il profitait avant l’accident : « Ainsi ont été la condition et les circonstances de vie de cet homme depuis plusieurs années ; et il jouit maintenant de la plus parfaite santé et d’un parfait équilibre de sa constitution, avec l’entière force et vigueur de chacune des fonctions de son système[19]. » Peut-être Beaumont le fait-il pour se dédouaner de lui avoir fait subir les expériences dont il révèle froidement les effets invalidants dans la suite de son livre. Leurs effets psychologiques, jamais pris en considération dans ses analyses ni, d’ailleurs, dans les relations réelles entre les deux hommes, ne filtreront qu’indirectement dans le livre et la correspondance de Beaumont.
Malgré lui, Beaumont mythifie le personnage de Saint-Martin en lui donnant des attributs classiques de la figure du voyageur. Bien entendu, la force et l’endurance de Saint-Martin n’étaient pas dues aux prouesses chirurgicales de son médecin, mais constitutives de sa personne. Il en fallait en effet pour survivre à cet accident et aux épuisantes et douloureuses opérations subséquentes, et reprendre ensuite le travail de voyageur, comme il l’a fait durant les premières années où il a fui Beaumont, entre 1825 et 1829 : « [I]l s’engagea pour la Compagnie de la Baie d’Hudson en tant que voyageur dans le pays indien. Il y alla en 1827, y retourna en 1828 ; et subséquemment travailla dur pour soutenir sa famille[20]. » Pagayer et portager jusqu’à dix-huit heures par jour, dormir à la dure, aller-retour Montréal/Fort William, aujourd’hui Thunder Bay, voilà un labeur qu’on peine à concevoir aujourd’hui et qui était déjà considérable pour quiconque n’avait pas de fistule gastrique.
Mais Beaumont élève les accomplissements de Saint-Martin au rang d’exploits propres à faire de lui un personnage plus grand que nature. Après deux ans à Prairie du Chien, Saint-Martin rentre à Berthier avec sa femme – Marie Joly – enceinte de jumeaux, et leurs trois enfants. Beaumont « l’équip[a], ainsi que sa femme et ses enfants. Ils partirent en canot découvert sur le Mississippi et passèrent Saint-Louis, Missouri ; ils remontèrent la rivière Ohio ; puis traversèrent l’État de l’Ohio jusqu’aux Lacs ; puis ils descendirent les lacs Érié et Ontario, puis le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal, où ils arrivèrent en juin[21] ». Nous avons ici l’exploit d’un voyageur qui ramène seul sa femme et ses enfants, en canot, de l’ouest du lac Michigan à Montréal. Imaginons seulement le portage en famille pour contourner les chutes du Niagara… Peu importe qu’ils aient sans doute bénéficié à un certain moment du transport maritime sur les rivières américaines et les Grands Lacs, l’image proposée par Beaumont est qu’ils ont voyagé en canot de mars à juin et que Saint-Martin a ainsi démontré qu’il avait recouvré ses forces et son endurance exceptionnelles. Or, non seulement a-t-il cette vigueur étonnante, mais il est aussi immunisé contre la maladie : en 1832, « il était au milieu de l’épidémie de choléra au moment où elle s’imposait et traversait le Canada, et il résista impunément à ses ravages, tandis que des centaines tombaient autour de lui, sacrifiés par son influence fatale[22] ». De sa guérison jusqu’à la fin des expériences en 1833, Saint-Martin, selon Beaumont, « souffrit d’une bien moindre prédisposition à la maladie qu’il n’est commun chez les hommes de son âge et de ses circonstances de vie[23] ». Cette puissance et cette endurance[24], cette santé de fer[25] correspondent bien au profil du voyageur canonisé en 1931 par Grace Lee Nute dans son ouvrage fondateur The Voyageur.
L’esprit libre et l’insoumission[26], autres traits caractéristiques des voyageurs, sont aussi attribués à Saint-Martin et ainsi semés dans l’imaginaire par Beaumont. Durant les onze années au cours desquelles ils se côtoient par intermittence, Beaumont a le droit de regard sur ses déplacements, en position d’autorité sur Saint-Martin, d’abord pour des raisons morales et caritatives après lui avoir sauvé la vie et l’avoir pris à domicile à Mackinac[27], puis en vertu de contrats d’engagé que Saint-Martin signe d’un X en 1832 et en 1833[28], et enfin en tant que supérieur militaire quand Beaumont l’enrôle dans l’armée américaine pour l’avoir sous son commandement et faire défrayer l’institution. Il a la bonne grâce de lui permettre de rentrer quand la Black Hawk War, au Michigan, le sollicite entièrement en tant que chirurgien militaire[29], ou encore quand le père d’Alexis et son aînée meurent du choléra en 1832 ; sinon Beaumont le garde à son service « en tant qu’homme à tout faire[30] », et l’amène avec lui lors de ses nombreux voyages en Nouvelle-Angleterre. Mais la première fuite de Saint-Martin en 1825, et sa dernière en 1834, sont considérées part Beaumont comme des désertions : « De ce dernier lieu, il retourna dans son Canada natal, sans obtenir mon consentement[31]. » Dans son second article du Medical Recorder de 1826 où se trouve la version initiale de ce passage, Beaumont avait attribué un caractère criminel à la fuite de Saint-Martin : « L’homme s’est enfui au Canada[32]. » Ces fuites nourriront le mythe d’un Saint-Martin égoïste et déloyal, incapable de gratitude envers son sauveur et bienfaiteur.
Car Beaumont ne trouve rien à se reprocher, ni ses contemporains, ni ses premiers commentateurs. Dans la lettre qu’il fait parvenir à James Webster, l’éditeur du Medical Recorder, pour présenter son second article, il a beau jeu de regretter l’ingratitude de Saint-Martin, parti bien qu’il ne souffrît apparemment pas des expériences faites sur lui : il aurait « refusé qu’on expérimente sur lui, bien que ça ne lui causât que peu de douleur ou de détresse[33] ». Pourtant, les manipulations, les conditions mêmes des expériences et leurs résultats prouvent la souffrance de Saint-Martin. Par exemple, le mode d’extraction du suc gastrique par lequel Beaumont en recueille des litres et des litres à travers les années pour s’en servir lors de ses expériences in vitro et le distribuer libéralement aux chimistes des États-Unis – et même de Suède, où il en envoie une pinte –, consiste à insérer un tube de caoutchouc par la fistule dans l’estomac à jeun, pour en irriter la membrane et faire sécréter le suc gastrique, et à le bouger de haut en bas pour accentuer la sécrétion. « Son extraction est généralement suivie de cette sensation particulière au creux de l’estomac qu’on appelle enfoncement, accompagné d’un certain degré d’étourdissement, qui rend nécessaire d’arrêter l’opération[34] », note-t-il. D’autres expériences consistent en la suspension dans l’estomac de tout type de nourriture attachée par une ficelle, ou d’un sac de mousseline contenant la nourriture, et à leur retrait pour constater l’état de digestion des aliments après un temps donné. Le mouvement des sacs de mousseline provoque lui aussi ce sentiment de « douleur et de détresse au creux de l’estomac[35] ». La prise quotidienne de température interne par l’insertion d’un thermomètre dans l’orifice entraîne aussi de la douleur et des étourdissements. La pratique révèle pour la première fois in vivo le mouvement du sphincter du pylore, muscle qui régule, par sa contraction et sa dilatation, le passage du contenu de l’estomac dans le duodénum ; or ce mouvement, semblable à la déglutition, provoque une réaction conduisant à avaler le thermomètre dans le corps : « [I]l était tiré vers l’extrémité du pylore sur toute sa longueur, dix ou onze pouces, ce qui occasionnait une détresse considérable, du vertige, et un sentiment d’enfoncement à la fosse épigastrique[36]. »
Quoi qu’en dise Beaumont à l’éditeur du Medical Recorder, la première ronde d’expérimentations, en août et septembre 1825, prouve leur extrême désagrément. Ces quatre expériences révèlent à la fois la souffrance du cobaye et l’entêtement légèrement sadique du chercheur. La première mérite d’être citée plus longuement pour illustrer ce à quoi Saint-Martin a dû se soumettre, infantilisé (« le garçon »), subordonné au paternalisme de son chirurgien :
À deux heures PM, examinai de nouveau – trouvai le boeuf à la mode digéré en partie : le boeuf cru était légèrement macéré en surface, mais sa texture générale était ferme et entière. L’odeur et le goût des fluides de l’estomac étaient légèrement rances ; et le garçon se plaignait de quelque douleur et inconfort à la poitrine. Je les y ai remis.
Le garçon se plaignant d’une détresse et d’inconfort considérables dans l’estomac, d’une lassitude et d’une débilité générale, avec de la douleur à la tête, je retirai la ficelle, et trouvai les portions restantes de l’aliment presque dans la même condition que lorsque examinées la dernière fois ; le fluide plus rance et piquant. Le garçon se plaignant toujours, je ne les y ai plus remis.
2 août. La détresse dans l’estomac et la douleur à la tête demeurant, accompagnées de constipation, d’un pouls déprimé, d’une peau sèche, d’une langue saburrale, et de nombreux points blancs ou pustules, qui ressemblaient à de la lymphe coagulée, répandus sur la surface interne de l’estomac, je trouvai avisé de donner des médicaments ; et, conséquemment, je fis tomber dans l’estomac, par l’ouverture, une demi-douzaine de pilules de calomel, de quatre ou cinq grains chacune […][37].
Au-delà de cette souffrance physique dûment documentée, Saint-Martin est sujet à de considérables souffrances psychologiques, qui ne paraissent dans les analyses de Beaumont que de manière indirecte ou fort atténuée. Durant l’expérience précédemment citée, le fait que Beaumont ait poursuivi ses manipulations malgré la douleur de Saint-Martin (« Je les y ai remis. ») montre le peu de considération qu’il lui accorde. Et Saint-Martin n’est pas insensible à ces traitements, à preuve l’analyse par Beaumont des effets de la peur et de la colère sur l’état[38] de l’estomac et sur son fonctionnement[39]. Si l’on ne peut accuser Beaumont d’avoir malicieusement provoqué ces états psychologiques (bien que le jeûne et l’activité physique aient été imposés, qu’importe leurs conséquences[40]), on ne trouve nulle part qu’il ait cherché à les empêcher (il se permet même des jugements voilés[41] sur l’attitude de Saint-Martin), et force est de constater qu’ils ont été de profitables occasions d’étude.
Par ailleurs, la souffrance de Saint-Martin s’est exprimée indirectement par son alcoolisme. Il est évidemment impossible d’isoler les causes de sa dépendance à l’alcool, mais l’on peut présumer sans trop errer que le choc post-traumatique causé par sa blessure, l’humiliation de son infirmité, la douleur physique elle-même, la soumission à des expériences invasives, l’exil, l’éloignement de sa famille (des expériences ont été réalisées le 25 décembre 1832 et le 1er janvier 1833 alors qu’il était seul à Washington…) ont contribué à sa maladie. Là encore, celle-ci a ses mérites, car elle fournit l’occasion à Beaumont d’étudier l’effet de l’alcool sur l’état et le fonctionnement de l’estomac : « [L]a consommation de spiritueux donne toujours un aspect maladif à l’estomac[42] », inclut-il au treizième rang des 51 « Inférences » en conclusion de son ouvrage. Si l’alcoolisme de Saint-Martin n’y est abordé que pour des raisons descriptives et analytiques (« semble avoir bu de l’eau-de-vie trop librement » ; « Saint-Martin a bu des spiritueux, fort librement, durant les huit ou dix derniers jours » ; « La consommation de spiritueux, de vin, de bière, ou de toute liqueur intoxicante, maintenue durant plusieurs jours, a invariablement produit ces changements morbides [les conditions maladives de la surface de l’estomac][43] »), elle est jugée négativement dans sa correspondance et dans le hors-texte des rééditions d’Experiments and Observations. Cela permet à Beaumont, à ses interlocuteurs et aux préfaciers des rééditions du livre d’accoler au personnage de Saint-Martin un autre trait caractéristique des voyageurs, celui-là moins glorieux que la force surhumaine ou l’indépendance d’esprit : la beuverie. Tant que Beaumont a cherché à récupérer Saint-Martin après son retour au bercail, l’alcoolisme de ce dernier a été un problème d’importance. Beaumont et ses émissaires hésitaient à lui avancer de l’argent pour financer sa venue aux États-Unis de peur qu’il ne le dilapide. Clément Beaulieu, un agent de la American Fur Company près de Trois-Rivières, écrit ainsi à Ramsay Crooks, président de la compagnie et ami de Beaumont : « Mon opinion Monsieur est qu’on court un grand risque à donner 100 dollars en main propre à Saint-Martin au Canada. La première des choses qu’ils feront lorsqu’ils auront l’argent, est de s’enfermer lui et sa famille, étant Ivrogne il pourrait dépenser le reste avant le départ de chez lui, et y rester encore comme il l’a déjà fait[44]. » Ramsay Crooks confirme à Beaumont que Saint-Martin « est devenu un ivrogne si perdu[45] » qu’on ne peut lui faire confiance, et mentionne à un autre agent recruteur à Berthier qu’il est ainsi « totalement bon à rien[46] ». Malgré une période de consommation plus modérée dans les années 1840, Saint-Martin sera aux prises avec l’alcoolisme jusqu’à sa mort, ce que soulignera le médecin William Osler dans une allocution à la mémoire de Beaumont d’abord publiée en 1902, puis reprise en tant que préface aux rééditions d’Experimentsand Observations au xxe siècle. Il cite les paroles d’un juge de Berthier nommé Baby : « Quand je rencontrai [Saint-Martin], il était plutôt pauvre, vivant sur une petite ferme rudimentaire à Saint-Thomas, et très dépendant de l’alcool, presque un ivrogne, pourrait-on dire[47]. » La réédition de 1838 faisait déjà dire à l’éditeur Andrew Combe que les conclusions de Beaumont « confirm[aient] [ses] croyances en l’étendue des méfaits issus d’[erreurs diététiques], particulièrement chez les jeunes hommes exposés à la tentation de boire[48] », une observation générale sur les effets de la consommation. Mais l’inclusion du texte d’Osler en préface de l’oeuvre de Beaumont personnalise désormais cette faiblesse devant la tentation, et concrétise la construction du personnage de Saint-Martin en alcoolique.
Il est intéressant de noter que la consommation d’alcool de Saint-Martin n’est pourtant relevée par Beaumont qu’à partir de la quatrième et dernière ronde d’expériences à Plattsburgh en 1833, après dix ans de collaboration. Cela ne signifie pas, bien sûr, que Saint-Martin ne buvait pas avant. Mais cela laisse croire que cette consommation est devenue telle, à partir de ce moment, qu’elle s’est mise à influencer les expériences et leurs résultats. Peu importe les conséquences de ses conditions de vie avec Beaumont, sa douleur, sa mélancolie, qu’importe que les jumeaux, dont sa femme était enceinte lorsqu’ils sont rentrés de Prairie du Chien en 1831, soient morts coup sur coup en 1833 et en 1834, ou qu’il vive dans un état de deuil constant étant donné le très haut taux de mortalité dans sa famille, peu importe les souffrances psychologiques causées par la pauvreté : on ignore l’influence du milieu dans le jugement de l’alcoolisme de Saint-Martin. La littérature subséquente considérera que cette tare ne peut être qu’un atavisme de voyageur, donc d’un viveur irresponsable, et les apôtres de la tempérance, au Bas-Canada, prendront Saint-Martin en contre-exemple.
Tous ces éléments révèlent les contradictions à l’oeuvre dans la création du personnage textuel de Saint-Martin par Beaumont dans son ouvrage. L’auteur a l’intention d’offrir à la science « un corps de faits » en dépersonnalisant son sujet d’étude et en se concentrant sur son organe comme s’il n’était pas sien, mais il raconte en fait quel individu était Saint-Martin, bien présent dans toutes les pages du livre, dans les moindres secrets de son anatomie. On ne peut ignorer qu’il s’agit de la description de l’organe d’un homme soumis à toutes ces manipulations, un homme fort, résistant, têtu, dissolu et fêtard (conformément au mythe des voyageurs), mais aussi sensible et vulnérable, attaché à sa famille, qui souffre physiquement et psychologiquement de sa condition, de ce qu’on lui fait, de ce qu’on lui fait faire. « Le discours médical n’est pas violent en lui-même, dit encore Gérard Danou, mais le devient selon les conditions de son énonciation[49]. » Les écrits scientifiques de Beaumont, sous le couvert de l’objectivité du scientifique, racontent une violence typique de son époque et aveugle à elle-même : ils documentent au nom de la science les effets d’une forme de torture.
Les véritables opinions se révèlent
Comme j’ai commencé à le relever plus haut au sujet de l’alcoolisme, les autres écrits de Beaumont, en dialogue avec ses interlocuteurs immédiats, transforment le portrait de Saint-Martin. Sans le prétendu filtre de l’objectivité du chercheur, ils modulent les caractéristiques de Saint-Martin déjà établies dans ses publications. À partir du moment où Saint-Martin part pour ne plus revenir, Beaumont y révèle tout le mépris et la haine qu’il a pour lui. Saint-Martin devient alors vil, lâche, cupide et méprisable, et ce personnage textuel – puisqu’ils n’auront plus jamais de contact direct – remplit une nouvelle fonction dans la vie de Beaumont. Il n’est plus question de se soucier, en tant que médecin, du bien-être de Saint-Martin, qui n’a plus besoin de soins pour survivre, mais, en tant que scientifique empêché dans ses ambitions, de démontrer – et surtout de s’en plaindre – que son cobaye est à la fois un moins que rien et une nuisance.
L’un de ces documents est une demande de financement au Congrès américain formulée par Beaumont en 1834 pour qu’on le défraie des coûts qu’a engendrés jusqu’alors la présence de Saint-Martin dans sa vie. Étant donné les objectifs de sa requête (le financement) et les personnes à qui elle est adressée (les membres du congrès, et non des scientifiques), il noircit le portrait de Saint-Martin en fonction de ses besoins : « Alexis Saint-Martin […] était un habitant indigent du comté de Michillimackinac, territoire du Michigan – pas un soldat, mais dépendant entièrement de son labeur quotidien pour sa subsistance et son soutien, et sans proche ni ami pour prendre soin de lui ou subvenir à ses besoins dans l’infortune qui s’abattit sur lui[50]. » Selon ce portrait, Saint-Martin n’est donc plus un engagé de la American Fur Company vivant de ses gages, mais un misérable habitant des lieux, sans famille, ni collègues, ni soutien. Pourtant, les voyageurs formaient une communauté dynamique, avec ses structures hiérarchiques, son système d’entraide, sa culture, sa lingua franca et ses coutumes. Certes, comme ses collègues du bas de l’échelle dans le monde des voyageurs, Saint-Martin n’était ni riche ni privilégié. Mais Beaumont, afin de mettre l’accent sur sa propre magnanimité, le présente dans son mémoire comme encore plus démuni qu’il ne l’était avant l’accident.
Bien sûr, les événements rendent Saint-Martin dépendant de toute l’aide qu’on puisse lui apporter ; or les autorités décident après un an qu’un voyageur invalide ne mérite pas de telles dépenses. Elles le déclarent « indigent aux frais de la communauté[51] » et cherchent à le renvoyer au Bas-Canada dans le prochain canot à partir de Mackinac. Beaumont affirme avoir tout fait pour empêcher son départ, et avoir résolu,
en tant que seul moyen de sauver Saint-Martin d’une inévitable misère et de la mort, et d’arrêter le processus de son transport et de prévenir la souffrance qui s’ensuivrait, de le prendre avec sa propre famille, où tous les soins et l’attention que sa condition nécessitait lui ont été accordés. Saint-Martin était à ce moment, tel qu’auparavant évoqué, entièrement impuissant et souffrant des effets débilitants de sa blessure – démuni et dépouillé de tout[52].
Encore ici, Beaumont exagère et se garde bien de mentionner que Saint-Martin habitait alors chez une femme nommée Mary Lafleur[53], qui lui prodiguait les soins requis. La situation de Saint-Martin, bien que sérieuse, est encore assombrie par l’effacement de la communauté à laquelle il pouvait s’identifier et sur laquelle il pouvait s’appuyer dans sa détresse, ici celle des Canadiens français et des Métis – francophones qui habitaient Mackinac en permanence.
La dépréciation de Saint-Martin se poursuit par omission. Dans son mémoire, Beaumont ne dresse pas le portrait d’un homme fort et endurant, comme il le fait dans son livre dans le but de vanter ses prouesses médicales. Il se contente de mentionner sa guérison, tout en spécifiant qu’elle a nui à sa capacité à le garder à son service, puisque Saint-Martin ne nécessitait plus de soins pour sa survie et n’était plus qu’un objet de recherche. C’est ce qui explique pourquoi Beaumont affirme avoir payé son retour de Mackinac à Montréal en 1825, alors que Saint-Martin s’est en réalité enfui. En ajoutant ce faux déboursé à toutes les dépenses abondamment détaillées dans son mémoire afin d’être dédommagé, Beaumont a beau jeu de se plaindre de l’ingratitude de Saint-Martin. Rien de ce que son serviteur a pu accomplir pour lui comme tâches domestiques durant cette douzaine d’années – sans compter le travail de ménagère accompli par sa femme durant les deux années passées à Prairie du Chien – n’est considéré dans ses calculs : Beaumont n’aurait reçu « aucune autre indemnisation à ce moment que les remerciements d’un homme indigent pour lui avoir sauvé la vie[54] ». Dans ce mémoire, Saint-Martin est ainsi montré comme étant non seulement encore plus démuni qu’il ne l’était vraiment, mais incapable de reconnaissance envers son bienfaiteur. Preuve du contraire, il respectera la dette morale qui les unit en refusant de collaborer avec d’autres scientifiques jusqu’à la mort de Beaumont en 1853.
Il est manifeste que la dépersonnalisation et le morcellement de Saint-Martin par Beaumont, par lesquels le chercheur réifie son estomac comme s’il n’était pas le sien, ne sont pas que le fruit d’une posture scientifique. Beaumont considère réellement Saint-Martin comme un sous-homme, un inférieur qui lui appartient et dont il doit reprendre possession coûte que coûte après son départ. Il considère son refus de se soumettre à d’autres expériences comme une infâme injustice. Les deux premières rondes d’expériences ont été accomplies avec l’accord verbal de Saint-Martin, en fonction de cette dette morale occasionnée par le fait que Beaumont lui avait sauvé la vie et l’avait accueilli dans son foyer. Les suivantes, en revanche, l’ont été en vertu de contrats signés par Saint-Martin avec le X des analphabètes. Ces contrats stipulent qu’Alexis devra « servir le ci-haut mentionné William Beaumont, demeurer avec lui et le suivre où qu’il aille ou voyage, ou réside en quelque endroit du monde[55] », et que
le ci-haut mentionné Alexis, en tout temps durant la période mentionnée, lorsqu’ainsi le commandera ou le requerra le ci-haut mentionné William, se soumettra et participera par tous les moyens en son pouvoir aux expérimentations Physiologiques ou Médicales, et les encouragera […] et obéira et se conformera à tous les ordres ou expériences raisonnables et appropriés du ci-haut mentionné William, et les tolérera[56].
Que Saint-Martin ne comprenne pas ce discours légal dans une langue étrangère n’a pas d’importance. De par son X, il est maintenant un engagé, en fonction d’une servitude contractuelle, selon le sens de l’expression anglaise indentured servitude, et devra obéir, tolérer, se soumettre et se conformer, etc. Beaumont affermit encore son autorité sur lui en le faisant s’enrôler pour cinq ans, à compter de décembre 1832, dans la réserve d’ordonnance de l’armée américaine, pour l’avoir sous son commandement direct. Saint-Martin ne s’appartient plus, mais appartient à un individu en fonction de leurs ententes conclues privément, et à un État[57] en tant que domestique militaire.
Au moment où son cobaye part pour ne plus revenir, Beaumont jouit enfin de la notoriété en raison de son livre et est sollicité par des scientifiques d’Amérique et d’Europe. La perte de son sujet d’étude provoque chez lui une colère et une frustration qui, comme le révèle sa correspondance, l’accompagneront jusqu’à sa mort. Si certains de ses correspondants continuent de métonymiser Saint-Martin en le réduisant à son organe et sa fonction[58], ou le réduisent à un simple poids mort à livrer par bateau « comme du bagage[59] », pour Beaumont, Alexis Saint-Martin et sa famille sont désormais des animaux. Ce ne peut être plus clairement formulé que lorsqu’il écrit à William Morrison « pour [s]’enquérir de [s]on animal domestique spécial[60] », ou à son cousin de Plattsburgh Samuel Beaumont au sujet du refus de Saint-Martin de venir aux États-Unis sans sa famille : « Je dois l’avoir mort ou vif, avec ou sans son bétail[61]. » Au cours du reste de sa vie, Beaumont exprime sans retenue et de toutes sortes de manières son mépris envers « Alexis ce vieux fistuleux[62] », ce « gredin de Français[63] », cet « irresponsable dépravé – déloyal et réfractaire[64] », cet être si minable qu’on ne peut le regarder qu’avec dégoût et un tel sentiment de supériorité qu’il en est inconfortable (« si vous pouvez endurer la désagréable condescendance causée par la vue d’Alexis[65] », écrit-il à Morrison, qu’il sollicite pour réengager Saint-Martin). Beaumont est prêt à le laisser s’abîmer dans la pauvreté afin de pouvoir le récupérer, comme il l’écrit au chirurgien-général de l’armée américaine, Joseph Lovell :
Je n’ai pas pris note de ses communications, et je ne ferai aucune démonstration dans le but de l’obtenir à nouveau avant mon retour en automne (dont j’espère recevoir la permission sans faute), alors qu’il aura dépensé tout l’argent que je lui ai avancé pour soutenir sa famille durant l’année à venir, devenant ainsi misérablement pauvre et malheureux, et il voudra bien renier son ignoble obstination et sa vilenie, et alors je serai en mesure d’en reprendre possession[66].
Ce mépris s’exprime aussi par l’affirmation répétée que Saint-Martin n’agit que par son intention d’extorquer Beaumont, qu’il est mu par le mensonge[67], « jouissant des fruits de l’ingratitude et de l’injustice[68] ». Les offres monétaires de Beaumont pour l’attirer aux États-Unis ne sont que des « pots-de-vin pour sa cupidité[69] ».
Dans l’esprit de Beaumont, cet avilissement de Saint-Martin opère un renversement du pouvoir dans la relation qui les unit. Il se considère la victime de la vilenie, des demandes exagérées et des manigances de son cobaye. « J’ai évité ses desseins jusqu’ici[70] », se vante-t-il à son cousin Samuel dans son ultime lettre au sujet de Saint-Martin. Cette rhétorique qui le place lui-même dans une position de difficulté était déjà présente dans son mémoire au congrès (« votre mémorialiste non seulement a eu, avec trouble et dépenses, à fréquemment le rechercher au Canada après une absence imprévue de plusieurs années, mais a été obligé de lui payer de hauts salaires[71] »), et on la retrouve par exemple dans l’évaluation de son mémoire par les congressistes (le chairman Sewall regrette « [l]es sacrifices en temps et en argent du docteur Beaumont dans la poursuite de ces expériences[72] », et dans la réception de son livre (l’élu P. C. Fuller vante « les efforts et les sacrifices requis pour se procurer Saint-Martin[73] »). Avec ses interlocuteurs variés et dans ses appels réguliers à Saint-Martin pour qu’il lui revienne, Beaumont ne cesse de mentionner la déception et les préjudices qu’il lui cause. Ce ton victimaire apparaît dès la première lettre écrite à Lovell en 1834 après le départ définitif de Saint-Martin :
Une déception contrariante et un empêchement imprévu à Plattsburgh, en l’attente du retour de monsieur le sergent Saint-Martin chez moi, ont retardé mon arrivée ici de plusieurs semaines, et je suis maintenant mortifié de le déclarer absent sans permission. […] Cela m’a placé dans la plus déplaisante et contrariante des situations fâcheuses[74].
Ce même ton se maintient jusqu’à la dernière lettre qu’il écrira en désespoir de cause à son cobaye, adressée en français à « Mon ami » :
Alexis, tu sais ce que j’ai fait pour toi depuis tant d’années ; ce que j’ai tenté et suis toujours ardemment désireux de faire avec toi et pour toi ; de quels efforts, angoisses, expectatives et déceptions j’ai souffert en raison de ton insatisfaction de mes attentes. Ne me déçois plus ni n’abandonne les récompenses et les bienfaits qui te sont réservés[75].
Il n’est pas étonnant que Beaumont se perçoive lui-même comme le parti lésé dans cette relation. Saint-Martin n’existe que pour le servir, et donc, hors de cette fonction, il n’existe pas. À preuve son animalisation et son morcellement, à preuve les omissions de Beaumont dans son mémoire pour ignorer les communautés auxquelles il appartenait quand il le côtoyait (celle des voyageurs, celle des Canadiens français et des Métis francophones de Mackinac et de Prairie du Chien) et, quand il ne le côtoyait plus, son entêtement à l’empêcher de revenir avec sa famille. En l’isolant et le privant de ce qui fait de lui un sujet relationnel construit par son appartenance à des sphères collective et privée, en lui retirant même sa capacité à ressentir de la douleur comme on ignorerait celle d’un animal, il le prive de son humanité, de son identité : il n’est qu’un outil. Par conséquent, comme le poids de Saint-Martin dans la relation est nul, le plateau de la balance ne peut pencher que du côté de Beaumont, le seul à rencontrer des problèmes et à faire des sacrifices durant ses expériences, et à devoir surmonter quelque embûche pour accomplir ses exploits.
La longévité d’un sombre portrait
William Beaumont, dans la position d’autorité que lui confèrent ses statuts de chirurgien, de patron et de supérieur militaire, dresse donc un portrait unidirectionnel d’Alexis Saint-Martin. Sous sa plume, il est un personnage riche et contradictoire, à la fois étonnamment fort, endurant, résistant à la maladie, et porté sur la bouteille, sensible, fragile, aimant sa famille, affecté par de profondes souffrances physiques et morales. Ces derniers traits, révélant la complexité de la condition humaine de Saint-Martin, lui sont subséquemment retirés par Beaumont dans ses textes légaux et sa correspondance, laquelle laisse cours à sa haine et son mépris envers lui. Saint-Martin devient alors un personnage irresponsable, cupide, retors, laid, vil, obstiné, méprisable.
Ainsi, la représentation de Saint-Martin par Beaumont dans ses écrits non scientifiques est nettement plus dure que dans ses articles et dans son livre. D’ailleurs, Beaumont et ses interlocuteurs ne lui trouvent pas le moindre trait positif, ni dans sa personne même, ni dans les gestes qu’il pose, ni même dans ceux qu’il ne pose pas en se laissant étudier de manière si invasive durant « sa contribution passive à la science[76] », comme l’interprète en 1913 Jesse S. Myer, l’un des biographes apologistes de Beaumont. Chaque humain a ses faiblesses et ses défauts, et Saint-Martin n’en manquait certainement pas. Or, le portrait que Beaumont dresse de son cobaye manque justement de l’humanité et de la moindre empathie qui auraient permis de poser d’emblée leur relation comme ce qu’elle était vraiment, une relation de codépendance.
Si les évidentes questions éthiques soulevées par leur relation n’ont pas été abordées dans cet article, c’est parce que Beaumont lui-même ne se les posait pas, et donc que le corpus étudié n’en contenait pas d’emblée l’interrogation. En fait, le seul reproche que ses contemporains lui ont adressé est de ne pas avoir réussi à fermer entièrement la plaie ; ils n’ont pas remis en question leur relation de servitude spécifiquement médicale, ni la nature ou les effets des expériences accomplies. Ni la pratique ni l’époque n’admettaient un tel regard autocritique, et ce portrait négatif de Saint-Martin, peint par un homme dont on ne remettait pas le jugement en question, a fait autorité très longtemps. Par exemple, voici ce qu’écrivait le physiologiste Arno Luckhardt en 1939 à propos d’une lettre rédigée au nom de Saint-Martin et conservée dans les archives de Beaumont à l’Université de Chicago :
Facsimilé d’une lettre d’Alexis Saint-Martin écrite et adressée au docteur Beaumont pour l’illettré Saint-Martin par un copiste canadien inconnu (probablement le curé de la paroisse). Le texte traduit de cette lettre, représentatif de bien d’autres écrites par le patient et cobaye hargneux, irresponsable, cupide et ingrat à son bienfaiteur généreux, bienveillant et miséricordieux, se lit comme suit[77].
Le mépris qu’a durablement inspiré Saint-Martin dans l’imaginaire pourrait difficilement être plus explicite. Il faudra attendre les années 1950 pour qu’on commence à interroger l’éthique des expériences de Beaumont et qu’on cherche à nuancer le portrait unilatéral qu’il avait fait de Saint-Martin, notamment avec les travaux d’Edward Bensley, membre d’un comité affecté par la Société de physiologie du Canada à la reconnaissance de Saint-Martin dans l’histoire médicale, et ceux du médecin Sylvio Leblond dans les années 1960, un des rares Québécois à s’intéresser à Saint-Martin.
Ce portrait qu’a créé Beaumont de Saint-Martin, d’abord en le réduisant à une partie de son anatomie, métonymisé en seul estomac, puis en le décrivant à la fois comme surhumain et inhumain, est un artifice textuel bien éloigné de la réalité complexe et irréductible de la vie d’un homme, et que Beaumont a instrumentalisé pour construire son propre personnage : dans ses écrits publics, celui du docteur désintéressé, qui place la survie d’un condamné au-dessus de tout, et du scientifique débrouillard et persévérant ; dans ses écrits privés, celui de l’ambitieux chercheur brimé par son sujet d’expérimentation dans son parcours vers la gloire et la postérité. Beaumont n’avait pas de prétentions littéraires, et son écriture tendait vers d’autres objectifs que l’esthétique ou l’expérimentation de la forme. Mais à travers leurs fonctions scientifique, légale ou platement épistolaire, ses textes emploient divers mécanismes littéraires comme la focalisation interne (ici strictement unidirectionnelle, et jouissant au sens propre de l’autorité de l’auteur), la mythification, la manipulation d’un personnage tiré de la réalité et fait imaginaire, qui passe du statut de victime à celui de vilain. Un personnage qui, pour reprendre les termes de Danou cités plus haut, tire sa substance « des idéologies politiques et des fantasmatiques individuelles et collectives » de son contexte d’énonciation, et qui, par sa représentation lacunaire et caricaturale, démontre la méconnaissance de la culture canadienne dans les États-Unis du milieu du xixe siècle. Cette représentation initiale de Saint-Martin sera systématiquement reconduite dans la fiction biographique sur Beaumont avant qu’on tente, à partir des années 1970, et toujours avec les limites de la focalisation américaine, de redonner à Saint-Martin un peu de sa singularité et de son humanité.
Appendices
Note biographique
Maxime Raymond Bock a publié cinq oeuvres de fiction, dont les recueils de nouvelles Atavismes (2011, réédition chez Boréal compact en 2013), Les noyades secondaires (Cheval d’août, 2017), et le roman Morel (Cheval d’août, 2021). Il a complété un doctorat à l’Université de Montréal en 2020 avec une thèse intitulée Gilbert La Rocque, Montréal et la modernité pourrie. Bénéficiant d’une bourse du CRSH, il a été stagiaire postdoctoral à l’Université de l’Alberta en 2021-2022.
Notes
-
[1]
William Beaumont, Experiments and Observations on the Gastric Juice and the Physiology of Digestion, Plattsburgh, F.P. Allen, 1833. Je citerai la réédition de 1959 en facsimilé du livre de Beaumont (New York, Dover Publications). Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle EO, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[2]
« Beaumont is known as the father of gastric physiology » (William Beaumont Papers, 1812-1959, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, consulté le 24 juin 2022, URL : https://findingaids.nlm.nih.gov/repositories/ammp/resources/ beaumont131 ; je traduis). Toutes les traductions dans le présent article sont de moi.
-
[3]
William Osler, « William Beaumont. A Pioneer American Physiologist », The Journal of the American Medical Association, vol. 39, no 20, November 15, 1902, p. 1223-1231.
-
[4]
Reginald Horsman, Frontier Doctor: William Beaumont, America’s First Great Medical Scientist, Columbia, University of Missouri Press, coll. « Missouri Biography Series », 1996.
-
[5]
William Osler, « Backwood Physiologist », An Alabama Student and Other Biographical Essays, London, Oxford University Press, 1909, p. 126-152.
-
[6]
Gérard Danou, « Discours médical et corps malade. Quelle violence ? », dans Michel Porret (dir.), Le corps violenté. Du geste à la parole, Genève, Droz, coll. « Travaux d’histoire historico-politique », 1998, p. 273.
-
[7]
Pensons aux travaux de James Marion Sims en gynécologie sur des esclaves afro-américaines dans les années 1840. Beaumont n’était propriétaire d’aucun esclave, mais a entretenu durant les dernières décennies de sa vie à Saint-Louis, Missouri, une profonde amitié avec Robert E. Lee, qui deviendrait le général de l’armée confédérée durant la guerre de Sécession.
-
[8]
Journal of Cases in W. Beaumont’s Medical Practice, Including Earliest Descriptions of the Wounding of St. Martin, Recorded at Fort Mackinac, MI. November18, 1822 – January12, 1825, Saint Louis, Bernard Becker Medical Library Archives, Washington University School of Medicine, p. 12, consulté le 24 juin 2022, URL : http://digitalcommons.wustl.edu/beaumont_1812_1827/16.
-
[9]
Journal of Cases…, ouvr. cité, p. 12.
-
[10]
Journal of Cases…, ouvr. cité, p. 12.
-
[11]
« a body of facts » ; EO, p. 6. Entendre ici le mot « corps » dans son acception d’« ensemble », de « groupe », comme dans l’expression « corps diplomatique, corps enseignant », etc.
-
[12]
« Alexis St. Martin, who is the subject of these experiments, was a Canadian, of French descent, at the above mentioned time [1822] about eighteen years of age, of good constitution, robust and healthy. He had been engaged in the service of the American Fur Company, as a voyageur, and was accidentally wounded by the discharge of a musket, on the 6th of June, 1822 » ; EO, p. 9.
-
[13]
« youth », « man », « lad » ; EO, p. 9, 18, 20 et 125.
-
[14]
« The projecting portion of the stomach was nearly as large as that of the lung » ; « In five or six days there came away a cartilage, one inch in length » ; EO, p. 10 et 15.
-
[15]
« Je l’abandonnai en tant que sujet d’expériences physiologiques », affirme Beaumont après la première fuite de Saint-Martin en 1825, qui l’accompagnait durant une permission à Plattsburgh (« I gave him up as a lost subject for physiological experiment » ; EO, p. 18).
-
[16]
« From the month of April, 1823, at which time he had so far recovered as to be able to walk about and do light work, enjoying his usual good appetite and digestion, he continued with me, rapidly regaining his health and strength » ; EO, p. 16.
-
[17]
« In the spring of 1824 he had perfectly recovered his natural health and strength » ; EO, p. 17.
-
[18]
« il jouit d’une santé parfaite » (« he enjoyed perfect health » ; EO, p. 18) ; « sa santé était bonne » (« his health was good » ; EO, p. 19) ; « Il a été actif, athlétique et vigoureux ; pratiquant des exercices, mangeant et buvant comme les autres personnes actives et en santé » (« He has been active, athletic and vigourous; exercising, eating and drinking like other healthy and active people » ; EO, p. 20).
-
[19]
« Such has been this man’s condition and circumstances for several years past; and now he enjoys the most perfect health and constitutional soundness, with every function of the system in full force and vigour » ; EO, p. 20.
-
[20]
« he engaged with the Hudson Bay Fur Company, as a voyageur to the Indian country. He went out in out 1827, and returned in 1828; and subsequently laboured hard to support his family » ; EO, p. 18.
-
[21]
« gave him an outfit for himself, wife and children. They started in an open canoe, via the Mississippi, passing by St Louis, Mo; ascended the Ohio rive; then crossed the state of Ohio, to the Lakes; and descended the Erie, Ontario, and the River St. Lawrence, to Montreal, where they arrived in June » ; EO, p. 19.
-
[22]
« He was in a midst of the cholera epidemic, at the time it prevailed and passed through Canada, and withstood its ravages with impunity, while hundreds around him fell sacrifices to its fatal influence » ; EO, p. 19-20.
-
[23]
« suffered much less predisposition to disease than is common to men of his age and circumstances in life » ; EO, p. 20.
-
[24]
« […] bien que le voyageur fût petit, il était fort. Il pouvait pagayer quinze – oui, si nécessaire, dix-huit – heures par jour durant des semaines et blaguer au coin du feu à la conclusion du labeur de la journée. Il pouvait porter de 200 à 450 livres de marchandise sur son dos dans des sentiers de portage rocailleux à un rythme qui faisait haleter les accompagnateurs allèges dans leur tentative de ne pas se laisser distancer » (« […] though the voyageur was short, he was strong. He could paddle fifteen—yes, if necessary, eighteen—hours per day for weeks on end and joke beside the camp fire at the close of each day’s toil. He could carry from 200 to 450 pounds of merchandise on his back over rocky portage trails at a pace which made unburdened travelers pant for breath in their endeavor not to be left behind » ; Grace Lee Nute, The Voyageur [1931], St. Paul, Minnesota Historical Society, 1955, p. 131).
-
[25]
« Les hommes n’étaient pas souvent malades […] Cox, un Astorien et traiteur sur la côte pacifique, dit des hommes qu’ils profitaient d’une bonne santé et, à l’exception d’occasionnelles attaques de rhumatismes, étaient rarement affligés par la maladie » (« The men were not often sick […] Cox, an Astorian and a trader on the Pacific Coast, says of the men that they enjoyed good health and, with the exception of occasional attacks of rheumatism, were seldom afflicted with disease » ; Grace Lee Nute, The Voyageur, ouvr. cité, p. 91).
-
[26]
« […] ils étaient néanmoins très bavards, et indépendants dans leurs manières – des hommes du Nord-Ouest jusqu’à la moelle […] » ; « Il n’y a pas de vie aussi heureuse qu’une vie de voyageur ; aucune aussi indépendante ; aucun lieu que le pays indien où un homme puisse profiter de tant de variété et de liberté » (« […] they were, nevertheless, very talkative, and independent in their way—North-Westers to the backbone […] » ; « There is no life so happy as a voyageur’s life; none so independent; no place where a man enjoys so much variety and freedom as in the Indian country », etc. ; Grace Lee Nute, The Voyageur, ouvr. cité, p. 206 et 208).
-
[27]
« Il est alors entré à mon service » (« He now entered my service » ; EO, p. 19).
-
[28]
« En novembre 1832, il s’est encore engagé avec moi pour douze mois, dans le but de se soumettre expressément à une autre série d’expériences » (« In November, 1832, he again engaged himself to me for twelve months, for the express purpose of submitting to another series of experiments » ; EO, p. 20).
-
[29]
« Au printemps 1831, des circonstances firent que son retour avec sa famille au Bas-Canada à partir de Prairie du Chien était indiqué. J’ai mis un terme à son engagement envers moi pour cette période, sur la promesse qu’il reviendrait lorsque ce serait requis… » (« In the spring of 1831, circumstances made it expedient for him to return with his family from Prairie du Chien to Lower Canada again. I relinquished his engagement to me for the time, on a promise that he would return when required… » ; EO, p. 19).
-
[30]
« as a common servant » ; EO, p. 19.
-
[31]
« From that latter place, he returned to Canada, his native place, without obtaining my consent » ; EO, p. 18.
-
[32]
« The man absconded to Canada » (« Further Experiments on the Case of Alexis San Martin, Who Was Wounded in the Stomach by a Load of Buckshot », The Medical Recorder, vol. 9, no 1, January 1826, p. 97).
-
[33]
« unwilling to be experimented upon, though it caused him little pain or distress », William Beaumont, cité dans Jesse S. Myer, Life and Letters of Dr. William Beaumont, Saint-Louis, Mosby, 1912, p. 122. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LL, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[34]
« Its extraction is generally attended by that peculiar sensation at the pit of the stomach, termed sinking, with some degree of faintness, which renders it necessary to stop the operation » ; EO, p. 21.
-
[35]
« pain and distress at the pit of the stomach » ; EO, p. 251.
-
[36]
« it would be drawn down towards the pyloric end, its whole length, ten or eleven inches, occasioning considerable distress, vertigo, and a sense of sinking at the scrobiculus cordis » ; EO, p. 216.
-
[37]
At 2 o’clock, P.M., examined again—found the a la mode beef partly digested: the raw beef was slightly macerated on the surface, but its general texture was firm and entire. The smell and taste of the fluids of the stomach were slightly rancid; and the boy complained of some pain and uneasiness at the breast. Returned them again.
The lad complaining of considerable distress and uneasiness at the stomach, general debility and lassitude, with some pain in his head, I withdrew the string, and found the remaining portions of the aliment nearly in the same condition as when last examined; the fluid more rancid and sharp. The boy still complaining, I did not return them any more.
August 2. The distress at the stomach and pain in the head continuing, accompanied with costiveness, a depressed pulse, dry skin, coated tongue, and numerous white spots, or pustules, resembling coagulated lymph, spread over the inner surface of the stomach, I thought advisable to give medicine; and, accordingly, dropped in the stomach, through the aperture, half a dozen calomel pills, four or five grains each […] » ; EO, p. 126 (Beaumont souligne).
-
[38]
« Le dérangement des organes de la digestion, une légère excitation fébrile, la peur, ou quelque soudaine affection des passions causent une altération matérielle de son apparence. […] La peur et la colère freinent aussi ses sécrétions : la colère entraîne un afflux de bile dans l’estomac, qui nuit à ses propriétés dissolvantes » (« Derangement of the digestive organs, slight febrile excitement, fright, or any sudden affection of the passions, cause material alterations in his appearance. […] Fear and anger check its secretion, also:—the latter causes an influx of bile into the stomach, which impairs its solvent properties » ; EO, p. 86-87).
-
[39]
Par exemple, après avoir fait une ponction de suc gastrique « contaminé » par de la bile, Beaumont écrit : « Et ceci a été, je suppose, l’effet d’une violente colère qui a eu lieu autour du moment où a été retiré ce paquet. Cette expérience montre l’effet des passions violentes sur l’appareil digestif. Il a été estimé que la présence de bile, en cette occasion, est due à l’effet de la colère » (« And this I suppose to have been the effect of violent anger, which occurred about the time of taking out this parcel. This experiment shows the effect of violent passion on the digestive apparatus. The presence of bile, in this instance, was believed to be the effect of anger » ; EO, p. 153-154).
Après une autre expérience, il conclut que la colère et l’impatience ralentissent le processus digestif : « Une ou deux autres circonstances peuvent aussi avoir contribué à l’interruption du processus de digestion, comme la colère et l’impatience, qui ont été manifestées par le sujet durant cette expérience » (« Another circumstance or two, may also, have contributed to interrupt the process of digestion, such as anger and impatience, which were manifested by the subject, during this experiment » ; EO, p. 155).
-
[40]
« Après le déjeuner, il fit de l’exercice modéré. Vers midi, il marcha environ deux milles très rapidement. Après son retour à son logement, il lança son manteau et ressortit au grand air à nouveau. Peu de temps après, il commença à sentir des douleurs à la tête, etc. » (« After breakfast, he exercised moderately. About 12o’clock, M., he walked about two miles very quick. After his return to his lodging, he threw off his coat, and went in the open air again. Soon after which, he began to feel the pain in his head, &c. » ; EO, p. 175).
-
[41]
« Des sentiments d’impatience ont évidemment accéléré son pouls ici, en position dressée. Il était vexé d’avoir été privé quelques minutes de son déjeuner » (« Feelings of impatience here evidently accelerated his pulse, in the erect position. He was vexed at being detained a few minutes from his breakfast » ; EO, p. 184).
-
[42]
« the use of ardent spirits always produces disease of the stomach » ; EO, p. 276 (Beaumont souligne).
-
[43]
« appears to have been drinking liquor too freely » ; « St. Martin has been drinking ardent spirits, pretty freely, for eight or ten days past » ; « The free use of ardent spirits, wine, beer, or any intoxicating liquors, when continued for some days, has invariably produced these morbid changes [the diseased conditions of the coats of the stomach] » ; EO, p. 236, 237 et 239.
-
[44]
« my opinion Sir it is a great risk to give St. Martin $100 in his hand in Canada first thing they will do when they get the money, is to close himself and his family and as he his a Drunkard he may spend the rest before the start from this place, and then remain again as he did before » (cité dans Henry D. Janowitz, « Newly Discovered Letters Concerning William Beaumont, Alexis Saint-Martin and the American Fur Company », Bulletin of the History of Medicine, vol. 22, no 6, November-December 1948, p. 829-830. Désormais, les références à cet article seront indiquées par le sigle NDL, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[45]
« had become such an abandoned drunkard » ; LL, p. 283.
-
[46]
« utterly worthless » ; NDL, p. 831.
-
[47]
« When I came across [Saint-Martin] he was rather poor, living on a small, scanty farm in St. Thomas, and very much addicted to drink, almost a drunkard one might say » ; EO, p. xviii.
-
[48]
« confirmed [his] belief in the extent of mischief arising from [dieteticerror], particularly in young men exposed to the temptation of drinking » (Andrew Combe, « Concluding Remarks by the Editor », dans William Beaumont, Experiments and Observations, Edinburgh, MacClachlan and Stewart, 1838, p. 394-395).
-
[49]
Gérard Danou, « Discours médical et corps malade. Quelle violence ? », art. cité, p. 273.
-
[50]
« Alexis St. Martin […] was an indigent inhabitant of the county of Michillimackinac, Mich. Ter.—not a soldier, but dependent entirely on his daily labor for his subsistence and support, and without friend or relative to take care of or provide for him in the misfortune which befell him » (« To the Honorable, The Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled », 1834 ; LL, p. 212).
-
[51]
« common pauper » (« To the honorable… » ; LL, p. 212).
-
[52]
« as the only way to rescue St. Martin from impending misery and death, and to arrest the process of transportation and prevent the consequent suffering, by taking him into his own family, where all the care and attention were bestowed that his condition required. St. Martin was at this moment, as before intimated, altogether helpless and suffering under the debilitating effects of his wound—naked and destitute of everything » (« To the honorable… » ; LL, p. 212-213).
-
[53]
Ronald L. Numbers, « William Beaumont and the Ethics of Human Experimentation », Journal of the History of Biology, vol. 12, no 1, Spring 1979, p. 115.
-
[54]
« no other indemnification at present than the thanks of an indigent man for the preservation of his life » (« To the honorable… » ; LL, p. 214).
-
[55]
« serve, abide, and continue with the said William Beaumont, wherever he shall go or travel, or reside in any part of the world » (« Articles of agreement… », 16 octobre 1832 ; LL, p. 147).
-
[56]
« the said Alexis, will at all times during said term, when thereto directed or required by said William, submit to, assist and promote by all means in his power such Physiological or Medical experiments […] and will obey, suffer and comply with all reasonable and proper orders or experiments of the said William » (« Articles of agreement… » ;LL, p. 147-148).
-
[57]
C’est dans cet esprit de propriété étatique qu’un défenseur de Beaumont au Congrès américain, lors du débat sur son dédommagement, affirme dans une pétition signée par plus de deux cents élus que sans soutien financier à Beaumont, la chance de poursuivre ces recherches « serait pour toujours perdue pour notre pays » (« would be lost to our country forever » ; Edward Everett au Secrétaire Lewiss Cass ; LL, p. 229).
-
[58]
Il est, par exemple, « votre digesteur breveté » (« yourpatent digester ») écrit Hercules L. Dousman, un officier de la American Fur Company, à Beaumont le 13 novembre 1837 (LL, p. 243).
-
[59]
« the same as baggage » ; NDL, p. 831.
-
[60]
« to inquire about [his] special pet » (Beaumont à William Morisson, février 1842, Saint Louis, Bernard Becker Medical Library Archives, Washington University School of Medicine, consulté le 24 juin 2022, URL : http://digitalcommons.wustl.edu/beaumont_1842/10).
-
[61]
« I must have him dead or alive, with or without his live stock » (Beaumont à Samuel Beaumont, 4 avril 1846 ; LL, p. 283).
-
[62]
« that old fistulous Alexis » (Beaumont à Samuel Beaumont, 20 octobre 1852 ; LL, p. 292).
-
[63]
« rascally Frenchman » (Reginald Horsman, Frontier Doctor, ouvr. cité, p. 205).
-
[64]
« reckless reprobate—faithless & intractable » (Beaumont à W. G. Edwards, 31 janvier 1850, dans Reginald Horsman, Frontier Doctor, ouvr. cité, p. 289).
-
[65]
« if you can endure the disagreeable condescension of seeing Alexis » (Beaumont à William Morrison ; LL, p. 236).
-
[66]
« I have taken no notice of his communication, nor shall I make any demonstrations to get him again till I return in the fall (which I hope to be permitted to do without fail), by which time he will have spent all the money I advanced him to provide for his family for the year ensuing, become miserably poor and wretched, and be willing to recant his villainous obstinacy and ugliness, and then I shall be able to regain possession of him again » (Beaumont à Joseph Lovell, 31 juillet 1834 ; LL, p. 228).
-
[67]
Beaumont se permet même un petit poème à ce sujet : « Ce n’est qu’un aperçu des manières de Monsieur/ Ainsi va-t-il avec ses tours et ses mensonges/ pour lesquels il pense être bien payé » (« This’s just a snatch of Monsieur’s ways. / Thus go’s he on in tricks and lies, / And thinks to get well paid for it » [Beaumont à Joseph Lovell, 31 juillet 1834 ; LL, p. 228 ; Beaumont souligne].
-
[68]
« enjoying the fruits of ingratitude and injustice » (Samuel Beaumont à Alexis Saint-Martin, lui rapportant l’opinion de William Beaumont, 12 janvier 1835 ; LL, p. 235).
-
[69]
« a bribe to his cupidity » (Beaumont à Samuel Beaumont, 20 octobre 1852 ; LL, p. 292).
-
[70]
« I have evaded his designs so far » (William Beaumont à Samuel Beaumont, 20 octobre 1852 ; LL, p. 292).
-
[71]
« your memorialist had not only to be at the trouble and expense of frequently seeking him in Canada after an unexpected absence of several years, but was obliged to pay him high wages » (« To the Honorable » ; LL, p. 212 et 213).
-
[72]
« Dr. Beaumont’s sacrifices of time and money in the prosecution of these experiments » ; LL, p. 216.
-
[73]
« the efforts and the sacrifices required to procure St. Martin » ; LL, p. 206.
-
[74]
« A vexatious disappointment and an unexpected detention at Plattsburgh, awaiting Mons. Sergt. St. Martin’s return to me at that place, prevented my arrival here several weeks sooner, and now I have the mortification to report him absent without leave. […] This placed me in a most unpleasant and vexatious predicament » (Beaumont à Joseph Lovell, 31 juillet 1834 ; LL, p. 227-228).
-
[75]
« Alexis, you know what I have done for you many years since; what I have been trying and am still anxious and wishing to do with and for you; what efforts, anxieties, anticipations and disappointments I have suffered from your nonfulfilment of my expectations. Don’t disappoint me more, nor forfeit the bounties and blessings reserved for you » (Beaumont à Saint-Martin, 5 octobre 1852 ; LL, p. 291).
-
[76]
« his passive contribution to science » ; LL, p. 117.
-
[77]
« Facsimile of a letter by Alexis St. Martin written and addressed to Dr. Beaumont for the illiterate St. Martin by some unknown Canadian amanuensis (probably the parish priest). The translated text of this letter representative of many others written by the surly, irresponsible, pecunious, ungrateful ward and human guinea pig to his solicitous, merciful, and generous benefactor reads as follow » (Arno Luckhardt, « Medical History Collections in the United States and Canada. I. The Doctor Beaumont Collection of the University of Chicago », Bulletin of the History of Medicine, vol. 7, no 5, May 1939, p. 551).
Bibliographie
- BEAUMONT, William, Experiments and Observations, Edinburgh, MacClachlan and Stewart, 1838.
- BEAUMONT, William, Experiments and Observations on the Gastric Juice and the Physiology of Digestion, Plattsburgh, F.P. Allen, 1833 (facsimilé, New York, Dover Publications, 1959).
- COMBE, Andrew, « Concluding Remarks by the Editor », dans William Beaumont, Experiments and Observations, Edinburgh, MacClachlan and Stewart, 1838, p. 303-319.
- DANOU, Gérard, « Discours médical et corps malade. Quelle violence ? », dans Michel Porret (dir.), Le corps violenté. Du geste à la parole, Genève, Droz, coll. « Travaux d’histoire historico-politique », 1998, p. 273-286.
- HORSMAN, Reginald, Frontier Doctor: William Beaumont, America’s First Great Medical Scientist, Columbia, University of Missouri Press, coll. « Missouri Biography Series », 1996.
- JANOWITZ, Henry D., « Newly Discovered Letters Concerning William Beaumont, Alexis Saint-Martin and the American Fur Company », Bulletin of the History of Medicine, vol. 22, no 6, November-December 1948, p. 822-832.
- LEE NUTE, Grace, The Voyageur [1931], St. Paul, Minnesota Historical Society, 1955.
- LUCKHARDT, Arno, « Medical History Collections in the United States and Canada. I. The Doctor Beaumont Collection of the University of Chicago », Bulletin of the History of Medicine, vol. 7, no 5, May 1939, p. 535-563.
- MYER, Jesse S., Life and Letters of Dr. William Beaumont, Saint-Louis, Mosby, 1912.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, William Beaumont Papers, 1812-1959, Bethesda, Maryland, URL: https://findingaids.nlm.nih.gov/repositories/ammp/resources/beaumont131.
- NUMBERS, Ronald L., « William Beaumont and the Ethics of Human Experimentation », Journal of the History of Biology, vol. 12, no 1, Spring 1979, p. 113-135.
- OSLER, William, « Backwood Physiologist », An Alabama Student and Other Biographical Essays, London, Oxford University Press, 1909, p. 126-152.
- OSLER, William, « William Beaumont. A Pioneer American Physiologist », The Journal of the American Medical Association, vol. 39, no 20, November 15, 1902, p. 1223-1231.
- WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE IN ST.LOUIS, Journal of Cases in W. Beaumont’s Medical Practice, Including Earliest Descriptions of the Wounding of St. Martin, Recorded at Fort Mackinac, MI. November 18, 1822–January 12, 1825, Saint Louis, Bernard Becker Medical Library Archives, URL : http://digitalcommons.wustl.edu/beaumont_ 1812_1827/16.