Abstracts
Résumé
Cet article examine la représentation filmique de la Tchoukotka et de ses habitants depuis les premiers temps de l’image animée jusqu’aux films diffusés sur Internet. Ce siècle d’images filmiques de la Tchoukotka peut être divisé en trois grands moments. Le premier est celui du début du cinéma muet, où la Tchoukotka attire des opérateurs de divers horizons à la recherche d’images spectaculaires d’un bout du monde et de ses habitants « exotiques ». À partir de l’avènement du pouvoir bolchevique, et plus particulièrement de la période stalinienne, se met en place un répertoire de motifs globalement homogènes autour de la mise en scène de la libération des Tchouktches par le pouvoir. Le dernier moment, celui d’un cinéma autochtone de Tchoukotka, commence dans les années 1970 par le passage de l’écrivain tchouktche Iouri Rytkhéou au scénario, donnant naissance à un cinéma sibérien qui s’épanouira véritablement dans la période postsoviétique. Cette analyse sur le long terme permet de mettre au jour les ruptures et les continuités dans le régime de représentation, c’est-à-dire le répertoire d’images qui interagissent entre elles à un moment historique donné, de la Tchoukotka à l’écran. Elle permet également d’interroger dans sa complexité le long moment soviétique qui constitue une période où les Autochtones de Tchoukotka, souvent génériquement présentés comme Tchouktches, sont particulièrement présents sur les écrans et où, grâce à la politique soviétique de promotion des minorités, permet à l’un de ses représentant de passer derrière la caméra.
Mots-clés:
- Cinéma autochtone,
- cinéma soviétique,
- représentations des Autochtones,
- Iouri Rytkhéou,
- Tchoukotka à l’écran
Abstract
This article examines the filmic representation of Chukotka and its inhabitants from the earliest days of the moving image to the films distributed on the Internet. This century of filmic images of Chukotka can be divided into three main moments. The first is that of the beginning of silent cinema, when Chukotka attracted operators from various horizons in search of spectacular images of a faraway world and its “exotic” inhabitants. From the advent of Bolshevik power, and more particularly during the Stalinist period, a repertoire of globally homogeneous motifs was established around the staging of the liberation of the Chukchi by the authorities. The last moment, that of an indigenous cinema of Chukotka, begins in the 1970s with the shift of the Chukchi writer Yuri Rytkheu to the screenplay, giving birth to a Siberian cinema that will truly flourish in the post-Soviet period. This long-term analysis allows us to bring to light the ruptures and continuities in the regime of representation, i.e. the repertoire of images that interact with each other at a given historical moment, from Chukotka to the screen. It also makes it possible to question in its complexity the long Soviet moment in which the natives of Chukotka, often generically presented as Chukchi, are particularly present on the screen and in which, thanks to the Soviet policy of promotion of minorities, one of its representatives is able to pass behind the camera.
Keywords:
- Indigenous cinema,
- Soviet cinema,
- representations of indigenous people,
- Yuri Rytkheu,
- Chukotka on the screen
Аннотация
В данной статье рассматривается кинематографическое представление о Чукотке и ее обитателях с первых дней появления движущегося изображения до фильмов, распространяемых в сети Интернет. Этот век кинематографических образов Чукотки можно разделить на три основных периода. Первый – это зарождение немого кино, когда Чукотка привлекала операторов в поисках зрелищных образов края света и его «экзотических» обитателей. С приходом к власти большевиков, а особенно в сталинский период, вокруг инсценировки освобождения чукчей советской властью сложился репертуар глобально однородных мотивов. Последний период начинается в 1970-е годы с включением чукотского писателя Юрия Рытхэу в сценарную работу и рождением сибирского кино, которое будет процветать в постсоветский период. Этот многолетний анализ позволяет выявить разрывы и преемственности в режиме репрезентации, то есть репертуаре образов, взаимодействующих друг с другом в конкретный исторический момент, от Чукотки до экрана. Исследование подвергает критическому анализу кино о Чукотке в советскую эпоху – период, когда уроженцы Чукотки, часто представленные только как чукчи, присутствуют на экранах и когда, благодаря советской политике поощрения меньшинств у одного из представителей коренного народа появляется возможность пройти за камеру.
Ключевые слова:
- Аборигенное кино,
- советское кино,
- образы коренных народов,
- Юрий Рытхэу,
- Чукотка на экране
Article body
À l’instar de la littérature et des autres arts, le cinéma, en tant que producteur d’imaginaire, sert de révélateur de la place assignée aux autochtones dans une société donnée. À cet égard, les autochtones de Tchoukotka, souvent génériquement présentés comme Tchouktches, malgré la diversité des peuples dans la région, occupent une position singulière dans l’imaginaire cinématographique russe. Ils sont présents sur les écrans depuis les débuts du cinéma et constituent même la nationalité la plus représentée parmi celles qui composent la catégorie des « Petits Peuples du Nord[1] » pendant l’ère soviétique. C’est aussi la seule de ces nationalités qui verra un de ses représentants, Iouri Rytkhéou[2], en position de créateur d’oeuvres filmiques durant cette période (en tant que scénariste). L’ère postsoviétique, durant laquelle émergent des cinémas sibériens, est enfin celle de la prise en main de la caméra par des cinéastes autochtones natifs de Tchoukotka. Cet article examine la représentation filmique de la Tchoukotka et de ses habitants depuis les premiers temps de l’image animée jusqu’aux films diffusés sur Internet en confrontant les films (quand ils ont été conservés) aux sources « non-film ». Ce terme désigne les archives extérieures au film et qui lui sont reliées dans les processus de production et de réception. Inédites (dossier de production, scénario, etc.) ou imprimées (presse, matériel publicitaire, récits de cinéastes, etc.) et conservées dans diverses institutions en Russie, leur recours donne la possibilité de reconstituer le contenu et le parcours des films et de contextualiser les représentations à l’oeuvre. Une analyse sur le temps long permet de mettre au jour les ruptures et les continuités dans le régime de représentation, c’est-à-dire le répertoire d’images qui interagissent entre elles à un moment historique donné (Hall 2003), de la Tchoukotka à l’écran.
Durant plus d’un siècle d’images filmiques, trois grands moments se détachent. Le premier est celui du début du cinéma muet, avant la révolution d’Octobre, où la Tchoukotka attire des opérateurs de divers horizons à la recherche d’images spectaculaires d’un bout du monde et de ses habitants « exotiques ». L’avènement du pouvoir bolchevique constitue un deuxième temps, durant lequel la Tchoukotka devient le territoire réservé des cinéastes soviétiques. La période stalinienne met en place un répertoire de motifs globalement homogènes autour de la mise en scène de la libération des Tchouktches par le pouvoir soviétique. Le Dégel qui suit est l’occasion d’une révision profonde du récit canonique stalinien alors que l’espace arctique au cinéma est investi par la thématique de la guerre froide. Enfin, le troisième moment, celui d’un cinéma autochtone de Tchoukotka, commence dans les années 1970 par le passage de l’écrivain tchouktche Iouri Rytkhéou au scénario, donnant naissance à un cinéma sibérien qui s’épanouira véritablement dans la période postsoviétique.
Les Autochtones de Tchoukotka : une figure de l’« Autre » au cinéma
Dès les premiers temps du cinématographe, le Nord, à l’instar des « lointains » exotiques, apparaît comme une destination prisée pour les opérateurs (Kaganovsky, MacKenzie et Westerståhl Stenport 2019). En Russie, il devient un sujet de film dès 1908 avec Dans le Nord lointain (Na dal’nem/krajnem severe), produit par la compagnie commerciale Drankov (Višnevskij 1996). Les premiers films d’expédition, à visée scientifique, éducative ou exotique, apparaissent dès les années 1910. La Tchoukotka est visitée avec une caméra en 1913 lors d’un voyage au-delà du cercle polaire à bord du bateau Kolyma, vers le détroit de Béring et le Kamtchatka. Les images tournées par l’opérateur Fedor Bremer pour la compagnie Khanjonkov seront exploitées en plusieurs films : Vie du Nord (Žizn’ severa, 1914), Au pays des Tchouktches (V strane čukčej, 1916) et Voyage au détroit de Béring (Putešestvie po beringovomu prolivu, 1916). Bremer a relaté ce tournage dans un magazine publié par la production : il y décrit les Autochtones avec un certain mépris, comme « inférieurs à la race blanche » (Sarkisova 2014, 224). Seul Vie du Nord a été conservé[3]. Le film montre les interactions entre l’équipage et les Autochtones. Les images sont souvent statiques mais usent aussi de panoramiques et de travellings depuis le bateau en mouvement, parfois appuyés par un sur-cadrage en forme de jumelles. De ce fait, elles renforcent la distance entre le filmeur russe et les filmés autochtones, et augmentent pour le spectateur l’impression de ne faire que passer (Sarkisova 2019, 232-233).
Les Russes ne sont pas les seuls à tourner en Tchoukotka. À l’été 1917, l’archéologue et anthropologue finnois Sakari Pälsi prend des vues en complément de ses observations ethnographiques lors d’une expédition au détroit de Béring, dans la région de l’Anadyr et au Kamtchatka[4]. Spécialiste de l’Âge de pierre, Pälsi se rend chez les Autochtones de Tchoukotka, les voyant comme des représentants contemporains de la préhistoire. Pourtant, ses images montrent une réalité plus nuancée. On sent l’effort de Pälsi à documenter de manière relativement systématique la vie des Autochtones, anticipant un certain regard du cinéma ethnologique : il capte des techniques de pêche, le montage d’une iaranga (habitat en peau), des jeux traditionnels (comme le jeu de balle ou la lutte), la fabrication de vêtements, la gravure sur ivoire, etc. Mais il filme aussi toute une série d’activités qui témoignent de contacts permanents avec les sociétés russe et japonaise : des Autochtones installés dans une tente occidentale, d’autres qui travaillent dans une pêcherie proto-industrielle, la présence d’un chercheur d’or estonien, etc.
Avant la révolution bolchevique, la Tchoukotka est sillonnée par les expéditions cinématographiques venues notamment d’Amérique. En 1913, l’expédition Harvard-Smithsonian s’adjoint les services de l’opérateur d’actualités Will E. Hudson pour tourner en Tchoukotka et au Kamtchatka (Figure 1.)
Figure 1
L’opérateur Will E. Hudson en Tchoukotka en 1913
Presque au même moment, le sauvetage d’une autre expédition dirigée par l’explorateur canadien Vilhjalmur Stefansson fait l’objet d’un film présenté comme « éducatif », The Rescue of the Stefansson Arctic Expedition (1914). Les images, tournées par l’opérateur Fred L. Granville, s’attachent aux animaux sauvages et aux populations locales, assimilées à des « Indiens », comme le proclame une publicité évoquant une « squaw tchouktche » (Anon 1914). Toujours dans la veine du cinéma instructif, la série de films en couleurs Siberia, The Vast Unknown (réal. inconnu, 1916) produite par Pathé emmène le spectateur depuis l’Alaska jusqu’en Kolyma. La série, qui décrit les coutumes de la « tribu des Tchouktches » dans son deuxième épisode, est distribuée jusqu’en Amérique latine (Iglesias 1916).
Dans une optique plus ouvertement spectaculaire, il faut signaler l’aventurier Frank E. Kleinschmidt, immigré allemand installé en Alaska. Ses films, tournés des deux côtés du détroit de Béring, mettent en avant le caractère sauvage du Grand Nord et la mise en scène héroïque de soi grâce notamment au motif de la chasse au gros gibier où la capture de l’ours polaire constitue l’attraction principale (H.F.H. 1912). Lors de ses expéditions, Kleinschmidt n’hésite pas à accoster en Tchoukotka et nomme sa compagnie Alaska-Siberia Motion Pictures. Son premier film, Carnegie Museum Expedition (1912), réalisé sous le patronage du très sérieux Muséum d’Histoire Naturelle Carnegie de Pittsburgh, est un succès. Dix ans plus tard, Captain Kleinschmidt’s Adventures in the Far North (1922) relate sept mois de voyage avec sa femme à bord du Silver Screen. Toujours à la recherche d’animaux polaires, l’expédition fait escale en Tchoukotka, territoire devenu soviétique mais encore en guerre civile (Morgan 2011, 34-35). Le film dépeint « les moeurs des chasseurs sanguinaires habitant les forêts arctiques » (Mirbel 1923) qualifiés indistinctement d’« Eskimos » dans les articles de l’époque.
Tous ces regards restent ceux d’Occidentaux qui voient les Autochtones de Tchoukotka comme une figure exotique de l’altérité extrême. Le cinéma muet cultive un certain goût pour les paysages grandioses de l’Arctique. Deux ans après sa dernière expédition, Kleinschmidt repart en Tchoukotka avec l’explorateur danois Knud Rasmussen pour un nouveau film cette fois centré sur la vie quotidienne d’un Inuk, influencé par l’approche de Robert Flaherty qui vient de triompher sur les écrans avec Nanouk l’Esquimau (Nanook of the North, 1922). Mais cette fois-ci, les autorités soviétiques interdisent à l’équipe de mettre pied à terre avec une caméra ou de parler aux Autochtones sans la présence d’un soldat de l’Armée rouge. Elles confisquent la pellicule (Morgan 2011, 38-39). Car, maintenant la guerre civile apaisée, les bolcheviks entendent marquer leur territoire et seuls les cinéastes soviétiques tourneront en Tchoukotka.
Des fictions au service du récit « soviétisateur »
La rupture révolutionnaire marque par ailleurs un autre changement significatif pour les Tchouktches au cinéma : ils vont pour la première fois devenir des personnages de fiction. C’est, en effet, véritablement après la révolution d’Octobre que le cinéma s’intéresse aux peuples autochtones de Sibérie et du Nord autrement que dans le rôle de l’« Autre » générique et de l’espace exotisant des films d’expédition. Pour le nouveau régime, intégrer ces peuples à la fiction signifie d’une certaine façon les intégrer à l’Union soviétique, où toutes les nationalités sont censées désormais être sur un pied d’égalité. Les incorporer à une histoire signifie aussi les faire entrer dans l’histoire. Leur introduction dans la fiction est le fait d’un régime révolutionnaire qui se veut en rupture avec le passé, notamment dans sa politique des nationalités. Dès leur accession au pouvoir, les bolcheviks entendent « résoudre » la question nationale, en partie pour conserver le pouvoir sur le territoire de l’ex-empire et s’assurer du soutien des peuples non-russes. Il s’agit non seulement de promouvoir des peuples opprimés par le biais d’une « discrimination positive » (Martin 2001), mais aussi de donner des entités ethno-territoriales à ces groupes en fonction de leur position sur l’échelle des stades de développement vers la « modernité » communiste afin d’accélérer le processus historique et de faire à terme disparaître les différentes nations, qui se fonderaient alors en un unique peuple communiste (Hirsch 2005). Sous l’impulsion de la nouvelle politique bolchevique des nationalités, le cinéma soviétique fait des représentants des peuples du Nord des personnages individualisés (au lieu de les restreindre à de simples « types » ethnographiques) : ils sont désormais nommés même s’ils restent stéréotypés. Parmi les peuples autochtones, les Tchouktches sont les plus représentés sur les écrans de cinéma et de télévision durant la période soviétique[5]. Ils apparaissent comme personnages principaux dans neuf films (et téléfilms) de fiction, réalisés entre 1934 et 1982 sur un total de 30 fictions représentant les peuples du Nord (Damiens 2017, 676). La position géographique des Autochtones de Tchoukotka, à l’extrême Nord-Est du continent, la plus éloignée du centre politique russe, ainsi que leur farouche résistance à la colonisation russe au XIXe siècle (Forsyth 1992) expliquent peut-être cette surreprésentation : ils représentent une altérité absolue, l’exotisme par excellence, et à ce titre leur intégration au mode communiste témoigne de la puissance de l’URSS.
Durant la période stalinienne (qu’on délimitera ici comme allant de 1928, le Grand Tournant, à 1953, la mort de Staline), les Tchouktches sont le sujet de quatre films Djou (Džou, Alexandre Litvinov, 1934), Je veux vivre (hochu žit’, Alexandre Litvinov, 1934), Les Romantiques (Romantiki, Mark Donskoï, 1941), et Alitet s’en va dans les montagnes (Alitet uhodit v gory, Mark Donskoï, 1950)[6]. Résultat de la première expédition cinématographique soviétique en Tchoukotka, dirigée par Alexandre Litvinov en 1932-1933, les deux premiers ne sont malheureusement pas conservés. Avant cela, seul le film de montage Au-delà du cercle polaire (Za poljarnym krugom, Vladimir Erofeev et Vera Popova, 1927) met en scène la Tchoukotka. L’oeuvre réutilise les images tournées par Bremer en 1913-1914 en leur donnant un sens nouveau. Le nouveau montage met en avant une communication permanente au-delà des frontières ethniques, culturelles ou politiques (Sarkisova 2014, 227). Les autres films sont tournés en studio ou extérieur loin de la Tchoukotka[7]. Si les Tchouktches sont absents des films de fiction des années 1920 qui regorgent pourtant de héros représentants des « Petits Peuples du Nord » à la fin de la décennie (citons Le Toungouse de Khènytchar [Tungus s Hènyčara, Manuel Bolchintsov, 1928], Le Vengeur [Mstitel’, Boris Chpis, 1930], Igdenbou [Igdenbu, Amo Bek-Nazarov, 1930], etc.), ils vont être de plus en plus régulièrement présents sur les écrans, à mesure que les autres nationalités autochtones du Nord disparaissent de la fiction pour rester cantonnées dans le documentaire. Les Tchouktches vont ainsi représenter à la fois leur peuple et, par extension, les peuples autochtones minoritaires du Nord sur la longue durée. En effet, lorsqu’on examine les représentations dans les fictions soviétiques, on constate que les différents peuples du Nord y constituent une catégorie homogène. Les films ne mettent pas en avant leur différence, mais, au contraire, construisent un récit de libération qui reprend les mêmes motifs cinématographiques selon un grand récit de l’avant/après la révolution.
Le régime de représentation cinématographique de la période stalinienne constitue une variation de l’intrigue matricielle mise en place par le réalisme socialiste en littérature au début des années 1930. Parmi les invariants de ce récit, on trouve la transformation du héros qui, sous la direction d’un mentor idéologique, passe d’un état de spontanéité à la conscientisation, au sein d’un espace-temps « schizophrénique » qui oscille entre le présent et les signes d’un futur utopique dans le présent (Clark 2000). Ainsi le régime qui se met en place au cinéma à propos des Tchouktches n’est pas fondamentalement éloigné du récit identifié en littérature[8] par Yuri Slezkine (1994), qu’il nomme « Le Long Voyage des Petits Peuples » :
[Ces] « Longs Voyages » commencent habituellement avec l’arrivée d’un ou plusieurs Russes : un détachement de partisans, un instituteur, un médecin ou un instructeur du Parti. Ils arrivent et prononcent des discours […]. Les Autochtones ne comprennent pas toujours la signification des mots mais ressentent toujours leur sincérité et la vérité supérieure qu’ils révèlent. Un mot – « Lénine » – a un effet particulièrement puissant. Il exprime toutes les belles choses dont ont été privés les autochtones depuis si longtemps[9].
Slezkine 1994, 293-294
Au cinéma, cette rhétorique du « contact libérateur » avec les bolcheviks se décompose en plusieurs motifs qu’on retrouve de films en films : l’insatisfaction générée par la société traditionnelle, le sauvetage par les bolcheviks, la seconde naissance des Autochtones et le commerce équitable comme rétablissement de la justice. Si j’insiste sur la description de ce récit « soviétisateur » stalinien, c’est parce qu’il se trouve à la base des représentations post-staliniennes, notamment celles des films autochtones qui s’attacheront à les réfuter.
Le motif de l’insatisfaction qui justifie la Révolution est central dans la mise en narration du socialisme. En effet, le grand récit du cinéma soviétique est constitué par la Révolution et ses causes. Ce motif s’inscrit, par ailleurs, dans la fable de la liquidation de l’arriération, l’un des grands mythes du stalinisme (Fitzpatrick 2002, 24-26). Dans le cas des peuples autochtones du Nord, qui ne sont pas le moteur du processus révolutionnaire et qui ont pu s’y opposer (Leete 2005), il s’agit de plaquer ce motif sur les sociétés autochtones. En montrant une société en état de dysfonctionnement, en proie à la famine ou au malheur, exploitée par des personnages issus de ses rangs (qui sont des émanations du capitalisme émergeant), les oeuvres filmiques légitiment l’interventionnisme bolchevique dans les cultures autochtones. Dans le cas des Tchouktches, cela passe particulièrement par la dénonciation du rituel de mort volontaire, sorte d’euthanasie selon laquelle une personne d’un âge avancé demande à mourir des mains de ses proches, le plus souvent par strangulation. Dans la société tchouktche, le rituel est perçu comme une manière de perpétuer la vie : la personne qui demande à mourir, ayant assuré sa descendance sur deux générations, doit quitter la vie afin d’assurer la circulation des âmes et le renouvellement des générations en accord avec la conception du cycle de vie tchouktche (Vaté 2003). Dans Les Romantiques ou Alitet s’en va dans les montagnes, la pratique de la mort volontaire est transformée en conséquence directe de la famine causée par l’exploitation et l’oppression, à laquelle il suffit de mettre un terme pour qu’elle apparaisse comme la démonstration d’une société qui ne fonctionne pas. Cette mise en scène d’une société en manque sert la vision téléologique du contact libérateur bolchevico-autochtone.
Au sein de ce récit de libération, la mission de sauvetage que s’est attribuée l’Union soviétique envers des peuples qu’elle perçoit au bord de l’extinction (ils sont en effet désignés « peuples moribonds ») est fictionnalisée. Également célébré dans la littérature (Bogoraz-Tan 1935 ; Sangi 1983), le sauvetage historique des peuples du Nord est pris au pied de la lettre par les scénarios. La première rencontre des personnages tchouktches et bolcheviques montre souvent un Autochtone dans une situation de péril imminent, d’où le sauve littéralement un bolchevik. C’est le cas dans Les Romantiques où le héros tchouktche aux prises avec un ours blanc est sauvé in extremis par le tir du bolchevik russe qui vient installer une base culturelle dans la région, unissant dans le même mouvement soviétisation et secours[10] (Figure 2).
Figure 2
Le sauvetage par les bolcheviks
Les études décoloniales nous apprennent que la rhétorique du sauvetage est avant tout celle de la nouveauté et de la modernité (Mignolo 2011). De même nature que celle qui opérait par la conversion religieuse hier et opère encore par le « développement » à l’heure actuelle, elle prend la forme de la soviétisation pour les peuples du Nord dans les années 1920-1930. L’URSS se veut une modernité alternative par rapport au modèle capitaliste dont elle entend se distancer. La politique soviétique des nationalités est ainsi célébrée comme ayant évité aux peuples du Nord le génocide des peuples amérindiens en contexte capitaliste (Sergeev 1955). Poussé à l’extrême, le marxisme peut être lu comme une eschatologie (avec la création de l’« Homme nouveau », promis par Marx, comme signe de la fin de l’histoire et du salut de l’humanité) que l’expérience soviétique a tenté de mettre en oeuvre (Halfin 2000). Dans les films, le sauvetage aboutit à une seconde naissance qui figure l’entrée des Tchouktches dans la modernité. Ce qui, par contrecoup, a pour effet de proclamer la mort des cultures autochtones. Alitet s’en va dans les montagnes met en scène ce motif par la figure d’un vieil homme tchouktche, nommé Vaal, qui ressuscite (il est ranimé par le médecin russe après le rituel de mort volontaire[11]) sous le nom de Vladimir, prénom russe qui est surtout celui de Lénine[12]. Par ce nouveau baptême, le film traduit cinématographiquement la politique des nationalités : mourir pour renaître soviétisés, voilà le destin présenté aux cultures autochtones.
Un dernier motif du régime de représentation des Tchouktches, que je nommerai le « commerce équitable », est aussi l’un des plus répandus. Représentée de façon presque incontournable en réponse à la scène du « commerce inéquitable », c’est-à-dire la vente de précieuses fourrures à des marchands malhonnêtes (nommés « accapareurs » dans le parler soviétique) qui les paient à vil prix, la scène du commerce équitable illustre le rétablissement de la justice dans le Nord en payant le juste prix aux trappeurs des taïgas et des toundras, désormais « travailleurs » soviétiques (Figure 3).
Figure 3
Le commerce équitable
Figure filmique centrale du rapport entre le pouvoir et les Autochtones, elle se veut l’incarnation du bon gouvernement soviétique. Mais il faut noter que ce motif du juste prix des peaux n’est jamais mis en relation avec la pratique du « iassak », l’impôt spécifique en fourrure que les peuples du Nord devaient en allégeance au tsar russe (Forsyth 1992, 36-45 ; Slezkine 1994, 11-31). Cette pratique a constitué l’essence de l’exploitation des peuples de Sibérie et du Nord par les Russes depuis le XVIIe siècle et n’a été abolie qu’en 1917, suite à la révolution de Février. La fourrure a constitué un des moteurs de l’expansion russe vers l’est, et le iassak, face sombre de cette expansion, a eu des conséquences parfois dramatiques pour les populations autochtones de Sibérie, menant certains peuples près de l’extermination pendant qu’il remplissait les caisses de l’État russe (Chichlo 1999 ; Etkind 2011, 72-90). La scène du commerce équitable est remarquable par sa répétition filmique[13], mais également par sa cécité quant à l’impôt impérial. Si le commerce des fourrures est un motif d’exploitation des peuples du Nord « conforme » à l’histoire, il est frappant en revanche que les films n’accusent jamais l’État russe de cette exploitation. Les personnages qui accaparent les précieuses peaux sont souvent des étrangers ou des marchands russes agissant pour leur propre compte. Cet aveuglement face au phénomène impérial agit comme un symptôme : les films montrent le rétablissement de la justice, mais évitent d’accabler le pouvoir russe, comme pour ne pas avoir à désavouer l’oeuvre néo-impérialiste et coloniale qu’est la soviétisation des territoires non russes de l’Union. Peut-être aussi parce que la fourrure est un élément indispensable à l’économie : une marchandise à haute valeur d’échange sur le marché international dont il faut absolument conserver le monopole d’exportation[14]. Paradoxalement, tout en mobilisant la rhétorique avant/après, les films évitent d’établir une comparaison avec l’ancien régime, qui pourrait être défavorable aux bolcheviks.
Réviser les récits soviétisateurs, rejeter les Autochtones hors de l’histoire
À la mort de Staline s’ouvre la période du Dégel et de la déstalinisation ; elle introduit une révision du stalinisme, qui ne remet pas en question totalement l’idéologie marxiste-léniniste, mais prône notamment un retour aux thèses léninistes de l’internationalisation. Ainsi, au cinéma, le motif de la Révolution est revisité afin de mieux restaurer l’esprit révolutionnaire (Prokhorov 2001). Réalisé en 1966, Le Chef de la Tchoukotka (Načal’nik Čukotki, Vitali Melnikov) est l’un des nombreux films planifiés pour commémorer le cinquantenaire de la révolution d’Octobre. Contrairement à la plupart des films de ce « sous-genre », Le Chef de la Tchoukotka est un succès et est certainement encore à ce jour le film le plus populaire sur la Tchoukotka. Si le réalisateur et les scénaristes (Viktor Viktorov et Vladimir Valoutski) ont choisi la Tchoukotka, c’est avant tout parce que c’est l’un des derniers espaces du pays qui n’avait pas « son » film sur l’arrivée du pouvoir bolchevique produit spécialement pour le jubilé (Mel’nikov 2011, 224). Le choix du Grand Nord offre aux cinéastes un espace « vierge » qui permet de réviser le récit révolutionnaire canonique, où la neige fonctionne comme une page blanche. La problématique des nationalités est laissée de côté et semble surtout un prétexte pour donner un contexte à la comédie. Cela apparaît dès le générique où les noms des comédiens sont divisés en trois catégories, les « nôtres », les « contre-révolutionnaires » et les « citoyens de Tchoukotka ». Annonçant le récit qui suit, le générique met en place deux forces historiques qui s’opposent : les bolcheviks et les contre-révolutionnaires. Rejetés hors de la dynamique historique, les « citoyens de Tchoukotka » sont le plus souvent dans une position passive quant aux événements qui ont lieu dans leur village. Ils sont les spectateurs d’une histoire qui se joue largement sans eux. Plus important, bien que « citoyens », ils ne font pas partie des « nôtres », groupe avec lequel le film identifie ses héros comme ses spectateurs. Les autochtones sont de fait à nouveau relégués dans la catégorie des « Autres » et, en conséquence, ne sont pas véritablement intégrés au récit.
À travers son climat (caractérisé par le froid) et son environnement particulier (la glace et la neige), la Tchoukotka est avant tout ici un espace arctique envisagé comme le site privilégié de l’imaginaire culturel de la guerre froide (Westerståhl Stenport 2014). Et, bien sûr, le détroit de Béring est aussi le lieu de la frontière immédiate entre les deux blocs. À ce titre, Le Chef de la Tchoukotka offre une version comique de la vision de l’espace arctique comme lieu de rencontre et de collision de deux mondes idéologiques. Même avec une attention moindre aux habitants autochtones, l’intrigue du Chef de la Tchoukotka reprend largement le récit du contact libérateur élaboré dans les films précédents. Toutefois, le film utilise le ton comique pour mettre le discours soviétisateur à distance. Enfin, bien que le choix du lieu de l’action soit, d’après les auteurs du film, dû au hasard, il est difficile de ne pas faire le lien entre cette vision parodique et l’émergence au même moment (années 1960-1970) des Tchouktches comme anti-héros privilégiés des blagues soviétiques (Graham 2003, 191-202 ; Regamey 2007, 104-107). L’humour se sert ici des Tchouktches comme des représentations d’un extrême géographique et culturel à la fois pour démontrer l’échec de la soviétisation et pour exprimer une défiance, voire un rejet de l’égalitarisme multinational soviétique.
Iouri Rytkhéou scénariste : des films soviétiques du point de vue tchouktche
C’est vers la télévision qu’il faut se tourner pour trouver des films qui présentent un point de vue intérieur sur les Tchouktches. Le passage de l’écrivain tchouktche Iouri Rytkhéou de la littérature à l’écriture de scénario à la fin des années 1960 est l’occasion de la naissance d’un cinéma autochtone en URSS ouvrant la possibilité d’une « souveraineté visuelle » (Raheja 2010) dans le nouveau territoire des images animées qu’est la télévision. Ce passage d’un medium à l’autre se situe en effet, d’une part, dans le sillage des « nouvelles vagues » centrasiatiques des années 1960, où des cinéastes nationaux mobilisent histoires, traditions et mythologies nationales pour mieux les revisiter (Abikeeva 2006, 49-97) ; et d’autre part, correspond au « sursaut identitaire » (Pitiot 2003, 81) qui s’exprime dans la littérature autochtone de Sibérie au même moment. En janvier 1973, la Télévision centrale soviétique diffuse Les Plus Beaux Bateaux (Samye krasivye korabli, Anatoli Nitotchkine, 1972), un téléfilm en deux parties sur un scénario de Rytkhéou, adapté d’un de ses écrits. Il s’agit du premier film soviétique où non seulement un Tchouktche, mais aussi un représentant des peuples autochtones du Nord, se trouve à l’un des postes créatifs clés. En effet, bien que Rytkhéou ne signe pas le film en tant que réalisateur et que l’oeuvre soit produite par l’unité de création Èkran, studio de téléfilms émanant du Comité d’État pour la radio et la télévision (Gosteleradio), on peut considérer ce film comme point de départ du cinéma autochtone sibérien si l’on prend en compte la dimension collaborative caractéristique de la création filmique[15]. Ce faisant, l’oeuvre marque un début de réappropriation du contrôle de l’image et du regard sur soi, rompant avec des décennies de représentations exogènes. Le film est réalisé à un moment charnière dans la biographie de Rytkhéou : quand celui-ci prend ses distances avec la célébration de la soviétisation et réévalue sa propre tradition. Écrivain à l’identité fracturée et à la position ambivalente quant à la soviétisation (Barker 1993), Rytkhéou est un personnage controversé, défenseur ardent du régime, et dont les premiers écrits offrent une vision positive de la soviétisation, quitte à renier les traditions de son peuple.
Les Plus Beaux Bateaux raconte l’histoire de Vèkèt, jeune Tchouktche qui, à l’issue de sa scolarité en Tchoukotka, ne souhaite pas quitter sa terre pour faire des études, mais devenir éleveur de rennes. Il se rapproche de son oncle éleveur (incarné par Rytkhéou lui-même, acteur pour l’unique fois de sa carrière) et se fait embaucher dans une brigade. Il rencontre Vaïke, jeune étudiante estonienne en arts plastiques venue en Tchoukotka peindre des tableaux. Ils tombent amoureux. Quand Vaïke est rappelée à Leningrad, Vèkèt la rejoint. Mais, une fois sur place, il découvre qu’il ne peut vivre ailleurs qu’en Tchoukotka. On peut voir dans le personnage de Vèkèt un « double » de Rytkhéou, déchiré entre son attirance pour la culture soviétique (figurée par Vaïke) et la fidélité à sa terre. Toutefois, Les Plus Beaux Bateaux autorise une double lecture : une visant un public autochtone minoritaire et nouvellement touché par la télévision (si tant est qu’il puisse y avoir accès, du fait de la couverture satellite encore restreinte) ; et une dirigée vers un auditoire pan-soviétique. Vu sous cet angle, par exemple, le motif de la chanson personnelle, élément traditionnel qui donne son titre au film, peut être lu de deux manières différentes : pour le public général, la métaphore des plus beaux bateaux qui passent au loin peut représenter les choix à faire au seuil de l’âge adulte (trouver son « propre bateau ») ; tandis que, pour le public autochtone, celle-ci figure une pratique traditionnelle réhabilitée et « vulgarisée » à destination des non autochtones, en même temps qu’une expression de la colonisation par les étrangers (dont les navires peuvent venir du monde tsariste, capitaliste ou communiste), qui ont accosté sur les rives des Tchouktches (Damiens 2020).
Le film reçoit un bon accueil et Rytkhéou renouvelle l’expérience du scénario deux fois encore, mais avec un succès moindre : au cinéma avec La Trace du glouton (Sled rosomahi, Gueorgui Kropatchev, 1978) et à nouveau pour la télévision avec Quand partent les baleines (Kogda uhodjat kity, Anatoli Nitochkine, 1981). Pour La Trace du glouton, Rytkhéou adapte une nouvelle fois son texte littéraire, mais le scénario en diverge grandement. Le roman raconte l’histoire de Toutril, universitaire tchouktche spécialisé dans le folklore de son peuple et vivant à Leningrad parmi le monde scientifique, et de son voyage en Tchoukotka pour collecter de nouvelles légendes. Il y rencontre Aïnana, qui pratique la chasse et vit en iaranga avec ses grands-parents Toko et Èïvèèmneou. Ensemble, ils partent à la chasse au glouton, animal du Grand Nord, et tombent amoureux. Ils périssent dans une tempête de neige. Au-delà de l’histoire d’amour, le roman est une critique à peine voilée de la politique des villages fermés et relocalisés. Rytkhéou y décrit le nouveau village de Noutèn et l’opposition de Toko à celui-ci. Le vieux conteur de légendes rappelle à ses congénères l’expérience de la communauté délitée après la fermeture du village yupik de Naoukan, brandie à plusieurs reprises dans le texte (Rythèu 1977, 110-111, 119, 182). À travers ce motif, le récit insiste sur la peur de perdre sa culture et dresse un portrait sombre du « progrès » apporté par la soviétisation. Les relocalisations de villages dits « sans perspectives » frappent de plein fouet les villages autochtones dans les années 1960. L’industrialisation du Nord et, dans les régions frontalières comme la Tchoukotka, la fermeture des frontières entraînent la relocalisation de nombreux villages déclarés « non-rentables », dont la population est transférée vers des bourgs toujours plus gros. La politique de relocalisation s’intensifie après la Deuxième Guerre mondiale et le refroidissement des relations Est-Ouest : la fermeture en 1948 du village d’Imaklik sur l’île Ramatov (la Grande Diomède), à la frontière de l’Union soviétique et des États-Unis, en marque le lancement véritable. La population du village est déplacée vers Naoukan, qui sera fermé à son tour en 1958, et deviendra un symbole des déplacements forcés. Le résultat de cette politique est catastrophique. La plupart des familles concernées ont pu subir plusieurs déplacements forcés au cours de leur existence et chacun de ces déplacements s’accompagnent de drames humains et de pertes considérables sur les plans linguistique et culturel (Krupnik et Chlenov 2007).
Toutes les critiques de la politique de relocalisation sont supprimées du scénario sur demande du ministère du cinéma (Goskino) et la fin pessimiste doit être modifiée[16]. Alors qu’il en constitue une part essentielle dans la nouvelle, le thème particulièrement sensible des fermetures de villages et du refus du « progrès » est réduit à son minimum dans le film : le vieux Toko vit dans une maison en bois et ne se retire dans sa iaranga que pour sa retraite. La mésaventure de l’adaptation de La Trace du glouton montre la difficulté, voire l’impossibilité de critiquer le discours du progrès dans le cinéma soviétique. Certains thèmes, comme celui du sauvetage soviétique des peuples du Nord, arrachés à l’arriération de la tradition pour entrer dans la modernité scientifique, ne supportent pas un point de vue qui diverge du canon dominant.
Le film suivant scénarisé par Rytkhéou, Quand partent les baleines, adapte son roman du même titre paru en 1975. Selon le plan de l’unité de production de téléfilms Èkran auquel il est intégré en 1979-1980, le film doit revêtir « une forme poétique et musicale » et porter sur « des valeurs éternelles : l’amour, la compréhension mutuelle, l’harmonie de l’humain et de la nature »[17]. Le thème est donc moins politiquement risqué que les relocalisations. L’intrigue propose un récit des origines des humains sur Terre du point de vue tchouktche. Elle conte l’histoire de la première femme, Naou (N’av), qui naît dans la toundra de l’union des éléments, et s’unit à Réou (r ‘’èuv), la baleine faite homme (Figure 4).
Figure 4
L’homme-baleine
Ensemble, ils donnent naissance au peuple du littoral. Quand partent les baleines situe son action dans une période mythique. On peut supposer qu’à la suite de ses déboires avec la censure en parlant du présent, Rytkhéou a estimé plus sûr de se tourner vers le passé. Cependant, ce passé n’a rien à voir avec le moment iconique du contact libérateur prisé par le cinéma soviétique (le moment de l’arrivée des bolcheviks en Tchoukotka après la guerre civile en 1922-1923). Le récit propose un autre point de départ de la civilisation : dans un passé hors de l’histoire telle qu’elle est écrite par les Russes, qui font débuter l’histoire de la Tchoukotka avec celle du contact, c’est-à-dire vers 1641-1642, moment où la première mention des Tchouktches apparaît dans les sources russes (Tagryn’a-Weinstein et Weinstein 1999). Ce faisant, le film crée un espace-temps hors de la colonisation russo-soviétique : il est notable qu’aucun personnage russe n’intervient dans la narration.
Le film offre un récit des origines des Tchouktches maritimes. Mais, s’il prend corps dans le mythe autochtone qui fait de ceux-ci les enfants de la baleine, l’histoire telle qu’elle est racontée dans le film n’est pas seulement une légende tchouktche collectée et transmise. Elle est aussi réarrangée par Rytkhéou pour en faire une « légende contemporaine », selon le sous-titre, c’est-à-dire qui a des résonnances dans le présent. Le film oppose deux moments : celui de la création et de l’harmonie entre les humains et la nature, et celui où les humains ne sont plus satisfaits de leur mode de vie traditionnel et veulent régner sur la nature, ce qui se termine par la destruction de la société. Le moment de l’harmonie est figuré par les danses de Naou et de Réou. Leur union, qui est aussi celle de la terre et de la mer, a lieu dans un monde idéal qui, soulignons-le, dresse un portrait inversé de la figure de l’insatisfaction des films précédents. Bien des années après la création, alors que Réou est retourné à la mer et que Naou est une très vieille femme, certains membres de la communauté (descendants de la femme et de la baleine) commencent à mettre en doute sa parole quand elle rapporte le récit fondateur qui a valeur de mythe. Parmi eux, deux personnages en particulier le contestent : Armol et Vetly. Ces deux personnages peuvent être vus comme des incarnations (tchouktches) des révolutionnaires : ils doutent de la parole ancestrale, remettent en cause un système qui à leurs yeux les désavantage, veulent faire table rase du passé pour refonder une nouvelle vie et se pensent supérieurs (donc aussi extérieurs) à la nature. Quand partent les baleines peut être lu comme une vision inversée du récit soviétisateur : les personnages positifs sont les passeurs de la tradition, tandis que les personnages négatifs sont ceux qui veulent changer la société. À la fin du film, Armol et Vetly, qui ont entraîné presque toute la communauté avec eux, tuent la baleine, et, avec elle, Naou, qui s’enfonce dans la mer à la suite de son mari-cétacé. Libérés de Naou, symbolisant la tradition, les descendants de la baleine se réjouissent : « Nous allons vivre comme nous le souhaitons ! » Mais la nature se venge. Pour avoir tué leur frère et ancêtre baleine, les humains sont immédiatement ensevelis sous un éboulement. Cette scène, qui ne se trouve pas dans le roman, met l’accent sur la vanité humaine qui prétend effacer le passé et construire une vie nouvelle sans tenir compte des liens qui unissent humains et environnement. In fine, Quand partent les baleines propose une critique de la soviétisation, un appel à réécouter les valeurs portées par la tradition qui, bien que parfois obscures et peu « rationnelles » à première vue, doivent être valorisées.
Les trois films scénarisés par Rytkhéou, s’ils restent peu nombreux face à une filmographie exogène plus importante, doivent être considérés comme le début d’un cinéma autochtone sibérien. Ils présentent un point de vue intérieur sur l’histoire soviétique s’éloignant radicalement des représentations qu’on trouve sur les écrans soviétiques à la même période qui, eux, glorifient les autochtones comme une figure du passé, au bord de la mort et de l’extinction, à l’image de la coproduction soviéto-japonaise Dersou Ouzala (Dersu Uzala, Akira Kurosawa, 1975)[18]. Mais c’est véritablement à partir de la période postsoviétique que des cinémas autochtones sibériens vont pleinement s’épanouir sur les écrans. De ce point de vue, l’expérience audiovisuelle de Rytkhéou en fait un précurseur. Il est intéressant cependant d’observer que son oeuvre filmique reste circonscrite à la période soviétique. Ceci est d’autant plus frappant quand on sait que, lorsque le cinéaste bouriate Baras Khalzanov, insatisfait de la représentation des peuples de Russie dans le cinéma, fonde le studio Zov en 1990, il appelle expressément Rytkhéou à le rejoindre dans son entreprise (Tcherneva 2014, 157). Celui-ci semble toutefois ignorer cet appel : il ne participera pas au travail scénaristique d’adaptation de son roman, Un rêve au début du brouillard pour le film du même nom (Son v načale tumana, 1994, Baras Khalzanov). On peut ainsi penser que l’écrivain tchouktche a été déçu de son expérience audiovisuelle, notamment à la suite de ses déconvenues avec la censure de La Trace du glouton et l’indifférence suscitée par Quand partent les baleines.
Vers un cinéma sibérien autochtone post-soviétique
Après que Rytkhéou a quitté l’industrie filmique pour se consacrer plus exclusivement à la littérature, aucun autre représentant d’un peuple autochtone minoritaire du Nord ne se trouvera à un poste créatif clé jusqu’à la fin du régime soviétique. C’est seulement à partir des années 1990 et surtout 2000 que la Sibérie a vu naître un cinéma autochtone, en partie grâce à la chute de l’Union soviétique et à la disponibilité croissante des outils numériques audiovisuels. Plusieurs cinéastes indépendants ou industries cinématographiques régionales sont apparus dans les différentes entités ethno-territoriales de la Fédération de Russie : Iakoutie, Bouriatie, Khakassie, Tatarstan, Bachkortostan, etc. La Tchoukotka ne fait pas exception.
Le Yupik Alekseï Vakhrouchev est un des premiers cinéastes issus des peuples autochtones du Nord qui commence à tourner après la chute de l’URSS. Fils de la poétesse et militante autochtone Tatiana Atchirguina, il est né en 1969 à Anadyr en Tchoukotka où il a effectué sa scolarité. Il étudie l’art documentaire au prestigieux VGIK, l’Institut de cinéma de Moscou, entre 1991 et 1996, et tourne ses premiers films dans les années 1990. Le Temps de la fonte des rêves (Vremja tajanija snov, 1993) – on note la référence directe à la première oeuvre de Rytkhéou : Le Temps de la fonte des neiges (Vremja tajanija snegov, 1958) – et Les Oiseaux de Naoukan (Pticy Naukana, 1996), deux films de non-fiction, sont consacrés à l’histoire traumatisante des fermetures de villages ; ils insistent sur la coupure avec la tradition et les racines que ces relocalisations ont entraînée. Dans les oeuvres de Vakhrouchev, le passé soviétique est réexaminé depuis un point de vue interne aux sociétés autochtones, bouleversées par les changements parfois brutaux introduits dans leurs modes de vie par la modernisation soviétique. Dans Les Oiseaux de Naoukan, Vakhrouchev utilise le montage pour peindre le monde autochtone tel qu’il aurait pu être sans l’ingérence soviétique, dans une sorte de riposte au principe du réalisme socialiste (qui peignait la vie, non comme elle est, mais comme elle sera dans le futur communiste). Grâce au montage, il « repeuple » cinématographiquement le village fermé de Naoukan par l’insertion d’images d’archives au sein de plans des ruines d’une civilisation autochtone déclarée « sans perspectives ». Projet plus ambitieux, le documentaire Bienvenue à Enourmino (Dobro požalovat’ v Enurmino!, 2008) décrit le quotidien d’un village tchouktche isolé du reste du monde entre ravages de l’alcoolisme et débrouille.
Son film le plus connu, LeLivre de la toundra. Un conte de Voukvoukaï, le petit caillou (Kniga tundry. Povest’ o Vukvukaj – malen’kom kamne, 2011), qui a reçu de nombreux prix en Russie et dans des festivals de cinéma internationaux, entend montrer « comment s’effectue la transmission de l’expérience et du savoir traditionnels par des adultes à des enfants » (Sin’kevič 2011). Pour cela, il suit le cycle calendaire complet de la vie nomade des éleveurs de rennes. Faire ce film, selon Vakhrouchev, relève de sa responsabilité en tant que natif de Tchoukotka. Trop de cinéastes en effet ne font que passer, tournent une semaine ou deux avant de repartir. Vakhrouchev entend porter sur cette culture et sa compréhension du monde un regard intérieur afin de la faire découvrir au reste du monde, mais aussi de convaincre la jeunesse de Tchoukotka que leur culture a une valeur[19]. Le film s’organise en chapitres autour du vieux Voukvoukaï, âgé de 72 ans, qui mène le mode de vie traditionnel des éleveurs de rennes nomades en compagnie des siens. À la fin du film, lorsque l’hélicoptère, « l’oiseau de fer » qui matérialise l’interventionnisme d’État, vient chercher les enfants pour les emmener à l’école-internat, perpétuant la tradition soviétique qui coupe les enfants autochtones de leur culture, la narration filmique « accomplit » alors la volonté de Voukvoukaï. En effet, dans le dernier chapitre, « où Voukvoukaï inverse le cours du temps », Vakhroushev utilise à nouveau un procédé de montage pour réunir toutes les générations dans la toundra. Le film se clôt sur ces images de la vie comme elle doit être selon le vieil éleveur (Figure 5).
Figure 5
La vie comme elle doit être selon Voukvoukaï
Enfin, dans son dernier film, Le Livre de la mer (Kniga morja, 2018), sorti en avril 2020 sur les écrans russes, Vakhrouchev suit cette fois des Tchouktches chasseurs d’animaux marins. Le récit documentaire est entremêlé à des séquences d’animation qui racontent le mythe de la femme qui s’était mariée avec une baleine, nouvelle référence à Rytkhéou. Le film entrelace ainsi temps et activités du présent (tournés en prises de vues réelles) avec l’imaginaire traditionnel (traité sur le mode de l’animation) dans lesquels elles font sens. Il reprend en cela le procédé déjà utilisé dans un autre film autochtone sibérien sur la Tchoukotka, Fata Morgana (2004) de la cinéaste nénètse Anastasia Lapsouï en collaboration avec Markku Lehmuskallio, qui se servait de l’animation pour construire visuellement les légendes tchouktches, accolée à des images documentaires et d’archives[20].
Autre cinéaste natif de la région, le Tchouktche Vladimir Pouya s’est lui auto-formé au langage audiovisuel. Né dans le village de Kantchalan, en Tchoukotka, après des études à l’institut agronomique de Blagovechtchensk, il travaille pendant plus de 20 ans dans la toundra comme éleveur de rennes, zootechnicien ou ingénieur mécanicien avant de faire des films documentaires. Il s’intéresse toutefois, dès l’école primaire, au cinéma et à la photographie. Son passage dans l’armée lui permet de se former au numérique (il effectue son service dans l’unité d’électronique). Mais c’est véritablement avec l’apparition de caméras numériques grand public qu’il passe à la réalisation de films. En 2009, il suit un cours de montage et de prise de vues à Moscou et tourne son premier film[21], Ceux qui attrapent au lasso (Lovčaki, 2009) sur le dressage de rennes. Son film suivant, Les Nomades de la Tchoukotka de l’Est (Kočevniki vostočnoj Čukotki, 2012) se veut pédagogique et « calibré » pour le monde occidental : les scènes qui auraient pu selon lui froisser la sensibilité occidentale ont été supprimées[22].
Son projet le plus important est Tchavtchou (Čauču, 2014), un film cette fois pensé « pour soi », pour les siens, non pour être vendu à l’extérieur, mais qui a suscité, selon son auteur, un grand intérêt à l’étranger[23]. Tchavtchou montre quelques jours de la vie d’une brigade de Tchouktches éleveurs de rennes nomadisant. Il entend montrer leur mode de vie qui, s’il semble particulier pour certains, n’est que la vie habituelle pour les personnes concernées, comme l’affirme Pouya dans le commentaire en voix off. Le film, à l’image du Livre de la toundra, met en scène la transmission de cette manière d’être au monde entre les générations (en insistant sur les personnages du bébé et de l’aïeule). Il se termine par un message militant de l’auteur lui-même contre les interventions russo-soviétiques dans ce mode de vie ancestral. Pour être sûr de ne pas travestir la réalité, Pouya a préalablement soumis son travail à des spectateurs autochtones, qui s’y sont reconnus, reproduisant ainsi la pratique du feed-back audiovisuel théorisé par Jean Rouch dans les années 1960[24].
Dans ces deux cas, on remarque que les cinéastes autochtones, à l’image de Rytkhéou, envisagent leurs films dans deux directions : à la fois des films pour soi, pour les siens, et des films pour les autres, pour « éduquer » un public exogène sur sa culture. On note également que les films de fiction sur les Tchouktches disparaissent après l’ère soviétique (à l’exception notable d’Un rêve au début du brouillard en 1994). Les cinéastes autochtones se restreignent au cinéma de non-fiction essentiellement par manque de moyens[25]. Mais on pourrait aussi considérer que cette disparition plus globale des autochtones de Tchoukotka du cinéma de fiction russe révèle aussi en creux le processus d’effacement de ces autochtones de l’imaginaire du corps (multi)national de la Fédération de Russie. Par exemple, le film Comment j’ai passé l’été (Kak ja provel ètim letom, 2010, Alekseï Popogrebski), tourné à Valkarkaï, dans le nord de la Tchoukotka, ne se sert de l’environnement arctique que pour offrir un décor oppressant au huis clos de ses personnages russes enfermés dans la solitude pesante d’une station météorologique sur une île fictive pour de longs mois. Ici la toundra glacée est un véritable « lieu d’enfermement à ciel ouvert » (Zvonkine 2017 : 242), bien loin du lieu de vie riche de ses traditions décrit par les cinéastes autochtones. Dans le cinéma russe contemporain, la Tchoukotka n’est plus ce lieu de la mission civilisatrice à la soviétique, mais une terre aride et dure où les héros peuvent prouver leurs capacités, dans un régime de représentation qui renoue avec les premières bandes d’expédition muettes[26].
Conclusion
Les trois grands moments distingués ici permettent de voir l’évolution du régime de représentation des Autochtones de Tchoukotka sur les écrans soviétiques et russes durant plus d’un siècle. Le (long) moment soviétique se détache à la fois comme une période où les Tchouktches sont particulièrement présents à l’écran et, surtout, pas uniquement cantonnés au mode documentaire. Ainsi, le cinéma soviétique les fait sortir, à l’instar des autres peuples du Nord, de la rhétorique du spectacle ethnographique selon laquelle les peuples autochtones, « peuples de nature », sont imaginés visuellement. En effet, selon cette rhétorique, les Autochtones sont enfermés dans le genre supposé naturel du film – le documentaire – laissant toute la place de la fiction aux peuples « de culture », dans une réinterprétation de l’opposition occidentale Nature/Culture appliquée au cinéma (Rony 1996). Au contraire, les Tchouktches, personnifiant l’ensemble des autochtones de Tchoukotka, deviennent des personnages à part entière du grand récit cinématographique soviétique, même si leur rôle est limité à celui des bénéficiaires de l’aide et de la civilisation russe. En effet, le cinéma soviétique, notamment durant la période stalinienne, met en place un récit soviétisateur qui formera une matrice autour de laquelle vont s’organiser les représentations ultérieures. Le répertoire d’images soviétiques se concentre autour du récit du contact bolchevico-autochtone libérateur et salvateur, et se focalisent sur un passé héroïque : le moment charnière de l’arrivée des bolcheviks en Tchoukotka, en 1922-1923, moment qui marque le début de la soviétisation.
Tandis que le cinéma russe post-soviétique a délaissé pour l’essentiel jusqu’à maintenant les minorités ethniques pour refaire de la Tchoukotka un lieu lointain et d’aventures à l’image de la période prérévolutionnaire, l’émergence d’un cinéma, essentiellement documentaire, fait par des Autochtones offre la possibilité d’un changement de perspective. Au lieu d’un passé muséifié, les films autochtones privilégient le moment contemporain, le mêlant parfois aux récits mythiques que l’on peut encore entendre aujourd’hui. Ces films dressent un bilan des conséquences de la soviétisation, souvent plus réaliste et amer que dans les films non autochtones. Ils proposent aussi une version de l’histoire qui ne débute pas avec l’arrivée des bolcheviks ou même des Russes en Tchoukotka, mais qui a pour effet d’enraciner les autochtones dans une temporalité qui leur est propre.
Il faut souligner que ce retournement du regard débute au sein même de la période soviétique, lorsque l’écrivain Rytkhéou passe au scénario, ce qu’il parvient à faire grâce à la politique de promotion des minorités. Ce renversement de regard est donc moins le fait du changement de régime politique que du changement de point d’énonciation et le fait qu’un Autochtone prenne le contrôle du point de vue. En outre, le travail de Rytkhéou comme celui de ses héritiers cinéastes contemporains natifs de Tchoukotka, pose avec acuité la question du public (autochtone ou allochtone). De ce fait, ces cinéastes autochtones nous poussent à nous questionner sur la réception de ces images par les principaux intéressés, les Autochtones de Tchoukotka eux-mêmes, en prolongement de ce travail d’analyse des représentations.
Appendices
Notes
-
[1]
Les « peuples autochtones peu nombreux du Nord, de Sibérie et d’Extrême-Orient [korennye maločislennye narody Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka] », selon la dénomination officielle soviétique, sont plus communément nommés les « petits peuples du Nord [malye narody Severa] ». Cette catégorie comprend 26 groupes ethniques comptant moins de 50 000 représentants et vivant traditionnellement de la chasse, de la pêche et de l’élevage de rennes. Dans un ordre géographique allant d’est en ouest, il s’agit notamment des Saames, Khantys, Mansis, Nénètses, Énètses, Selkoupes, Nganassanes, Dolganes, Kètes, Évenkes, Évènes, Ioukaguirs, Tchouvantses, Tchouktches, Koriaks, Itelmènes, Yupik, Aléoutes, Nivkhes, Néguidales, Nanaïs, Oultches, Orotches, Oroks, Oudégués et Tofalars (Slezkine 1994).
-
[2]
Iouri Rytkhéou (1930-2008) est né à Ouelen en Tchoukotka dans une famille de chasseurs de mammifères marins. Produit de la méritocratie soviétique, il étudie la littérature à Leningrad et commence à publier dans les années 1950. Il est l’auteur de nombreux romans et certainement l’écrivain autochtone le plus connu en Union soviétique et en Occident. Les noms propres et les noms de peuples sont francisés, les autres termes russes sont translitérés.
-
[3]
Le film est conservé aux Archives d’État de documents ciné-photographiques (RGAKFD, Rossijskij gosudarstvennyj arhiv kinofotodokumentov) à Krasnogorsk, près de Moscou.
-
[4]
Signalons qu’à ce moment-là, la Finlande fait encore formellement partie de l’empire russe pour quelques mois. Outre ses images, Pälsi tire deux livres de ce voyage : Extraits du journal d’exploration : descriptions de voyage de Béring, Anadyr et Kamtchatka (Pälsi 1919) et Images arctiques : oeuvres d’art primitives du nord-est de la Sibérie (Pälsi 1920). La documentariste Kira Jääskeläinen est retournée sur les pas de Pälsi cent ans plus tard. Son film Northern Travelogues (Pohjankävijäin merkintöjä, 2019) combine des images et des notes de Pälsi à de nouvelles séquences et des récits autochtones.
-
[5]
Je ne parle ici que des films de fiction. Les films de non-fiction, beaucoup plus nombreux, sont plus difficiles à inventorier dans leur totalité. On ne peut que supposer que les proportions sont similaires.
-
[6]
Ils sont également présents, mais dans des rôles très secondaires, dans Aerograd (Aèrograd, Alexandre Dovjenko, 1935) et Les Sept Braves (Semero smelyh, Sergueï Guerassimov, 1937). Les films de fiction conservés sont au Gosfilmofond (Fonds d’État du cinéma de la Fédération de Russie) situé à Belye Stolby, près de Moscou.
-
[7]
Il faut également noter que ces films emploient des acteurs non-autochtones dans les rôles de Tchouktches, ce qui pose la question de l’incarnation ethnique au cinéma et de la politique du casting. Pour une discussion approfondie de cette question, voir Damiens 2019.
-
[8]
Plusieurs films sont d’ailleurs des transpositions de romans comme Les Romantiques ou Alitet s’en va dans les montagnes, tous deux adaptés d’oeuvres de Tikhon Semouchkine.
-
[9]
Sauf mention contraire, toutes les traductions du russe et de l’anglais sont de l’auteure.
-
[10]
Cette scène est déclinée dans Alitet s’en va dans les montagnes (Alitet uhodit v gory, 1950) où l’ours est remplacé par un loup : le Tchouktche en péril est réanimé par les bolcheviks qui arrivent, encore une fois, juste à temps.
-
[11]
On trouve une scène similaire dans Les Romantiques avec une vieille femme tchouktche.
-
[12]
Dans le roman qui sert à l’adaptation du scénario, le vieux Tchouktche se « réincarne » en Ilitch, laissant encore moins de place au doute quant à l’hommage (Semouchkine 1950). Cependant, le ministère du Cinéma a peur de l’effet de « galvaudage et de profanation » que le nom d’Ilitch pourrait entraîner et propose de le renommer Ivan (Archives d’État de littérature et d’art [RGALI, Rossijskij gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva] 2456/1/1950/18, 23). Les scénaristes ont coupé la poire en deux avec Vladimir.
-
[13]
La scène circule de film en film. Outre Les Romantiques (1941) et Alitet (1950), on la trouve dans les non-fictions À travers l’épaisse forêt de l’Oussouri (Po debrjam ussurijskogo kraja), Alexandre Litvinov, 1928) et Terre inconnue (Nevedomaja zemlja, Alexandre Litvinov, 1930) et les fictions Igdenbou (Amo Bek-Nazarov, 1930) et Le Renard bleu (Goluboj pesec, Piotr Malakhov, 1930). Par ailleurs, cette scène centrale continuera à habiter le cinéma soviétique, puisqu’on la retrouvera dans des oeuvres plus tardives comme Le Chef de la Tchoukotka (Načal’nik Čukotki, Vitali Melnikov, 1966) ou la minisérie télévisée Le Chamane blanc (Belyj šaman, Anatoli Nitotchkine, 1982).
-
[14]
Au début des années 1920, les peuples du Nord fournissent en effet 86,5% de l’ensemble des fourrures de l’État (Slezkine 1994 : 136-137). Mais le commerce avec les organisations étatiques soviétiques est loin d’être équitable pour les autochtones qui s’en plaignent. Le paiement des peaux est même moindre qu’avant la guerre : une fourrure de renard arctique, payée entre 18 et 22 pouds de pain sous le tsar, n’en vaut plus que 17 en 1925-1926 et seulement 11,5 en 1926-1927 (Leete 2007, 92-93).
-
[15]
Cette position est particulièrement dominante dans l’historiographie des cinémas autochtones où la « pureté » autochtone du film est souvent impossible à établir. Ainsi, pour Amalia Cordova, universitaire et programmatrice mapuche, « réduire l’identité autochtone du film à la seule origine ethnique de son réalisateur n’a aucun sens. Cela exclut les membres des communautés autochtones qui peuvent avoir participé activement à la construction du récit filmique sans pour autant en avoir assuré la réalisation. » (Gergaud 2019, 19).
-
[16]
RGALI 2944/4/4279/6, 43-44.
-
[17]
Archives d’État de la Fédération de Russie (GARF, Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii) R-6903/32/912/8.
-
[18]
Par manque de place, je n’évoque pas ici la minisérie Le Chamane blanc, diffusée en avril 1983 à la Télévision centrale, qui raconte (à nouveau) l’arrivée des bolcheviks dans un village tchouktche. Les trois épisodes reprennent à leur compte le récit soviétisateur.
-
[19]
Entretien de l’auteure avec Alekseï Vakhrouchev, le 20 juillet 2012, à Moscou.
-
[20]
Les réalisateurs n’avaient pas obtenu l’autorisation de se rendre en Tchoukotka (communication personnelle des cinéastes à V. Vaté).
-
[21]
Avant cela, Pouya travaille comme réalisateur-opérateur avec l’Association des minorités autochtones de Tchoukotka. Il réalise plusieurs films pour des ensembles de danse ou chant folklorique.
-
[22]
Entretien de l’auteure avec Vladimir Pouya, le 10 octobre 2017, à Paris.
-
[23]
Ibid.
-
[24]
Entendu comme un « contre-don audiovisuel », le feed-back aspire à dépasser la relation traditionnelle filmeur-filmé, que Rouch compare à celle d’un entomologiste observant l’Autre tel un insecte, pour entrer dans une relation d’« anthropologie partagée », stimulatrice de reconnaissance mutuelle (Rouch 1979).
-
[25]
Entretien de l’auteure avec Alekseï Vakhrouchev, le 20 juillet 2012, à Moscou.
-
[26]
Sorti en octobre 2020 en Russie, lors de l’écriture de cet article, Kitoboy (Filipp Iouriev, 2020) semble amorcer un changement. Écrit et réalisé par un cinéaste fasciné par la Tchoukotka, le film est tourné sur place (Lorino) avec des acteurs autochtones (Beumers 2020). Ancré dans le contemporain, il narre les premiers émois d’un adolescent tchouktche qui tombe amoureux d’une cam-girl américaine sur Internet.
References
- Abikeeva, Gul’nara, 2006 Naciostroitel’stvo v Kazahstane i drugih stranah Central’noj Azii i kak ètot process otražaetsja v kinematografe [La construction nationale au Kazakhstan et autres pays d’Asie centrale, et la façon dont ce processus est exprimé au cinéma]. Almaty, OF “CCAK”.
- Anon, 1914 « The Rescue of the Stefansson Arctic Expedition ». Motion Pictures News, 10 (24) : 109.
- Barker, Adele, 1993 « The Divided Self: Yuri Rytkheu and Contemporary Chukchi Literature ». In G. Diment et Y. Slezkine (dir.), Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture, p. 215-226. New York, St Martin’s Press.
- Beumers, Birgit, 2020 « Filip Yiriev: The Whaler Boy », KinoKultura, 70. Consulté le 1er décembre 2020, http://www.kinokultura.com/2020/70r-kitoboi.shtml.
- Bogoraz-Tan, V.G., 1935 Voskresšee plemja [La tribu ressuscitée]. Moscou, Hudožestvennaja literatura.
- Chichlo, Boris, 1999 « Sibérie : mode de colonisation – mode de production », Questions sibériennes « Histoire, cultures et littérature », II : 95-118.
- Clark, Katerina, 2000 [1981] The Soviet Novel: History as Ritual. Indianapolis, Indiana University Press.
- Damiens, Caroline, 2017 Fabriquer les peuples du Nord dans les films soviétiques : acteurs, pratiques et représentations. Thèse de Doctorat, arts, INALCO.
- Damiens, Caroline, 2019 « Incarnation de l’ethnicité à l’écran et politique du casting : l’exemple du cinéma soviétique », Mise au Point, 12, Consulté le 1er décembre 2020, https://journals.openedition.org/map/3758.
- Damiens, Caroline, 2020 « The Birth of a Soviet ‘Fourth Cinema’ on Prime Time Television: Iurii Rytkheu and The Most Beautiful Ships ». Studies in Russian and Soviet Cinema, 14 (1) : 17-36.
- Fitzpatrick, Sheila, 2002 [1999] Le Stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les années 30. Paris, Flammarion.
- Forsyth, James, 1992 A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony 1581-1990. Cambridge, Cambridge University Press.
- Etkind, Alexander, 2011 Internal Colonization. Russia’s Imperial Experience. Cambridge, Polity.
- Gergaud, Sophie, 2019 Cinéastes autochtones : la souveraineté culturelle en action. Laval, Warm.
- Graham, Seth, 2003 A Cultural Analysis of the Russo-Soviet Anekdot. Thèse de doctorat, littérature russe, Université de Pittsburgh.
- H.F.H., 1912 « Alaska-Siberia Pictures open in New York and Philadelphia », Moving Picture World, 12 (9) : 838.
- Halfin, Igal, 2000 From Darkness to Light. Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburg, University of Pittsburg Press.
- Hall, Stuart, 2003 « The Spectacle of the Other ». In S. Hall (dir.), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, p. 223-290. Londres, Sage Publications.
- Hirsch, Francine, 2005 Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, Cornell University Press.
- Iglesias, Gerardo, 1916 « Cinematografia instructiva », Cine-mundial, I (VIII) : 335.
- Kaganovsky, Lilya, Scott MacKenzie et Anna Westerståhl Stenport, 2019 « Introduction. The Documentary Ethos and the Arctic ». In L. Kaganovsky, S. MacKenzie et A. Westerstahl Stenport (dir.), Arctic Cinemas and the Documentary Ethos, p. 1-28. Bloomington, Indiana University Press.
- Krupnik, Igor et Mikhail Chlenov, 2007 « The End of “Eskimo Land”: Yupik Relocation in Chukotka, 1958-1959 ». Études Inuit Studies 31 (1-2) : 59-81.
- Leete, Art, 2005 « Anti-Soviet Movements and Uprisings among the Siberian Indigenous Peoples during the 1920-40s ». Studies in Folk Cultures:« The Northern Peoples and States: Changing relationships », V : 55-89.
- Leete, Art, 2007 La guerre du Kazym : La lutte des peuples de Sibérie occidentale contre le pouvoir soviétique en 1933-1934. Paris, L’Harmattan/Adéfo.
- Martin, Terry, 2001 The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalisms in the Soviet Union 1923-1939. Ithaca, Cornell University Press.
- Mel’nikov, Vitalij, 2011 Žizn’. Kino [Vie. Cinéma]. Saint-Pétersbourg, BHV-Peterburg.
- Mignolo, Walter D., 2011 The Darker Side of Western Modernity. Global Futures, Decolonial Options, Durham, Duke University Press.
- Mirbel, Jean de, 1923 « La Croisière blanche », Cinémagazine 42 : 95-98.
- Morgan, Lael, 2011 Eskimo Star. From the Tundra to Tinseltown: The Ray Mala Story. Kenmore, Epicenter Press.
- Pälsi, Sakari, 1919 Pohjankävijän päiväkirjasta: Matkakuvauksia Beringiltä, Anadyriltä ja Kamtshatkasta [Extrait du journal de l’explorateur : Descriptions de voyage de Béring, Anadyr et Kamtchatka]. Helsinki, Otava.
- Pälsi, Sakari, 1920 Arktisia kuvia: alkeellisia taideteoksia koillisesta Siperiasta [Images arctiques : Oeuvres d’art primitives du nord-est de la Sibérie]. Helsinki, Otava.
- Pitiot, Danielle, 2003 « Youri Rytkhéou : une interprétation ambivalente des mythes et de la spiritualité du peuple tchouktche d’après Légendes contemporaines (1978) et L’île de l’espoir (1987) ». Slovo, 28-29 : 77-94.
- Prokhorov, Alexander, 2001 « The Unknown New Wave: Soviet Cinema of the 1960s ». Springtime for Soviet Cinema. Re/Viewing the 1960s, p. 7-28. Pittsburgh, 2001, Russian Film Symposium.
- Raheja, Michelle H., 2010 Reservation Reelism. Redfacing, Visual Sovereignty, and Representations of Native Americans in Film, Lincoln, University of Nebraska University Press.
- Regamey, Amandine, 2007 Prolétaires de tous pays, excusez-moi ! Dérision et politique dans le monde soviétique. Paris, Buchet/Chastel.
- Rony, Fatimah Tobing, 1996 The Third Eye. Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle. Durham, Duke University Press.
- Rouch, Jean, 1979 « La caméra et les hommes ». In C. de France (dir.), Pour une anthropologie visuelle, p. 69-71. Paris, Mouton.
- Rythèu, Jurij, 1977 « Sled rosomahi » [La Trace du glouton] In Ju. Rythèu, Kogda kity uhodjat. Povesti i rasskazy [Quand partent les baleines. Romans et nouvelles], p. 93-234 Leningrad, Sovetskij pisatel’.
- Sangi, V.M. (dir.), 1983 Vtoroeroždenie. Proizvedenija začinatelej literatur narodnostej Severa i Dal’nego Vostoka [Seconde naissance. oeuvres des fondateurs des littératures des peuples du Nord et de l’Extrême-Orient]. Moscou, Sovremennik.
- Sarkisova, Oksana, 2014 « Arctic Travelogues: Conquering the Soviet North ». In S. MacKenzie et A. Westerståhl Stenport (dir.), Films on ice. Cinemas of the Arctic, p. 222-234. Édimbourg, Edinburgh University Press.
- Sarkisova, Oksana, 2019 « Moving Through the Century: The Far North in Soviet and Contemporary Russian Nonfiction ». In L. Kaganovky, S. MacKenzie et A. Westerståhl Stenport (dir.), Arctic Cinemas and the Documentary Ethos, p. 231-253 Bloomington, Indiana, Indiana University Press.
- Semouchkine, Tikhon, 1950 Alitet s’en va dans les montagnes, traduit du russe par E. Makotinskaia. Paris, Éditions du Pavillon.
- Sergeev, M.A., 1955 Nekapilalističeskij put’ razvitija malyh narodov Severa [La voie non capitaliste de développement des petits peuples du Nord]. Moscou, Izd-vo Akademii nauk SSSR.
- Sin’keviČ, Raisa, 2011 « Cˇitaja knigu tundry ». Poljarnaja Zvezda [« En lisant le livre de la toundra », Etoile du Nord], 27 avril, 16 : 11.
- Slezkine, Yuri, 1994 Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North, Ithaca, Cornell University Press.
- Tagryn’a-Weinstein, Zoïa et Charles Weinstein, 1999 « Les Russes et la Tchoukotka », Slavica Occitania, 8 : 323-333.
- Tcherneva, Irina, 2014 « Le “cinéma national” et le rapport centre/périphéries. L’exemple du studio de Sverdlovsk (1950-1960) ». In M.-C. Autant-Mathieu (dir.), L’étranger dans la littérature et les arts soviétiques, p. 147-158. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
- Vaté, Virginie, 2003 « Le rituel de mort volontaire : Rendre l’âme pour perpétuer la vie », Chemins d’étoiles 10 : 55-61.
- Višnevskij, Venjamin, 1996 Dokumental’nye fil’my dorevoljucionnoj Rossii [Les films documentaires de la Russie prérévolutionnaire], 1907-1916. Moscou, Muzej Kino.
- Westerståhl Stenport, Anna, 2014 « The Threat of the Thaw: The Cold War on the Screen ». In S. MacKenzie et A. Westerståhl Stenport (dir.), Films on Ice. Cinemas of the Arctic, p. 161-175 Édimbourg, Edinburgh University Press.
- Zvonkine, Eugénie, 2017 « L’espace comme piège dans les films russes contemporains ». In E. Zvonkine (dir.), Cinéma russe contemporain, (r)évolutions, p. 237-254. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
List of figures
Figure 1
L’opérateur Will E. Hudson en Tchoukotka en 1913
Figure 2
Le sauvetage par les bolcheviks
Figure 3
Le commerce équitable
Figure 4
L’homme-baleine
Figure 5
La vie comme elle doit être selon Voukvoukaï

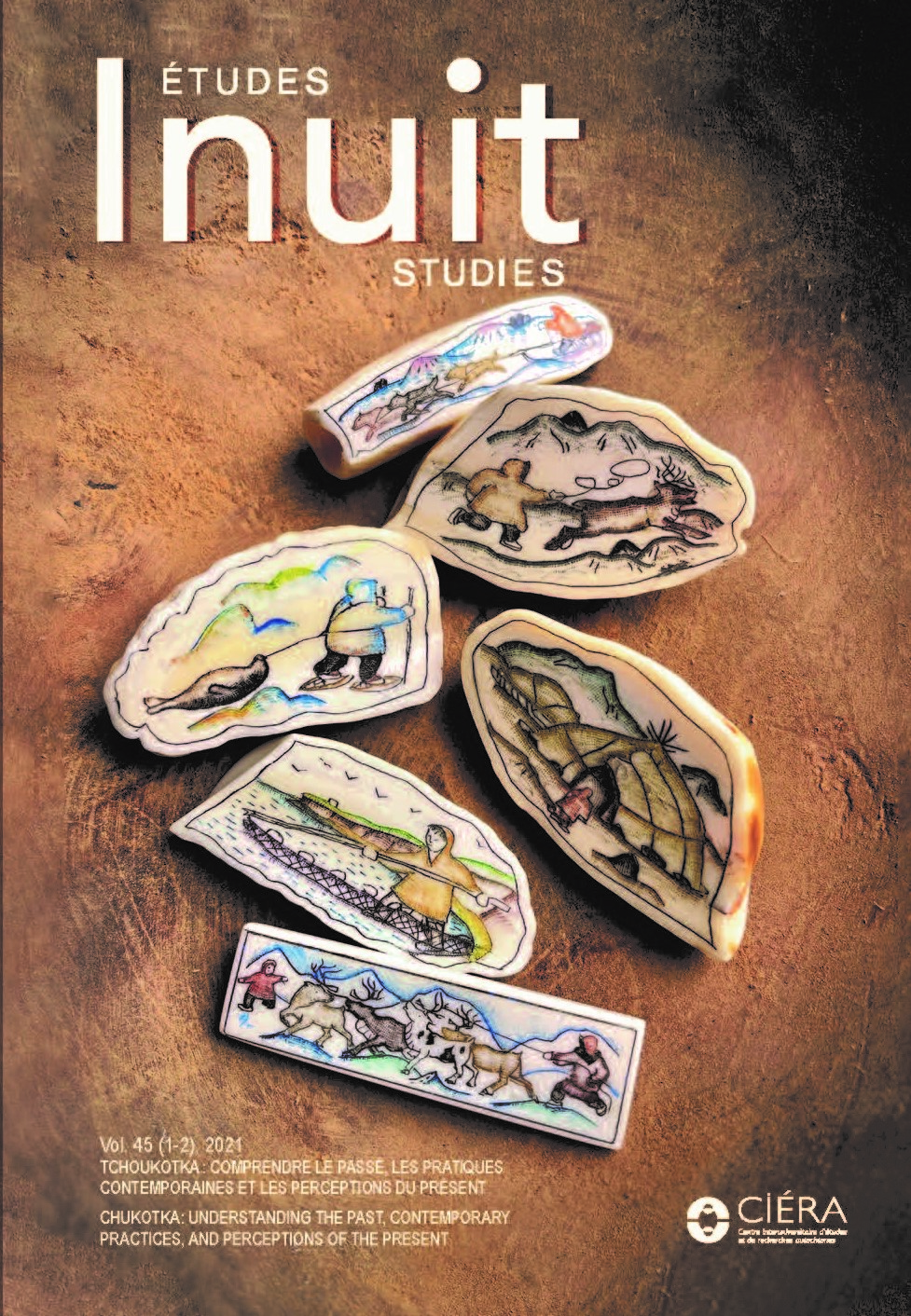





 10.7202/019715ar
10.7202/019715ar