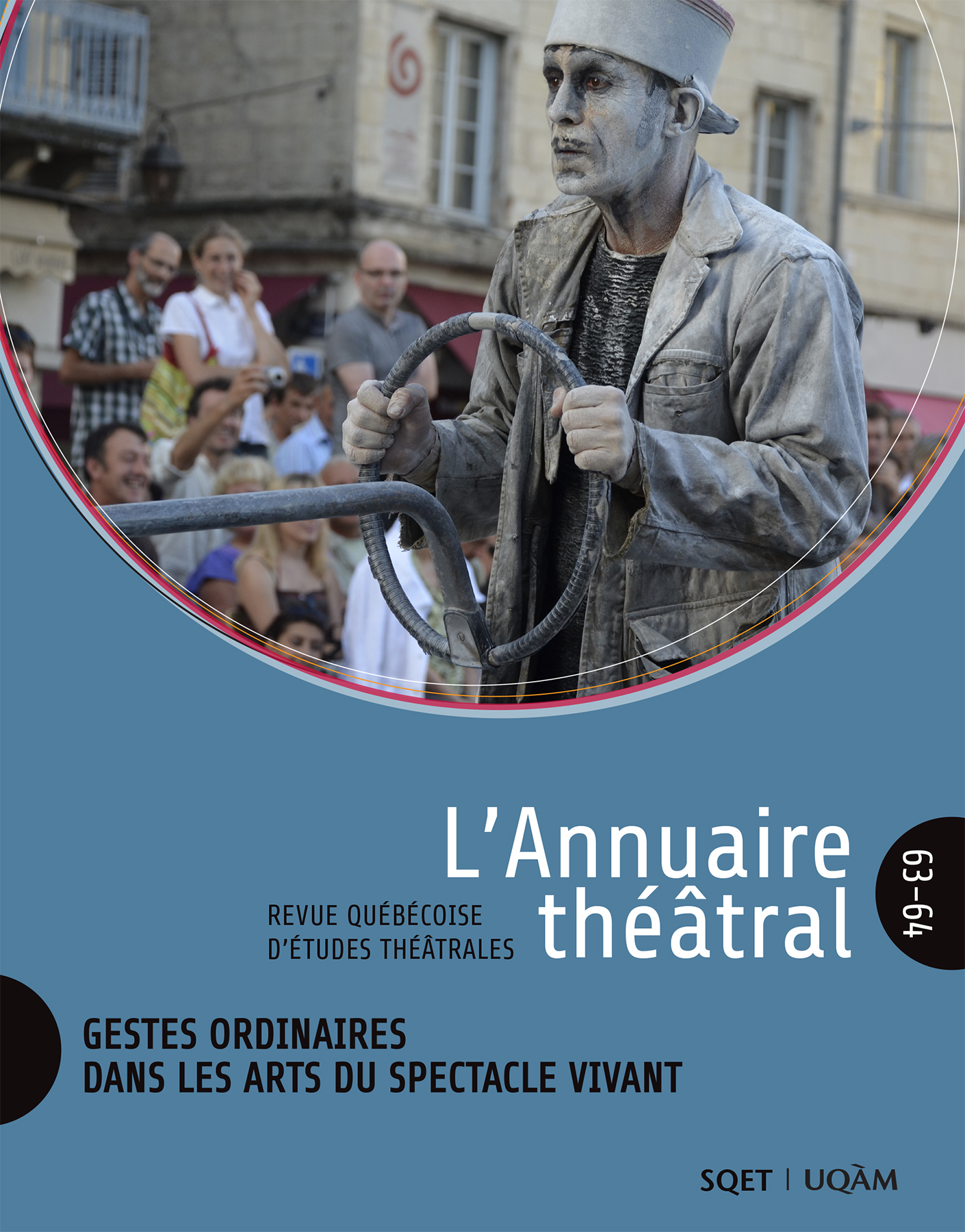Corps de l’article
En utilisant beaucoup de médias assez différents dans mon travail, j’ai développé une hypersensibilité à la voix intérieure de chaque médium. « Ne demandez pas ce qu’un médium peut faire pour vous; demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour le médium… » Ce qui m’intéresse d’abord, c’est comment la contamination d’un médium par un autre donne lieu à une forme hybride avec sa propre voix. Cette hybridité (l’intermédialité) nous parle beaucoup des qualités internes de chaque médium. Mettons un peu d’ordre avant tout…
L’invention du cinéma, d’abord muet et parlant ensuite, a littéralement volé le quatrième mur du théâtre, tous les accessoires inclus. Depuis, le théâtre comme médium est en deuil permanent de la perte de ses pouvoirs fictionnels. En fait, si on la compare à la force du cinéma, il est devenu un petit peu ridicule de croire encore en la force de la fiction au théâtre. On n’y voit plus des personnages : on y voit des acteurs jouant des personnages (parfois d’une manière virtuose, parfois pas). La présence physique de l’acteur rend la crédibilité de son personnage assez problématique. Si Hamlet se suicide sur scène, en tant que spectateur, on n’a que deux possibilités éthiques : ou bien on court au secours, ou bien on n’y croit pas. Ce dilemme a été résolu dans le cinéma par l’absence de l’acteur physique. Il n’y a que la lumière sur une toile blanche qui se suicide, ce qui donne la possibilité au spectateur d’y croire à fond.
Si le cinéma est devenu le paradis de la fiction, qu’est-ce qui reste au théâtre? C’est la réalité, lente et lourde, sans raccourcis. C’est le jeu physique avec la gravité. C’est le jeu se montrant comme jeu. Die Verfremdung (la distanciation) de Bertolt Brecht est un théâtre dérobé de la fiction crédible où l’analyse du réel est sur scène. Dans cette perspective, une scénographie n’est plus un lieu de fiction, référant à un autre lieu préexistant. En fait, une scénographie est une machine qui produit du réel dans le théâtre. C’est une machine à l’action, à la performance.
Dans mon travail de scénographe, j’ai la réputation (un peu exagérée et chérie en même temps) de ne jamais lire les pièces pour lesquelles je vais proposer une scénographie. En collaborant avec un metteur en scène, je me considère plutôt comme l’architecte d’un parc : le parc est un lieu de possibilités et d’impossibilités qui ne prédit pas tout ce qui va s’y passer. Le parc n’est pas coupable des tragédies qui vont s’y produire. Parfois, je connais déjà la scénographie avant le premier rendez-vous avec le metteur en scène et le projet. D’autres fois, c’est la façon de parler du metteur en scène, ou la connaissance de ses projets antérieurs qui m’influencent… Je me demande toujours : quelle serait la plus belle machine pour ce projet? Est-ce qu’il faut une machine très rigide produisant des réalités très rythmées, ou est-ce qu’il faut une machine qui génère des libertés et de l’imprévisible? Pour l’opéra Avis de tempête de Georges Aperghis[1], j’avais dessiné une « bulle d’écrans vidéo », au sein de laquelle se logeait une tour de contrôle en forme de microscope pointu, qui pouvait exploser dans l’espace. Mais tout a changé au cours du projet (le concept et le libretto), sauf la scénographie. Pour le chorégraphe néerlando-brésilien Guilherme Miotto, j’ai conçu quelques scénographies et lumières bien avant la première répétition ou avant le concept du spectacle. Même les lumières étaient déjà préprogrammées. Cela peut paraître un peu bizarre, paresseux ou arrogant même, mais en fait, cela se passe ainsi dans notre vie de tous les jours. Les rues, les parcs, les endroits où nous vivons étaient déjà là bien avant notre « histoire », et les lumières (même la pluie ou le brouillard) sont programmées en ignorant nos intentions ou nos histoires. Si vous voulez monter un spectacle, lisez la Bible avant tout. À la première page de la Genèse[2], tout est assez bien expliqué :
(Genèse, 1.1-1.4).Au commencement, Dieu créa les Cieux et la terre.
La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de
[Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres
Bref, je suggère de monter un spectacle d’abord par la lumière, ensuite par le lieu et, enfin, par les acteurs et leurs tragédies.
Ce qui m’a toujours paru étrange c’est que, dans le théâtre, nous avons pris l’habitude de faire l’inverse. En tant que metteur en scène et scénographe, je radicalise cette approche. Pour la création de Kepler[3], le dernier opéra de Philip Glass que j’ai mis en scène à Linz (dans le cadre de Linz09), le décor a, à peu de choses près, été conçu avant l’écriture du livret. Mieux encore, la scénographie de Kwartet[4] de Heiner Müller était une machine à vidéo en forme de cube que j’avais conçue anciennement. Dans les notes, j’avais indiqué – en boutade : « pour donner un très mauvais exemple, on pourrait jouer Quartett là-dedans ». Ce n’était rien qu’un jeu de mots – je n’avais jamais lu Quartett. Par coïncidence, le théâtre où je travaillais à ce moment-là a vendu ce projet au Schauspielhaus de Vienne : rien à faire, il me fallait monter Quartett dans cette machine, et en deux langues : le néerlandais et l’allemand.
Retournons aux médias (to make matters worse[5]) : chaque médium (que je considère comme le territoire d’une technologie) essaie de se propager le plus vite possible, comme une entité biologique. Le médium le plus agile et le mieux adapté à son environnement, le médium le plus « rapide » va gagner le concours. Ce qui rend un médium plus agile et rapide, c’est sa capacité à modifier le temps. Cette force autonome du médium est sous-estimée systématiquement. Comme Marshall McLuhan l’explique dans « Le message c’est le médium », chapitre de son célèbre ouvrage Pour comprendre les médias (1977[6]), c’est l’ampoule électrique qui a inventé le travail de nuit. Ou, bien avant cela, comme Yuval Noah Harari le démontre dans Sapiens (2011), nous n’avons pas domestiqué le blé, c’est le blé qui nous a domestiqués. Pendant toute l’histoire de l’humanité, nous sommes devenus les esclaves inconscients de nos propres inventions technologiques et de leur territoire, les médias. Ainsi, on pourrait dire que ce ne sont certainement pas les journalistes ni les électeurs qui ont élu Donald Trump, mais le médium de la télévision et de l’Internet. On vit en symbiose permanente avec les médias que nous avons inventés avec nos technologies. Et c’est la vitesse du médium le plus rapide (ou agile) qui décide du cours de la route.
Au cinéma, on regarde la fiction à la vitesse de nos mémoires. En fait, une réalité est pré-comprimée à la façon de nos mémoires. Le jump-cut est l’outil essentiel : tout ce qui empêche la construction d’une mémoire fictionnelle est supprimé. Nous vivons presque à la vitesse de la lumière : la lumière vide, sans jugement, sans conséquence, projetée dans le noir absolu sur un blanc absolu. Dans une salle de cinéma, il n’y a rien, on y est le seul spectateur. C’est assez différent du théâtre où la fiction (ou, plus précisément, la construction de la fiction) se joue à la vitesse de la réalité. Si le théâtre peut être considéré comme un médium, c’est un médium qui ne transforme pas la vitesse du temps. De plus, on le regarde toujours en collectivité, très conscient des constructeurs de la pièce et des autres spectateurs. On est toujours là, ensemble, spectateurs et acteurs, dans un même espace éthique et politique…
La fragmentation virtualisante qu’Internet impose émule nos rêves. Sur Internet, nous existons dans plusieurs mondes en parallèle, en sautant d’une « fenêtre ouverte » à l’autre, ce qui crée des ruptures temporelles. C’est devenu une dépendance assez semblable à nos rêves. On ne vit plus dans la réalité ni dans la fiction linéaire : la vie devient rêve…
Dans mes propres projets, j’essaie de problématiser cette « bagarre » entre les médias, the survival of the fittest[7]. Qu’est-ce qui se passe quand on infecte le théâtre par l’emploi des médias virtualisants? Retournons à Kwartet : comme il me fallait monter la pièce en deux langues, j’ai retenu l’idée de faire doubler (lip-sync, surjeu) tout le texte par les acteurs, de sorte que ces mêmes acteurs (d’environ vingt-trois ans) pouvaient jouer la pièce dans les deux langues, même s’ils ne parlaient pas l’allemand. De plus, je pouvais fabriquer des humains hybrides : des jeunes acteurs parlant avec des voix de femmes adultes. Pour ce procédé, tout le texte, que j’ai préenregistré avec chacune des deux actrices, séparément, a été coupé en 1400 séquences que les acteurs, situés sur leur petit plateau translucide surplombant les spectateurs, pouvaient lancer à partir d’un ordinateur. Quand les deux personnages de Kwartet décidaient de changer de rôle, les deux acteurs changeaient de voix d’actrice. En fait, dans tout ce spectacle, les acteurs ne disaient rien, ils faisaient semblant. Cette construction d’un mensonge médiatisé était au coeur de ce projet. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est que la plupart des spectateurs n’avait aucune idée de ce qui se passait. « D’où viennent ces acteurs avec ces voix assez extraordinaires? » était l’un des commentaires les plus fréquents. Dans la version allemande (qui mettait en présence les mêmes acteurs, mais en surjeu des voix préenregistrées d’actrices autrichiennes), cet effet était encore plus étrange : « comment peuvent-ils jouer dans une langue qu’ils ne parlent pas? »
Dans les projets que j’ai réalisés ensuite, j’ai d’abord travaillé avec des voix virtuelles, puis avec des acteurs ou chanteurs virtuels sur scène. L’effet est pareil : en tant qu’être humain, le spectateur n’est pas doué pour remarquer la virtualité sur scène. Il est extrêmement facile de tromper le spectateur – d’où la popularité des concerts qui rendent présents des chanteurs morts grâce à la technique de l’hologramme. Ces chanteurs ne sont jamais des hologrammes en 3D, ce ne sont que des projections en 2D (le plus souvent en utilisant le vieux procédé du Pepper’s Ghost[8]). Il ne s’agit pas tellement du triomphe de la technologie, mais plutôt d’un défi lancé à notre capacité de spectateur à distinguer le réel du virtuel. En réalité, notre cerveau a peu évolué ces derniers millénaires. Il est doué pour courir dans la savane, mais pas pour discerner nos propres truquages technologiques…
Dans mon dernier grand projet, la création du nouvel opéra Der Golem de Bernhard Lang[9], on a essayé de pousser les limites du concept de cette intermédialité (la contamination d’un médium par un autre). Au lieu de partir d’un livret écrit, j’ai réalisé un film muet, qui tenait compte du rythme et de la longueur de l’opéra (encore à composer à ce moment). Ce film[10] est comme une énigme, sans histoire linéaire. Je voulais me rapprocher du style « pseudo Kabbale » du roman original de Gustav Meyrink, publié en 1915. J’ai envoyé ce film à Bernhard Lang, le compositeur viennois, qui en était extrêmement ravi. En lisant la composition de l’opéra un an plus tard, j’étais d’abord un peu déçu du résultat, parce qu’en fait, pour l’histoire chantée de cet opéra, Lang a repris sa propre réduction du livre de Meyrink. Bizarrement, le film-livret a surtout influencé la composition musicale même. L’opéra suit les temps, la structure, les rythmes et les atmosphères du film, mais pas l’histoire énigmatique. Ce n’est pas si étrange que cela, car un film muet est presque insupportable à regarder sans le son. Un film muet supplie la musique de venir. Ainsi, ce procédé assez singulier du « livret en vidéo » avait du sens… Au lieu de guider le récit de l’opéra (comme prévu), ou d’influencer la scénographie ou la mise en scène, il a produit de la musique.
Concernant la mise en scène et la scénographie de l’opéra Der Golem, j’avais déjà pensé la majeure partie de la scénographie avant la finition du film. Toutes les formes sur scène étaient des écrans, mais pour les images, à part celles des chapitres du film, je n’ai presque rien récupéré du film. Ce dernier est une énigme solitaire que je voulais synchroniser, dans le futur, avec la musique de l’opéra final.
Dans nos discussions que nous menons parfois à la manière d’un numéro de stand-up comedy, mon cher ami Chiel Kattenbelt défend l’hybridité inhérente du théâtre et moi, je rêve d’un théâtre vierge, dénudé de tout effet médiatique. Ironiquement, dans ma pratique artistique (parfois citée comme référence par Kattenbelt), c’est l’inverse : c’est moi qui suis coupable d’infester le théâtre par des procédés virtualisants.
Dans mon rêve d’un théâtre vierge, si l’on donne la chance au théâtre de devenir l’endroit où la réalité reste encore pure, avec sa lenteur et sa gravité non médiatisée, je suis persuadé que ce sera l’art le plus privilégié de notre monde, qui, lui, devient toujours plus virtuel et dont l’accélération du rythme est exponentielle. Le théâtre sera un abri contre la virtualité qui, de plus en plus, infiltrera chaque aspect de notre vie quotidienne. Dès lors, mon travail de vidéaste et scénographe est subversif : j’essaie de montrer dans et par l’espace théâtral les menaces de la contamination médiatique. Dans notre vie, nous risquons de perdre la réalité. Essayons de la préserver et de la fêter sur scène grâce à des machines scénographiques qui produisent de la réalité pure et dure… En tant que scénographe, en prenant la responsabilité autonome de la création de l’endroit (et du médium) où va se jouer la pièce, on peut sauvegarder cette réalité précieuse, en péril.
Parties annexes
Note biographique
Ayant étudié la vidéographie à Bruxelles, Peter Missotten travaille sur divers types de médias et se spécialise plus particulièrement dans le métissage de la technologie et du théâtre. Il a participé à la conception de plusieurs spectacles mis en scène par Guy Cassiers, comme Rouge décanté (2005) et The Woman Who Walked into Doors (2001). Il a mis en scène Kwartet de Heiner Müller (2006), The Waste Land de T.S. Eliot (2007), L’intruse de Maurice Maeterlinck (2010) et a réalisé la mise en scène et la scénographie de Kepler (création mondiale de l’opéra de Philip Glass pour Linz09, 2009) ainsi que de deux opéras de Bernhard Lang au Nationaltheater Mannheim : Montezuma (2010) et Der Golem (2016). Depuis 2004, il enseigne l’art de la performance à la Toneelacademie de Maastricht. Il est professeur d’art, axé sur la technologie (Lector Technology Driven Art) à l’Université de Zuyd. www.technologydrivenart.org
Notes
-
[1]
Avis de tempête est un opéra sur un livret de Georges Aperghis et Peter Szendy créé en 2004 à l’Opéra de Lille, dans une mise en scène de Georges Aperghis et une scénographie de Peter Missotten. Le travail de la vidéo a été assuré par Kurt d’Haeseleer (De Filmfabriek).
-
[2]
« La Terre, le temps et l’espace », mise en scène et scénographie de Dieu (début du temps).
-
[3]
Kepler, opéra de Philip Glass sur un livret de Martina Winkel. Création à Linz (Autriche) le 20 septembre 2009, sous la direction de Dennis Russel Davies, dans une mise en scène et une scénographie de Peter Missotten.
-
[4]
Kwartet (Quartett) de Heiner Müller. Création à Toneelhuis van Antwerpen (Belgique) en 2007, dans une mise en scène et une scénographie de Peter Missotten. La graphie néerlandaise Kwartet est conservée dans le texte pour distinguer ce spectacle des autres productions de Quartett.
-
[5]
Allons de pire en pire.
-
[6]
L’ouvrage original, Understanding Media, a paru en 1964.
-
[7]
La loi du plus adapté.
-
[8]
« Inventé en 1862 par l’ingénieur britannique Henry Dircks et amélioré par John Henry Pepper, […] le Pepper’s Ghost effect [ou fantôme de Pepper] est l’un des effets optiques les plus spectaculaires dans l’univers des arts de la scène et de l’illusionnisme fantasmagorique » (Dospinescu, 2013 : 292). Cet effet est produit en utilisant un projecteur de lumière et une surface transparente; il donne l’impression que des objets peuvent disparaître, apparaître ou se transformer. « L’effet fantomatique […] s’explique par la réflexion d’une partie de lumière alors que l’autre partie se disperse en traversant la surface transparente. C’est la lumière qui se reflète dans la surface [transparente] qui crée l’illusion d’une présence fantomatique tridimensionnelle sur scène. Celle-ci semble ainsi interagir avec l’univers scénique » (idem).
-
[9]
Der Golem, un opéra de Bernhard Lang sur le livret de Gustav Meyrink et le livret vidéo de Peter Missotten. Le spectacle a été créé au Nationaltheater Mannheim (Allemagne) le 16 avril 2016 sous la direction de Joseph Trafton, dans une mise en scène et scénographie de Peter Missotten.
-
[10]
Consulter la page www.vimeo.com/104054401 pour visionner le film muet.
Bibliographie
- DOSPINESCU, Liviu (2013), « “Être ou ne pas être” : l’impossible présence du personnage virtuel au théâtre », dans Renée Bourassa et Louise Poissant (dir.), Personnage et corps performatif : effets de présence, Québec, Presses de l’Université du Québec, « Esthétique », p. 285-304.
- HARARI, Yuval Noah (2011), Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin Michel.
- MCLUHAN, Marshall (1977), Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, trad. Jean Paré, Paris, Seuil.