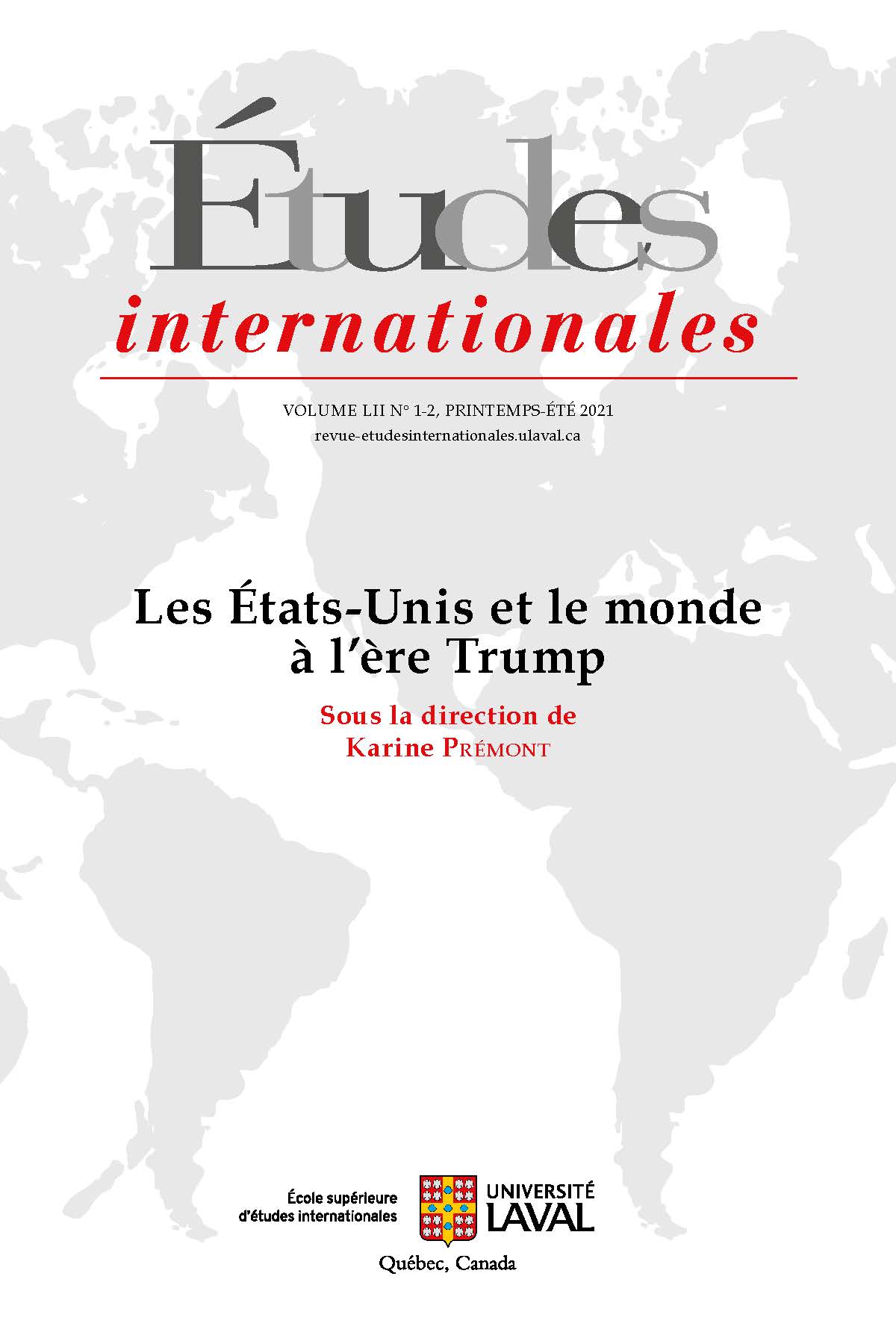Résumés
Résumé
Les conséquences de la personnalité et du style présidentiel de Donald Trump sur la politique étrangère des États-Unis ont fait l’objet de nombreuses spéculations à son arrivée à la Maison-Blanche. Est-ce que les méthodes non orthodoxes de ce président inexpérimenté transformeront irrémédiablement la politique étrangère ? Est-ce que les contraintes institutionnelles et structurelles de la société américaine et du système international pourront freiner la révolution annoncée ? Après quatre ans d’une présidence tumultueuse, nous constatons plutôt que Donald Trump a mis en place une politique étrangère histrionique qui agissait comme miroir grossissant des ambiguïtés, des hésitations et des erreurs de la politique étrangère américaine depuis le 11 septembre 2001 et ce, à trois niveaux. D’abord, une rupture de ton mais une continuité sur le fond qui envoyait des messages contradictoires, tant au sein de l’appareil de sécurité nationale que dans le monde, et qui minait la crédibilité des États-Unis ; ensuite, une double crise – de l’identité américaine et de l’ordre mondial – qui faisait obstacle au compromis ; enfin, une gestion du déclin axée à la fois sur la compétition économique et le désengagement politique et militaire, qui contribuait à l’instabilité internationale et à l’affaiblissement du leadership américain. Les articles de ce numéro analysent ces éléments de la politique étrangère de Trump à travers le prisme de différents enjeux régionaux et transnationaux.
Mots clés:
- États-Unis,
- politique étrangère,
- système international,
- déclin,
- Trump
Abstract
The impact of Donald Trump’s personality and leadership style on u.s. foreign policy was the subject of much speculation upon his arrival at the White House. Will this inexperienced president’s unorthodox methods irrevocably transform foreign policy ? Are the institutional and structural constraints of the American society and the international system would hinder the announced revolution ? After four years of a tumultuous presidency, we find that Donald Trump has put in place a histrionic foreign policy that acted on three levels, as a magnifying mirror of the ambiguities, hesitations, and errors of American foreign policy since September 11, 2001. First, a break in tone but a substantive continuity that sent contradictory messages, both within the national security apparatus and in the world, undermining the credibility of the United States ; second, a double crisis – of American identity and of the world order – that impeded compromises ; third, a management of decline focused on both economic competition and political and military disengagement that contributed to international instability and the weakening of American leadership. In this issue, authors analyze these elements of Trump’s foreign policy through the prism of various regional and transnational issues.
Keywords:
- United States,
- foreign policy,
- international system,
- decline,
- Trump
Corps de l’article
Le président Donald Trump a rapidement imposé son rythme au système international et plus particulièrement aux alliés traditionnels des États-Unis. Tout d’abord, en matière de commerce, il a annoncé que les États-Unis ne participeraient pas au Partenariat transpacifique (tpp), puis il a mis en branle le processus de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (aléna) avec le Mexique et le Canada, en même temps qu’il accusait l’Organisation mondiale du commerce (omc) d’être inefficace et qu’il déclarait une guerre commerciale avec la Chine. En termes politiques et diplomatiques, Trump s’est inscrit en porte-à-faux avec la plupart des alliés des États-Unis, en particulier avec les pays européens, notamment dans le cadre des sommets tels que le g7 et le g20, lors desquels il a refusé de collaborer aux ententes multilatérales sur les questions environnementales et de dénoncer le comportement de la Russie sur la scène internationale. Ces décisions ne semblaient pas s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale mais émanaient plutôt d’une vision transactionnelle de la politique étrangère où les relations internationales constituaient un jeu à somme nulle, dont le slogan « America First » était l’incarnation. Il faut dire que le processus décisionnel de Trump, au-delà des dysfonctions propres à son style présidentiel, était miné par la succession des conseillers à la sécurité nationale et par la paralysie, voire la destruction, du National Security Council. Dans ces circonstances, peut-on dire qu’au-delà d’un simple changement de ton, Donald Trump a fondamentalement transformé la politique étrangère américaine ? Pour répondre à cette question complexe, il faut d’abord s’interroger sur trois autres dimensions. D’abord, celle de la continuité – ou de la rupture – de la politique étrangère des États-Unis sous Trump : en quoi la politique étrangère américaine a-t-elle changé et quelle est la nature de ces changements ? Ensuite, celle des conséquences des bouleversements simultanés de la société américaine et du système international : comment la crise identitaire des États-Unis empêche-t-elle ce pays de trouver sa place au sein d’un monde en profonde mutation ? À l’inverse, comment les États-Unis sous Trump se sont-ils adaptés aux transformations du système international ? Enfin, celle du déclin, réel ou perçu, de la puissance américaine dans le monde : la logique de compétition et la stratégie de désengagement qui constituaient le coeur de la politique étrangère de Trump représentaient-elles une réponse adéquate au déclin ? L’objectif de cette introduction n’est pas de statuer sur ces éléments, mais plutôt de contextualiser la réponse de l’administration Trump à ces questions pour comprendre comment elle a modelé la politique étrangère des États-Unis, notamment en accroissant l’instabilité mondiale et en affaiblissant le leadership américain. Les articles de ce numéro constitueront autant d’illustrations de ces effets.
I – Rupture ou continuité de la politique étrangère de Donald Trump ?
Depuis quatre ans, les spécialistes débattent de l’importance et de la nature des changements qui ont affecté la politique étrangère des États-Unis durant le mandat de Donald Trump (Foreign Affairs 2018 ; Ashbee et Hurst 2020 : 5). S’il est encore trop tôt pour en mesurer les effets durables, certains auteurs soutiennent que Donald Trump n’a pas radicalement transformé la politique étrangère comme promis durant la campagne de 2016. Proposant une perspective plus nuancée, ils affirment que nous étions face à la fois à une continuité et à une rupture par rapport aux administrations précédentes. Une continuité d’abord, puisque les contraintes structurelles et diplomatiques sont telles qu’elles empêchent les changements trop marqués (Porter 2018 : 40 ; Olsen 2019). En ce sens, le « repli brutal » des États-Unis de la scène internationale, sous Trump, ne serait que la suite de ce que Robert Zoellick appelle la « réticence diplomatique » de Barack Obama (Zoellick 2020 : 463). Pour Peter Dombrowski et Simon Reich, Trump n’a fait que perpétuer le mouvement isolationniste enclenché par George W. Bush et Obama, par exemple sur les questions liées à l’immigration et à la frontière (Dombrowski et Reich 2017 : 1035), voire même, selon Daniel Druckman, par Bill Clinton au sujet d’Israël (Druckman 2019 : 103). Si la forte institutionnalisation des alliances leur permettait de résister aux pressions de Trump (Brands 2017 : 29), la perte de crédibilité et l’affaiblissement du leadership des États-Unis étaient déjà perceptibles sous Obama : les dossiers de la Corée du Nord et de la Syrie en sont des illustrations claires (Yahri-Milo 2018 : 71, 75).
La politique étrangère de Trump serait aussi en rupture avec celle de ses prédécesseurs sur des enjeux peu complexes ou plus techniques (Macdonald 2018 : 404), comme le retrait des États-Unis des accords de Paris et du tpp, mais aussi sur la forme. La personnalisation extrême de la diplomatie et l’utilisation de Twitter comme canal principal de communication avec les alliés et les adversaires (Lüfkens 2018), tout comme la relation amicale entretenue par le président avec des dirigeants autoritaires et des dictateurs (Hill et Hurst 2020 : 1 ; Woodward 2020 : 224) – de Kim Jong-un à Vladimir Poutine, en passant par Rodrigo Duterte, Recep Tayyip Erdogan et Jair Bolsonaro – démontrent à quel point le style de Trump différait de celui qui est habituellement attendu des présidents. Des changements paradigmatiques ont toutefois aussi été observés, que ce soit le rejet de l’activisme des États-Unis dans les affaires internationales (Harris 2018), l’adoption sans condition du protectionnisme par l’administration Trump (Zoellick 2020 : 466) ou encore « l’abandon d’un objectif moral bien défini » pour la politique étrangère américaine (Ashbee et Hurst 2020 : 5). Ces ruptures, toutefois, ne doivent pas être exagérées (Ashbee et Hurst 2020 : 15), d’autant plus que le président n’a pas pu bénéficier d’un second mandat pour les pérenniser.
La question de la continuité et du changement n’est pas unique à la présidence Trump : chaque nouveau président, en particulier lorsqu’il a un style ou une idéologie qui tranche avec les standards de son époque, peut être perçu comme un perturbateur ou un transformateur (Skowronek 1997). Sans oublier que la plupart des nouveaux présidents arrivent en poste en promettant le changement et « se définissent par contraste » avec leurs prédécesseurs (Kitchen 2020 : 98). Par exemple, l’ouverture à la Chine orchestrée par Richard Nixon et la rétrocession du canal de Panama ratifiée par Jimmy Carter ont suscité de vives controverses et ont été dénoncées comme des ruptures avec les traditions de la politique étrangère des États-Unis. Plus récemment, l’invasion de l’Irak par l’administration de George W. Bush « sans légitimation de l’onu » (Kandel 2018 : 181) et le rapprochement entre Obama et Raùl Castro ont aussi été fortement critiqués, en partie parce que ces gestes étaient perçus comme des déviations importantes de la politique étrangère traditionnelle des États-Unis – l’intervention de l’Irak parce qu’elle rejetait le multilatéralisme qui prévalait depuis une vingtaine d’année, le rapprochement avec Cuba parce qu’il accordait légitimité et reconnaissance diplomatique à un régime dictatorial. Dans le cas de Donald Trump, son inexpérience, en particulier en politique étrangère, renforçait cette impression d’un président perturbateur, surtout qu’il se targuait, durant les primaires républicaines de 2016, de ne pas avoir besoin de conseils en matière de politique étrangère (Gass 2016).
Avec l’arrivée d’un président perturbateur et imprévisible aux commandes, plusieurs observateurs s’attendaient à de nombreux bouleversements au moment où les États-Unis se trouvaient à un moment charnière de leur histoire diplomatique. En effet, la volatilité des idées du président (Woodward 2018), son traitement inadéquat de l’information (Burke 2018 : 656), l’importance démesurée accordée à ce qu’il voyait à la télévision (Yahri-Milo 2018 : 75) et son mépris de l’expertise (Wolff 2018 : 114) ont eu des conséquences importantes sur le processus décisionnel de son administration (Da Vinha 2019 ; David 2020), sur la confiance des alliés et sur la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale (Brands 2017 : 30 ; Pagedas 2018 : 33 ; Yahri-Milo 2018 : 68 ; Babbitt 2019).
II – Les États-Unis à la confluence de deux crises
S’il est facile de blâmer Trump pour les déboires de la politique étrangère des États-Unis ces dernières années – et l’Histoire le fera sans doute –, il ne faut pas oublier que cette politique était aussi, et peut-être surtout, tributaire du contexte de la politique intérieure des États-Unis et du contexte international. Ainsi, depuis au moins vingt ans, les États-Unis se retrouvent à la confluence de deux bouleversements qui ont un impact majeur sur la politique étrangère et dont les effets ont été exacerbés par la présidence de Trump : une société américaine en pleine crise identitaire et un système international en redéfinition, ces deux phénomènes ayant pour conséquence immédiate de redéfinir les rapports de force traditionnels. Les États-Unis vivent ainsi une période « d’interrègne » (Starobin 2009b : 7), tant à l’échelle nationale qu’internationale, dont l’issue est encore incertaine. Dès 2012, Stephen Walt avait posé une question fondamentale qui liait ces deux crises : les changements intérieurs et extérieurs qui marquent le début du 21e siècle « ont-ils rendu plus difficile l’exercice d’une influence dominante » par les États-Unis sur la scène internationale (Walt 2012, 2018) ?
La crise identitaire que traversent les États-Unis est le résultat de trois phénomènes, dont les origines sont antérieures à Trump. Premièrement, la fin du consensus bipartisan[1] qui prévalait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (Drezner et al. 2020) et qui stipulait notamment la prépondérance de l’internationalisme libéral et sa nécessaire défense. Deuxièmement, la polarisation croissante des deux grands partis politiques américains – le Parti démocrate et le Parti républicain – qui fait obstacle à l’atteinte de compromis politiques (Schultz 2017). Et enfin, la montée du nationalisme (Wojczewski 2019), qui mène à un repli sur soi des États-Unis et mine la capacité du pays d’exercer son leadership sur les affaires internationales. Ce qui étonne, ce n’est pas l’existence même de ces phénomènes, mais plutôt leur simultanéité et leur durée (Kandel 2018 : 183). Bien s’ils soient apparus il y a déjà quelques années, ils ont culminé sous la présidence de Trump et les conséquences de cette crise identitaire ont affecté la politique étrangère des États-Unis de multiples façons. Il y eut tout d’abord l’instrumentalisation des crises à des fins partisanes ou électorales (Kandel 2018 : 180) : ce fut le cas au sujet de l’Iran, que ce soit lors du retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 ou pendant la période de fortes tensions militaires entre les deux pays en décembre 2019 et janvier 2020. Ensuite, l’impossibilité d’adopter des solutions durables aux problèmes de politique étrangère et de sécurité nationale en raison de la multiplicité des voix qui parlaient au nom du pays (Beckley 2011-2012 : 77) : un exemple flagrant est sans aucun doute l’imposition de sanctions contre la Russie à la suite de son ingérence dans le processus électoral de 2016, adoptées par le Congrès malgré les réticences du président Trump, qui affirmait publiquement que cette ingérence était en fait un « canular » des Démocrates et des médias. Enfin, la difficulté pour les États-Unis de prendre des engagements à long terme – et pour les alliés et les adversaires d’y croire – puisqu’ils peuvent être menacés, voire annulés, lors d’un changement d’administration (Schultz 2017 : 9), comme dans le cas des accords de Paris, de la renégociation de l’aléna ou encore de la menace de l’administration Trump de mettre fin à l’accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud (korus fta).
En même temps que les rapports de force changent au sein des institutions américaines, ils sont également mis à rude épreuve à l’intérieur du système international, qui subit lui aussi de profondes mutations depuis le début du siècle. En effet, l’accroissement de la multipolarité, la baisse de confiance envers les institutions internationales et la diminution de leur influence, de même que les développements technologiques – autant militaires qu’informationnels – ont pour effets d’accroître l’incertitude des relations internationales et de diluer l’influence américaine dans le monde, alors même que les États-Unis s’interrogent sur la pertinence d’y jouer encore un rôle de premier plan. Selon Rosa Brooks, la politique étrangère des États-Unis a, sous Obama, « oscillé aléatoirement entre une passivité extrême et une action frénétique mais inefficace » (Brooks 2014), avec pour résultat que le nouvel ordre mondial – voire la coexistence de plusieurs ordres (Acharya 2017) – qui semble se dessiner, bien qu’encore flou, fait peu de cas des intérêts stratégiques, diplomatiques et politiques des États-Unis. Sous Trump, la perte d’influence des États-Unis a été accentuée par l’absence d’une stratégie globale (grand strategy), c’est-à-dire d’un cadre permettant d’identifier les objectifs à long terme de la politique étrangère et de déterminer les stratégies nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique (Popescu 2017 ; Brands 2018 ; Lawless 2020 ; Shively 2020), et par la doctrine unilatéraliste, « America First », du président républicain (Clarke et Ricketts 2017 : 373). L’une des manifestations de cette absence de vision stratégique de l’administration Trump est le fait qu’il n’y avait pas « de discussions stratégiques sur la façon dont les deux grandes puissances [que sont la Chine et les États-Unis] vont coopérer, se concurrencer ou contester » le futur ordre mondial (Zoellick 2020 : 468).
La simultanéité de la crise identitaire des États-Unis et de celle du système international a aussi un impact sur la préparation des États-Unis aux crises et aux tensions, comme l’a révélé la pandémie de covid-19. L’incapacité – ou le refus – des États-Unis d’exercer un leadership positif à ce sujet a d’ailleurs été vivement critiquée par la communauté internationale (Applebaum 2020 ; Ivanov 2020 : 46 ; David et Vallet 2020 : 11), en particulier lors du retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (oms), annoncé en juillet 2020.
III – L’inévitable question du déclin de la puissance américaine
La difficulté qu’ont les États-Unis à faire face à ces défis pose inévitablement la question du déclin de la puissance américaine. Bien entendu, celle-ci a été soulevée maintes fois avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais elle s’impose maintenant avec encore plus d’acuité à la lumière des quatre années de sa présidence. Les tenants du déclin remarquent notamment le retard des États-Unis dans des domaines aussi importants et variés que la santé, l’éducation, la réglementation financière, l’environnement et les technologies (Starobin 2009a ; Starobin 2009b : 79-95), ce qui les empêchent de donner l’exemple et de mettre en oeuvre des projets innovants. Les États-Unis souffrent également de plus en plus de la comparaison avec la Chine, en particulier en termes militaires et économiques (Itzkowitz Shifrinson et Beckley 2012-2013 : 172), d’autant plus que, selon David Rothkopf, l’appareil de sécurité national américain est incapable « d’encourager la réflexion stratégique » pour faire face aux changements du système international (Rothkopf 2014 : 18). Bien que cette comparaison soit contestée – la puissance américaine ne se limite pas à l’économie et au militaire mais s’exerce aussi par l’influence politique et culturelle (Beckley 2011-2012 : 43) –, les conséquences du déclin américain, réel ou perçu, font craindre à certains observateurs qu’elles n’entraînent à leur tour le déclin des normes et des institutions internationales (Kagan 2012 : 99) et menacent la stabilité et la prospérité mondiales (Rachman 2011 : 292).
Le débat sur le déclin de la puissance américaine n’est pas nouveau. Presque toutes les décennies ont semblé annoncé la chute des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale : les années 1950 avec la perte de la Chine aux mains des communistes et le lancement réussi de Spoutnik par l’urss ; les années 1960 et 1970 avec la guerre du Viêt Nam et la parité nucléaire avec l’urss ; la montée de la puissance économique de l’Allemagne et du Japon dans les années 1980 ; l’émergence de la Chine dans les années 1990 (Schultz 2017 : 7) ; la guerre en Irak et la crise financière des années 2000. La chute de l’urss, en 1991, a par ailleurs semblé consacrer la thèse de Paul Kennedy sur le déclin des grandes puissances. Reprenant la thèse de Robert Gilpin (1981) sur le déclin hégémonique, Kennedy affirmait que l’engagement croissant d’un pays dans les affaires mondiales l’obligeait à augmenter considérablement ses dépenses militaires, minant ainsi son économie et causant au bout du compte son déclin (Kennedy 1987). Mais en réalité, la menace du déclin pourrait venir d’ailleurs. Ainsi, Henry Nau a rappelé que la puissance d’un pays ne se mesure pas uniquement en termes militaires et qu’on aurait tort de négliger l’importance de l’identité nationale comme facteur déterminant de celle-ci (Nau 2002). Kenneth Schultz renforce cette affirmation en analysant l’hyperpolarisation américaine comme facteur de déclin (Schultz 2017 : 7). Les attentats du 11 septembre 2001 ont par ailleurs relancé les thèses déclinistes (Lieber 2019 : 23). D’une part, la réponse incohérente et unilatérale de l’administration de George W. Bush à ces attentats aurait accéléré un déclin amorcé trente ans plus tôt (Wallerstein 2009) et, d’autre part, c’est la peur qui guiderait depuis la politique étrangère des États-Unis, freinant le dynamisme et l’innovation (Rothkopf 2014 : 18).
Le déclin est toutefois « une métaphore trompeuse », selon Matt Johnson : les chercheurs ignorent encore beaucoup de choses sur le cycle de vie des États et, dès lors, il est impossible de déterminer avec précision où les États-Unis en sont dans ce cycle (Johnson 2012). Pour Mathieu Bélisle, si les États-Unis « vont de crise en crise » depuis la fin de la guerre froide, ce n’est pas tant en raison de leur déclin, mais plutôt de leur métamorphose, de leur absorption par le reste du monde (Bélisle 2020 : 19-21).
A – La gestion du déclin
Malgré les divergences entre chercheurs, déclinistes ou non, il demeure que ce sont les réactions des présidents face aux mouvances intérieures et extérieures qui sont sans doute les plus révélatrices de l’état de la puissance des États-Unis. Même Richard Nixon et Henry Kissinger avaient accepté, dans les années 1970, l’idée du déclin des États-Unis (Zoellick 2020 : 472), ce qui est peut-être la meilleure façon d’y remédier (Brooks 2014). Les différentes « stratégies d’adaptation » (coping strategies) préconisées par les présidents pour faire face au déclin des États-Unis sont nombreuses. Elles consistent « à utiliser les ressources économiques, militaires, culturelles et politiques existantes de manière compétente – ou stratégique[2] – vis-à-vis d’autres acteurs » (Mérand 2020 : 7)[3]. Face aux acteurs internationaux, la stratégie d’adaptation adoptée par George W. Bush pour gérer le déclin géopolitique des États-Unis a été de tenter de le prévenir (Mérand 2020 : 17) en réaffirmant la puissance militaire américaine par le biais de la « guerre contre le terrorisme » et la guerre en Irak en 2003. Quant à Barack Obama, qui, devant la situation des États-Unis, a plutôt accepté de « décliner poliment » (Quinn 2011 ; Kitchen 2020 : 99), il a surtout opté pour une stratégie de retranchement – ponctuée quelquefois d’engagements, surtout sous forme d’accords économiques et environnementaux multilatéraux – (Mérand 2020 : 17), comme le démontre son approche de leadership from behind lors de l’intervention américaine en Libye en mars 2011, puis durant les événements du Printemps arabe en 2012.
B – La gestion du déclin par Trump : logique de compétition et stratégie de retrait
En raison de l’inexpérience de Donald Trump, de ses caractéristiques personnelles, de sa vision des États-Unis et de leur place dans monde, il n’est pas étonnant de voir que sa stratégie d’adaptation était à l’opposé de celle qu’Obama avait adoptée – et même de celle de George W. Bush. D’abord, parce que Trump a utilisé le déclin perçu des États-Unis comme « une stratégie politique » (Kitchen 2020 : 99) et électoraliste. Ensuite, parce que sa politique étrangère, axée sur la prépondérance des intérêts américains – « America First » – s’écartait « de manière significative des politiques qui ont sous-tendu le leadership mondial des États-Unis au cours des soixante-dix dernières années » (Schultz 2017 : 8) et évoquait « l’isolationnisme de l’entre-deux-guerres et le nationalisme à somme nulle » (Porter 2018 : 38). Finalement, la stratégie d’adaptation du président Trump, basée sur la compétition (Mérand 2020 : 17) se voulait une critique et un rejet de la politique étrangère de son prédécesseur.
Or, en examinant les actions posées par l’administration Trump en matière de politique étrangère, cette stratégie de compétition, bien que significative, ne semble pas suffire pour expliquer et définir cette politique étrangère. Pour Trump, en effet, nul besoin de nier le déclin des États-Unis ou de s’en indigner : les États-Unis ne peuvent être puissants qu’en se retirant des affaires internationales, ou alors, en s’assurant de retirer des bénéfices substantiels de leur présence et de leurs engagements (Atwood 2019 ; Siniver et Featherstone 2020 : 71). La stratégie de compétition adoptée par Trump pour gérer le déclin des États-Unis semblait avérée d’un point de vue global mais était moins adaptée pour comprendre la façon dont les enjeux régionaux étaient abordés par l’administration, en particulier à partir de 2018. Si le deuxième conseiller à la sécurité nationale de Trump[4], H.R. McMaster, avait une vision plus large de la politique étrangère, ses successeurs John Bolton et Robert O’Brien ont forcé, au National Security Council, la priorisation des analyses géographiques plutôt que celles portant sur les enjeux transnationaux (Gans 2019 ; Gans 2020). Il apparaît donc fondamental de prendre en considération les disparités régionales dans la politique étrangère de Trump, d’autant plus qu’elles confirment la personnalisation de cette politique.
Ces réflexions sur la continuité ou la rupture de la politique étrangère de Trump, sur la double crise à laquelle les États-Unis font face et sur le déclin – ou non – de la puissance américaine nous ramènent à la question de départ de ce texte : Donald Trump a-t-il fondamentalement et durablement transformé la politique étrangère des États-Unis ? Nous pensons que l’administration Trump a plutôt créé une politique étrangère histrionique[5], c’est-à-dire basée sur une quête perpétuelle d’attention par tous les moyens (dsm 2013 : 667) – de la menace à la séduction, de la théâtralité à la personnalisation des relations diplomatiques, de la manipulation à l’émotivité excessive. Cette politique étrangère histrionique devenait alors le lieu où s’affrontaient à la fois une logique de compétition (économique) et une stratégie de désengagement (politique et militaire), deux réponses privilégiées par l’administration Trump pour faire face à la complexité et à l’instabilité du monde – dont elle était elle-même une cause. Les articles de ce numéro proposent des analyses qui feront la démonstration de la coexistence de ces deux manifestations de la politique étrangère américaine sous Trump et ce faisant, de son caractère histrionique.
Tout d’abord, deux textes démontrent comment la logique de compétition choisie par l’administration Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche a structuré les relations des États-Unis avec ses rivaux économiques mais aussi, paradoxalement, avec ses principaux partenaires commerciaux. Cette compétition économique et commerciale a exacerbé les tensions géopolitiques et, par le fait même, a affaibli la crédibilité et le leadership américains (Brands 2017 : 31 ; Pagedas 2018 : 33 ; Yahri-Milo 2018 : 75 ; Babbitt 2019 : 118). Dans « Make Geo-Economics Great Again : la géo-économie tabloïde de Donald Trump à l’égard du Canada », Frédérick Gagnon affirme que l’adoption par le président Trump des codes et du style des journaux à sensation et son utilisation « de la logique du conflit militaire » pour aborder les enjeux économiques et commerciaux ont donné lieu à la « géo-économie tabloïde ». Cette approche expliquerait en bonne partie l’impopularité de Trump au Canada, mais aussi la transformation de la relation canado-américaine pendant sa présidence, qui risque de survivre à Trump en raison de l’intérêt des Américains pour les questions économiques et pour la position protectionniste prônée par le président républicain. En ce sens, la politique commerciale de Trump face au Canada constituait également une rupture avec celle de ses prédécesseurs, justifiée par ailleurs par la crise identitaire et partisane qui secoue les institutions politiques américaines.
Puis, Mathieu Arès et Charles Bernard, dans « De la rhétorique populiste au pragmatisme économique : la politique commerciale du président Trump », démontrent que la logique de compétition de Trump en matière commerciale et sa rhétorique fortement idéologique n’étaient pas suffisantes pour délégitimer l’ordre libéral et ne représentaient pas des ruptures drastiques avec les méthodes antérieures. En fait, selon les auteurs, Trump a « fait preuve de cohérence et d’un grand pragmatisme » dans sa politique commerciale, ne serait-ce qu’en raison des contraintes qui limitent le pouvoir présidentiel, en particulier en matière de commerce international. L’ordre mondial, malgré les tensions quelquefois vives qui le traverse, ne serait donc pas aussi fragile – ou aussi fragilisé – qu’on pourrait le croire.
Trois autres textes illustrent, pour leur part, la stratégie de désengagement en réaction au déclin annoncé sur les enjeux politiques et militaires. Sous Trump, les États-Unis se sont non seulement retirés de nombreux accords internationaux, mais ont aussi diminué substantiellement leur engagement militaire, dont en Afghanistan et en Syrie, mettant en péril les équilibres fragiles de ces pays, mais aussi, plus largement, celui de la puissance américaine (Glasser 2019 ; Brands, Feaver et Inboden 2020 ; Drezner 2020). Dans « La politique iranienne des États-Unis : oscillations et continuité ([1900] 1977-2020) », Pierre Pahlavi soutient que la politique de Trump face à l’Iran s’inscrivait davantage dans la continuité que dans la rupture, même si le ton et la forme avaient changé. La politique de « pression maximale » adoptée par l’administration pour forcer l’Iran à mettre fin à son programme nucléaire – et par le fait même, pour l’affaiblir à l’interne et sur la scène internationale – serait surtout le résultat d’une « modification majeure du contexte géopolitique ». Le désengagement américain du Moyen-Orient, amorcé par Obama mais accentué par Trump, en serait une illustration claire.
La stratégie de désengagement de l’administration Trump est aussi visible face à la Russie, comme l’explique Yann Breault dans « Le “nouveau départ” de la course russo-américaine aux arsenaux nucléaires ». Même si les deux pays s’affrontent sur le terrain de l’armement nucléaire – le retrait des États-Unis du traité inf en 2019 tend à le confirmer –, le point focal de l’attention américaine s’est clairement déplacé vers la Chine. Ainsi, l’administration Trump a semblé « peu à peu reléguer les activités militaires extraterritoriales de la Russie au second rang des priorités sécuritaires américaines », d’autant plus que le Congrès et la présidence ont eu du mal, en quatre ans, à s’entendre sur la position à adopter face à la Russie. La double crise à laquelle les États-Unis font face expliquerait alors en partie la retenue de l’administration Trump.
L’article de Christophe Cloutier-Roy, « “I Have an Open Mind to It” : la diplomatie climatique américaine comme reflet des perceptions du président, de George W. Bush à Donald Trump », est une démonstration de la stratégie de désengagement de Trump face aux changements climatiques, dont les effets « sont concrets et pourraient se réverbérer longtemps ». L’auteur analyse les positions de Bush, Obama et Trump et conclut que ce sont leurs perceptions qui dictent leurs politiques au sujet des changements climatiques – sur cet enjeu, mais aussi sur le multilatéralisme et la relation entre les États-Unis et la Chine. Encore une fois, la double crise, identitaire et internationale, renforce les perceptions du président et induit une stratégie de désengagement.
Au-delà de la question de la continuité ou de la rupture, ou même de celle du déclin et de l’importance du contexte international sur la formulation de la politique étrangère américaine, ce sont surtout les contradictions des politiques de Trump à ce sujet qui étonnent. Contradictions entre le discours et les actions (Russie et Afghanistan) et contradictions entre les objectifs et les effets (Corée du Nord et Iran). Si la personnalité du président Trump pouvait expliquer en partie ce phénomène, c’est surtout, selon Vincent Boucher et Karine Prémont, son hostilité envers l’expertise de l’appareil de sécurité nationale qui le distingue de ses prédécesseurs et qui l’empêchait de mettre en oeuvre sa politique étrangère. Dans le premier texte de ce numéro, intitulé « “I Alone Can Fix It” : les conséquences de l’hostilité de Donald Trump envers l’expertise sur la politique étrangère des États-Unis », les auteurs analysent les effets de cette hostilité : tout d’abord, une fausse tension loyauté-compétence dans le choix des conseillers ; ensuite, une préférence pour les gains symboliques et une sous-utilisation des ressources bureaucratiques pour pérenniser les changements instaurés ; et enfin, une préparation inadéquate aux crises.
Conclusion
L’objectif de ce numéro est de prendre la mesure des conséquences que la politique étrangère histrionique de Trump – faite à la fois de compétition et de désengagement – aura sur les enjeux centraux de ce difficile 21e siècle, notamment dans un contexte post-pandémique. La crise de la covid-19 aura assurément des effets sur « l’architecture de la sécurité globale » (Ivanov 2020 : 70) et plus particulièrement sur le leadership américain au sein de cette nouvelle configuration. Alors que Trump a vraisemblablement accéléré l’instabilité du système international, la présidence de Joe Biden réussira-t-elle à freiner à la fois la désagrégation des alliances et la perte d’influence des États-Unis ? Cela est-il même encore souhaitable ? Les altérations apportées par Trump à la politique étrangère des États-Unis, autant sur la forme que sur le fond, ont-elles ouvert la porte à une course à la succession pour remplacer l’hégémonie américaine ou alors à une alliance de circonstance entre la Chine et la Russie, dont les forces et les ambitions combinées pourraient empêcher le fameux « retour à la normale » tant espéré par les alliés des États-Unis ?
* * *
Alors que la francophonie regorge de femmes spécialistes des États-Unis et des Relations internationales et malgré les efforts déployés lors de l’élaboration de ce numéro pour qu’y figurent autant d’articles rédigés par des femmes que par des hommes, cet objectif n’a pu être atteint, même de loin. Autant de femmes que d’hommes ont été invitées à participer à ce numéro mais, alors que les hommes ont répondu positivement, les femmes nous ont dit que les responsabilités et les charges supplémentaires qui s’imposaient à elles en raison de la pandémie de covid-19 (les invitations ont été lancées en mars et avril 2020) les contraignaient à restreindre leurs activités professionnelles ou à s’en tenir aux engagements déjà pris. Il nous semble que cela est en soi révélateur des obstacles auxquels les femmes font face et des dynamiques de genre qui régissent – encore au 21e siècle – nos sociétés pourtant avancées et notre profession pourtant libérale.
Parties annexes
Note biographique
Karine Prémont
L’auteure est professeure à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’uqam.
Notes
-
[1]
Depuis les années 1990, plusieurs auteurs remettent toutefois en cause l’existence même d’un consensus bipartisan durant la guerre froide (Wittkopf et McCormick 1990 ; Perlstein 2020).
-
[2]
Italiques dans l’original.
-
[3]
Frédéric Mérand propose une typologie à deux niveaux de ces stratégies : sur la scène internationale (prévention, compétition, retranchement, engagement) et sur la scène nationale américaine (isolement, innovation, imitation, auto-renforcement). Notre objectif n’étant pas ici de décrire ou d’analyser ces stratégies, ni même de les remettre en question, les lectrices et lecteurs pourront consulter le chapitre de Frédéric Mérand à ce sujet dans l’ouvrage Coping with Geopolitical Decline, dont il est également le directeur (Mérand 2020 : 3-22). Pour les besoins de cet article, nous n’aborderons que les stratégies d’adaptation face au système international.
-
[4]
Le premier, Michael Flynn, n’aura occupé la fonction que pendant les trois premières semaines de l’administration.
-
[5]
L’utilisation du concept d’histrionisme, emprunté à la psychologie et à la psychiatrie, est ici dénué du jugement clinique qui accompagne généralement cette condition. Il s’agit uniquement de qualifier les manifestations visibles de la politique étrangère de Trump, et non le comportement du président lui-même.
Références
- Acharya Amitar, 2017, « After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order », Ethics and International Affairs, septembre. Page consultée sur Internet (https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2017/multiplex-world-order/) le 21 novembre 2020.
- American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Arlington, American Psychiatric Association.
- Applebaum Anne, 2020, « The Rest of the World Is Laughing at Trump », The Atlantic, 3 mai. Page consultée sur Internet (https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/time-americans-are-doing-nothing/611056/?utm_term=2020-05-03T10%253A45%253A57&utm_content=edit-promo&utm_campaign=the-atlantic&utm_source=twitter&utm_medium=social) le 1er juin 2020.
- Ashbee Edward et Steven Hurst, 2020, « The Trump foreign policy record and the concept of transformational change », Global Affairs, vol. 6, no 1 : 5-19.
- Atwood Kylie, 2019, « Trump administration may seek more money from us allies hosting military forces », cnn, 9 mars. Page consultée sur Internet (https://www.cnn.com/2019/03/09/politics/trump-admin-us-bases-more-money/index.html) le 11 novembre 2020.
- Babbitt Eileen F., 2019, « Will the Trump Administration Change International Diplomacy? » Negotiation Journal, vol. 35, no 1 : 117-149.
- Beckley Michael, 2011-2012, « China’s Century ? », International Security, vol. 36, no 3 : 41-78.
- Bélisle Mathieu, 2020, L’empire invisible. Essai sur la métamorphose de l’Amérique, Montréal, Leméac.
- Brands Hal, 2017, « The Unexceptional Superpower : American Grand Strategy in the Age of Trump », Survival, vol. 59, no 6 : 7-40.
- Brands Hal, 2018, American Grand Strategy in the Age of Trump, Washington, Brookings Institution Press.
- Brands Hal, Peter Feaver et William Inboden, 2020, « In Defense of the Blob », Foreign Affairs, 29 avril. Page consultée sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-29/defense-blob) le 11 novembre 2020.
- Brooks Rosa, 2014, « Embrace the Chaos », Foreign Policy, 14 novembre. Page consultée sur Internet (https://foreignpolicy.com/2014/11/14/embrace-the-chaos/) le 25 octobre 2020.
- Burke John P., 2018, « Struggling with Standard Order: Challenges and Performance of the Trump National Security Council System », Presidential Studies Quarterly, vol. 48, no 4 : 640-666.
- Clarke Michael et Anthony Ricketts, 2017, « Donald Trump and American Foreign Policy : The Return of the Jacksonian Tradition », Comparative Strategy, vol. 36, no 4 : 366-379.
- David Charles-Philippe, 2020, L’effet Trump. Quel impact sur la politique étrangère des États-Unis ? Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- David Charles-Philippe et Élisabeth Vallet, 2020, Comment Trump a-t-il changé le monde ? Le recul des relations internationales, Paris, cnrs Éditions.
- Da Vinha Luis, 2019, « Competition, Conflict, and Conformity: Foreign Policy Making in the First Year of the Trump Presidency », Presidential Studies Quarterly, vol. 49, no 2 : 280-309.
- Dombrowski Peter et Simon Reich, 2017, « Does Donald Trump Have a Grand Strategy? » International Affairs, vol. 93, no 5 : 1013-1037.
- Drezner Daniel W., 2020, « Immature Leadership: Donald Trump and the American Presidency », International Affairs, vol. 96, no 2 : 383-400.
- Drezner Daniel W., Ronald R. Krebs et Randall Schweller, 2020, « The End of Grand Strategy: America Must Think Small », Foreign Affairs, mai-juin : 107-117.
- Druckman Daniel, 2019, « Unilateral Diplomacy : Trump and the Sovereign State », Negotiation Journal, vol. 35, no 1 :101-105.
- Foreign Affairs, 2018, « Ask the experts : Has us foreign policy changed dramatically ? » Foreign Affairs, 13 février. Page consultée sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/ask-the-experts/2018-02-13/has-us-foreign-policy-changed-dramatically) le 25 octobre 2020.
- Gans John, 2019, « At the National Security Council, Trump loyalists are at war with career aides », The Washington Post, 21 novembre. Page consultée sur Internet (https://www.washingtonpost.com/outlook/inside-the-national-security-councils-war-between-trump-loyalists-and-career-aides/2019/11/21/0a5c0f52-0be1-11ea-bd9d-c628fd48b3a0_story.html) le 11 novembre 2020.
- Gans John, 2020, « Col. Vindman and the Trumpification of the National Security Council », The New York Times, 7 février. Page consultée sur Internet (https://www.nytimes.com/2020/02/07/opinion/alexander-vindman-nsc-trump.html) le 11 novembre 2020.
- Gass Nick, 2016, « Trump : “The Experts Are Terrible” », Politico, 4 avril. Page consultée sur Internet (https://www.politico.com/blogs/2016-gop-primary-live-updates-and-results/2016/04/donald-trump-foreign-policy-experts-221528) le 25 octobre 2020.
- Gilpin Robert, 1981, War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
- Glasser Susan, 2019, « Mike Pompeo, the Secretary of Trump », The New Yorker, 19 août. Page consultée sur Internet (https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/mike-pompeo-the-secretary-of-trump) le 11 novembre 2020.
- Harris Peter, 2018-2019, « Why Trump Won’t Retrench: The Militarist Redoubt in American Foreign Policy », Political Science Quarterly, vol. 133, no 4 : 611-640.
- Hill Matthew et Steven Hurst, 2020, « The Trump presidency: continuity and change in us foreign policy », Global Affairs, vol. 6, no 1 : 1-3 et 143-147.
- Itzkowitz Shifrinson Joshua R. et Michael Beckley, 2012-2013, « Correspondence: Debating China’s Rise and u.s. Decline », International Security, vol. 37, no 3 : 172-181.
- Ivanov Iskren, 2020, « Reshaping u.s. Smart Power: Towards a Post-Pandemic Security Architecture », Journal of Strategic Studies, vol. 13, no 3 : 46-74.
- Johnson Matt, 2012, « Declinist Pundits », Foreign Policy, 8 octobre. Page consultée sur Internet (https://foreignpolicy.com/2012/10/08/declinist-pundits/) le 25 octobre 2020.
- Kagan Robert, 2012, The World America Made, New York, Knopf.
- Kandel Maya, 2018, Les États-Unis et le monde. De George Washington à Donald Trump, Paris, Perrin.
- Kennedy Paul, 1987, The Rise and Fall of Great Powers, New York, Penguin.
- Kitchen Nicholas, 2020, « Why American grand strategy has changed : international constraint, generational shift, and the return of idealism », Global Affairs, vol. 6, no 1 : 87-104.
- Lawless Scott, 2020, « American Grand Strategy for an Emerging World Order », Strategic Studies Quarterly, vol. 14, no 2 : 127-147.
- Lieber Robert J., 2019, « American decline : destined, chosen, or contingent? », dans J. Massie et J. Paquin (dir.), America’s Allies and the Decline of u.s. Hegemony, New York, Routledge : 23-42.
- Lüfkens Matthias, 2018, Twiplomacy Study 2018, 10 juillet. Page consultée sur Internet (https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/) le 25 octobre 2020.
- Macdonald Paul K., 2018, « America First? Explaining Continuity and Change in Trump’s Foreign Policy », Political Science Quarterly, vol. 133, no 3 : 401-434.
- Mérand Frédéric, 2020, « Introduction: Coping with Geopolitical Decline », dans F. Mérand (dir.), Coping with Geopolitical Decline : The United States in European Perspective, Montréal, McGill/Queen’s University Press : 3-22.
- Nau Henry, 2002, At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy, Ithaca, Cornell University Press.
- Olsen Gorm Rye, 2019, « Donald Trump and “America first”: the road ahead is open », International Politics, septembre. Page consultée sur Internet (https://doi.org/10.1057/s41311-019-00203-w) le 21novembre 2020.
- Pagedas Constantine Q., 2018, « Ugly American Diplomacy: Donald Trump and the Art of the Deal », Japan Spotlight, janvier-février : 33-40. Page consultée sur Internet (https://www.jef.or.jp/journal/pdf/217th_Cover_Story_08.pdf) le 25 octobre 2020.
- Perlstein Rick, 2020, Reaganland: America’s Right Turn, 1976-1980, New York, Simon & Schuster.
- Popescu Ionut, 2017, Emergent Strategy and Grand Strategy: How American Presidents Succeed in Foreign Policy, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Porter Patrick, 2018, « Why America’s Grand Strategy Has Not Changed: Power, Habit, and the u.s. Foreign Policy Establishment », International Security, vol. 42, no 4 : 9-46.
- Quinn Adam, 2011, « The art of declining politely: Obama’s prudent presidency and the waning of American power », International Affairs, vol. 87, no 4 : 803-824.
- Rachman Gideon, 2011, Zero-Sum Future: American Power in an Age of Anxiety, New York, Simon & Schuster.
- Rothkopf David, 2014, National Insecurity: American Leadership in An Age of Fear, New York, Public Affairs.
- Schultz Kenneth A., 2017, « Perils of Polarization for u.s. Foreign Policy », The Washington Quarterly, vol. 40, no 4 : 7-28.
- Shively Jacob, 2020, Make America First Again: Grand Strategy Analysis and the Trump Administration, Amherst, Cambia Press.
- Siniver Asaf et Christopher Featherstone, 2020, « Low-Conceptual Complexity and Trump’s Foreign Policy », Global Affairs, vol. 6, no 1 : 71-85.
- Skowronek Stephen, 1997, The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton, Cambridge, Harvard University Press.
- Starobin Paul, 2009a, « After America », Foreign Policy, 1er juin. Page consultée sur Internet (https://foreignpolicy.com/2009/06/01/after-america-2/) le 25 octobre 2020.
- Starobin Paul, 2009b, After America: Narratives for the Next Global Age, New York, Viking.
- Wallerstein Immanuel, 2009, « The Eagle Has Crash Landed », Foreign Policy, 11 novembre. Page consultée sur Internet (https://foreignpolicy.com/2009/11/11/the-eagle-has-crash-landed/) le 25 octobre 2020.
- Walt Stephen M., 2012, « Whether or Not the u.s. is Declining is the Wrong Question », Foreign Policy, 26 janvier. Page consultée sur Internet (https://foreignpolicy.com/2012/01/26/whether-or-not-the-u-s-is-declining-is-the-wrong-question/) le 25 octobre 2020.
- Walt Stephen M., 2018, The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of u.s. Primacy, New York, Farrar, Straus & Giroux.
- Wittkopf Eugene et James C. McCormick, 1990, « The Cold War Consensus: Did it Exist? » Polity, vol. 22, no 4 : 627-653.
- Wojczewski Thorsten, 2019, « Trump, Populism, and American Foreign Policy », Foreign Policy Analysis, vol. 16, no 3 : 292-311.
- Woodward Bob, 2018, Fear: Trump in the White House, New York, Simon & Schuster.
- Wolff Michael, 2018, Fire and Fury : Inside the Trump White House, New York, Holt & Co.
- Yarhi-Milo Keren, 2018, « After Credibility: American Foreign Policy in the Trump Era », Foreign Affairs, Janvier-février. Page consultée sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-12-12/after-credibility) le 6 août 2020.
- Zoellick Robert B., 2020, America in the World: A History of u.s. Diplomacy and Foreign Policy, New York, Twelve.