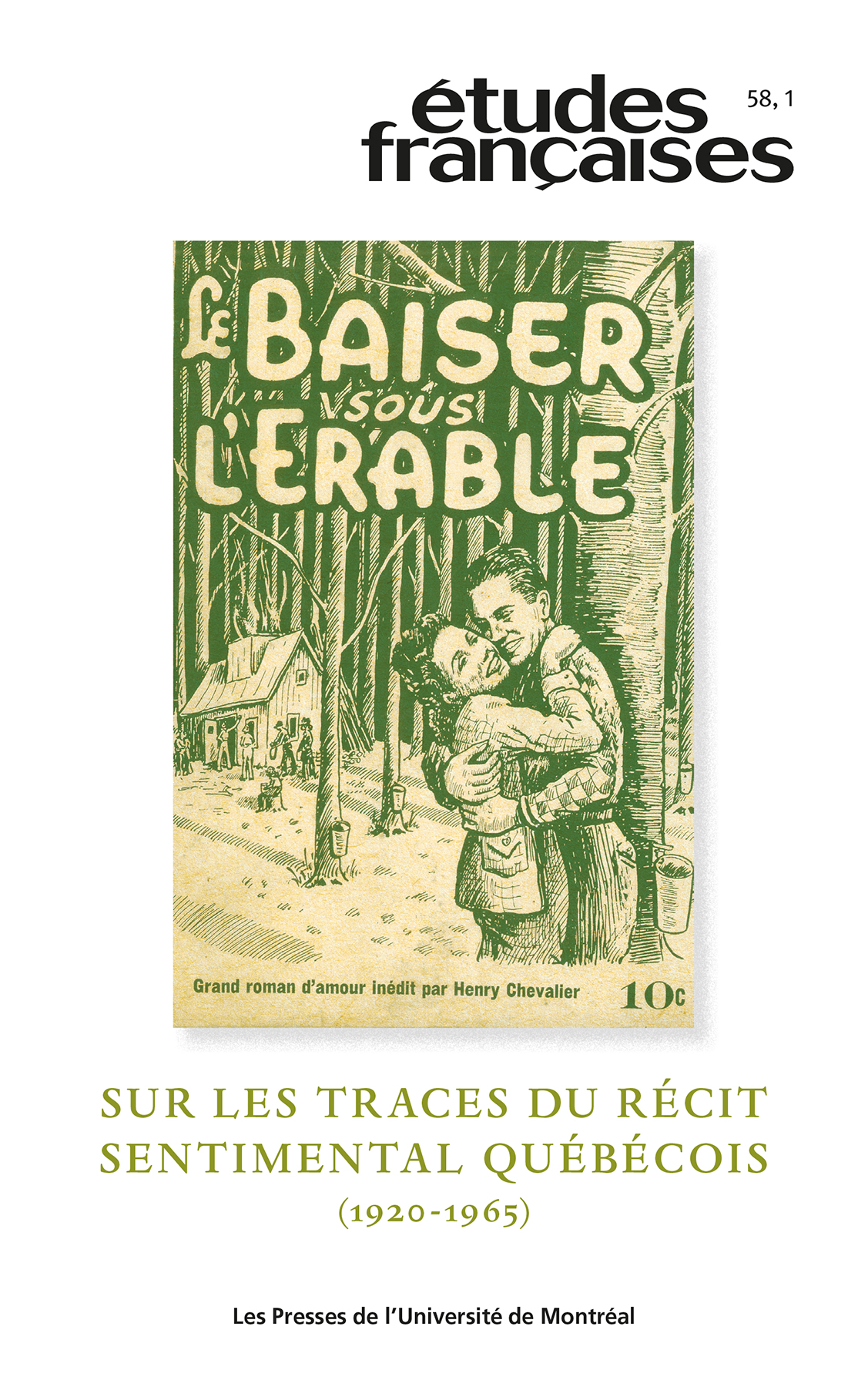Résumés
Résumé
Cet article s’inscrit dans un travail au long cours sur les écrits de Pierre Gélinas. Je m’intéresse à ses premiers textes, fruits de sa collaboration régulière à la page littéraire de l’hebdomadaire Le Jour. J’avance que Gélinas propose une pratique de l’interprétation et un discours autonomiste de la critique littéraire qui tranchent avec la « critique philosophique » dominante dans les années 1940 et 1950 au Québec. L’interrogation que Gélinas émet sur la méthode critique ainsi que son ton polémique montrent que le discours autonomiste, mis de côté par la critique personnaliste, a investi un support autre que la revue : l’hebdomadaire. Après avoir décrit l’espace critique de l’époque, j’analyse le corpus des articles littéraires de Gélinas au Jour, puis j’expose ses critères de jugement de même que sa conception de la critique. J’aborde ensuite ses critiques des livres de Jean Bruchési et de Guy Sylvestre, qui donnent lieu à des échanges soutenus.
Abstract
This article is part of a longer work on Pierre Gélinas’ writing. I focus on his first texts, results of his regular collaboration to the literary page of the weekly Le Jour. I put forward that Gélinas proposes a practice of interpretation and an autonomist discourse of literary criticism that contrasts with the dominating “philosophical criticism” in the ’40s and the ’50s in Quebec. His questioning of the critical method and his polemical tone show that the autonomist discourse, set aside by the personalist criticism, has invested other supports than the revue, namely the weekly. After a description of the critical space of the period, I analyze the corpus of Gélinas’ literary articles at Le Jour, then I bring to light Gélinas’ judgment criteria and his conception of criticism. Lastly, I address his criticism of Jean Bruchési’s and Guy Sylvestre’s books, which are subjected to some sustained exchanges.
Corps de l’article
Rien ne meurt en Laurentie ! Mais comme rien ne naît en Laurentie, ça fait le compte.
Pierre Gélinas[1]
Dans « Sociocritique et modernité au Québec », Lucie Robert signale que le débat entre Jeanne Lapointe, Félix-Antoine Savard et Pierre Gélinas dans les pages de Cité libre en 1955 « institue la littérature et les études littéraires sous la forme d’une discipline du savoir universitaire[2] ». Si Lapointe affirme la primauté de la valeur esthétique, voire psychologique, des oeuvres littéraires, Savard et Gélinas, selon Lucie Robert, « s’opposent de concert à cette vision qui dégage la critique de toute responsabilité collective, sociale, politique[3] ». Alors que Lapointe promeut fortement une critique thématique et une herméneutique parfois descriptive des oeuvres, que met en lumière sa traversée des romans les plus marquants de la période 1930-1950, Gélinas critique le « provincialisme[4] » des écrivains canadiens-français et l’absence de vérité sociale des oeuvres de son temps. Son intervention annonce une analyse proprement sociale des oeuvres littéraires à partir de la notion de « type » et du rapport à l’histoire[5]. Au-delà des raisons qui expliquent les défauts de « notre littérature », pour Gélinas, l’enjeu du débat avec Lapointe est d’abord méthodologique : « [E]n somme, quels sont vos critères ? En regard de quoi exercez-vous le jugement d’un livre ? Quand vous pesez le poids d’une oeuvre, que mettez-vous dans l’autre plateau de la balance ?[6] » C’est cette question de méthode qui occupe l’arrière-plan des critiques que publie Gélinas au Jour entre 1943 et 1946, lorsqu’il s’occupe notamment de la page littéraire et théâtrale.
Étiqueté comme étant « syndicaliste »[7], Gélinas n’a pas suscité d’enthousiasme critique au-delà de son débat avec Lapointe, qui lui a assuré une certaine postérité littéraire. Gélinas est pourtant un acteur important, bien que marginal, du journalisme dans les années 1940, puis du milieu politique, en tant que militant, dans les années 1950. Son implication au sein du Parti ouvrier progressiste, parti fédéral défendant des intérêts communistes[8], et à l’hebdomadaire communiste Combat[9] dès 1946 (il le dirigera de 1948 à 1955), fait écran à sa contribution à la critique et à la réflexion sur la pratique artistique. De 1943 à 1962, Gélinas intervient en effet à partir de lieux et d’exigences politiques et littéraires[10] (Le Jour, Combat, la revue Place publique, Cité libre), et la relation entre art et politique apparaît comme le centre solaire de ses préoccupations esthétiques. Militant actif jusqu’à la publication en 1956 du rapport Khrouchtchev qui met en lumière les crimes commis sous le régime de Staline, Gélinas participe – outre le débat avec Lapointe en 1955 – à deux querelles sur la dimension révolutionnaire de l’art automatiste[11], témoignant de son intérêt pour la définition du rôle de l’art : la première avec Gilles Hénault et Claude Gauvreau (1946-1947) dans les pages de Combat ; la seconde, avec Claude Gauvreau encore (et d’autres critiques d’art), dans l’hebdomadaire L’Autorité (1954). La fin de l’engagement politique marque pour Gélinas un retour en littérature par le roman : en 1959, il remporte le prix du Cercle du livre de France pour Les vivants, les morts et les autres, un roman d’apprentissage syndical et militant dont le personnage de Maurice Tremblay passe pour être son alter ego. Il publie en 1962 L’or des Indes, dans lequel un trio d’infortune tente de fonder la Société générale de béton à Trinidad, en pleine décolonisation des Antilles. Gélinas quitte ensuite la sphère culturelle pour y revenir à la fin des années 1990, avec une trilogie dystopique, Saisons (1996-2000).
À la parution de Les vivants, les morts et les autres, la journaliste Michelle Tisseyre affirme que Gélinas, dans les années 1940, « était considéré comme l’une des jeunes gloires du journalisme[12] ». Drop out, critique littéraire au Jour à dix-huit ans, puis journaliste intermittent à Radio-Canada, Gélinas, en adhérant au communisme, donne à sa trajectoire un tour imprévu[13]. La période de l’entre-deux-guerres et des années 1940 a fait l’objet de travaux récents[14] qui apportent un nouvel éclairage sur les conditions de possibilité de la critique littéraire, ses acteurs et ses actrices, et sur les différentes conceptions de la littérature canadienne-française qui circulent à cette époque. Dans cette perspective, je souhaite contribuer à cette histoire littéraire de la critique en me concentrant sur l’hebdomadaire Le Jour, périodique peu étudié dont la période d’activités (1937-1946) recoupe l’« âge de la critique » identifié par Pierre Hébert[15]. L’analyse des textes de Gélinas publiés entre 1943 et 1946[16] me permettra de discuter d’un des ethos critiques de cette publication. L’ethos se définit d’une part par l’articulation de l’ethos discursif et de l’ethos préalable, « représentation “pré-discursive” du locuteur, c’est-à-dire antérieure à l’énonciation[17] ». Il regroupe d’autre part, selon Dominique Maingueneau, trois dimensions : le ou les « rôles liés à l’exercice du discours » (« ethos catégoriel », par exemple : romancier, critique, etc.) ; le « positionnemen[t] des locuteurs dans un champ conflictuel de valeurs (politique, esthétique, religieux, philosophique…) » (« ethos idéologique ») et le « monde éthique » que porte le « ton » du texte (« ethos expérientiel »)[18]. Construit par le texte auquel il donne « corps » en retour, l’ethos se comprend de plus en fonction des stéréotypes d’une époque donnée et, dans le cas d’un journal, avec la poétique de ce support. En effet, écrire dans un périodique suppose une inscription dans un réseau de signatures, dans un projet spécifique qui précède l’article, qui caractérise ses paramètres de publication et que le texte confirme en retour.
J’avance l’hypothèse que Gélinas propose une pratique de l’interprétation et une éthique critique qui tranchent, à l’image d’autres textes du Jour, avec la « critique philosophique » qui domine les années 1940 puis 1950[19]. Son interrogation sur la méthode critique et son ton polémique montrent qu’un discours « matérialiste » a été mis de côté par la critique personnaliste, et que ce discours a investi d’autres supports que la revue, soit l’hebdomadaire (Le Jour, Combat et L’Autorité notamment). Après avoir décrit l’espace critique de l’époque, j’analyse le corpus des articles littéraires de Gélinas au Jour, puis je tente de dégager les critères de jugement de Gélinas ainsi que sa conception de la critique. J’aborderai alors plus particulièrement ses critiques des livres de Jean Bruchési et de Guy Sylvestre, qui donnent lieu à des échanges soutenus.
Pierre Gélinas et Le Jour : éthique critique et « marginalité » polémique
Lancé en 1937, Le Jour est un hebdomadaire publié le samedi. Fondé et dirigé par Jean-Charles Harvey, « dont le libéralisme économique et social passe pour un anticonformisme notoire[20] », Le Jour épouse la ligne idéologique marginale et souvent polémique de son directeur. Périodique « indépendant, politique, littéraire et artistique » selon son intitulé complet, l’hebdomadaire a fait l’objet de très peu d’études[21] malgré l’importance qu’il accorde, dans ses pages, à l’actualité politique et artistique. C’est un journal résolument antifasciste, fortement antinationaliste et anticlérical, qui défend la liberté de pensée, la démocratie et l’accès à une éducation laïque. Pour le dire avec Pascale Guimont, « Le Jour n’est pas un journal d’information, mais bien plutôt un journal de formation, un journal idéologique[22] », et cette dimension « idéologique » institue les collaborateurs plus souvent en juges querelleurs qu’en rapporteurs objectifs. Sous l’impulsion d’Harvey, Le Jour se situe sur un plan « nord-américain[23] », et promeut un libéralisme économique peu ouvert aux interventionnismes étatique et syndical. Certains collaborateurs des premières années montrent malgré tout un « souci socialiste », comme le critique Louis Dantin et George Wilkinson, militant terre-neuvien proche de Gabrielle Roy, qui y publie également[24]. Dans la période qui m’intéresse, les trois dernières années du journal (1943-1946), les collaborateurs réguliers du Jour sont, outre Harvey (directeur, éditorialiste) et Émile-Charles Hamel (rédacteur en chef et critique), André Bowman (politique nationale et internationale), Félicien Mondor, Robert Goffin, Maximilien Rudwin, Paul Riverin, Pierre Gélinas, parfois Henri Tranquille, Claire Harvey, Monique Robert. Lyse Nantais[25] et Ernest Pallascio-Morin y publient régulièrement des poèmes.
Il faut remonter au développement rapide de la critique littéraire dans les années 1930 pour saisir le contexte dans lequel s’inscrit celle qui est pratiquée au Jour. Si « les deux initiateurs de cette éclosion de la critique littéraire dans les premières décennies du siècle […] sont Louis Dantin et Mgr Camille Roy[26] », le « foisonnement » des années 1930 est le fait d’une nouvelle génération d’écrivains aux idées et aux parcours parfois divergents (Jean-Charles Harvey, Claude-Henri Grignon, Harry Bernard, Alfred DesRochers, Albert Pelletier, Maurice Hébert, etc.). Cette période qui voit les nouveautés littéraires et les recueils de critiques être largement commentés – notamment ceux publiés par la Librairie d’Action canadienne-française d’Albert Lévesque – se caractérise aussi par « un retournement du commentaire littéraire sur lui-même et par conséquent une remise en question constante et multiforme de ses fondements, contraintes et modes d’expression[27] ». Autrement dit, comme le souligne Michel Lacroix, « [l]a relation critique à l’oeuvre se double d’une relation constitutive à “la” critique littéraire ou à “des” critiques littéraires[28] », qu’ils soient des amis, des maîtres ou des aînés (comme Dantin et Roy). Ainsi, si ces années sont celles de la « consécration de la critique comme genre[29] », elles sont aussi le fait d’une « crise de l’autorité[30] » de la parole critique qui, on peut le penser, se poursuit au début des années 1940. Cette critique « métacritique » est pratiquée notamment par Alfred DesRochers, autodidacte et journaliste, et par Albert Pelletier, deux « franc-tireurs » que Richard Giguère qualifie de « modernes[31] ». Évoquant Carquois, le recueil critique de ce dernier, Giguère relève par exemple que « [l]e ton est souvent polémique et la critique radicale[32] ». Quant à DesRochers, il serait plutôt « à la recherche d’une critique qui ne soit ni polémique, ni dogmatique », tout en usant d’« un ton sentencieux, sans retour[33] ».
Karine Cellard englobe DesRochers et Pelletier dans une pratique qu’elle qualifie de « critique subjective », qui s’oppose à une « critique institutionnelle » impersonnelle : « Partageant la sensibilité artistique de leur aîné [Dantin] mais souvent moins courtois et accueillants, ces critiques subjectifs jugent les oeuvres de manière ouvertement partiale, inscrivant leur singularité à la fois dans leurs choix linguistiques et dans la trame du texte où le lecteur se fait même à l’occasion personnage de l’intrigue critique[34]. » Elle note également l’existence, au sein de cette « critique subjective », d’« une veine polémique[35] » inspirée par Olivar Asselin et dans laquelle s’inscrivent notamment Jean-Charles Harvey et Albert Pelletier. Plutôt caractéristique des années 1930, ce discours polémique fait du style un « élément spectaculaire[36] » de persuasion. Comme l’écrit Cellard, le polémiste met en scène sa marginalité, qu’il revendique : il « reste en marge mais critique désormais le centre, délaisse la dynamique communautaire de consolidation de la littérature canadienne-française pour investir une posture hétéronome dans ses préoccupations[37] ». Plusieurs voix critiques du Jour se situent à mon sens à la frontière de la critique subjective (Dantin, DesRochers) et de la critique polémique (Asselin, Harvey, Pelletier). Cette critique se situerait elle-même sous la double enseigne de l’ethos polémique des années 1930 et de l’ethos philosophique caractéristique des années 1940, non dans sa dimension « spirituelle », mais horizontale (ce qui est commun aux individus de ce monde). La périodicité de l’hebdomadaire et les caractéristiques spécifiques du support expliquent peut-être une « intégration » différente, et sous d’autres modalités et avec une autre « vitesse », des exigences changeantes du champ littéraire.
S’inscrivant dans une filiation critique à la fois subjective et polémique, Gélinas propose dans ses textes un discours sur la valeur littéraire et le rôle social de la critique qui reprend certaines des idées des revues de l’époque, comme Amérique française, fondée en 1941, et La Nouvelle Relève, tout en s’y opposant nettement sur d’autres aspects. Ses critiques partagent le point de vue « universaliste » d’Amérique française[38], tout en estimant, à propos de Gants du ciel, qu’un « internationalisme de surface, élégant et superficiel, ne vaut guère mieux » qu’un « régionalisme fermé [et] sans issue[39] ». Une partie de la bibliothèque de la revue Amérique française informe aussi son point de vue sur la littérature : Proust, Cocteau[40], et surtout Gide. Celui-ci, que Gélinas défend[41], semble être la mesure de la valeur : « Dans la réédition, pour un Gide, combien d’horreurs et de sucre à la crème ?[42] » A contrario, Gélinas s’oppose à la critique thomiste, aux figures du personnalisme comme Maritain et s’irrite de la « “pénétration verticale”[43] » du révérend père Hilaire. Comme on le verra, il débat notamment avec Guy Sylvestre, dont il n’apprécie ni la revue Gants du ciel ni le recueil Sondages. Dans une critique assez verte de Connaissance du personnage, Gélinas écrit que « M. [Robert] Charbonneau exprime sur la littérature en général les opinions des maîtres catholiques français, opinions partagées aveuglément ici par un vaste clan qui serait dangereux pour l’avenir de l’esprit si les individus qui le composent avaient quelque envergure[44] ». J’y reviendrai, mais disons que l’on comprend que, dans ces années 1943-1946, Le Jour se situe en réaction à La Nouvelle Relève. Refusant au discours littéraire et critique tout hermétisme, Gélinas appelle à une critique « vulgarisée » et éclaireuse d’un public intéressé mais profane.
Pierre Gélinas et les « oncles » de la littérature
Né en 1925, Pierre Gélinas commence à publier dans Le Jour le 9 octobre 1943[45]. L’annonce officielle de son embauche paraît dans le numéro du 8 janvier 1944 : « Aujourd’hui, dernière acquisition, Pierre Gélinas, dont nos lecteurs ont pu apprécier les dons brillants, vient se joindre à notre rédaction permanente[46]. » Il écrit quasi chaque semaine jusqu’à l’été 1945, son nom disparaît entre septembre 1945 et janvier 1946, pour ressurgir ponctuellement jusqu’à sa dernière « Chronique des livres » le 27 avril 1946. Le Jour cesse de paraître en juin de la même année. Ses textes constituent un corpus nombreux et varié : il écrit (sauf erreur) dans quatre-vingt-quinze numéros[47], à raison d’un à quatre textes signés par numéro. Il est probable que Gélinas a rédigé des brèves anonymes et qu’il a utilisé un pseudonyme, pratique en usage au Jour.
Les textes culturels de Gélinas, je l’ai mentionné, portent sur un éventail de productions artistiques (littérature, théâtre, peinture, opéra, musique) liées à l’actualité. Je regroupe les textes littéraires de Gélinas en trois grands ensembles : 1. ceux de la rubrique régulière « Chroniques des livres », qui portent pour l’essentiel sur les livres français réédités par les maisons d’édition canadiennes-françaises, avec des critiques ponctuelles d’oeuvres canadiennes-françaises inédites (dont un texte intéressant sur Les îles de la nuit d’Alain Grandbois[48]) ; 2. les « Cahiers de Fra Gélatino » et la rubrique « Coups de sonde » qui peuvent jouer avec différentes formes et sur des plans variés, mais proposent en général un collage de critiques, d’échos[49] ou de comptes rendus d’événements culturels ou politiques, des réponses à des correspondances reçues ou à des articles d’autres journaux ou revues ; 3. les récits ironiques, les fictions critiques et les fantaisies, tous des récits à clé du milieu littéraire ou artistique, publiés sous différents titres, et qui constituent un corpus à haute teneur ironique et parodique, tonalités qu’on retrouve fréquemment dans les textes de Gélinas. À titre d’exemple, mentionnons la série « Petite histoire de l’art », dans laquelle Gélinas se moque de Robert Rumilly (nommé « Robertonn Rumillios ») et du directeur de l’École des beaux-arts (« Cretinas Goudenionn ») au moyen d’une fable « grecque » dans laquelle la France est Athènes et « la Laurentionnie » le Québec[50]. Il ridiculise l’Académie canadienne-française (et Victor Barbeau) dans plusieurs « fables » dont « Une réunion à l’Académie Impériale de Tierenlau [Laurentie][51] ». Si la dimension polémique du discours traverse l’ensemble du corpus critique (à différents degrés), la mise en fiction n’est pas mobilisée dans la critique des livres ; elle sert principalement la satire institutionnelle. Cette pratique semble courante au Jour des années 1943-1946 : sous le pseudonyme d’« A. Sainte-Croix »[52] paraît une série de portraits typiques très comiques (et parfois fantaisistes, tel « César Lapince, courtier en oeuvre littéraire[53] ») du milieu culturel canadien-français, en une parodie de Leurs figures de Maurice Barrès.
La première critique que signe Gélinas porte sur Désespoir de vieille fille de Thérèse Tardif [54], un livre qui provoque des réactions vives et assez contrastées. Comme le fera Orage sur mon corps d’André Béland, collaborateur au Jour, publié l’année suivante[55], ce roman met en scène la contradiction entre les désirs d’une femme et les conventions morales. Il fait l’objet d’un rejet critique important de la part des autorités cléricales. Pour Gélinas, il est clair que « [p]ersonne ne s’est contenté de comprendre et d’exposer au lieu de vouloir expliquer et conclure. Il ne s’agit pas de faire faire une cure à l’auteur, comme de charmants bonzes l’ont suggéré, mais de situer l’oeuvre[56]. » L’important, dit Gélinas, est de saisir le projet de l’oeuvre, et sa nécessité. Si le caractère subversif du roman de Tardif semble lui octroyer de facto une valeur[57], la qualité littéraire de Désespoir de vieille fille résiderait plutôt dans le caractère typique de la femme mise en scène : « Thérèse Tardif n’a pas créé, mais exprimé et mis au jour un type de femme. Femme qui se place exactement à mi-chemin de la cérébrale de Georges [sic] Sand et du corps animal de Colette[58]. » Gélinas se montre ainsi sensible à l’oeuvre étudiée pour elle-même, et se présente comme étant nettement plus avisé que les « charmants bonzes » à l’opinion datée : « Pour une fois, chez nous, un prosateur écoute son démon, comme dit Gide ; Thérèse Tardif est le seul ici (à part Nelligan et S[ain]t-Denys Garneau, mais qui sont poètes) à écrire de l’âme[59]. » Cette « écoute du démon » fait pour Gélinas de Désespoir de vieille fille la « première et seule réussite vraiment intéressante au pays[60] ».
Cette première critique donne le ton : s’inscrivant dans la trame mise en place par Louis Dantin et par Albert Pelletier, Gélinas se situe contre une critique normative, pour une littérature qui place la nécessité de l’oeuvre avant toute chose, pour un jugement critique dégagé des principes moraux. Gélinas emprunte à Gide un paradigme interprétatif : « À ceux qui pourraient me reprocher la forme de cet article je dirai qu’on ne juge pas Gide : on l’interprète[61]. » Dans un article postérieur, Gélinas insistera de nouveau sur sa propre lucidité critique et sur la qualité de son jugement littéraire : « J’ai été un des seuls à considérer dès le début l’ouvrage [Désespoir de vieille fille de Thérèse Tardif] comme un roman et la femme du Désespoir comme une création de laboratoire indépendante de la personnalité même de l’auteur. Mais, pour certains, il était trop commode de prendre la lettre au détriment de l’esprit[62]. » Cette affirmation confiante s’accompagne d’un propos moqueur sur la recension du roman de Tardif dans la Revue Dominicaine[63] : « Dans la dernière livraison de la Revue Dominicaine (pourquoi sont-ce donc toujours les gens dont on voudrait dire le plus de bien qui nous donnent toujours l’occasion de dire le plus de mal, par respect pour la vérité ?) […][64]. » Pour Gélinas, ce sont « les esprits dits laïcs [qui] s’attardent au côté art de la question » littéraire tandis que ce sont « les esprits dits religieux qui trouvent les premiers et dissèquent le plus longuement la morbidité d’une oeuvre, le caractère nauséabond et putride[65] ».
De la même façon, Gélinas se moque du « nationalisme artistique », arguant que « [f]aire, sans lui demander son avis, d’un artiste le chantre d’une race part d’un sentiment qui ne manque pas de noblesse, mais singulièrement d’intelligence[66] ». Cette position apparaît clairement dans des échanges cordiaux avec le critique et écrivain Jean Bruchési. En juillet 1944, Gélinas publie d’abord une critique virulente du plus récent livre de Bruchési, Le chemin des écoliers, dans lequel celui-ci ne cacherait pas son admiration pour Mussolini. Selon Gélinas, « M. Bruchési est soit un inconscient, un peu simple d’esprit, soit un fieffé coquin. Il n’y a pas plus cynique manière d’afficher ses sentiments fascistes[67]. » Trois semaines plus tard, Gélinas évoque la réaction d’un « [c]ertain grand auteur canadien », dont l’« ire intempestive et fort déplacée pour un monsieur qui s’offre à donner des leçons de savoir-vivre plongea le dit critique en de profondes et subtiles méditations sur la vertu des oncles et dans le monde et dans la littérature[68] ». Cette mise en scène (fictive ou non) d’un échange de sentiments amicaux avec Bruchési est l’occasion de réfléchir aux conditions d’exercice de la critique au Québec : « La critique a ses périls en un pays où tout le monde se prend sinistrement au sérieux. / L’explication de ce phénomène est sans doute dans l’inaptitude générale à dissocier la valeur d’un livre de la position sociale de son auteur[69]. » Cette « inaptitude » toucherait autant les « oncles », ces auteurs qui n’hésitent pas à mobiliser une relation familiale ou un prestige particulier pour exiger une reconnaissance littéraire auprès des critiques, que la pratique artistique générale. Plus encore :
Il faudrait tout de même finir par comprendre que la hiérarchie sociale et la hiérarchie religieuse ne contrôlent pas la hiérarchie littéraire. Mais, en ce bon pays de Québec, il suffit d’être ministre pour rendre des oracles artistiques, comme il suffit d’être troisième vicaire à Saint-Céleste-des-Anges pour que son oeuvre soit à l’abri de toute critique : si vous attaquez le livre, on dira que vous en voulez à la religion.
Et c’est d’un système comme celui-là qu’on attend une littérature[70].
« [L]’échelle des valeurs », comme l’appelle Gélinas, est alors complètement faussée par la subordination des critères d’évaluation au politique et à l’orthodoxie catholique. Gélinas affirme toute l’importance d’une pratique critique « à l’abri » des exigences hétéronomes dans la constitution d’une littérature de valeur.
Si l’artiste ne doit se subordonner, selon Gélinas, à aucun service patriotique, national ou politique, la critique possède un rôle d’éclaireur du public[71], en marge de ces systèmes hétéronomes, uniquement guidée par la « valeur littéraire » d’une oeuvre. Dans un texte sobrement intitulé « Critique » paru le 28 octobre 1944[72], Gélinas publie une lettre de l’un de ses correspondants avant de lui répondre. La lettre lui « “reproche d’avoir, devant les oeuvres, en tant que critique” » une attitude « “vulgaire” » et empreinte d’« “agressivité” » – reproche souvent formulé à l’endroit de Gélinas –, et de ne pas juger, dans les mots de Gélinas, les « intentions de l’auteur ». Dans sa réponse, Gélinas définit la critique comme un art de la franchise sans filet, qui « ne met pas de gants blancs avec les ratés » au nom de principes artistiques supérieurs : « La critique n’a pas à emboîter le pas derrière les convenances et se demander ce que l’auteur peut bien s’attendre qu’on dise de lui. Le devoir de la critique est de guider, non de suivre[73]. » Ainsi, Gélinas revendique l’étiquette « “vulgaire”[74] », refusant ce qu’il construit, dans le discours, comme une exigence « “mondaine” » de l’approbation et de l’admiration mutuelles. Il retourne alors l’« “agressivité” » qui lui est reprochée en qualité et en éthique de la critique, que sa haute exigence placerait à la fois au-dessus « des petites satisfactions d’amour propre des écrivains[75] » et aux côtés d’un public avide de vérité.
En phase avec la ligne idéologique du Jour qui, selon Pascale Guimont, « s’affirme contre tout nationalisme et contre tous les isme[76] » et défend la liberté de pensée, Gélinas engage ponctuellement le débat avec une critique (professée à la Revue Dominicaine par exemple) ou des écrivains qu’il juge aliénés à des principes étrangers à la littérature. Le critique du Jour lui-même met en récit, dans plusieurs articles, son émancipation des habitudes de pensée promues par l’école. Celle-ci apparaît, sous la plume de Gélinas (comme d’autres de ses collègues), comme produisant des esprits peureux, grégaires, peu inventifs, brimés dans leur développement par des carcans moraux, propos (et prose) qui rappellent par moments ceux d’Albert Pelletier[77]. Il souligne à maintes reprises la sécheresse des esprits créée par les collèges classiques et, par exemple, ses maîtres qui « professaient pour lui [Claudel] un culte aveugle et rigoureux, et ce pour des raisons qui n’étaient pas uniquement littéraires[78] ». Or comme l’écrit Gélinas : « [J]e ne souscris plus aux poèmes faits sur commande, ni aux livres de compositions appliquées[79]. » Cet autodidactisme reproduit la marginalité de l’ethos polémique, tout en insistant sur la « liberté » de pensée et de jugement que Gélinas aurait acquise par lui-même. Invité à l’Université Queen’s par le professeur Marcel Tirol à prononcer une conférence sur la littérature canadienne-française, Gélinas affirme, dans le compte rendu de sa visite, que « [c]e sont [l]es autodidactes qui sont présentement l’espoir de notre littérature[80] » et que « [c]e sont ces autodidactes, comme mes amis Roger Lemelin et Yves Thériault, qui nous ont donné les oeuvres les plus significatives, les plus personnelles[81] ». Cette valorisation de l’authenticité du créateur libre et « désintéressé », sans formation, rejoue sans doute la position de Gélinas, lui-même autodidacte. Si les écrivains doivent exercer et exiger une liberté radicale, le critique doit accompagner à la fois le public et l’écrivain dans leur « formation » littéraire à l’extérieur de tout cadre (institutionnel ou idéologique). Le critique est un guide agnostique[82] et « agressif ». Cette manière de concevoir l’éthique et la pratique critique occasionne quelques tensions, comme on le verra bientôt, entre Pierre Gélinas et Guy Sylvestre.
Critique du jugement et de la raison thomiste
Comme l’écrit un certain « Diogène » en 1955, « [a]u Jour, Pierre Gélinas, qui fait aujourd’hui profession d’aimer l’humanité [avec le communisme], assassinait les auteurs avec des pinces monseigneur[83] ». En effet, Gélinas se fait un devoir de pourfendre ce qu’il estime être la médiocrité littéraire, essentiellement pratiquée, selon lui, par les auteurs nationalistes et religieux, qu’ils soient révérends pères ou clercs thomistes, personnalistes ou néo-catholiques. Dans sa « Chronique des livres », Gélinas porte peu d’intérêt par exemple à Jacques Maritain – référence de La Nouvelle Relève – qu’il se dit « bien incapable de prendre au sérieux[84] ». Pour lui, « [l]e néo-mysticisme et le néo-catholicisme » produisent des critiques malhonnêtes, prêts à « déformer la pensée d’un auteur afin de la faire servir à [leur] propre cause : c’est un de ces cas où la sainteté du but excuse la malhonnêteté des moyens[85] ». À Maritain, Claudel, Ghéon et Bergson, Gélinas préfère Gide, Cocteau, Roger Martin du Gard et Aldous Huxley[86].
Dès la fondation de Gants du ciel (1943), estimant qu’« il ne serait pas franc de se montrer tendre », Gélinas regrette fortement que la revue tende « vers la droite[87] » et ne revendique pas une pleine liberté artistique et idéologique. Ses recensions des livraisons suivantes sont plus nuancées[88] ; Gélinas participera lui-même au sixième numéro de Gants du ciel [89]. Il persiste toutefois à critiquer tous les révérends pères qui y publient[90], et remet fréquemment en question la qualité et la probité des critères du jugement littéraire de Guy Sylvestre. On pourrait dire que la relation entre les deux journalistes et écrivains est assez tendue, mais elle demeure médiée par le journal où la critique de l’un et la réplique de l’autre sont publiées côte à côte.
En mars 1945, leur querelle se dessine autour de la publication du recueil de critiques Sondages de Sylvestre. Elle donne lieu à une définition du rôle du critique et de son éthique professionnelle. Elle offre en effet à Gélinas une nouvelle occasion d’affirmer le manque d’avenir de la critique néo-thomiste – que représente Sylvestre –, et, surtout, le peu de pertinence de cette critique pour la littérature. Dans sa réponse à la lettre de Guy Sylvestre que Le Jour publie le 31 mars 1945, Gélinas revient sur sa critique parue sept jours plus tôt : « [J]’ai constaté seulement, et tout le monde est à même de le constater avec moi, que le mouvement thomiste n’a pas donné de grands critiques littéraires[91]. » Le problème avec cette « école particulière[92] », pour Gélinas, est la recherche de l’« orthodoxie[93] » de l’oeuvre avant l’évaluation de ses qualités littéraires, et l’« orgueil[94] » de cette critique qui croit en la supériorité de ses critères artistiques, ce que Gélinas nomme « l’intransigeance[95] » thomiste. Dans son compte rendu de Sondages, Gélinas écrit :
Le premier devoir du critique est de chercher à comprendre, non pas à juger. Le critique ne peut être qu’un interprète ; pas davantage, car le romancier, le poète ou le dramaturge auront toujours sur lui la supériorité d’avoir créé. Et le critique lui-même ne peut atteindre à une certaine grandeur que par son effort désintéressé et honnête à pénétrer d’abord la pensée de l’auteur qu’il analyse, à l’exposer ensuite avec objectivité. Le critique ne doit pas descendre l’écrivain à son niveau, lui imposer ses propres vues avec la conviction que l’écrivain n’est bon que dans la mesure où il se conforme à ses principes de critique. Il doit au contraire chercher à s’élever jusqu’à la pensée de l’écrivain afin d’en transmettre au public le reflet le plus clair et le plus authentique[96].
« Désintéressé et honnête », le critique ne doit pas être prescriptif mais doit savoir être généreux, prompt à respecter une double fidélité, à l’oeuvre et au public. Cette mise en scène du critique comme guide attentif et comme professeur objectif offre à Gélinas l’occasion de se présenter en critique moralement supérieur à Sylvestre, dont les valeurs néo-thomistes gauchiraient le jugement sur les oeuvres. À la fin de sa critique de Sondages, Gélinas émet un constat sans appel : « La véritable critique est encore à naître au Canada[97]. »
Dans sa réponse, Sylvestre reproche à Gélinas de laisser volontairement dans l’ombre les réalisations d’André Rousseaux, de Daniel-Rops, de Charles Du Bos et de quelques autres[98]. Il relève ce qu’il considère être un discours de mauvaise foi envers son livre Sondages et plus largement envers les auteurs catholiques : « Si vous me permettez une remarque personnelle, je vous proposerai une petite étude : prenez une vingtaine de vos articles au hasard et relisez-les attentivement et vous remarquerez sans doute que, dès que vous traitez d’un écrivain catholique, le ton change, votre style manifeste un évident malaise[99]. » Gélinas aurait « singulièrement péché contre [ses] principes » en laissant de côté la nécessité de rendre compte de « la pensée de l’auteur » pour s’en prendre à son catholicisme. Dans sa réplique, Gélinas voit dans le « malaise » relevé par Sylvestre la preuve « que vous, thomistes, n’échappez point à cette déformation de prétendre trouver chez les autres des “luttes intérieures” et des “combats spirituels” dont vous croyez sincèrement que ne peuvent manquer d’être le théâtre les esprits qui ne partagent point vos vues. Croyez bien que si je ressens quelques fois des “malaises”, ce n’est qu’à la lecture d’écrits dans lesquels le parti pris se montre avec trop de cynisme[100]. »
Le conflit se situe donc sur deux plans, idéologique et littéraire (et peut-être aussi sur un troisième : personnel). Gélinas revendique une liberté intransigeante qu’il reproche à Sylvestre de ne pas pratiquer. Il est vrai que le critique du Jour montre peu d’affinités avec Maritain, Claudel, Henri Ghéon et Mauriac dont il reconnaît cependant la qualité de romancier plus que d’essayiste[101]. Cette position lui vaut à plusieurs reprises d’être accusé d’hostilité envers la religion catholique, ce que ne manque pas de souligner Sylvestre. Gélinas épouse une logique « matérialiste », au sens concret, de l’« interprétation » des oeuvres, qui n’exclut pas une métaphysique de l’expérience esthétique mais s’oppose à une critique « spirituelle » qui conçoit la foi comme le dénominateur commun des individus. Au contraire, la vérité de l’oeuvre est à la fois dans sa « nécessité », dans son accomplissement comme oeuvre, mais aussi dans une authenticité dont le typique, pour le roman par exemple, serait exemplaire.
Entre 1943 et 1946, pour Gélinas, l’oeuvre idéale est du côté non de la destruction – de la révolte, des « épouvantails à bourgeois[102] » –, mais de la construction, de la proposition, du typique. Certes, Gélinas n’est pas qu’un critique qui « assassin[e] les auteurs avec des pinces monseigneur » (« Diogène »), il admire aussi, bien entendu, le travail de plusieurs de ses contemporains. Tant au Jour qu’à Combat, et même dans son intervention à Cité libre, Gélinas voue par exemple une grande admiration à l’auteur de Au pied de la pente douce. Son compte rendu d’une conférence de Lemelin au Cercle universitaire ne cache pas son admiration et éclaire, par ce qu’il célèbre de l’oeuvre de Lemelin, ce qu’il espère de la littérature, une littérature en
communion directe avec les valeurs humaines, charnelles en quelque sorte : ce n’est point pour lui [Lemelin] passe-temps de dilettante, mais préoccupation dont la constance se confond avec la constance de la vie. L’hermétisme n’est point son fait, et il aura puisé chez Balzac, Flaubert et Stendhal, le respect de la « réalité », en même temps qu’il y aura appris à tenir compte du social en littérature, c’est-à-dire des influences multiples qu’une telle société en des circonstances données exerce sur un personnage[103].
L’écrivain a ainsi un rôle social, et son livre aussi, celui de « tenir compte du social en littérature » et de la vérité de la vie pour faire une oeuvre qui ne soit point « hermétique », mais qui soit tournée vers son public. Le critique a aussi des comptes à rendre au public, mais en vertu d’une fidélité à la plus haute exigence esthétique, dépouillée de tout cadrage idéologique. Or Gélinas n’est pas un défenseur radical de l’avant-garde artistique. Son point de vue n’est cependant pas univoque : il vante la clarté, la mesure et les règles académiques tout en louangeant Saint-Denys Garneau et Borduas.
Si l’embauche de Gélinas est annoncée dans les pages du Jour, son départ en 1946, peu de temps avant la fermeture de l’hebdomadaire, n’est pas (sauf erreur) signalé. À la fin de la même année, le nom de Gélinas est cité dans les journaux pour d’autres raisons que ses critiques littéraires polémiques : une descente et une perquisition ont lieu dans les bureaux de Combat, l’hebdomadaire du Parti ouvrier-progressiste[104]. Les circonstances du passage de Gélinas du Jour à Combat demeurent pour l’heure inconnues. Peut-on penser que les affinités communistes de plus en plus grandes de Gélinas ont créé une rupture avec Harvey, connu pour rejeter vivement les thèses communistes et socialistes, répétant ainsi le conflit du directeur avec Louis Dantin ? En 1947, Gélinas signe dans Combat un article intempestif contre le livre L’URSS, paradis des dupes que vient de faire paraître Harvey. Intitulé « M. HARVEY DÉCOUVRE L’URSS, l’histoire d’une dégringolade », l’article est, on le devine, peu tendre envers l’auteur. Gélinas réfute les thèses d’Harvey sur la vie en Union soviétique, les qualifiant de « reconstitutions romanesques[105] ». Visiblement déçu de voir son ancien patron épouser le même combat anticommuniste que L’Action catholique, il parle de cet « homme qui fut un brillant styliste, que la fréquentation de Voltaire et d’Anatole France avait doué d’un sens assez précis de la mesure et du goût[106] », marquant par l’usage du passé le caractère révolu de cette époque. « L’ancien directeur du Jour n’a pas pu ne pas sentir l’injure que lui font à l’heure actuelle les louanges de Montréal-Matin, organe du gouvernement Duplessis qu’il dénonçait naguère, et les fleurs paternelles de Roger Duhamel, qu’il écrasait de son indifférence supérieure. / M. Jean-Charles Harvey est béni de tous ceux-là qu’il se faisait une juste gloire de combattre. Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut le plaindre[107]. » Critiquant la crédulité d’Harvey tout en louangeant l’« ancien » Harvey, Gélinas évoque ici une relation complexe, tiraillée, qu’il faudra étudier.
Parties annexes
Note biographique
Rachel Nadon est stagiaire postdoctorale à l’Université du Québec à Trois-Rivières et à l’Université Paul-Valéry (Montpellier III), et travaille sous la supervision conjointe de Mathilde Barraband et de Marie-Ève Thérenty. Sous la direction de Martine-Emmanuelle Lapointe, elle a soutenu en 2020 à l’Université de Montréal une thèse intitulée La vie économique dans le roman québécois (1956-1983) : représentations, histoire et pratiques.
Notes
-
[1]
« Le diable dans le bénitier », Le Jour, 5 février 1944, p. 5 col. 3.
-
[2]
Lucie Robert, « Sociocritique et modernité au Québec », Études françaises, vol. 23, no 3 (« À la jeunesse d’André Belleau », dir. Ginette Michaud), hiver 1988, p. 37.
-
[3]
Ibid., p. 39.
-
[4]
« De notre littérature. Lettre à Jeanne Lapointe », Cité libre, no 12, mai 1955, p. 31.
-
[5]
Lue à la lumière de l’engagement communiste de Gélinas, la « Lettre à Jeanne Lapointe » reste peu analysée en comparaison de l’article de Lapointe, malgré son point de vue intéressant pour l’histoire des pratiques et des lectures sociales du littéraire au Québec : « Peut-on concevoir un grand roman dont les personnages ne seraient pas typiques du milieu particulier dans lequel le romancier les fait évoluer ? (Laissons de côté, ici, le problème plus général de ce qui constitue le typique “social”.) » (Ibid., p. 29.)
-
[6]
Ibid., p. 27.
-
[7]
Alex Noël, par exemple, évoquant le débat entre Jeanne Lapointe et Pierre Gélinas, présente celui-ci comme « syndicaliste et militant marxiste » puis comme « un syndicaliste et un romancier » (« L’ouverture d’un espace dialogique dans les interventions intellectuelles de Jeanne Lapointe », Mens, vol. 18, no 1, automne 2017, p. 29 et p. 36 note 19).
-
[8]
Parti que Fred Rose représente à la Chambre des communes de 1943 à 1946, avant l’affaire Gouzenko qui provoquera son expulsion du pays. Voir Hugues Théorêt, La peur rouge. Histoire de l’anticommunisme au Québec, 1917-1960, Québec, Septentrion, 2020.
-
[9]
Qui sera fermé, notamment en vertu de la loi du cadenas (« Loi protégeant la province contre la propagande communiste ») en 1948. Pour une description détaillée des activités militantes de Gélinas, incluant ses arrestations, voir ma postface, « Pierre Gélinas et son temps », à la réédition de L’or des Indes (Montréal, Alias, 2020, p. 269-300).
-
[10]
Outre Gélinas, l’écrivain Jean-Jules Richard et le poète Gilles Hénault, tous deux gravitant aussi dans le réseau du Jour, s’impliqueront dans des cercles communistes. Richard se fait compagnon de route au début des années 1950, participant au Congrès mondial des partisans de la paix à Varsovie en 1950, où il fait notamment la rencontre de Gélinas. Il devait également participer à l’« American Intercontinental Peace Conference » à Rio de Janeiro en 1952, mais le gouvernement brésilien interdit la tenue de l’événement sur son territoire (« Conférence interdite », L’Action populaire, 13 mars 1952, p. 2 col. 6-7, non signé). Richard publie dans Combat la première partie du Feu dans l’amiante (voir l’analyse que j’en propose : « Les “fictions syndicales” : Jean-Jules Richard et Pierre Gélinas. Littérature et communisme dans la décennie 1950 », dans La vie économique dans le roman québécois (1956-1983) : représentations, histoire et pratiques, thèse, Université de Montréal, 2020, p. 130-188). Gilles Hénault publie quelques articles dans Combat et travaille quelque temps comme mineur et activiste syndical à Sudbury.
-
[11]
Marcel Saint-Pierre, « Une discussion entre amis… », dans Une abstention coupable. Enjeux politiques du manifeste « Refus global », Montréal, M éditeur, 2013, p. 83-95.
-
[12]
Michelle Tisseyre ajoute : « Découvert par Jean-Charles Harvey, directeur du Jour, ses critiques virulentes dans le domaine littéraire, et ses pastiches d’auteurs célèbres, révélaient un esprit à la fois clair et fougueux et un don d’observation certain » (« Pierre Gélinas, lauréat du prix du Cercle du Livre. Son roman est une expérience vécue », Photo-journal, 7-14 novembre 1959, p. 21).
-
[13]
Selon Jacques Pelletier, le communisme de Gélinas a provoqué et justifié sa mise à l’écart du monde culturel. Pour une analyse des Vivants, les morts et les autres, voir la préface de Pelletier, « Un roman révolutionnaire », à la réédition de ce roman (Trois-Pistoles, éditions Trois-Pistoles, 2010, p. 7-34).
-
[14]
Adrien Rannaud, La révolution du magazine au Québec. Poétique historique de « La Revue moderne », 1919-1960, Montréal, Nota bene, 2021 et De l’amour et de l’audace. Femmes et roman au Québec dans les années 1930, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Nouvelles études québécoises », 2018 ; Caroline Loranger, Imaginaire du « roman canadien ». Discours sur le genre romanesque et pratiques d’écriture au Québec (1919-1939), thèse, Université de Montréal, 2019 ; Karine Cellard et Vincent Lambert (dir.), Espaces critiques. Écrire sur la littérature et les autres arts au Québec (1920-1960), Québec, Presses de l’Université Laval, 2018 ; « La révolution littéraire des années 1940 au Québec », Voix et images, no 122 (vol. 41, no 2, dir. Marie-Frédérique Desbiens et Denis Saint-Jacques), hiver 2016.
-
[15]
Pierre Hébert, « Présentation », Voix et images, no 50 (vol. 17, no 2, « L’âge de la critique, 1920-1940 »), hiver 1992, p. 166-168.
-
[16]
Cette analyse s’inscrit dans un travail au long cours sur les écrits de Pierre Gélinas. Elle se concentre ici sur ses articles qui portent sur la littérature, laissant de côté ceux sur la peinture, le théâtre, la musique et la politique. En effet, à son arrivée au Jour, Gélinas publie, à l’initiative d’Émile-Charles Hamel, une série de textes sur la peinture : « Nous voudrions établir, si ce n’est pas trop demander, une sorte de pont entre le public et le peintre » (« Un peintre. Lucien Morin », 27 novembre 1943, p. 6 col. 4). Le point de vue de Gélinas sur l’abstraction et sur la pratique contemporaine de la peinture informe, à mon sens, sa manière de concevoir la littérature, qui est à la fois académique, normative mais attentive à l’accomplissement esthétique. Il estime par exemple que l’abstraction est l’expérience de la solitude dans le monde, qu’il s’agit d’« un moyen de transition, une chambre noire de la peinture » (« Un peintre. Charles Daudelin », 11 décembre 1943, p. 5 col. 1). Ces articles mériteraient une étude spécifique.
-
[17]
Dominique Maingueneau, « Le recours à l’ethos dans l’analyse du discours littéraire », dans Jérôme Meizoz, Jean-Claude Mühlethaler et Delphine Burghgraeve (dir.), Postures d’auteurs : du Moyen Âge à la modernité, actes du colloque de Lausanne, 20-21 juin 2013, § 6 (disponible en ligne : fabula.org/colloques/document2424.php, page consultée le 28 février 2022).
-
[18]
Ibid., § 11, 14, 17.
-
[19]
Karine Cellard a retracé les différentes scénographies de la critique des années 1930 et 1940 afin d’éclairer le passage d’une critique institutionnelle et d’une critique subjective à une « critique philosophique » (voir « De l’individu à la personne : la transformation de la subjectivité critique, de la Crise à l’après-guerre », dans Karine Cellard et Vincent Lambert [dir.], op. cit., p. 119-149).
-
[20]
Ibid., p. 128.
-
[21]
Victor Teboul, « Le Jour ». Émergence du libéralisme moderne, Montréal, Cahiers du Québec / Hurtubise HMH, « Communications », 1984 ; Jacques Rivet, Grammaire du journal politique à travers « Le Devoir » et « Le Jour », Montréal, Cahiers du Québec / Hurtubise HMH, « Communications », 1979 ; Pascale Guimont, « Le Jour, 1937-1946 », dans Fernand Dumont, Jean Hamelin et Jean-Paul Montminy (dir.), Idéologies au Canada français 1930-1939, Québec, Presses de l’Université Laval, « Histoire et sociologie de la culture », 1978, p. 131-163. Dans son mémoire, David Éric Simard s’intéresse plus précisément au fondateur-directeur du journal : Jean-Charles Harvey, défenseur des libertés et promoteur de la modernité : « Le Jour » (1937-1946), mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal (département de Science politique), 2007.
-
[22]
Pascale Guimont, loc. cit, p. 133.
-
[23]
Jean-Charles Harvey, « Nous, Nord-Américains », Le Jour, 13 octobre 1945, p. 1 col. 1-2. Ajoutons que Louis Dantin a tenu, dans ce journal, une chronique sur le roman et la vie américaine de 1938 à 1942 et que Le Jour fait mention à de nombreuses reprises des publications d’intellectuels français en exil aux États-Unis ou à Buenos Aires. Pour une description des rapports transnationaux entre les revues de l’époque (excluant les journaux), voir Élyse Guay, « Réception critique de la littérature canadienne-française à l’étranger. Lettres françaises et le réseau transaméricain des revues francophones », dans Karine Cellard et Vincent Lambert (dir.), op. cit., p. 165-181.
-
[24]
Selon Ben-Z. Shek, Georges Wilkinson aurait fait entrer Roy au Jour, « où elle publia trente chroniques entre le 6 mai 1939 et le 16 mars 1940 » (« De quelques influences possibles sur la vision du monde de Gabrielle Roy : George Wilkinson et Henri Girard », Voix et images, no 42 [vol. 14, no 3, « Gabrielle Roy », dir. François Ricard], printemps 1989, p. 439). Wilkinson a lui-même publié dans Le Jour quelques articles sur la situation révoltante des chômeurs terre-neuviens (voir ibid., p. 442-444).
-
[25]
Gélinas a entretenu une longue relation d’amitié avec Lyse Nantais. Celle-ci a annoté et commenté tous ses manuscrits. Ils ont également entretenu une correspondance intermittente. Ces lettres et manuscrits ont été légués par Lyse Nantais à Jacques Pelletier. Ces archives, minces mais éclairantes, sont maintenant conservées au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université du Québec à Montréal.
-
[26]
Richard Giguère, « Alfred DesRochers et Albert Pelletier : deux critiques et essayistes modernes », Voix et images, no 50 (vol. 17, no 2, « L’âge de la critique, 1920-1940 », dir. Pierre Hébert), p. 219.
-
[27]
Michel Lacroix, « Dantin et l’âge de la métacritique. École, amitié et dissensus », Voix et images, no 113 (vol. 38, no 2, « Louis Dantin », dir. Jean Morency), hiver 2013, p. 74.
-
[28]
Ibid., p. 76.
-
[29]
Karine Cellard, loc. cit., p. 122.
-
[30]
Michel Lacroix, loc. cit., p. 78.
-
[31]
Richard Giguère, « Alfred DesRochers et Albert Pelletier : deux critiques et essayistes modernes », loc. cit.
-
[32]
Ibid., p. 221.
-
[33]
Ibid., p. 226 et 227.
-
[34]
Karine Cellard, loc. cit., p. 127.
-
[35]
Ibid., p. 132.
-
[36]
Ibid., p. 134.
-
[37]
Ibid., p. 133.
-
[38]
Il y aurait une étude comparée à faire d’Amérique française et du Jour, en particulier autour de l’ethos ironique et de l’usage des formes brèves, tels les « récits en quête d’incidents » qu’évoquent Élyse Guay et Michel Lacroix (« Saillies et paradoxes : Amérique française et l’ethos du moraliste bouffon », Voix et images, no 122 [vol. 41, no 2, « La révolution littéraire des années 1940 au Québec », dir. Marie-Frédérique Desbiens et Denis Saint-Jacques], hiver 2016, p. 67-81).
-
[39]
« Deux revues. Gants du ciel. Amérique française », Le Jour, 1er janvier 1944, p. 7 col. 3.
-
[40]
Pour Gélinas, « c’est le théâtre de Giraudoux qui est à la mesure de son siècle, celui de Cocteau » et non celui d’Henri Ghéon par exemple (« Les Cahiers de Fra Gélatino », Le Jour, 4 novembre 1944, p. 4 col. 5).
-
[41]
Jacques Cotnam a souligné l’« influence […] manifeste » de Gide sur Jean-Charles Harvey, en particulier en 1934 dans Les demi-civilisés (« Refus et acceptation de Gide au Québec », Cahiers André Gide, no 3 [« Le Centenaire »], 1972, p. 292 note 1). Cotnam estime que le discours critique sur Gide se modifie dans les années 1940. Une des critiques de Gélinas (« Chronique des livres. Les nourritures terrestres par André Gide », Le Jour, 20 janvier 1945, p. 5 col. 2) lui semble exemplaire de ce changement, et précurseure des lectures subséquentes : « Qu’on soit d’accord ou non avec ce jugement, force est cependant d’admettre qu’il traduit des préoccupations nouvelles en milieu québécois et qu’il est énoncé sur un ton qui se distingue nettement de celui de la plupart des critiques précédemment cités. Pierre Gélinas est de cette génération montante de Québécois qui, avides d’air frais, s’élanceront bientôt à la recherche de valeurs nouvelles […]. Dans un sens donc, les propos de Gélinas sont prémonitoires des secousses qui, sous peu, ébranleront la société traditionaliste et maladivement repliée sur elle-même qui est sienne ; d’autre part, son attitude vis-à-vis de Gide anticipe celle des jeunes écrivains québécois d’aujourd’hui » (Jacques Cotnam, loc. cit., p. 302 ; je souligne).
-
[42]
« Obsessions et démissions (décalque à la mode) », Le Jour, 4 décembre 1943, p. 4 col. 1. Aux yeux de Gélinas, Gide est mal perçu : « [O]n le considère comme l’esprit infernal par excellence » or « [i]l croit en l’homme. (Les nourritures terrestres). C’est cette foi que j’aime en lui » (« Chronique des livres. Interviews imaginaires par André Gide », Le Jour, 1er avril 1944, p. 5 col. 2).
-
[43]
« Revue des revues : Gants du ciel », Le Jour, 15 juillet 1944, p. 6 col. 1. Gélinas cite ici une expression de François Hertel.
-
[44]
« Chronique des livres. Connaissance du personnage par Robert Charbonneau », Le Jour, 13 mai 1944, p. 7 col. 3.
-
[45]
Son premier article est intitulé « Remise en question du problème d’une littérature » (p. 6 col. 4).
-
[46]
« Un départ », Le Jour, 8 janvier 1944, p. 8 col. 1 (article non signé). L’embauche de Gélinas est placée sous le signe du devoir national de formation des « jeunes journalistes canadiens » : « Maintenant que des journaux français existent aux États-Unis, où les écrivains exilés peuvent écrire et transmettre leur message, nous croyons opportun de revenir à notre politique traditionnelle et de ramener Le Jour à sa ligne canadienne. Un à un, nos collaborateurs français ont été remplacés par de jeunes Canadiens de talent et d’avenir. » Selon cette « politique », Boris Skomo fait ses adieux aux lecteurs du Jour après avoir animé pendant trois années la page de politique internationale du journal.
-
[47]
Le corpus a été rassemblé grâce à des recherches dans la collection du Jour numérisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, complétées par un dépouillement manuel du Jour entre 1943 et 1946 afin d’obtenir un corpus exhaustif.
-
[48]
« Chronique des livres. Les îles de la nuit par Alain Grandbois », Le Jour, 27 mai 1944, p. 5 col. 3-4.
-
[49]
Par « écho », j’entends « les nouvelles qui circulent dans la ville, dans les salons et les lieux publics » (Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, 1865-1876, t. VII, p. 84 col. 3).
-
[50]
« Petite histoire de l’Art [I] », Le Jour, 27 mai 1944, p. 5 col. 4.
-
[51]
« Les Cahiers de Fra Gélatino. Une réunion à l’Académie Impériale de Tierenlau », Le Jour, 10 juin 1944, p. 5 col. 1.
-
[52]
C’est peut-être Félicien Mondor qui prend ce pseudonyme : Mondor fait référence à « Macropolis », une série signée « Sainte-Croix », dans un article qu’il signe de son propre nom (« Sortie des artistes », Le Jour, 25 novembre 1944, p. 2 col. 1). Gélinas, lui, se défend contre François Hertel qui lui reproche de se cacher derrière « A. Sainte-Croix » : « C’est fort aimable à lui [Hertel], car Sainte-Croix est bien meilleur écrivain que je ne le suis » (« Les Cahiers de Fra Gélatino », Le Jour, 8 juillet 1944, p. 5 col. 4). Une autre hypothèse est que « A. Sainte-Croix » est une hydre à plusieurs têtes, qui pourrait regrouper Mondor, Gélinas, Hamel, voire Paul Riverin, Bruno Blais et / ou Henri Tranquille.
-
[53]
« A. Sainte-Croix », « César Lapince, courtier en oeuvre littéraire », Le Jour, 15 juillet 1944, p. 5 col. 1-2.
-
[54]
« Désespoir de vieille fille par Thérèse Tardif », Le Jour, 30 octobre 1943, p. 7 col. 3-4.
-
[55]
Pour une analyse croisée de la réception critique de ces deux romans, voir Véronique Ostiguy, Dire sans dire : censure et affirmation du désir dans « Désespoir de vieille fille » de Thérèse Tardif (1943) et « Orage sur mon corps » d’André Béland (1944), mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2010.
-
[56]
« Désespoir de vieille fille par Thérèse Tardif », loc. cit., col. 3. (Je souligne.)
-
[57]
Cette « attitude agressive », en littérature, n’est cependant pas toujours louangée. Gélinas estime ainsi que Orage sur mon corps relève d’une « littérature contre », dont « les résultats sont discutables ». Ainsi, dans le roman de Béland, « il y a du talent, certes, mais aussi beaucoup de donquichottisme. Pour protester contre un certain esprit, on prend la tangente et l’on est vite rendu aux antipodes ». Selon Gélinas, le « juste milieu » serait « seul favorable à l’éclosion d’une oeuvre littéraire » (« Lettres québécoises en Ontario », Le Jour, 23 décembre 1944, p. 3 col. 4).
-
[58]
« Désespoir de vieille fille par Thérèse Tardif », loc. cit., col. 4.
-
[59]
Ibid., col. 3.
-
[60]
Gélinas fait cette affirmation un mois après son compte rendu : « Le cas serait assez cocasse : une femme serait notre meilleur romancier ! / Des lectures subséquentes n’ont fait que me confirmer dans mon opinion sur Désespoir de vieille fille, première et seule réussite vraiment intéressante au pays » (« Coups de sonde. Un théâtre canadien », Le Jour, 27 novembre 1943, p. 7 col. 3).
-
[61]
« La porte étroite par André Gide », Le Jour, 20 novembre 1943, p. 7 col. 3.
-
[62]
« Coups de sonde », Le Jour, 12 février 1944, p. 7 col. 3. – Gélinas aime beaucoup Tardif, mais non sans quelques réticences. Dans cet article, il se dit déçu qu’elle montre un « esprit fortement colonial » puisqu’elle se réclame de la France. Or, pour Gélinas, « [u]n romancier a une idée, et l’idée impose sa forme. Il n’y a pas à chercher plus loin ! La question de technique est une question d’individu, non de couleur de peau » (ibid.). Selon la même logique, il discrédite ses modèles : « J’ai pour le mot maître une répulsion intime, et celle-ci s’est encore accentuée quand Mlle Tardif a nommé Valdombre parmi ces derniers. Flûte, dirait l’autre ! Mais que peut-on apprendre de Valdombre, je me le demande ? » (Ibid.)
-
[63]
Revue Dominicaine, vol. L, tome I, février 1944, p. 125-127 (recension signée « Gabriel- M. Lussier, O. P. »).
-
[64]
« Coups de sonde », loc. cit., col. 4. Relevons, dans ce même article, une pique dirigée contre Simone Routier (« En réponse à une bande de crétins et de malpolis – dont Mlle Simone Routier est l’homme ( ?) de paille […] », ibid., col. 3), que je crois motivée par la publication par Simone Routier, sous le pseudonyme « Marie de Villers », de Réponse à « Désespoir de vieille fille » dont la Revue Dominicaine rendra favorablement compte (vol. L, tome I, mars 1944, p. 190-192 ; signé par le même « Gabriel-M. Lussier, O. P. »).
-
[65]
« Coups de sonde », loc. cit., col. 4.
-
[66]
« Le nationalisme artistique », Le Jour, 4 mars 1944, p. 5 col. 3.
-
[67]
« Chronique des livres. Le chemin des écoliers par Jean Bruchési », Le Jour, 8 juillet 1944, p. 5 col. 3.
-
[68]
« Les Cahiers de Fra Gélatino », Le Jour, 29 juillet 1944, p. 5 col. 4.
-
[69]
Ibid.
-
[70]
Ibid.
-
[71]
La critique de peinture aurait un devoir similaire envers le « public », que le public définirait : « Le public cherche chez les critiques une introduction aux méthodes des peintres, leur demande de lui faire voir ce qu’il n’aperçoit pas de lui-même » (« Chronique des livres. Borduas par Robert Élie », Le Jour, 29 janvier 1944, p. 5 col. 3).
-
[72]
« Critique », Le Jour, 28 octobre 1944, p. 4 col. 1-2.
-
[73]
Ibid.
-
[74]
« J’ai la vulgarité de n’avoir que mépris pour le médiocre et d’encourir la désapprobation de nos bonzes, à cause de cela » (ibid., col. 2).
-
[75]
Ibid.
-
[76]
Pascale Guimont, loc. cit., p. 135.
-
[77]
Dans « Littérature nationale et nationalisme littéraire », Albert Pelletier critique vertement la formation des professeurs et l’éducation en général, qu’il qualifie de « cati déchiqueté », ajoutant qu’« [il] ne croi[t] pas à la vertu éducative de paragraphes isolés et de bouts de phrases des idiomes anciens, sauf si l’éducation consiste à chloroformer les intelligences et abolir leurs qualités essentielles » (Carquois, Montréal, Librairie d’Action canadienne-française, 1931, p. 14-15). Il associe cette éducation déficiente à une « émasculation systématique [inconsciente] de toute virilité intellectuelle » (ibid., p. 15).
-
[78]
« Chronique des livres. Ainsi donc encore une fois… par Paul Claudel », Le Jour, 15 janvier 1944, p. 5 col. 3.
-
[79]
Ibid.
-
[80]
« Lettres québécoises en Ontario », loc. cit., col. 3.
-
[81]
Ibid., col. 4.
-
[82]
Assez tôt, dans une critique de La part du diable de Denis de Rougemont, Gélinas se présente comme un athée ou un agnostique. « [L]à où pèche M. de Rougemont, c’est de vouloir donner à une forme nouvelle de société les bases de la forme précédente : Dieu et le Diable. Entre nous, ce sont des notions qui se meurent, de même que l’idée de race et de nation » (« Chronique des livres. La part du diable [nouvelle version] par Denis de Rougemont », Le Jour, 16 septembre 1944, p. 5 col. 3).
-
[83]
« Diogène », « Crépuscule des dieux (les critiques) », Photo-Journal, 27 août 1955, p. 34 col. 4-5.
-
[84]
« Monsieur Maritain et Machiavel (deuxième article) », Le Jour, 25 mars 1944, p. 5 col. 3 : « Je ne dirai pas que M. Maritain soit un farceur, mais je me déclare bien incapable de le prendre au sérieux. Il accumule contradiction sur contradiction. M. Maritain devrait se contenter de faire la preuve des axiomes ; ça ne ferait de mal à personne et ça lui donnerait pour autant la sensation de la philosophie, tout en le dispensant d’étaler son ignorance de l’histoire et de la philosophie. »
-
[85]
« Chronique des livres. Connaissance du personnage par Robert Charbonneau », loc. cit., p. 7 col. 3.
-
[86]
Que Gélinas cite largement contre Bergson et Maritain dans sa « Chronique des livres. De Bergson à Thomas d’Aquin par Jacques Maritain » (Le Jour, 17 juin 1944, p. 5 col. 2-3).
-
[87]
« Deux revues. Gants du ciel. Amérique française », Le Jour, 1er janvier 1944, p. 7 col. 3. Gélinas rend compte des deux premières livraisons de Gants du ciel.
-
[88]
Dans sa recension de la troisième livraison de la revue, on lit : « En résumé, Guy Sylvestre a présenté un bon cahier où chacun pourra trouver son profit, ne serait-ce que celui d’y rencontrer une façon générale de penser qu’il doit éviter » (« Revue des revues. Gants du ciel 3 », Le Jour, 1er avril 1944, p. 5 col. 6).
-
[89]
Pierre Gélinas, [sans titre], Gants du ciel, no 6 (« Jeunes poètes canadiens. Poésie – Musique – Peinture »), décembre 1944, p. 36-37.
-
[90]
Dans sa recension de la cinquième livraison de Gants du ciel, Gélinas vise notamment les propos du père Hyacinthe-Marie Robillard, qu’il cite pour s’en moquer : « J’espère maintenant qu’on ne m’accusera pas d’en vouloir spécialement “aux curés” si je trouve ces “vers” horribles. Ça me fait de la peine pour sainte Agathe, qui, elle, ne fut point poêêête, et demeura toute sa vie une brave fille » (« Les Cahiers de Fra Gélatino », Le Jour, 4 novembre 1944, p. 4 col. 3).
-
[91]
« M. Guy Sylvestre nous écrit », Le Jour, 31 mars 1945, p. 4 col. 3.
-
[92]
Ibid., col. 2. – Cette position rappelle en partie celle des critiques « individualistes » des années 1930 : « La volonté de n’appartenir à aucune école manifeste tout à la fois des dispositions esthétiques (dont le désir d’échapper au conflit entre exotiques et régionalistes), des dispositions sociales (signalées par l’hostilité envers les mondanités) et des dispositions littéraires, lesquelles mènent aux attaques contre la critique de complaisance et contre les “sociétés d’admiration mutuelle” » (Michel Lacroix, « Dantin et l’âge de la métacritique », loc. cit., p. 81).
-
[93]
« Chronique des livres. Sondages par Guy Sylvestre », Le Jour, 24 mars 1945, p. 5 col. 3.
-
[94]
Ibid., col. 2.
-
[95]
« M. Guy Sylvestre nous écrit », loc. cit., col. 2.
-
[96]
« Chronique des livres. Sondages par Guy Sylvestre », loc. cit., col. 2.
-
[97]
Ibid., col. 3.
-
[98]
« M. Guy Sylvestre nous écrit », loc. cit., p. 4 col. 2.
-
[99]
Ibid., col. 3.
-
[100]
Ibid.
-
[101]
Voir « Chronique des livres. La vie de Jean Racine par François Mauriac », Le Jour, 20 mai 1944, p. 5 col. 2-3.
-
[102]
« La révolte est une porte fermée qui ne mène nulle part en littérature ; j’entends la révolte ouverte et déclarée, avec manifestes, cris et épouvantails à bourgeois. La société n’est pas une base pour une oeuvre d’art, qu’on veuille la célébrer, la réformer ou l’abattre, pour bête qu’elle soit » (« Prémices d’anthologie : Jan Jul Richard », Le Jour, 18 décembre 1943, p. 5 col. 2).
-
[103]
« Chroniques. Roger Lemelin », Le Jour, 16 décembre 1944, p. 5 col. 1.
-
[104]
« Descente aux quartiers généraux des communistes », La Presse, 10 décembre 1946, p. 3 col. 6-7. « La quatrième descente a été exécutée à la filiale française du parti, 263 est, rue S[ain]te-Catherine, app. 8, où sont installés les bureaux d’un nouvel hebdomadaire communiste publié en français. Les rédacteurs, Pierre Gélinas et Mlle Julia Boucher, étaient là quand la police est arrivée avec un mandat » (col. 7).
-
[105]
« M. HARVEY DÉCOUVRE L’URSS, l’histoire d’une dégringolade », Combat, 15 février 1947, p. 2 col. 6.
-
[106]
Ibid., col. 5.
-
[107]
Ibid., col. 6.