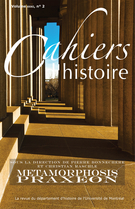Résumés
Résumé
Au cours des dernières décennies, la recherche en histoire ancienne a connu un important renouvellement historiographique, méthodologique et thématique ayant permis d’aborder sous des angles novateurs d’importants acquis et présupposés de la recherche et de leur apporter de riches nuances. Les multiples enquêtes sur les constructions, déconstructions et reconstructions des identités anciennes ont grandement contribué à ce renouvellement de la recherche. Loin d’être utopiques et anachroniques, les recherches sur les phénomènes identitaires dans l’Antiquité ouvrent sur des perspectives nouvelles qu’il convient désormais de prendre en considération en histoire ancienne.
Abstract
Over the last decades, research in Ancient History has known an important historiographical, methodological and thematical renewal offering new perspectives on old assumptions, therefore nuancing our knowledge. The multiple inquiries on the constructions, deconstructions and reconstructions of the Ancients’ identities greatly contributed to this renewal of this field of expertise. Far from being utopic or anachronic, these inquiries offer new insights that we need to take into account when studying Antiquity[1].
Corps de l’article
Les vingt dernières années ont été marquées par l’effervescence des questionnements identitaires. Cette remise en question de nos sociétés modernes a rapidement trouvé écho dans les milieux savants dont les travaux sur la question des identités paraissent à un rythme soutenu, voire insoutenable tant cette production est abondante et diversifiée. Tour à tour furent interrogées les identités ethniques, nationales, provinciales, régionales, politiques, culturelles, religieuses, de genre, des minorités pour ne nommer que certains des principaux champs d’investigation. Loin de se limiter aux sociétés modernes, les identités des sociétés du passé, toutes périodes confondues, ont également été revisitées à la lumière des outils d’interprétation développés, entre autres, par la sociologie, l’anthropologie culturelle et la psychologie sociale.
Bien évidemment, les spécialistes de l’Antiquité n’ont pas échappé à cette tendance, partant à leur tour à la conquête de l’identité (ou des identités) grecque(s), romaine(s), barbare(s), judéenne(s) et chrétienne(s). Leur intérêt s’est également porté sur les identités propres aux diverses catégories sociales, politiques, juridiques, religieuses ou professionnelles. Non seulement le nombre de publications en la matière est impressionnant, mais celles-ci sont complétées par de nombreux colloques scientifiques[2], organisés par des centres et des laboratoires de recherche universitaires consacrés à la question des identités dans l’Antiquité[3]. Cependant, comme le souligne avec justesse S. C. Mimouni, les titres de plusieurs de ces publications, malgré l’excellence de leur contenu, surpassent les attentes qu’ils ont suscitées dans leur approche des identités anciennes[4]. Il est vrai que le concept même d’identité, peu importent les différentes terminologies qu’il peut prendre selon les disciplines, soulève une série de questionnements. L’unique consensus qui existe autour de ce concept, c’est bien qu’il est lui-même difficilement définissable[5] et que son usage est abondamment galvaudé[6]. Il faut admettre que plusieurs recherches faisant usage du concept d’identité en offrent rarement une définition claire. De plus, elles n’en circonscrivent pas nécessairement son application pour un contexte sociohistorique particulier et ne prennent pas toujours conscience de l’importance de combiner les approches de types « - emic » et « - etic » afin de pénétrer au coeur des structures et des représentations d’une société donnée[7]. Dans une étude récente, C. Macris a montré la valeur heuristique de cette double approche pour l’étude de groupes/communautés de type « secte », notamment pour les mouvements tels que les pythagoriciens, les esséniens, les pharisiens ou les chrétiens. Si, du point de vue « - emic », le terme secte, comme catégorie, existe bien dans l’Antiquité (hairesis/secta), il désignait principalement une « école de pensée » de type philosophique, ou plutôt philosophico-religieuse — en tant que groupe, communauté, mouvement, institution ou courant/système de pensée et de mode de vie —, du moins avant que les penseurs chrétiens ne se réapproprient tardivement le terme pour désigner péjorativement les groupes « hétérodoxes », les « hérésies », soit les mouvements considérés comme marginaux, schismatiques et déviants, par opposition à une autorité religieuse officielle s’autoproclamant « orthodoxe ». En s’éloignant de la définition péjorative et polémique moderne du terme « secte » au profit de sa signification ancienne et en reprenant, d’un point de vue « - etic », les théories sociologiques des phénomènes sectaires pour les appliquer aux réalités du monde antique, Macris, abordant particulièrement le cas des communautés pythagoriciennes des ve et ive siècles avant notre ère, a montré que ces théories, en tant qu’outil interprétatif, contribuaient à dégager certains aspects encore inédits des communautés religieuses dans l’Antiquité[8]. La combinaison des approches de types « - emic » et « - etic » s’avère donc essentielle pour comprendre plusieurs phénomènes dans l’Antiquité, notamment les phénomènes identitaires. Cependant, mis à mal par la recherche, le concept d’identité suscite actuellement de nombreux débats dans les diverses sciences humaines et sociales, débats auxquels participent activement les spécialistes de l’Antiquité. Notre contribution à ce numéro spécial consacré aux nouvelles approches et thèmes en histoire ancienne tentera de montrer que, malgré les débats qu’il suscite, le concept d’identité conserve sa pertinence en histoire ancienne et permet d’ouvrir sur de nouvelles perspectives.
Le concept d’identité : de sa naissance philosophique à son application en sciences sociales
Dans sa Philosophie de l’esprit d’Iéna, Hegel a montré la nature sociale que possède l’identité, considérant celle-ci comme la résultante d’une connaissance réciproque. Le Soi n’existerait alors que par une double reconnaissance : celle que l’individu a de lui-même et celle que l’Autre lui accorde[9]. Introduisant la notion d’autrui dans la réflexion philosophique, la perspective hégélienne, qui définit l’identité dans une relation dialectique entre le Soi et l’Autre, a été déterminante dans l’approche qu’en ont par la suite faite la psychologie sociale et la sociologie. C’est à cette première que l’on doit l’émergence du concept d’identité hors des cadres philosophiques dans lesquels il a longtemps été cantonné[10]. Les recherches de W. James, J. M. Balwin et C. H. Cooley, qui ont poursuivi la réflexion hégélienne sur la nature dialectique de l’identité, ont montré l’importance de l’altérité dans la définition du Soi, car, par un jeu d’interactions, le Soi et l’Autre concourent à la construction identitaire[11]. Pour leur part, les interactionnistes, tels que C. H. Cooley et G. H. Mead, ont développé le concept de Soi social[12] et la psychanalytique de S. Freud a pour sa part introduit la notion d’identification, processus par lequel l’individu développe dès son enfance ses premiers liens affectifs avec une personne ou un groupe par assimilation[13]. C’est toutefois au tournant des années 1950 que le concept d’identité a connu son véritable essor comme objet de recherche grâce aux travaux d’É. Erickson[14] qui ont montré que l’identité repose sur un processus évolutif qui traverse différentes phases dont les transitions sont vécues comme des périodes de crise identitaire[15].
Les philosophes n’ont pas été les seuls à s’intéresser aux questionnements identitaires. En effet, dès le début du xixe siècle, certains sociologues et certains anthropologues ont également commencé à intégrer le concept d’identité à leurs travaux. En s’intéressant aux représentations sociales, É. Durkheim a distingué deux niveaux d’être chez l’individu : un être privé et un être collectif correspondant à des réalités différentes[16]. Pour Durkheim, l’identité collective joue un rôle prépondérant dans la construction de l’identité individuelle par l’attachement de l’individu à divers groupes sociaux, car l’identité se développe à travers ces différentes appartenances. M. Weber s’est opposé au concept d’inculcation proposé Durkheim. Niant le fait que l’identité se veut la résultante d’une contrainte exercée par la société sur les individus, Weber considère plutôt l’identité comme « le produit de parcours ou d’attitudes singulières[17]. » L’impact de l’environnement social sur la construction identitaire, indéniable depuis les recherches de ces précurseurs, est alors devenu l’un des principaux axes de recherches sur l’identité qui a conduit à l’élaboration de la théorie des rôles[18] et de la théorie du groupe de référence[19].
À partir des années 1960, avec le développement de la psychologie cognitive, les études de l’impact des relations sociales sur l’identité (individuelle et collective) se sont multipliées et ont été influencées par les travaux de S. Moscovici sur les représentations sociales[20]. Ce dernier a montré que les représentations sociales constituent un guide pour l’action et les relations sociales et qu’elles déterminent les comportements tout en permettant de ramener l’inconnu au connu par l’émission d’un jugement sur l’Autre[21]. Pour Moscovici, « l’identité n’existe que dans le rapport d’un sujet (individuel ou collectif) à un alter (individuel ou collectif) et vis-à-vis d’un objet (réel ou imaginaire, physique ou social) »[22]. Dans cette perspective, l’identité, étroitement liée à un environnement social et à un contexte sociohistorique et culturel, se veut plutôt processus qu’un produit, une fonction instable plutôt qu’une réalité substantielle[23].
Marquées par les revendications identitaires des minorités, les années 1970 ont vu la création de départements universitaires spécialisés dans l’étude des identités minoritaires et marginales[24]. Plusieurs historiens, influencés par les travaux de É. Durkheim et de M. Weber, ont alors commencé à intégrer les concepts issus de la sociologie et de l’anthropologie dans leurs recherches, ouvrant dès lors un vaste débat qui allait perdurer[25]. Malgré ce débat interdisciplinaire, les perspectives sociologiques ont dirigé la recherche vers de nouveaux horizons et de nouveaux champs d’investigation auxquels a grandement contribué l’école des Annales, notamment avec les travaux de L. Febvre et de M. Bloch qui ont abordé la question des représentations collectives[26]. Toutefois, ce n’est qu’avec la Nouvelle histoire que la recherche sur les représentations collectives et sur l’identité prit son véritable envol avec les travaux de M. Foucault, de G. Duby, de J. Le Goff et de P. Ariès [27]. L’étude des représentations sociales s’est alors ouverte sur celle des identités, des interactions sociales et de la mémoire collective.
Dans les années 1980 et 1990, avec le retour de l’acteur social, la recherche s’est particulièrement intéressée à la question de l’identité. Sous l’influence des courants constructivistes (constructivist turn) et interactionnistes, la recherche historienne, avec les travaux de précurseurs tels que de P. Bourdieu[28] et de A. Prost[29], a renouvelé son approche des identités en « montrant le caractère historiquement constitué et évolutif des catégories de pensée et de mesure »[30]. Analysées comme des constructions historiques basées sur les représentations collectives élaborées par les acteurs sociaux (individuels ou collectifs) dans un contexte donné, les catégories et les identités sociales ont alors été considérées comme des constructions discursives. Influencée par le Linguistic turn, la recherche s’est également intéressée aux stratégies discursives de construction des réalités sociales et des identités. L’apport des Subaltern Studies et surtout des Postcolonial Studies doit également être souligné. Abordant les identités en situation coloniale, des chercheurs comme E. Saïd[31] et H. K. Bhabha[32] ont ouvert la voie à une série d’études sur les processus de construction identitaire en situation interculturelle. Bhabha a insisté sur le fait que les identités culturelles « ne se développent pas dans l’espace binaire d’un face-à-face entre totalités symboliques qu’on pourrait décrire “à l’état pur”, mais dans ce qu’il appelle le “troisième espace d’énonciation”, celui de l’hybridité intrinsèque des cultures »[33].
Ce rapide survol historiographique illustre, pour reprendre les mots de C. Halpern, que « l’identité est […] devenue incontournable aussi bien dans les recherches sur l’immigration, le nationalisme, la religion ou les gender studies que dans les travaux sur l’ethnicité »[34]. Bien que la question des identités occupe une place particulièrement importante dans la recherche historienne, il faut déplorer l’absence d’une historiographie exhaustive sur cette thématique qui demeure éparpillée entre l’histoire des mentalités, l’histoire sociale et l’histoire culturelle. À notre connaissance, une réflexion épistémologique sur l’Histoire des identités demeure à écrire[35]. Malgré la diversité des objets d’étude, certaines constantes peuvent cependant être dégagées de la recherche actuelle sur la question de l’identité.
L’identité (individuelle ou collective) peut être considérée comme une articulation entre un processus évolutif et dynamique de socialisation, en constante formation et modification[36], et une structure stable reposant sur la permanence et la continuité. Malgré les variations qu’elle subit à travers l’influence des interactions sociales, l’identité n’existe que si elle s’inscrit sur un continuum relativement stable qui lui assure son unité dans le temps[37]. Lorsque les variations sont insérées à l’intérieur de ce continuum, l’identité est préservée, mais, lorsqu’elles sont perçues comme des ruptures, cela conduit souvent à une crise identitaire[38]. L’identité est également indissociable de son contexte social, culturel, historique et relationnel[39]. Elle peut donc être comprise comme une construction propre à un contexte sociohistorique particulier qui en fournit les modèles de référence structurant les définitions identitaires. Construction sociale et historique, l’identité n’est toutefois accessible qu’à travers les discours que les acteurs sociaux en font, peu importe la forme qu’ils peuvent prendre[40]. Cette construction discursive, élaborée à partir des représentations sociales, varie en fonction des contextes d’énonciation, se répercute dans la réalité vécue des acteurs sociaux[41] et répond principalement à deux besoins identitaires : le besoin d’identification, permettant aux acteurs sociaux de se reconnaître et d’être reconnus, et celui de différenciation, permettant de se distinguer de l’Autre en portant sur lui un jugement souvent stéréotypé qui permet également d’affirmer sa propre unicité. L’identité ne se construit donc pas seulement dans un rapport à Soi, mais également dans un rapport à l’Autre[42], rapport majoritairement compétitif, mais pas nécessairement polémique. L’identité est indissociable de la différence, car elle est façonnée par la représentation de Soi et par la perception de l’Autre, et trouve sa concrétisation dans la réalité vécue à travers la catégorisation sociale. Le concept d’identité s’avère donc précieux pour analyser les structures mentales qui orientent le fonctionnent d’un groupe ou d’une société. La recherche effectuée sur la question des identités dans l’Antiquité au cours des vingt dernières années a montré la pertinence de ce concept pour comprendre les sociétés anciennes et les divers groupes qui les composent.
Les phénomènes identitaires dans l’Antiquité : réflexions épistémologiques et méthodologiques
La question des identités dans l’Antiquité oblige le spécialiste à délaisser les définitions modernes au profit d’un tout autre mode raisonnement identitaire propre aux sociétés anciennes. Si le concept même d’identité n’existe pas dans l’Antiquité[43], cela ne signifie pas pour autant que les Anciens n’avaient aucune conscience de leur(s) identité(s). L’enjeu principal de la recherche a donc été de comprendre les stratégies et les mécanismes mis en oeuvre dans les processus de construction des identités anciennes. À partir de quelques approches des identités anciennes, notre propos se limitera à illustrer certaines perspectives nouvelles mises en lumière par les récents travaux.
Pour étudier la question de l’identité dans l’Antiquité, les spécialistes ont sollicité plusieurs postes d’observation en s’intéressant notamment à la formation des identités[44], à l’identité en auto-définition[45], à l’identité dans le miroir de l’Autre[46], à l’impact des interactions entre le Soi et l’Autre sur les définitions identitaires[47], aux frontières identitaires et à leurs transgresseurs[48], etc. Ces différentes approches, souvent combinées les unes aux autres, ont contribué à mettre en évidence la complexité des processus de construction des identités dans l’Antiquité dont on reconnaît désormais le caractère fluide et dynamique, malgré les idéologies de stabilité sur lesquelles elles se sont construites. Dans le cadre de cette étude, nous insisterons particulièrement, mais non exclusivement, sur les travaux s’étant intéressés à la question des identités judéennes et chrétiennes.
Abordant la notion d’ethnicité, P. Bauduin a souligné que :
L’identité ethnique, loin d’être une donnée statique et immuable, est le résultat de processus de construction (et de reconstruction) par lesquels les individus et les groupes s’identifient eux-mêmes et par rapport aux autres dans des contextes spécifiques, sur la base d’une perception de traits culturels, d’attitudes, d’origines et/ou d’intérêts communs[49].
Dans cette perspective, l’identité grecque peut être considérée comme la résultante d’un double processus discursif : intégratif (reposant sur les similarités avec les groupes pairs) et dissociatif (reposant sur les différences avec l’altérité)[50]. F. Hartog a montré que l’auto-définition de l’identité grecque s’est construite sur une « rhétorique de l’altérité », car définir l’Autre oblige également à se définir[51]. Prenant appui sur un schéma binaire ethnocentrique (Grecs/barbares), les Grecs ont d’abord élaboré une définition linguistique de leur identité[52], mais après les Guerres médiques, cette identité s’est cristallisée autour d’une définition culturelle de l’appartenance hellénique qui refusait de reconnaître l’identité culturelle de l’Autre considérée comme inférieure[53]. « “Néantiser” les autres, ou les peindre toujours différents et inconvenants, pour s’affirmer soi-même »[54], tel est l’usage que les Grecs ont fait de la « rhétorique de l’altérité » et sur laquelle ils ont construit leur singularité identitaire. Si la « rhétorique de l’altérité » n’était pas absente des discours identitaires romains, elle a été employée d’une manière complètement différente.
Analysant les discours identitaires romains, principalement ceux émanant de l’aristocratie, D. Roman et Y. Roman ont montré le caractère à la fois discursif et évolutif de l’identité romaine. Ainsi, de la République à la période impériale, les Romains ont construit leur identité, d’abord fondée sur la citoyenneté[55], sur deux grands types de discours : ceux qui excluent et ceux qui rassemblent[56]. Ces discours d’exclusion appartenaient à deux registres : intérieur/intérieur, opposant des citoyens romains de rangs différents, et intérieur/extérieur, opposant Romains et barbares. Le premier niveau d’exclusion, de nature sociopolitique, était celui de l’aristocratie qui « discrédita tous les autres et d’abord ses adversaires en usant des mêmes discours d’exclusion qui, dans le temps, disaient sa propre excellence »[57]. L’identité romaine était donc en premier lieu une identité définie par les grands. Contrairement aux Grecs, l’opposition entre Romains et barbares n’était pas « une opposition culturelle fondée sur le couple même/autre, […], mais une opposition géographique fondée sur le couple intérieur/extérieur[58] ». L’instauration du régime impérial et l’extension de la citoyenneté romaine par la Constitution antonine en 212 a contribué à l’émergence d’une tout autre forme de discours, les discours de rassemblement autour du prince[59]. Cependant, malgré cette volonté unificatrice, tous les habitants de l’Empire ne se sentaient pas Romains de la même manière, ni pour les mêmes raisons[60]. Ainsi, « “être Romain” variait selon la hiérarchie sociale, les autodéfinitions identitaires et les points de vue extérieurs »[61]. Dans une perspective différente, E. S. Gruen considère que l’identité romaine s’est construite en opposition à une identité grecque réinventée par Rome[62], car les Romains, comme l’ont fait les autres peuples (Grecs, Judéens) de l’Antiquité, n’ont pas hésité à discerner, voire à inventer, des relations de parenté et des racines partagées[63].
Ces exemples, qui mériteraient bien des nuances, permettent néanmoins de constater que les identités anciennes reposaient essentiellement sur les appartenances qui déterminaient les statuts sociopolitiques et ethniques sur lesquels s’élaboraient les définitions identitaires à partir de discours d’inclusion et d’exclusion qui ont varié selon les époques et selon les contextes d’énonciation. Ainsi, « ce qui existait, c’était le statut, résultante de diverses données juridiques et sociologiques. Le problème était non celui de l’identité psychologique, mais de l’identification sociale, non de se définir, mais d’être reconnu »[64]. Plusieurs études se sont alors intéressées aux marqueurs identitaires (ethniques, culturels religieux, géographiques), notamment ceux des ethnicités anciennes[65], en insistant sur leur caractère social, évolutif et surtout discursif[66].
L’étude des processus de construction des identités ethniques a également contribué à renouveler notre compréhension de l’identité judéenne. Cette dernière a longtemps été considérée comme une identité basée sur une définition strictement religieuse. Les travaux de S. Masson[67], de S. J. D. Cohen[68] et de J. Lieu[69] ont toutefois montré que les Judéens ont d’abord été compris comme un groupe ethnique, comparable aux autres groupes ethniques de l’Antiquité, dont l’ethnonyme a d’abord référé à une appartenance géographique plutôt qu’à une appartenance religieuse[70], car, dans l’Antiquité, « l’identité “religieuse” n’existait pas de façon autonome. Elle était une des facettes de l’identité sociale des individus, déterminée par les entités collectives dont ils étaient membres (l’ethnos, la polis, l’État, la maison, la phratrie, etc.), à plus forte raison pour les agents cultuels publics »[71]. C’est donc du point de vue ethnique ou ethnico-religieux qu’il convient désormais d’aborder la définition de l’identité judéenne et les rapports que les Judéens ont entretenus avec les autres Nations[72]. Pour affirmer leur unité et leur unicité, les Judéens ont élaboré diverses stratégies identitaires visant à la fois à assurer la cohésion des communautés dispersées et à façonner leurs spécificités par rapport à d’autres ethnos par la normalisation d’un certain nombre de rites et de pratiques dont le fonctionnement reposait sur une idéologie ethnico-religieuse imposée notamment par les auteurs sacerdotaux[73]. La définition des identités anciennes reposait donc sur des mécanismes de pouvoir et des stratégies discursives visant à établir ou à contester les normes et les processus d’identification sur lesquels s’érigeait la frontière distinguant le « Nous » du « Eux ».
Dans une perspective similaire, J. Lieu[74] et D. Kimber Buell ont montré que l’auto-définition des premiers chrétiens s’est élaborée sur un « raisonnement ethnique » comparable à celui employé par d’autres ethnies de l’époque. Pour S. C. Mimouni, une distinction doit cependant être faite entre les appartenances qui relèvent des statuts sociopolitiques et ethniques et engagent le statut de l’individu du point de vue juridique et les appartenances religieuses et idéologiques qui reposent, d’un point de vue spirituel, sur la pensée de l’individu[75]. Pour marquer la différence entre ces deux modes d’appartenance, Mimouni associe à la première catégorie la notion d’identité et à la seconde la notion de « conscience identitaire » qu’il définit comme la faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité spirituelle et intellectuelle[76]. Ainsi, poursuit Mimouni, « il y a une grande différence entre les Judéens qui partagent une identité et les chrétiens qui, nonobstant leur identité d’origine, partagent une croyance », « une “conscience fédérative”, celle de leur fidélité à la messianité de Jésus de Nazareth »[77]. Les chrétiens auraient ainsi tenté d’élaborer une forme d’identité qui offrait la possibilité de transcender les autres formes d’appartenance[78].
Non seulement ces rhétoriques identitaires ont offert aux chrétiens des manières de négocier leur identité ou leur « conscience identitaire » dans l’Empire romain et d’affirmer leurs spécificités, mais ces stratégies identitaires éminemment discursives leur ont également permis d’entrer en compétition de manière polémique avec l’Autre[79], que ce soit avec les Judéens ou avec certains courants chrétiens en vue de les exclure[80]. Cependant, soulignant à la fois le caractère discursif sur lequel s’est élaborée l’identité chrétienne et l’absence, du moins avant le ive siècle, d’une autorité « rabbinique » et d’une autorité « chrétienne » suffisamment affermies pour s’imposer sur un vaste ensemble de communautés, certains chercheurs ont remis en question le modèle d’une partition entre le « judaïsme » et le « christianisme » qui se serait produit au cours du iie siècle, voire antérieurement. Les plus récentes recherches sur ce problème « rendent historiquement peu plausible l’idée d’une haute, unique et unilatérale séparation dont les raisons se laisseraient réduire à un dénominateur commun »[81] et estiment qu’il convient davantage de parler en termes de « processus de distanciation » plutôt qu’en termes de « rupture » ou de « séparation »[82]. De plus, pour plusieurs spécialistes, il convient désormais de distinguer la présentation discursive, rhétorique et souvent polémique que les auteurs chrétiens ont faite de cette « séparation » de la réalité vécue localement, celle que nous connaissons davantage, par les différentes communautés chrétiennes[83]. En effet, plusieurs sources littéraires et épigraphiques, de même que certaines découvertes archéologiques récentes attestent d’une tout autre réalité laissant penser qu’il conviendrait peut-être de repousser les frontières de cette partition au ive siècle, voire ultérieurement, après que le « christianisme » se soit institutionnalisé comme « religion » d’État[84]. Encore faudrait-il ne pas confondre, comme on le fait souvent, « séparation » et « relations », ou « interactions », car, même une fois cette « séparation » survenue, cela ne signifie pas pour autant l’impossibilité de « relations », ou d’« interactions », parfois conflictuelles, d’autres fois amicales, entre Judéens et chrétiens. Plusieurs témoignages anciens montrent effectivement que les « relations » entre Judéens et chrétiens se sont poursuivies tout au long de l’Antiquité[85]. Actuellement, on tend donc à considérer que, même après le iie siècle, les frontières entre les identités judéennes et chrétiennes sont demeurées floues, d’autant plus que le « judaïsme » et le « christianisme » trouvaient encore leur expression dans une pluralité de Ways — qui ont varié selon les contextes géographiques, culturels et sociaux — à travers lesquelles les Judéens et les chrétiens ont interagi.
Le « judaïsme » et le « christianisme » anciens n’ayant jamais constitué des réalités monolithiques et monophoniques, il convient alors de considérer que c’est dans une polyphonie de chemins que les différents mouvements issus du « judaïsme » et du « christianisme » anciens — poursuivant des contacts de nature et de degré variés selon les contextes, les lieux et les endroits tout au long de l’Antiquité — se sont entrecroisés puis, progressivement, différenciés et distancés. Comme l’a proposé récemment S. C. Mimouni, il conviendrait peut-être de repenser cette question en prenant désormais en considération trois formes, ou trois voix, de « judaïsme » : le « judaïsme rabbinique », le « judaïsme synagogal » et le « judaïsme chrétien »[86]. Ainsi, si certaines communautés chrétiennes ont rapidement ressenti le besoin de se distancier du « judaïsme », qu’il soit de type « synagogal » ou « rabbinique », certaines semblent plutôt avoir été exclues de manière plus ou moins rapide et radicale par le judaïsme « rabbinique » et surtout « synagogal »[87], alors que d’autres sont demeurées plus longtemps très près des pratiques et des institutions du « judaïsme », principalement du « judaïsme synagogal », pensons notamment aux communautés nazoréennes et ébionites. On constate bien que cette question, éminemment complexe, implique une pluralité de Ways, sur lesquelles nous sommes parfois mal renseignés, et qu’elle ne saurait être résolue par la métaphore simplificatrice de deux chemins qui se seraient à un instant précis et de manière unilatérale partitionnés. Le problème actuel est donc davantage de savoir quelle est la relation entre la rhétorique des auteurs chrétiens et la réalité sociale[88] et, surtout, de comprendre « quel judaïsme s’est séparé de quel christianisme »[89]. Encore faudrait-il, en premier lieu, que les spécialistes partagent la même définition, ou plutôt la même compréhension, lorsqu’ils parlent du judaïsme, du christianisme, des Judéens et des chrétiens dans l’Antiquité[90].
L’étude des identités dans l’Antiquité est-elle utopique ?
Les recherches sur les identités dans l’Antiquité sont-elles utopiques, pis encore anachroniques comme on l’a parfois prétendu ? Peuvent-elles véritablement contribuer à une meilleure compréhension de la définition que les différentes communautés anciennes se faisaient d’elles-mêmes et des autres, de leurs fonctionnements et de leurs interactions entre elles ? Par cette contribution, nous avons tenté de montrer que, loin d’être utopiques et anachroniques, les recherches sur la question des identités anciennes ouvrent plutôt sur de nouvelles perspectives que l’on doit désormais prendre en considération en histoire ancienne.
Cela ne signifie pas pour autant que les théories sur les identités, principalement élaborées pour l’étude des sociétés modernes, peuvent être appliquées sans discernement aux diverses communautés anciennes. Si elles s’avèrent analogiquement éclairantes pour la compréhension des phénomènes identitaires dans l’Antiquité, elles ne peuvent être employées qu’en respectant les modes de raisonnements et de fonctionnements des communautés anciennes. L’étude de ces identités dans une perspective sociohistorique oblige donc une approche double et complémentaire : une approche du type « – emic », soit une approche qui tente de saisir de l’intérieur une société donnée en employant les catégories de pensée et les terminologies usuelles pour les acteurs de cette société – et une approche de type « – etic », soit une approche qui tente de saisir de l’extérieur cette même société en ayant recours aux concepts et aux outils interprétatifs développés, entre autres, par les sciences humaines et sociales modernes[91].
Aborder la question des identités dans l’Antiquité implique donc en premier lieu de comprendre les stratégies et les mécanismes mis en oeuvre dans les processus de construction des identités anciennes et de les considérer comme dynamiques, évolutifs et discursifs. De fait, les identités anciennes étaient d’abord et avant tout des identités d’appartenance à des communautés (ethniques, civiques, religieuses, etc.). Cumulables[92], ces appartenances relevaient des statuts sociopolitiques et ethniques qui engageaient soit, du point de vue juridique, le statut de l’individu, soit, du point de vue spirituel, la pensée de l’individu en ce qui concerne les appartenances religieuses et idéologiques. Déterminées par les appartenances, la définition de ces identités communautaires s’élaborait constamment sur un rapport Soi/Autre, inclusion/exclusion et reposaient sur des stratégies discursives qui variaient selon les époques et les contextes d’énonciation. Produit d’une rhétorique, l’étude des identités anciennes oblige donc de distinguer discours et réalités sociales. Si les discours ont pour effet d’ériger des frontières identitaires fixes et perméables, l’étude de la réalité vécue par les acteurs sociaux montre que ces frontières étaient plutôt fluides et imperméables[93]. Ainsi, loin de susciter de vains débats, la recherche sur les identités dans l’Antiquité permet d’aborder sous un angle novateur certains acquis de la recherche et de leur apporter de riches nuances.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cette étude a reçu l’appui financier du Fonds Québécois de la Recherches Société et Culture (FQRSC).
-
[2]
Suzanne Saïd, dir., Ἑλληνίσμος, Quelques jalons pour une histoire de l’identité grecque. Actes du Colloque de Strasbourg (25-27 octobre 1989), Leyde, New York, E. J. Brill, 1991, 402 p. ; « Valeurs, normes et constructions identitaires. Les processus d’identification dans le monde gréco-romain ». Actes du colloque-atelier de Québec organisé par Renaud Lussier (Université du Québec à Montréal) dans le cadre du 76e Congrès de l’Acfas (5 mai 2008) parus dans les Cahiers des études anciennes, XLIV (2007) ; Créer une identité dans l’Antiquité : quand, comment, pourquoi ? Colloque de Vandoeuvre (28-29 octobre 2011) organisé par la Fondation Hardt et la Faculté des sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève [à paraître] ; Les mondes grec et romain : définitions, frontières et représentations dans le « judaïsme », le « christianisme » et le « paganisme ». Atelier-colloque de Montréal (11 mai 2012) organisé par Anne Pasquier, Steeve Bélanger et Marie Chantal (Université Laval) dans le cadre du 80e Congrès de l’Acfas [à paraître].
-
[3]
Mentionnons, à titre d’exemple, le McMaster Project on Jewish and Christian Self-Definition dirigé par Ed Parish Sanders (McMaster University) ayant conduit à la publication de trois principaux volumes (Ed Parish Sanders, Albert I. Baumgarten, Alan Mendelson et Ben F. Meyer, dir., Jewish and Christian Self-Definition, Londres, Philadelphie, Fortress Press, 1980-1982) et aux travaux dirigés conjointement de 1997 à 2005 par Nicole Belayche (Centre Gustave Glotz : UMR 8585 / Recherches sur les mondes hellénistiques et romains, Paris) et Simon Claude Mimouni (Centre d’études des religions du Livre : UMR 8584 / Laboratoire d’études sur les monothéistes, Villejuif) ayant conduit à la publication des deux importants collectifs sur les identités religieuses dans l’Antiquité : Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition, Turnhout, Brepols, 2003, 351 p. ; Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Entre lignes de partage et territoires de passage. Les identités religieuses dans les mondes grec et romain. « Paganisme », « judaïsme », « christianisme », Paris, Louvain, Peeters, 2009, 502 p
-
[4]
Simon Claude Mimouni, « Les identités religieuses dans l’Antiquité classique et tardive : remarques et réflexions sur une question en discussion » dans Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Entre lignes de partage et territoires de passage, p. 485.
-
[5]
Giovanni Filoramo souligne à quel point la signification de ce concept est loin d’être claire. Giovanni Filoramo, Qu’est-ce que la religion ? Thèmes, méthodes problèmes, Trad. française de Noël Lucas, Paris, Cerf, 2007, p. 19-22.
-
[6]
Alfred Grosser, « Les identités abusives », Le Monde, 28 janvier (1994) cité par Philippe Hamman, « Comment (re)penser production et revendications d’identités » dans Adeline Cherqui et Philippe Hamman, dir., Production et revendications d’identités : éléments d’analyse sociologique, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 237. Dix ans plus tard, Éric Dupin ira même jusqu’à parler d’hystérie identitaire.. Éric Dupin, L’hystérie identitaire, Paris, Cherche Midi, 2004, 165 p. Ce constat, largement partagé dans le milieu savant, montre, selon A. Mucchielli, la nécessité d’un véritable « débat épistémologique sur les différents sens d’identité présents dans chaque discipline scientifique ». Alex Mucchielli, L’identité, 5e édition mise à jour, Paris, Presses Universitaires de France, 2002 [1986], p. 8.
-
[7]
D’abord appliquée en linguistique, plus particulièrement en phonétique, l’opposition « – emic / – etic » a été élargie et appliquée aux faits sociaux, notamment par Kenneth L. Pike qui a tenté, au tournant des années 1950, de dégager, dans une perspective anthropologique, certaines « unités complémentaires de comportements ». Le niveau « – emic », lorsqu’il concerne les représentations sociales, donc les identités, en vint à désigner, entre autres, les « notions, concepts et conceptions autochtones, locales, populaires, autrement dit d’ensembles, configurations ou schémas d’interprétation largement partagés par les sujets, au sein d’une culture ou d’une sous-culture donnée ». Jean-Pierre Olivier De Sardan, « Émique », L’Homme, 38, 147 (1998), p. 158.
-
[8]
Constantinos Macris, « “ Sectes ” et identité dans le monde antique. Bref tour d’horizon accompagné de quelques ébauches de réflexion » dans Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Entre lignes de partage et territoires de passage, p. 23-40.
-
[9]
Baugnet, L’identité sociale, Paris, Dunod, 1998, p. 9.
-
[10]
Par l’analyse des relations intergroupales, la psychologie sociale a contribué à « la maturation épistémologique et conceptuelle des travaux sur l’identité sociale », Ibid, p. 10. Sur le concept d’identité en sociologie, André Akoun, « Identité » dans André Akoun et Pierre Ansart, dir., Dictionnaire de sociologie, Paris, Le Robert - Seuil, 1999, p. 264-265 ; Daniel Benamouzig, « Identité » dans Raymond Boudon et al., dir., Dictionnaire critique de la de sociologie, Paris, Larousse, 2003, p. 117-118 ; Sciolla, « Identité », dans Massimo Borlandi et al., dir., Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 335-338.
-
[11]
Pour William James, The Principles of Psychology, American Science Series. Advanced Course, New York, H. Holt, 1890, l’identité du Soi social, qu’il distingue des autres constituantes du Soi, « se situe au point de rencontre entre la connaissance de Soi par soi-même et par autrui », ce qui implique l’existence de plusieurs Soi, puisque l’Autre, qui se forge une image de lui, est pluriel. Pour sa part, James Mark Balwin, Social and Ethical Interpretations in Mental Development, a Study in Social Psychology, New York, Macmillan, 1897, considère la personnalité sociale, qui se constitue dès l’enfance dans la relation établie entre l’Alter et l’Ego, comme un produit social et culturel. Le Soi social, qu’il nomme socius, repose alors sur une double perception : celle de l’Ego et de l’Alter. Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, New York, Scribners, 1902, poursuit cette réflexion en élaborant le concept du looking-glass self, du Soi réfléchi, du Soi dépendant de la représentation de l’Autre qui agit comme un miroir identitaire. L’Autre renvoie au Soi une image qui affecte son identité en lui permettant de s’évaluer et de se connaître. Ainsi, pour Cooley, il ne peut y avoir d’identité sans faire implicitement référence à l’Autre. Sur ces auteurs, voir Baugnet, L’identité sociale, p. 10-11 et Sciolla, « Identité », p. 335.
-
[12]
L’interactionnisme fut introduit par Herbert Blumer qui considère que le Soi s’élabore dans son rapport à l’Autre par la prise de rôle. Pour George H. Mead, ce n’est que par l’interaction sociale que l’individu peut prendre conscience de sa propre identité, car toute identité est constitutivement sociale. Mead s’oppose ainsi à la conception métaphysique d’auto-conscience qui appartenait à la réflexion philosophique et considère que l’identité repose sur un processus en constante évolution s’opposant ainsi aux structuralistes. Les théories de l’interactionnisme symbolique conçoivent que « les interactions sociales, à travers des systèmes symboliques partagés ou communs, forgent la conscience que l’individu a de lui-même », car elles sont une action sur autrui qui s’opère par le jeu et le langage verbal et non verbal. Jean-Claude Ruano-Borbalan, « Introduction générale. La construction de l’identité » dans Catherine Halpern et Jean-Claude Ruano-Borbalan, dir., Identité(s). L’individu, le groupe, la société, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2004, p. 14 ; Baugnet, L’identité sociale, p. 14-15 et 48-53 ; Sciolla, « Identité », p. 335.
-
[13]
Baugnet, L’identité sociale, p. 12-13.
-
[14]
Désirant dépasser les théories freudiennes, Érik Erickson publie, en 1950, Enfance et société où il introduit le concept d’identité. Ces travaux ont alors surtout connu un succès auprès des psychologues. Ce n’est que lors de la réédition de cet ouvrage en 1963 qu’il rejoignit un public plus large. Ruano-Borbalan, « Introduction générale », p. 12-13.
-
[15]
Selon Erickson, l’identité est la résultante des différentes identifications qui se développent dès l’enfance. Baugnet, L’identité sociale, p. 13-14.
-
[16]
Pour Durkheim, l’identité se construit durant l’enfance par transmission méthodique, par inculcation. L’être privé est constitué des traits de caractère, de l’hérédité, des souvenirs et expériences personnelles alors que l’être collectif correspond aux croyances religieuses, aux pratiques morales, aux traditions nationales ou professionnelles et aux opinions collectives des groupes d’appartenance de l’individu. Les recherches culturelles désignent ce phénomène enculturation. Mucchielli, L’identité, p. 81-83 ; Benamouzig, « Identité », p. 117 ; Georges Vignaux, Khadiyatoulah Fall et Laurier Turgeon, « Les recherches interculturelles : héritages conceptuels et nouveaux enjeux », dans Khadiyatoulah Fall et Laurier Turgeon, dir., Champ multiculturel, transactions interculturelles, des théories, des pratiques, des analyses, Paris, Montréal, L’Harmatan, 1998, p. 81 ; Carmel Camilleri, « La culture et l’identité culturelle : champ notionnel et devenir », dans Carmel Camilleri et Margalit Cohen-Emerique, dir., Chocs de cultures : concepts et enjeux pratiques de l’interculturel, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 28.
-
[17]
Benamouzig, « Identité », p. 117.
-
[18]
La théorie des rôles a été énoncée par des interactionnistes tels que N. N. Foot et T. Parsons. Foot a tenté de comprendre le processus d’identification qui entraîne l’individu à jouer certain(s) rôle(s) alors que Parsons a tenté de montrer que l’acteur social se conforme à un système de normes intériorisées lié à l’appartenance à une catégorie sociale. Baugnet, L’identité sociale, p. 14 ; Ruano-Borbalan, « Introduction générale », p. 14.
-
[19]
Le sociologue R. K. Merton a popularisé cette théorie qui considère que l’individu s’identifie à un groupe de référence, auquel il n’est pas nécessairement membre, et lui emprunte ses normes et ses valeurs. Ibid.
-
[20]
Serge Moscovici, La psychanalyse, son image et son public : étude sur la représentation sociale de la psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, xi-650 p.
-
[21]
Les représentations sociales servent à comprendre et à expliquer la réalité, à définir l’identité, en offrant des repères pour l’identification, et à sauvegarder la spécificité des groupes. Pour J.-C. Abric, « la représentation est une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de références, donc de s’y adapter, de s’y définir une place ». J.- C. Abric, « Les représentations sociales : aspects théoriques » dans JeanClaude Abric, dir., Pratiques sociales et représentations, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 13 ; Mucchielli, L’identité, p. 60-61 ; Baugnet, L’identité sociale, p. 16-18.
-
[22]
Baugnet L’identité sociale, p. 18-19.
-
[23]
Sur les représentations sociales, Pierre Mannoni, Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, 128 pages, Pascal Moliner, Images et représentations sociales, de la théorie des représentations à l’étude des images sociales, Paris, Presses Universitaires de Grenoble, 1996, 275 p. ; Abric, « Les représentations sociales », p. 11-36 ; Baugnet, L’identité sociale, p. 91-109.
-
[24]
Pensons notamment aux Afro-American Studies, Women’s Studies, Gay’s Studies, Jew Studies, etc. Jean-Claude Schmidt, « L’histoire des marginaux », dans Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, dir., La nouvelle histoire, Paris, Hachette, 1978, p. 344-369. C’est également durant cette période que la notion d’identité, par sa diffusion dans les diverses disciplines des sciences sociales et son utilisation par le politique et les médias, subit un éclatement. Ruano-Borbalan, « Introduction générale », p. 15.
-
[25]
Sur ce débat, on consultera Giovanni Busino, « Histoire et sociologie » dans Massimo Borlandi et al., dir., Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 319-322 ; Pierre Ansart, « Histoire et sociologie » dans André Akoun et Pierre Ansart, dir., Dictionnaire de sociologie, p. 256-257 ; Jean-Claude Ruano-Borbalan, « Histoire et sociologie. Les démêlés d’un vieux couple » dans Jean-Claude Ruano-Borbalan, dir., L’histoire aujourd’hui : nouveaux objets de recherche, courants et débats, le métier d’historien, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 1999, p. 441-446 ; Bertrand Müller, « Sociologie et Histoire », dans Christian Delacroix et al., dir., Historiographies, I, Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, p. 625-635.
-
[26]
Dans son Apologie pour l’histoire, ou le métier d’historien, 6e éd. Paris, A. Colin, 1967 [1949], p. 157-158, Marc Bloch a souligné avec justesse « que les faits historiques sont, par essence, des faits psychologiques ».
-
[27]
Ceux-ci vont aborder « l’outillage mental » en analysant les attitudes qui reposent sur les représentations collectives afin de reconstituer « les systèmes de représentation et les croyances du passé ». Pierre Mannoni, Les représentations sociales, p. 44. Leurs interrogations ont alors porté sur la question des attitudes devant la vie et la mort, la famille, l’enfant, sur l’imaginaire, sur l’altérité, allant également sur des terrains méconnus comme la sexualité et les comportements qui y sont liés, la folie, les déviants, les représentations du diable et du purgatoire, la vie quotidienne, les sentiments et les pulsions, etc. Cette nouvelle approche, l’histoire des mentalités, a fait appel à l’anthropologie, à la sociologie, à la psychologie et à l’ethnologie, car comme le mentionne M. Foucault, « [...] puisque l’homme historique, c’est l’homme vivant, travaillant et parlant, tout contenu de l’Histoire quel qu’il soit relève de la psychologie, de la sociologie ou des sciences du langage ». Michel Foucault, Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 378-384. Voir également, Michel Vovelle, « Histoire et représentations » dans Jean-Claude Ruano-Borbalan, dir., L’histoire aujourd’hui, p. 45-49. À la fin des années 1950, cet engouement pour une approche psychologique des phénomènes et des personnages historiques a favorisé l’émergence de la psychohistoire. Élaborée par les historiens étasuniens, cette approche a suscité, et suscite toujours, une vive controverse. Voir Jacques Szaluta, La psychohistoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, 127 p.
-
[28]
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964, 189 p. ; Pierre Bourdieu, « L’identité et la représentation, éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 35, novembre 1980, p. 63-72 ; Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, 142 p.
-
[29]
Antoine Prost, Les anciens combattants (1914-1939), Paris, Gallimard, 1977, 246 p. ; Antoine Prost, « Où va l’histoire sociale ? », Le mouvement social, 174 (janvier-mars, 1996), p. 15-22 ; Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire. Paris, Seuil, 1996, 330 p.
-
[30]
Nicolas Mariot et Philippe Olivera, « Constructivisme » dans Christian Delaroix et al., dir., Historiographies, II, Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, p. 708.
-
[31]
Edward Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1980, 392 p.
-
[32]
Homi K. Bhabha, The Location of Culture. New York, Routledge, 1994, 285 p.
-
[33]
Jacques Pouchepadass, « Subaltern et Postcolonial Studies », dans Christian Delacroix et al., dir., Historiographies, II, Concepts et débats, p. 641.
-
[34]
Jean-Claude Ruano-Borbalan, « Introduction générale », p. 16.
-
[35]
Certes, on retrouve des historiographies qui abordent une dimension précise de l’identité, comme l’identité ethnique (par exemple, David M. Miller, « Ethnicity Comes of Age : An Overview of Twentieth-Century Terms for Ioudaios », Currents in Biblical Research, 10 (2012), p. 293-311), mais, à notre connaissance, aucune historiographie n’apporte une réflexion plus large sur une Histoire des identités. Dans un récent collectif sur les principaux concepts et débats historiographiques (Christian Delacroix et al., dir., Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, 2 vol.), aucune section n’est consacrée à la question de l’identité, illustrant bien qu’une véritable réflexion épistémologique demeure à écrire. Bien qu’elle commence à apparaître dans la littérature savante et dans les milieux universitaires, l’appellation Histoire des identités demeure encore peu usitée pour désigner ce champ de recherche particulier.
-
[36]
Giovanni Filoramo décrit l’identité religieuse comme une « continuelle redéfinition et renégociation ». Filoramo, Qu’est-ce que la religion ?, p. 21.
-
[37]
Jean-François Bayart a montré que les fictions historiques créées par un groupe leur permettent d’assurer cette continuité en minimisant les variations qui ont engendré une certaine transformation de leur identité. Jean-François Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, 306 p.
-
[38]
Mucchielli, L’identité, p. 71-72.
-
[39]
Les identités sont « relatives au contexte socio-historique, aux circonstances particulières (lieux, moments), aux rôles sociaux, aux relations liées par les différents sujets ». Baugnet L’identité sociale, p. 8.
-
[40]
Pour P. Tap, « comprendre l’identité, c’est donc mettre à jour les processus qui en organisent la construction historique, la mise en question, la perte ou la réappropriation ». Pierre Tap, « Identité (psychologie) », dans Encyclopaedia Universalis, Tome 11, 2e éd., Giuseppe Annoscia, dir., Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002, p. 791. Ainsi, comme le souligne W. Pohl, « s’il est vrai que les identités ne sont pas des données objectives, mais des constructions sociales et culturelles, c’est aussi par l’écrit que ces constructions se sont achevées et communiquées. L’identité s’esquisse, se propose, se débat, se nie et se diffuse par le biais de texte ». Walter Pohl, « Nouvelles identités ethniques entre Antiquité et Haut Moyen Âge » dans Véronique Gazeau, Pierre Baudin et Yves Moderan, dir., Identité et ethnicité. Concepts, débats historiographiques, exemples (iiie-xiie siècle), Caen, Publications du Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales, 2008, p. 23-33. Par conséquent, « langage et représentation sont des dimensions, et peut-être les plus importantes, sur lesquelles s’édifient les identités collectives. Car c’est dans le discours que le groupe trouve une formulation de son unité et une image de son identité, par différentiation avec d’autres groupes ». Jean-René Lamiral et Edmond-Marc Lipiansky, La communication interculturelle, Paris, Armand Colin, 1989, p. 95.
-
[41]
Simon Claude Mimouni précise avec nuance que « toute définition identitaire se réalise sur le monde imaginaire et ne repose pas nécessairement sur une réalité : il n’empêche qu’elle a des répercussions d’ordre politique, économique et sociale qui ne sont pas négligeables et conditionnent l’avenir des personnes concernées ». Simon Claude Mimouni, « Les identités religieuses », p. 489.
-
[42]
« On ne peut en effet entrevoir son identité que difficilement, et non pas tant par un “ travail personnel ” que par des comparaisons systématiques avec d’autres individus, d’autres milieux, cultures ou sous-cultures ». Pierre Moessinger, Le jeu de l’identité, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 102. Ainsi, comme le souligne D. Oberlé, « les caractéristiques du groupe, ses finalités, ses enjeux n’acquièrent de signification que dans la confrontation avec d’autres groupes et les évaluations qui en découlent ». Dominique Oberlé, « Vivre ensemble. Le groupe en psychologie sociale » dans Catherine Halpern et Jean-Claude Ruano-Borbalan, dir., Identité(s), p. 123.
-
[43]
Comme le souligne H. Inglebert, « en latin, le concept moderne d’identité n’existe pas (identitas date du ive siècle apr. J.-C. et ne désigne qu’une catégorie logique, utilisée en particulier par les chrétiens pour réfléchir sur l’identité divine des personnes trinitaires), Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain » dans Hervé Inglebert, dir., Histoire de la civilisation romaine, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 465.
-
[44]
Marcel Simon, « Le christianisme : naissance d’une catégorie historique » dans Marcel Simon, Le christianisme antique et son contexte religieux. Scripta varia, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1981, p. 312-335 ; Maurice Sachot, L’invention du Christ. Genèse d’une religion, Paris, Odile Jacob, 1998, 251 p. ; François Blanchetière, « Comment le même est-il devenu l’autre ? ou comment Juifs et Nazaréens se sont-ils séparés ? », Revue des Sciences religieuses, 71, 1 (1997), p. 9-32 ; François Blanchetière, « Reconstruire les origines chrétiennes : le courant “ nazaréen ” » [en ligne], Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem, 18 (2007), http://bcrfj.revues.org/document229.html, page consultée le 16 mars 2012.
-
[45]
Jean-Pierre Vernant, L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’Autre en Grèce ancienne, Paris, Gallimard, 1989, 232 p. ; Gregory E. Sterling, Historiography and Self-definition. Josephos, Luke-Actes and Apologetic Historiography, Leyde / New York, E. J. Brill, 1992, 500 p. ; Alain Le Boulluec, « L’identité chrétienne en auto-définition chez Clément d’Alexandrie » dans Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Entre lignes de partage et territoires de passage, p. 437-458.
-
[46]
Adalbert G. Hamman, « Chrétiens et christianisme vus et jugés par Suétone, Tacite et Pline le Jeune » dans Forma Futuri. Studi in onore del cardinal Michele Pellegrino, Turin, Bottege d’Erasmo, 1975, p. 91-109 ; Robert L. Wilken, « The Christians as the Romans (and Greeks) Saw Them » dans Ed Parish Sander et Ben F. Meyer, dir., Jewish and Christian Self-definition, vol. I, The Shaping of Christianity in the Second and Third Centuries, Londres, SCM Press, 1980, p. 100-125 ; Eugen Cizek, L’image de l’Autre et les mentalités romaines du ier au ive siècle de notre Ère, Bruxelles, Latomus, 48 (1989), p. 360-371 ; MarieFrançoise Baslez, « Qui sont les chrétiens ? Le point de vue des Romains » dans MarieFrançoise Baslez, Les premiers temps de l’Église de saint Paul à saint Augustin, Paris, Gallimard, 2004, p. 171-180.
-
[47]
Danièle Roman et Yves Roman, Rome, l’identité romaine et la culture hellénistique (218–31 av. J.C.), Paris, Sedes, 1994, 347 p. ; Hervé Inglebert, Les Romains chrétiens face à l’histoire de Rome : histoire, christianisme et romanité en Occident dans l’Antiquité tardive (iiie–ve siècles). Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1996, 744 p. ; MarieFrançoise Baslez, « Pénétration et diffusion dans le monde grec » dans Marie-Françoise Baslez, Bible et histoire. Judaïsme, hellénisme, christianisme, Paris, Gallimard, 1998, p. 287-326.
-
[48]
Michel Dubuisson, « Remarques sur le vocabulaire grec de l’acculturation », Revue belge de philologie et d’histoire, 60, 1 (1982), p. 5-32.
-
[49]
Pierre Bauduin, « Introduction », dans Véronique Gazeau, Pierre Baudin et Yves Moderan, dir., Identité et ethnicité, p. 7-21.
-
[50]
« La catégorisation inhérente aux interactions groupales implique plusieurs mécanismes : un effet de contraste qui tend à l’accentuation des différences entre groupes ; un effet de stéréotypie qui joue sur la représentation de l’étranger ; un effet d’assimilation qui contribue à accentuer les ressemblances à l’intérieur d’un même groupe ». Jean-René Lamiral et Edmond-Marc Lipiansky, La communication interculturelle, p. 206-207.
-
[51]
François Hartog, Le miroir d’Hérodote : essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, 1980, 386 pages. Voir également Bruno Rochette, « Grecs, Romains et Barbares. À la recherche de l’identité ethnique et linguistique des Grecs et des Romains », Revue belge de philologie et d’histoire, 75, 1 (1997), p. 37-57.
-
[52]
Ainsi, « ἑλληνίζω implique d’abord, dès ses premiers emplois, une opposition entre les Barbares et les Grecs, et cette opposition est d’abord linguistique ». Michel Casevitz, « Hellenismos. Formation et fonction des verbes en –ivzw et de leurs dérivés » dans Suzanne Saïd, dir., Ἑλληνίσμος, p. 14.
-
[53]
Pierre Salmon, « “ Racisme ” ou refus de la différence dans le monde gréco-romain », Dialogue d’histoire ancienne, 10 (1984), p. 75-97 ; Jonathan M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 45-47. B. Isaac a souligné que dans la mentalité grecque influencée par la pensée d’Aristote, cette infériorité, justifiant la nature servile de l’Autre, était acquise collectivement et transmise héréditairement, ce qui la distinguait de la mentalité romaine qui ne considérait pas l’Autre comme inférieur par nature. Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton / Oxford, Princeton University Press, 2004, p. 248-249, p. 503-516. Nuançant la représentation de l’Autre dominante dans l’historiographie, perçu et conçu comme différent, E. S. Gruen a souligné qu’au-delà des contrastes et des aliénations, les Anciens ont également fondé leur identité sur des connections avec l’Autre en incorporant des traditions étrangères, des liens de sang, des associations avec d’autres cultures, notamment à travers des mythes, des légendes et des histoires fictives, envers lesquels ils avaient une certaine admiration. Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2011, p. xiv-415. Voir également, Erich S. Gruen, dir., Cultural Identity in the Ancient Mediterranean. Issues and Debates, Los Angeles, Getty Research Institute, 2010, vii-535 p.
-
[54]
Danièle Roman et Yves Roman, Aux miroirs de la Ville. Images et discours identitaires romains (iiie s. avant J.C. – iiie s. après J.-C.), Bruxelles, Latomus, 2007, p. 375.
-
[55]
« “ Être romain ” signifiait être citoyen romain ». Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain », p. 466.
-
[56]
Voir Danièle Roman et Yves Roman, Aux miroirs de la Ville...
-
[57]
Ibid., p. 131.
-
[58]
Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain », p. 468. Bien qu’ils se soient considérés comme supérieur, les Romains, qui ont adopté une politique d’intégration, n’ont pas considéré l’Autre comme étant par nature inférieur. Ils reconnaissaient chez les autres peuples des qualités distinctes et différentes des leurs, certains peuples étant effectivement nés pour être serviles, mais d’autres pas. Benjamin Isaac, The Invention of Racism, p. 248-249, p. 503-516.
-
[59]
« À côté de l’identité civique juridique, il existait une identité psychologique dont les critères communs à tous étaient l’obéissance à l’empereur et la participation matérielle à la romanitas (la civilisation romaine) ». Ibid.
-
[60]
« Les critères de distinction sont géographiques — l’opposition entre Occident et Orient —, culturels — entre Latins et Grecs —, et politiques — entre la capitale, Rome, et les provinces ». Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain », p. 470.
-
[61]
Ibid., p. 457.
-
[62]
Erich S. Gruen, Culture and National Identity in Republican Rome, Ithaca, Cornell University Press, Duckworth, 1992, xiii-347 pages.
-
[63]
Erich S. Gruen, Rethinking the Other...
-
[64]
Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain », p. 466.
-
[65]
Par exemple, J. D. G. Dunn considère que l’identité judéenne repose sur quatre principaux piliers : le monothéisme, la foi en l’élection, la Torah, la Temple de Jérusalem. La séparation entre le judaïsme et le christianisme serait la conséquence d’interprétations différentes de ces quatre piliers. James D. G. Dunn, The Partings of the Ways. Between Christianity and Judaism, and their Signifiance for the Character of Christianity, Londres, Philadelphie, SCM Press-Trinity Press International, 1991, p. 35.
-
[66]
« Ethnic identity is a cultural construct, perpetually renewed and renegociated through discourse and social praxis ». Jonathan M. Hall, Ethnic identity, p. 19.
-
[67]
Steve Mason, « Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism : Problems of Categorization in Ancient History », Journal for the Study of Judaism, 38 (2007), p. 457-512.
-
[68]
Shaye J. D. Cohen, The Beginning of Jewishness : Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley, University of California Press, 1999, p. 69-139. Voir en particulier p. 70, 92-93 pour l’assise géographique de la catégorie ethno-géographique « Judéens ».
-
[69]
Jonathan M. Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 239-248.
-
[70]
L’ethnonyme Ἰουδαίος a été d’abord employé dans un contexte de relations entre Judéens et gens de l’extérieur pour désigner un groupe ethnique qui se définissait en premier lieu sur la base de son appartenance à une origine géographique commune, la Judée. Cette ethnie, de manière comparable aux autres ethnies antiques, se distinguait par ses lois, par son Dieu, par ses institutions, par ses pratiques religieuses, etc. La désignation « Judéens » recouvrait ainsi un sens à la fois ethno-géographique et ethno-religieux, la première ayant cependant précédé la seconde. Jonathan M. Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, p. 239-248 ; Simon Claude Mimouni, « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », Revue biblique 115 (2008), p. 361-362 ; Nous profitons de l’occasion pour remercier Simon Claude Mimouni de nous avoir permis de prendre connaissance du texte éclairant de sa conférence intitulée « Juifs ou Judéens ? Une question de vocabulaire ou d’idéologie » qu’il prononça à l’Université de Lausanne le 31 mars 2010 dans le cadre d’un colloque de l’Institut romand des sciences bibliques de l’année académique 2009-2010.
-
[71]
Nicole Belayche, « Entrée en matière : de la démarche à un cas modèle » dans Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Entre lignes de partage et territoires de passage, p. 4.
-
[72]
Sur la perception des Judéens par les Grecs et les Romains, voir notamment Benjamin Isaac, The Invention of Racism, p. 440-491.
-
[73]
Alfred Marx, « Ethnicité et pérennité de l’Israël antique. Les stratégies identitaires consécutives à la disparition du Royaume de Juda » dans Francis Schmidt, Cristophe Batsch et Madalina Vârtejanu-Joubert, éd., Manières de penser dans l’Antiquité méditerranéenne et orientale. Mélanges offerts à Francis Schmidt par ses élèves, ses collèges et ses amis, Leyde, Boston, Brill, 2009, p. 129-143.
-
[74]
Jonathan M. Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, p. 239-268 ; Denise K. Buell, « Rethinking the Relevance of Race for Early Christian Self-Definition », Harvard Theological Review, 94 (2001), p. 449-476 ; Denise K. Buell, « Race and Universalism in Early Christianity », Journal of Early Christian Studies, 10 (2002), p. 429-468 ; Denise K. Buell, Why this New Race ? Ethnic Reasoning in Early Christianity, New York, Columbia University Press, 2005, xiv-257 p.
-
[75]
Simon Claude Mimouni, « Qu’est-ce qu’un “ chrétien ” aux ier et iie siècles ? Identité ou conscience ? », Annali di storia dell’esegesi, 27, 1 (2010), p. 11-34.
-
[76]
Ibid., p. 14.
-
[77]
Ibid., p. 28-32.
-
[78]
« L’identité religieuse dans le monde gréco-romain repose qu’on le veuille ou non sur un fondement ethnique. Ce n’est plus le cas avec le christianisme qui a imposé l’idée qu’il repose sur une conscience d’appartenance fondée uniquement sur la croyance messianique, ce au détriment de l’appartenance ethnique — c’est le troisième genos ». « Les identités religieuses dans l’Antiquité classique et tardive : remarques et réflexions sur une question en discussion », p. 501.
-
[79]
Selon D. Boyarin, dans la polémique qu’ils ont engagée avec les Judéens, les premiers chrétiens ont élaboré une tradition de succession apostolique afin de légitimer l’autorité des apôtres et celle des dirigeants ecclésiastiques. Centrés sur les écoles rabbiniques après la destruction du Second Temple, les Judéens ont parallèlement élaboré des discours de succession ininterrompue depuis Moïse afin de légitimer l’autorité des Rabbis. De part et d’autre, ces discours de légitimation d’autorité ont contribué à l’élaboration d’ « orthodoxies » concurrentes et d’hérésies permettant l’exclusion de l’Autre. Cette concurrence dans la légitimation d’une autorité a probablement joué un rôle déterminant dans le processus de séparation du christianisme et du judaïsme. Daniel Boyarin, Border Lines. The Partition of Judeo-Christianity, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2004, p. 74-86.
-
[80]
Denise K. Buell, Why this New Race ?, p. 2-4. Pour Nicole Belayche, « l’explicitation d’une identité, par ses porteurs ou ses observateurs, repose sur la mise en comparaison. Sa construction et l’altérité qu’elle postule sont d’autant plus vigoureuses qu’elles se développent dans des ambiances de protestation ou d’opposition. N. Belayche, « Entrée en matière », p. 10. M. Kahlos a montré que les apologètes ont élaboré à partir d’identités fluides des identités fixes de l’Autre afin de pouvoir les attaquer. Ils ont appliqué le même procédé pour créer et établir leurs propres identités et celles de leurs communautés en vue de la défendre. Maijastina Kahlos, Debate and Dialogue : Christian and Pagan Cultures (c. 360-430), Burlington, Aldershot, Ashgate, 2007, 213 pages.
-
[81]
François Vouga, Les premiers pas du christianisme. Les écrits, les acteurs, les débats, Genève, Labor et Fides, 1997, p. 149 ; Simon Claude Mimouni a montré que le « processus de distanciation » entre le « judaïsme » et le « christianisme » a reposé sur divers facteurs, notamment sur des controverses d’interprétation et d’observances de la Torah liées à des causes historiques et doctrinales. À ces controverses, il convient également d’ajouter les polémiques internes au « christianisme » qui ont opposé entre eux les différents mouvements chrétiens. Simon Claude Mimouni, « Pour une compréhension de la séparation entre les communautés “ chrétiennes ’’ et les communautés “ pharisiennes ’’ (CA. 70-135 de notre ère) », Henoch, 26 (2004), p. 145-171.
-
[82]
Simon Claude Mimouni, « Les frères jumeaux ou les frères triplets ? Christianisme, judaïsme et rabbinisme », Le monde de la Bible, 202 (septembre-octobre-novembre 2012), p. 23 ; Simon Claude Mimouni, « Sur la question de la séparation entre “jumeaux” et “ennemis” aux ier et iie siècle », dans Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon, dir., La croisée des chemins revisitée : quand l’« Église » et la « Synagogue » se sont-elles distinguées ?, Actes du colloque de Tours (18-19 juin 2010), Paris, Cerf, 2012, p. 18-19.
-
[83]
Plusieurs chercheurs vont situer les origines de cette partition au iie siècle, mais considèrent le ive siècle comme l’ère critique de l’auto-définition du christianisme et du judaïsme et celui d’un véritable « Parting of the Ways ». Dans cette perspective, la séparation n’apparaît pas comme le résultat d’une procédure ordonnée et linéaire, mais plutôt apparaît de diverses manières, en différents lieux à différents moments, d’où l’importance de conduire des études locales comme celle de S. Spence qui montre que cette séparation arrive très tôt au cours du premier siècle dans l’Église de Rome. Pour J. Lieu, le principal problème avec le modèle unique du « Parting of the Ways », c’est qu’il s’opère dans une conception universelle, alors que notre connaissance relève davantage du spécifique et du local. Stephen Spence, The Parting of the Ways : The Roman Church as a Case Study, Louvain, Dudley, Peeters, 2004, 404 p. ; Judith Lieu, « “ The Parting of the Ways ” : Theological Construct or Historical Reality ? », Journal for the Study of the New Testament, 56 (1994), p. 101-19.
-
[84]
Des études archéologiques et épigraphiques ont montré que dans certaines régions de l’Empire romain, les chrétiens ont continué jusqu’au iiie siècle, voire jusqu’au ive siècle, à partager les lieux de sépulture avec les Judéens et les gentils. Adriana Destro et Mauro Pesce, « From Jesus Movement to Christianity : A Model for the Interpretation. Cohabitation and Separation of Jews and Christians » dans Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon, dir., La croisée des chemins revisitée, p. 21-49. Voir également les remarques de Adam H. Becker et Annette Y. Reed, « Introduction. Traditional Models and New Directions » dans Adam H. Becker et Annette Y. Reed, dir., The Way that Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and The Early Middle Ages, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, p. 1-33. Également, Andrew S. Jacob, « Jew and Christians » dans Susan A. Harvey and David G. Hunter, dir., The Oxford Handbook of Early Christian Studies, New York, Oxford University Press, 2008, p. 169-185.
-
[85]
Cette thèse, qui s’opposait au supersessionnisme de Harnack, a été pour la première fois avancée en français par Marcel Simon, Verus Israel. Études sur les relations entre chrétiens et Juifs dans l’Empire romain (135-425), Paris, E. De Boccard, 1948, 475 p. Pour Simon, « l’explication [de la séparation entre le judaïsme et le christianisme] par les catastrophes palestiniennes tourne court. Elle est infirmée par la survivance, après 70 et même après 135, d’un judaïsme hellénistique très ouvert et très accueillant ; elle l’est surtout par ce conflit même dont Harnack conteste la réalité, entre l’Église et la Synagogue : il n’est plus concevable une fois opéré le repli d’Israël. » Citation tirée de Marcel Simon, Verus Israel, 2e éd., 1964, p. 433-434. Ainsi, pour Simon, contrairement à ce que prétendait Harnack, les oeuvres polémiques chrétiennes sur les Judéens ne correspondaient pas à un code rhétorique d’un passé révolu, mais s’avéraient plutôt le reflet de confrontations continues entre les Judéens et les chrétiens durant l’Antiquité jusqu’à l’époque de Constantin.
-
[86]
Simon Claude Mimouni, « Histoire du judaïsme et du christianisme antiques. Quelques remarques épistémologiques et méthodologiques », conférence présentée à l’Université de Lausanne le 12 décembre 2012 dans le cadre du colloque international « Les judaïsmes dans tous leurs états aux ier-iiie siècles (Les Judéens des synagogues, les chrétiens et les rabbins) ». La thèse d’un judaïsme à trois voix, ou plutôt d’une troisième composante du peuple judéen, est développée dans le plus récent ouvrage de Mimouni. On renverra particulièrement à sa présentation du « judaïsme synagogal » et à ses réflexions conclusives, Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien du vie siècle avant notre ère au iiie siècle de notre ère : des prêtres aux rabbins, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 553-567 et p. 854-857.
-
[87]
L’expulsion des chrétiens hors des synagogues pose un autre problème tout aussi complexe, celui de la Birkat ha-minim, de la « Bénédiction des hétérodoxes », qui fait actuellement l’objet d’un important débat entre spécialistes. Sans reprendre ce vaste dossier, soulignons que la Birkat ha-minim s’intègre dans un processus permettant d’exclure les mouvements considérés comme marginaux et déviants parmi lesquels se trouvaient certaines communautés chrétiennes d’origine judéenne, notamment les notzrims, les « nazaréens ». Or, actuellement, on remet en question la portée et l’efficacité de la Birkat ha-minim, une formulation liturgique qui aurait été introduite dans la prière quotidienne, la Shemoneh-’eresh, et qui aurait été appliquée unilatéralement par une autorité rabbinique à l’ensemble des communautés judéennes au cours du iie siècle, voire antérieurement. De plus, selon la thèse de L. Vana, la mention des notzrims n’aurait été introduite que tardivement, soit vers la fin du ive siècle. Par conséquent, en l’absence d’une autorité rabbinique affermie avant le ive siècle, voire le viie siècle, il semble peu probable que la Birkat ha-minim ait véritablement constitué une arme puissante entre les mains des rabbins dans le processus d’exclusion des chrétiens des institutions synagogales avant une date assez tardive. Cependant, cela ne signifie pas qu’il soit impossible, comme le laissent penser certains témoignages chrétiens, que certaines communautés chrétiennes soient entrées en conflit avec certaines communautés judéennes et que ces conflits aient conduit à leur expulsion des synagogues. Toutefois, cela semble davantage relever du contexte local et ponctuel que d’un dispositif répressif généralisé. À ce sujet voir Simon Claude Mimouni, « Une prière pharisienne contre les chrétiens d’origine juive : la “ Bénédiction des hérétiques ” », Religion & Histoire, 6 (2006), p. 63-67, Simon Claude Mimouni, « La “ Birkat Ha-Minim ” : une prière juive contre les judéo-chrétiens », Revue des sciences religieuses, 71, 3 (1997), p. 275-298 ; Liliane Vana, « Birkat ha-minim est-elle une prière contre les judéo-chrétiens ? » dans Nicole Belayche et Simon Claude Mimouni, dir., Les communautés religieuses, p. 201-241 ; Joel Marcus, « Birkat Ha-Minim Revisited », New Testament Studies, 55 (2009), p. 523-551 ; Daniel Boyarin, « Once Again Birkat Hamminim Revisited », dans Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon, dir., La croisée des chemins revisitée, p. 91-105 ; Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien, p. 490-491.
-
[88]
Paula Fredriksen, « What “ Parting of the Ways ” ? » dans Adam H. Becker et Annette Y. Reed, dir., The Way that Never Parted, p. 38 ; Simon Claude Mimouni, « Les origines du christianisme : nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux ? Bibliographie sélectionnée et raisonnée », Revue biblique, 115 (2008), p. 9.
-
[89]
Simon Claude Mimouni, « Les origines du christianisme », p. 9.
-
[90]
Pierluigi Piovanelli, « De l’usage polémique des récits de la Passion, ou Là où les chemins qui auraient dû se séparer ont fini par se superposer », dans Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon, dir., La croisée des chemins revisitée, p. 127-128 ; Adele Reinhartz, « A Fork in the Road or a Multi-Lane Highway ? New Perspectives on the “ Parting of the Ways ” Between Judaism and Christianity » dans Ian H. Henderson and Gerbern S. Oegema, dir., The Changing Face of Judaism, Christianity, and Other Greco-Roman Religions in Antiquity, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2006, p. 287.
-
[91]
Nous paraphrasons et adoptons ici la présentation que Constantinos Macris fait de ces deux approches dans son article « “ Sectes ” et identité », p. 27.
-
[92]
H. Inglebert donne l’exemple classique de Paul qui, sans aucune contradiction, était à la fois Judéen, pharisien, chrétien, grec de culture, originaire de la cité de Tarse et citoyen romain. Hervé Inglebert, « Les identités dans le monde romain », p. 466.
-
[93]
« Les frontières, identitaire en particulier mais pas seulement, s’établissent, se déplacent, se traversent et se transgressent : elles sont à la fois ligne de séparation et de contact ; elles sont à la fois manifestation d’une appartenance, d’une influence réciproque, d’une méfiance également réciproque. C’est pourquoi, elles évoluent dans le temps en même temps que les entités qu’elles délimitent et dont elles constituent les interfaces ». Simon Claude Mimouni, « Les identités religieuses », p. 500.