Résumés
Résumé
La critique littéraire a beaucoup analysé les modalités de restitution du passé dans les œuvres contemporaines, mais elle s’est peu penchée sur les pratiques mémorielles des femmes dont l’accès à l’héritage se trouve compliqué par l’absence d’archives et leur exclusion de l’histoire officielle. Les études féministes s’attachent à renverser cette tendance. Dans cette perspective, l’auteure vise à dégager les stratégies employées pour rétablir les filiations féminines brisées dans une œuvre majeure de la littérature québécoise contemporaine : le cycle Soifs de Marie-Claire Blais. L’hypothèse avancée est que Blais fait trois gestes pour reconstituer le legs des héritières : elle documente la disparition des femmes et de leurs œuvres, convoque des figures historiques et déploie une écriture polyphonique pour assurer la transmission d’une mémoire représentative de la diversité des expériences féminines.
Mots-clés :
- mémoire,
- littérature féministe,
- écriture des femmes,
- diversité,
- Marie-Claire Blais
Abstract
Literary criticism has extensively analyzed the ways in which the past is restituted in contemporary works. However little attention has been paid to the memorial practices of women, whose access to their heritage is complicated by the absence of archives and their exclusion from official history. Feminist studies are working to reverse this trend. In this regard, the author aims to identify the strategies employed to re-establish broken feminine filiations in a major work of contemporary Quebec literature: Marie-Claire Blais’s Soifs series. The hypothesis put forward is that Blais takes three steps to reconstruct feminine legacies. She documents the disappearance of women and their works, summons historical figures and uses polyphonic writing to ensure the transmission of a memory that is representative of the diversity of feminine experiences.
Resumen
La crítica literaria ha analizado ampliamente los métodos de restitución del pasado en la obra contemporánea, pero ha prestado poca atención a las prácticas memoriales de las mujeres, cuyo acceso a la herencia se ve complicado por la ausencia de archivos y su exclusión de la historia oficial. Los estudios feministas buscan revertir esta tendencia. En esta perspectiva, la autora tiene como objetivo identificar las estrategias utilizadas para restaurar las filiaciones femeninas rotas en una obra importante de la literatura quebequense contemporánea : el ciclo Soifs de Marie-Claire Blais. La hipótesis planteada es que Blais realiza tres gestos para reconstituir el legado de las herederas : documenta la desaparición de las mujeres y de sus obras, convoca figuras históricas y despliega una escritura polifónica para asegurar la transmisión de una memoria representativa de la diversidad de experiencias femeninas.
Corps de l’article
Les concepts d’héritage et de transmission font un retour en force dans les sciences humaines et les littératures de langue française (Cellard et Lapointe 2011 : 7). Les ouvrages consacrés aux modalités de restitution du passé affluent si bien que la thématique de la filiation constitue « une topique du discours critique sur le contemporain » (Dion 2020 : 134). En France, Dominique Viart et Bruno Vercier (2005 : 96) ont proposé la notion de récit de filiation pour rendre compte des tentatives, au sein de la production littéraire actuelle, de « rétablir la mémoire oubliée de ce qui fut » et de restaurer la dignité des « pères humiliés par l’Histoire ». Au Québec comme en France, cette notion a beaucoup été reprise par la critique littéraire, qui s’en est inspirée pour réfléchir à d’autres corpus et à différents types de filiation. Or, il y a un angle dont l’examen me semble avoir été quelque peu négligé dans les travaux cités plus haut : celui du genre (gender).
Qu’en est-il des filiations féminines, des mères biologiques, symboliques et littéraires? À quelles stratégies la littérature fait-elle appel pour reconstituer le legs des héritières, c’est-à-dire de celles qui « souffrent d’une filiation au pire absente, au mieux trouée » (Saint-Martin et Gibeau 2014 : 1)? Ces questions rencontrent encore trop peu d’écho dans les études plus largement consacrées à la littérature contemporaine. Celles-ci traduisent donc une vision partielle de la production actuelle, car elles ne tiennent pas compte du « travail d’excavation et de résurrection » effectué par les écrivaines et les féministes qui s’efforcent, depuis des décennies, de « retrouver dans le passé les figures de femmes […] que l’histoire dominante a occultées » (Collin 2014 : 98). Afin de combler cette lacune, des travaux ont été menés, dans le champ des études féministes, pour souligner la contribution des pratiques biographiques et mémorielles des femmes au renouvellement des formes littéraires et au développement de nouvelles modalités de transmission de l’héritage (Évelyne Ledoux-Beaugrand 2013, Lori Saint-Martin et Ariane Gibeau 2014, Julie Beaulieu, Adrien Rannaud et Lori Saint-Martin 2018).
C’est dans cette dernière perspective que je propose d’analyser des extraits tirés du cycle Soifs de Marie-Claire Blais. En quatrième de couverture du premier tome, paru en 1995, le cycle est décrit comme une « grande fresque baroque ». C’est juste : les dix volumes comportent, au total, près de 200 personnages dont les chemins se croisent sur une île luxuriante du golfe du Mexique. Véritable microcosme, l’île accueille des individus issus de tous les milieux : artistes appartenant à la bourgeoisie, familles fortunées, travailleuses ou travailleurs du sexe, adolescentes ou adolescents en crise, personnes réfugiées et sans-abris se côtoient dans un cadre enchanteur. Ces lieux n’offrent toutefois qu’une illusion de paradis, puisque ses habitants et ses habitantes n’y sont pas à l’abri de l’histoire ou des grands maux du monde contemporain : racisme, sexisme, homophobie et pauvreté sévissent sur l’île avec une violence inouïe.
Deux raisons expliquent le choix de cette oeuvre. D’une part, les romans du cycle Soifs sont tout indiqués pour l’étude des stratégies de construction de l’héritage, car ils sont traversés par la question de la mémoire et de sa transmission (Roy 2009; Pich-Ponce 2013). D’autre part, le cycle accorde une place prépondérante à la mémoire des populations exclues de l’histoire officielle. Dans son oeuvre, Blais ne se contente pas de remettre en cause les principes qui guident l’écriture de l’histoire : elle multiplie les stratégies pour remédier à l’absence d’archives et rétablir les filiations brisées. Ces stratégies, que la narration déploie pour faire contrepoids aux discours hégémoniques et contrer l’invisibilisation des groupes opprimés, ont notamment pour objet d’assurer la transmission de l’héritage féminin. Si cette préoccupation pour la mémoire des femmes est présente dans tout le cycle, elle se manifeste encore plus clairement dans les cinq tomes que j’étudie ici : Soifs (1997), Dans la foudre et la lumière (2001), Augustino et le choeur de la destruction (2005), Mai au bal des prédateurs (2010) et Une réunion près de la mer (2018). Certes, le cycle ne représente pas un cas exemplaire mais, étant donné l’étendue de la réflexion qu’il développe sur les mémoires minorisées, il offre certainement un terrain propice à l’analyse des tactiques employées aujourd’hui pour pallier les lacunes de l’histoire officielle.
Dans le cycle Soifs, l’écrivaine québécoise fait donc trois gestes pour tenter de reconstruire « toutes ces lignes spirituelles, encore trop méconnues de ces femmes qui [ont] combattu pour un art, une science » (Blais 2008 : 59-60). Elle documente la disparition des femmes et de leurs oeuvres, convoque des figures historiques afin d’empêcher qu’elles ne basculent dans l’oubli et déploie une écriture polyphonique pour assurer la transmission d’une mémoire plurielle.
Archiver l’absence et la disparition
Selon Laurent Demanze (2009 : 12), les figures contemporaines d’héritière et d’héritier ressentent un tiraillement entre l’injonction morale de commémorer leur ascendance et le désir coupable de faire table rase du passé pour aller de l’avant. Dans le cycle Soifs, le dilemme se pose autrement. Si les personnages oscillent entre la nécessité d’assurer « la continuité de la mémoire du monde » (Blais 2001 : 178) et le fantasme de créer « un paradis […] sans passé ni mémoire » (ibid. : 104), leur démarche mémorielle est compliquée par l’absence de traces et d’archives. Prisonniers d’un monde où « une femme ne [naît] pas pour durer » (Blais 1997 : 214), les personnages féminins du cycle n’ont pas accès aux oeuvres et aux savoirs de celles qui les ont précédés, car les vestiges de leur existence ont, dans certains cas, totalement disparu. Dans l’extrait suivant, par exemple, la décision de transmettre ou non le legs n’appartient pas aux héritières, puisque les liens avec le passé sont déjà rompus (ibid. : 193-194) :
Quand Mélanie entendrait-elle dans une salle de concert de New York, de Baltimore, les oeuvres d’Anna Amélia Puccini, toutes ces Anna Amélia oubliées, les oeuvres d’Anna Amélia Mendelssohn dont son frère Felix avait parfois usurpé les compositions, car le père d’Anna Amélia n’eût pas aimé que les oeuvres de sa fille fussent exécutées en public, qui sait si Anna Amélia n’avait pas été, comme Vivaldi, une violoniste virtuose, un chef d’orchestre soumis aux obligations de ses charges, elle avait été maître de chapelle dans les couvents, les monastères, […] plus puissante, elle avait été une abbesse écrivant au xiie siècle, une musique toute liturgique, une princesse de Prusse exigeant que ses compositions fussent jouées à la cour […], pauvre, elle avait emporté avec elle dans l’ensevelissement des fosses et des ravins […] sa musique encore dissonante des tremblements de son temps.
Mélanie n’adhère pas aux discours qui nient la contribution des femmes au domaine de la musique. À l’instar de la critique féministe, pour qui « l’absence des femmes dans l’histoire signifie leur éviction du pouvoir plutôt que leur manque d’activité » (Collin 2014 : 162), la militante s’efforce de faire ressortir les entraves à la connaissance des productions féminines. Son intervention, toutefois, vise moins à établir la culpabilité des pères et des frères qu’à exposer l’étendue des ravages causés par la domination masculine. À défaut de pouvoir accéder au contenu de l’héritage, déjà « emporté […] dans l’ensevelissement des fosses et des ravins » (Blais 1997 : 193-194), Mélanie dévoile la sélection arbitraire que l’histoire officielle opère dans une tentative de contrecarrer l’action du système patriarcal. Pour atteindre son but, elle reprend un procédé employé par Virginia Woolf dans A Room of One’s Own (2014) et crée une « lignée fictive de femmes musiciennes » (Roy 2009 : 32) : les « Anna Amélia oubliées ». Clin d’oeil à la figure de Judith Shakespeare, dont Woolf imagine la trajectoire pour mettre en évidence les nombreux obstacles à l’implantation d’une tradition littéraire féminine, les « Anna Amélia oubliées » traduisent la difficulté, pour les femmes, de s’inscrire dans la longue durée. Qu’elles soient « violoniste virtuose » comme Vivaldi, « maître de chapelle », « abbesse » ou « princesse de Prusse », les Anna Amélia restent confinées à la marge, voire vouées à disparaître. Comme le montre l’énumération des positions privilégiées occupées par ces femmes, rien n’assure la pérennité de leurs compositions : ni leur talent exceptionnel, ni leur dévouement à la religion, ni leur appartenance à la royauté. Le rétablissement de la filiation, en ce sens, offre un répit de courte durée, puisque Mélanie s’empresse de rappeler le danger qui la guette. La militante ne se contente pas de combler les ellipses de l’histoire en y réintroduisant une lignée de musiciennes; elle expose la menace de disparition qui pèse continuellement sur elles.
Chez Blais, les femmes ne sont jamais à l’abri de l’anéantissement si bien que leur legs est marqué au sceau de la précarité; Renata, tante de Mélanie, en fait la démonstration. En visite sur l’île, Renata loue une villa dans l’espoir d’y trouver des vestiges du passage d’une poétesse brésilienne. À la recherche de « cette femme dont le nom était peu connu » (Blais 1997 : 103), bien qu’elle ait « écrit des vers admirables » (ibid. : 229), l’avocate constate rapidement que la demeure où l’écrivaine a composé ses poèmes ne comporte « aucun signe tangible de sa présence » (ibid. : 103). En soi, l’absence de traces se révèle préoccupante, mais elle l’est d’autant plus qu’elle tranche avec l’étendue des connaissances accessibles sur un « poète célèbre » (ibid. : 102) ayant jadis séjourné dans la même maison pour y écrire son oeuvre. De lui, en effet, Renata précise qu’« on savait tout » (ibid. : 103) et même qu’on aurait dit qu’« il était encore là » (ibid.). Si ce contraste met en relief le mépris témoigné à l’écrivaine, « disparue en ces lieux comme elle le serait ailleurs » (ibid. : 229), il permet également de dénoncer l’accueil réservé, à divers moments de l’histoire, aux femmes et à leur mémoire.
Personnages aux contours peu définis, dont les noms propres ne sont jamais révélés, les artistes que décrit Renata acquièrent une portée symbolique en l’absence de traits définitoires précis. Au même titre que les « Anna Amélia », les deux poètes n’ont pas de référent unique. Ils illustrent des situations d’injustice et des dynamiques de pouvoir typiques des sociétés patriarcales. Alors que le cas de l’écrivaine brésilienne fait la lumière sur le sort réservé aux femmes, « toujours incomprises […], discréditées » ou « vite rejetée[s] dans l’oubli » (Blais 1997 : 143), celui du poète reflète la position hégémonique des hommes au sein de la communauté. Omniprésent, voire envahissant, il imprègne toute la maison « avec ses préférences pour l’austérité et la vie pastorale », à un tel point que Renata dit avoir l’impression que « veillait sur elle [son] esprit ordonné » (ibid. : 103). Dans ce contexte, il n’est pas anodin que l’avocate mentionne que le poète est « d’ascendance écossaise », et l’écrivaine, « d’origine brésilienne » (ibid. : 104). Par l’entremise de cette précision, Renata suggère que le genre n’est pas le seul facteur susceptible d’expliquer le traitement différentiel imposé à la poétesse, dont l’héritage se trouve d’autant plus menacé qu’elle appartient à la communauté latino-américaine, qui est historiquement opprimée aux États-Unis.
Pour l’avocate, la rupture de la filiation est une conséquence du patriarcat comme du racisme, deux fléaux qu’elle combat en préservant la mémoire des femmes et des minorités dont ces idéologies mortifères provoquent la disparition (Blais 1997 : 215) :
Et Renata avait choqué Mélanie en lui disant […] que pour ces cinq mille meurtres et viols [commis dans l’ancienne Yougoslavie] les assassins ne seraient jamais punis, ces sanglantes archives dormiraient parmi d’incommensurables autres archives des cruautés de l’histoire, et ces assassins, ces violeurs, jamais on ne les verrait devant des tribunaux organisés par des femmes.
Dans cet extrait, il n’est plus question des artistes dont l’histoire perd la trace, faute d’intérêt pour les oeuvres féminines, mais des femmes dont le meurtre et le viol causent un effondrement de la lignée. Dans ce cas-ci, Renata n’est pas placée devant une absence de données : elle dispose bel et bien d’archives, mais leur pouvoir de transformation est limité. Chez Blais, la transmission de la mémoire est menacée par la destruction des traces comme par « l’accumulation de perspectives partielles qui […] masque sous la surabondance des images la réalité de la tragédie » (Roy 2007 : 251) et l’expérience singulière des victimes, dès lors condamnées à l’anonymat. Trop vastes pour être exhumées, les archives ne permettent pas aux voix étouffées par la violence patriarcale de résonner et n’entraînent pas de justice pour les femmes décédées ni pour celles qui leur survivent. L’histoire suit son cours : « [l]es assassins, [l]es violeurs […] continu[ent] de violer, de tuer », tandis que « les femmes, les petites filles, à peine venues au monde » restent « vouées à des disparitions de tout ordre, abaissées dans leur silence » (Blais 1997 : 215).
Contrairement à Mélanie, qui croit fermement qu’« en ce nouveau siècle […] elle entendrait la voix des victimes, elle verrait les assassins incarcérés » (Blais 1997 : 215), l’avocate démontre peu de foi envers le système judiciaire. Si Renata jure de prononcer une « plaidoirie […] infatigable, pour ces vies, victimes ou criminelles » (ibid. : 232), l’essentiel de son travail de mémoire se concrétise ailleurs. Il prend forme dans les nombreux passages où l’avocate, « toujours du côté des humiliés » (ibid. : 36), rappelle tous les crimes commis à l’endroit des femmes, des viols perpétrés sur les campus américains (ibid. : 141-143) aux infanticides des filles pratiquées « en Inde, en Asie » (ibid. : 231). Dérivé du latin renatus (« né de nouveau »), le prénom de l’avocate prophétise son rôle dans le roman, où elle extirpe les victimes des limbes de l’histoire pour leur donner une seconde vie. Comme c’est le cas avec l’écrivaine brésilienne, Renata n’opère pas une restitution intégrale de l’héritage, car là n’est pas son objectif. Pour l’avocate, il n’est pas question de rétablir l’accès au legs – elle reconnaît que c’est peine perdue –, mais bien de veiller à ce que la postérité acquière une conscience de ce qui disparaît, qu’elle prenne la mesure de tout ce qui lui échappe. Dans l’impossibilité de conjurer la « malédiction inscrite dans la chair des femmes depuis des siècles » (ibid. : 39), Renata accomplit ce qu’il reste de mieux à faire : elle expose les rouages du système dans l’espoir de perturber son fonctionnement.
Sauvegarder la mémoire de celles qui restent
Dans le cycle Soifs, archiver l’absence devient un moyen de lutter contre la violence patriarcale, d’entraver « la marche altière de l’homme vers son destin, celui de la domination ou de la direction des puissances terrestres » (Blais 1997 : 61). Or, cette tactique n’est pas la seule que l’écrivaine adopte pour empêcher l’anéantissement des filiations féminines. Au fil des romans, Blais fait allusion à des artistes, à des scientifiques et à des militantes dont les accomplissements sont peu ou pas suffisamment reconnus pour créer, à même son oeuvre littéraire, des traces de leur contribution à la société. Dans un cycle où les personnages sont désignés par des prénoms incongrus pour marquer leur statut allégorique[1], l’évocation de figures historiques permet de contrebalancer le flou référentiel que l’écrivaine entretient pour donner une valeur exemplaire à son récit. En effet, l’intégration de références force les lectrices et les lecteurs à sortir de l’univers fictif des romans, à se remémorer le cours des événements mentionnés et à réfléchir aux enjeux mémoriels soulevés par les personnages à la lumière d’exemples concrets. Lors d’une conversation avec sa mère, Mélanie évoque ainsi des cas réels pour illustrer la situation précaire des héritages féminins (Blais 2001 : 216-217) :
Je sais que mes enfants garderont en mémoire le nom de Gandhi […] mais se souviendra-t-on de Rosa Parks et de son calme défi aux racistes blancs, refusant de quitter sa place dans un autobus à Montgomery, Alabama […] On se souviendra aussi de Nelson Mandela libérant l’Afrique du Sud, mais se souviendra-t-on d’une seule femme, une suffragette, d’Emmeline Pankhurst, mère de quatre enfants, comme moi, fondant un mouvement des femmes en 1903, se souviendra-t-on de cette longue croisade pour le vote des femmes, d’Emmeline Pankhurst, dont tous se moquaient, Winston Churchill, le premier.
Comme Renata dans le passage consacré au mystère de l’écrivaine brésilienne, Mélanie présente un contraste pour dénoncer l’accueil réservé par les discours dominants à la mémoire des femmes. Alors que le legs des figures masculines est placé sous le signe de la pérennité – le ton affirmatif de Mélanie suggère que la transmission de leur héritage se trouve assurée –, l’incertitude plane sur l’avenir des militantes et des héritages féministes. Cette fois, cependant, l’extrait sert moins à exposer le danger qui guette les femmes qu’à contrer l’oubli des figures féminines dont l’action a radicalement changé le cours de l’histoire. Dans le discours enflammé qu’elle tient à sa mère Esther, Mélanie communique plusieurs renseignements biographiques à propos de Rosa Parks et d’Emmeline Pankhurst. Elle mentionne leur nom complet, précise le lieu où elles ont été actives et résume brièvement leur démarche militante. À première vue, l’intégration de données biographiques à la conversation semble peu naturelle, d’autant plus que l’interlocutrice de Mélanie, féministe elle aussi, possède les mêmes connaissances. Cependant, cette dérogation aux règles de la vraisemblance s’explique par le fait que les propos et la question rhétorique de la fille – « se souviendra-t-on de Rosa Parks, […] d’une seule femme, […] d’Emmeline Pankhurst » – ne s’adressent pas uniquement à la mère. Dans le contexte, il est légitime de penser que les détails fournis visent également des destinataires hors du texte, qui ne connaissent pas forcément ces femmes ou leurs causes : le lecteur ou la lectrice. Chez Blais, la mémoire des groupes marginalisés est continuellement menacée de disparition si bien que la sauvegarde de leur héritage demande un engagement et des efforts collectifs, auxquels même le lectorat, désormais en possession du legs grâce à Mélanie, est invité à contribuer.
Dans le cycle Soifs, la commémoration des figures féminines se concrétise notamment dans l’insertion d’éléments biographiques, destinés à accroître la connaissance de ces personnalités marquantes et à maintenir leur héritage en vie. Mélanie, en effet, n’est pas la seule dont le flux de paroles est interrompu par la résurgence d’une figure historique. Disséminées ici et là dans les interventions des personnages féminins, les notices biographiques sont fréquentes dans le cycle, mais ne respectent pas toutes le même format. Ainsi, Caroline ne dit que quelques mots des exploits de Norma McCorvey, mieux connue sous le pseudonyme de « Jane Roe » (Blais 2005 : 170-171) : « [Ma fille] aurait combattu comme je le fis, pour le droit à l’avortement légal, aurait été bannie, controversée comme Norma McCorvey renversant les lois étriquées, au Texas, un lundi de janvier 1973. » Ailleurs, elle se livre à une longue réflexion sur le destin de Berthe Morisot et de Mary Cassatt, dont le passage reproduit ci-dessous ne représente qu’un court extrait (Blais 2005 : 194-195) :
Qui a enfermé ici avec moi ces femmes visionnaires dont j’entends les gémissements, […] si elles gémissent […], c’est parce que longtemps on les fit taire, celle dont le beau-frère Manet ne commenta jamais l’oeuvre, bien qu’elle prît une part essentielle au mouvement impressionniste, ou peut-être observa-t-il, condescendant, il faut avouer que ma belle-soeur, Berthe Morisot, sait peindre, cela oui, bon, mais ce n’est qu’une femme, […] une autre artiste américaine, qui vécut presque toute sa vie à Paris, […] chez ce peintre qui reçut les conseils de Degas, […] on ne semble avoir compris que le bonheur maternel, limitant la géniale artiste à cette expression, une femme qui sait peindre l’exclusive et passagère félicité d’être mère, que cela, […], on ne dit pas qui était cette femme, Mary Cassatt, née en Pennsylvanie en 1844.
Deux raisons expliquent la mise en commun de ces exemples. D’abord, cette comparaison illustre l’envergure d’un phénomène qui se déploie à différentes échelles dans le cycle Soifs. Bien que les figures convoquées se manifestent parfois très brièvement dans les textes et que leur présence ne soit pas forcément récurrente – c’est le cas, par exemple, de Norma McCorvey, de Maria Callas (Blais 1997 : 96) ou encore de Margaret Sanger (Blais 2005 : 112-113) –, toujours est-il que les conversations et le discours intérieur des femmes sont rythmés par l’apparition successive de personnages historiques. Chez Blais, les personnages féminins, même ceux qui sont réticents à l’idée d’affronter le passé comme Esther et Caroline, cohabitent avec une communauté de fantômes dont les visites sont fugaces mais régulières.
Ensuite, l’analyse de ces deux extraits permet de mettre en lumière les libertés que la voix narrative prend à l’occasion. Alors que certaines notices sont entièrement factuelles, d’autres, comme celles de Berthe Morisot et de Mary Cassatt, sont un peu plus romancées, Caroline allant jusqu’à imaginer les remarques misogynes adressées par le peintre Édouard Manet à sa belle-soeur. Si le recours à la fiction donne une profondeur aux figures historiques, dont l’intimité s’avère dès lors accessible aux lectrices et aux lecteurs, là n’est pas la principale fonction de ce procédé. Le but est plutôt de parvenir à synthétiser les combats et les humiliations quotidiennes de la figure convoquée par l’entremise d’une scène ou d’une anecdote révélatrice. Dans le cas de Berthe Morisot et de Mary Cassatt, il s’agit d’exposer la difficulté, pour une femme, d’établir sa crédibilité, même lorsqu’elle est décrite comme un « maître de la couleur possédant une technique si souple » (Blais 2005 : 195). Dans le cycle Soifs, les efforts de conservation de la mémoire féminine visent autant les « femmes visionnaires » que les batailles qu’elles mènent inlassablement contre les différentes incarnations du sexisme et de la misogynie. En effet, il y a une volonté de mettre en lumière les obstacles rencontrés par les Berthe Morisot et Mary Cassatt pour montrer la continuité des luttes féministes et ainsi raffermir les liens entre les ascendantes et leurs héritières, de toute évidence aux prises avec les mêmes antagonistes.
Si Blais accorde une place prépondérante à ces femmes dont les accomplissements sont une source de fierté pour la postérité, elle n’hésite pas à explorer des héritages plus sombres. Dans Une réunion près de la mer (2018), par exemple, l’écrivaine retrace la vie d’Herta Oberheuser, une chirurgienne nazie condamnée pour avoir pris part aux expérimentations médicales menées au camp de Ravensbrück. Or, plutôt que de résumer brièvement le parcours d’Oberheuser, comme elle le fait pour Berthe Morisot et pour Mary Cassatt, Blais (2018 : 147-157; 204-211) épouse le point de vue de la chirurgienne, puis celui d’autres femmes complices de la Shoah (2018 : 157-162). Dans ces longs passages, où elle souligne à plusieurs reprises l’appartenance des bourreaux au genre féminin, l’écrivaine entre dans le détail des atrocités perpétrées et relate la genèse, somme toute banale, de ces figures à la fois terriblement cruelles et étrangement ordinaires. De prime abord, l’intégration de ces voix semble curieuse, étant donné l’attention accordée, dans le cycle Soifs, aux souffrances et à la mémoire des victimes. Ce choix narratif, pourtant, s’inscrit bien dans la démarche globale de l’écrivaine. Blais, rappelons-le, ne vise pas l’établissement d’une mémoire glorieuse. Elle ne prétend pas que l’histoire des femmes comprend exclusivement des personnalités héroïques, toutes plus féministes et militantes les unes que les autres. Au contraire, dans le récit qu’elle construit, l’écrivaine incorpore la mémoire de celles qui, comme Oberheuser, ont engendré la violence, perpétué l’oppression ou accédé aux hautes sphères du pouvoir aux dépens d’autres populations marginalisées. Par l’introduction de figures féminines aux solidarités et aux ambitions radicalement opposées, Blais évite le piège du manichéisme : elle ne réduit pas les femmes à des victimes ou à des martyres. Elle institue une mémoire où celles-ci bénéficient d’une représentation nuancée, où il y a une reconnaissance du rôle tantôt funeste, tantôt émancipateur qu’elles ont joué.
Diversifier les filiations
Dans le cycle Soifs, les figures historiques s’introduisent continuellement dans les discussions et le flux de pensées des personnages. Bien qu’elle participe manifestement d’une tentative de préserver différents pans de l’héritage féminin, cette démarche d’exhumation des modèles comporte un risque, soit celui de reconduire une forme de hiérarchie et de réinscrire les minorités dans la marge. Comme le souligne Collin (2014 : 95), la transmission intégrale du passé est un fantasme : « Il est déjà évident que de nos acquis, tout ne passera pas, que certains éléments auxquels nous avions attaché une valeur considérable se périment ou doivent être retransformés […] Ce tri de l’histoire, que la génération montante est déjà en train d’effectuer, est inévitable. » Dès lors, comment empêcher que les héritières, tenues de choisir et de reconfigurer, ne deviennent complices du patriarcat et ne condamnent au silence et à l’invisibilité les lignées de femmes et de féministes dont l’expérience diverge de la norme établie? Chez Blais, la solution passe par le recours à une pluralité de voix narratives : le cycle en compte près de 200 à la fin (2018).
Depuis la publication du premier tome, en 1995, plusieurs études ont relevé la forme polyphonique des romans du cycle. Pour Nathalie Roy (2007 : 168), l’oeuvre récente de Blais tient sa spécificité de la multiplicité des perspectives qu’elle présente, si bien qu’elle la qualifie de « représentation allégorique de l’universel ». Dans les articles qu’ils consacrent au cycle Soifs, Michel Biron (2010 : 38-39) et Stéphane Inkel (2011 : 97) abondent dans le même sens. Le premier soutient que le cycle est caractérisé par sa « manière d’assembler autant d’images hétérogènes de l’humanité souffrante », et le second, que « le dispositif polyphonique crée une communauté plurielle qui fait écho à la diversité de classes et d’origines de l’espace politique ». Si plusieurs ont montré en quoi cette stratégie contribue à « transporte[r] du côté de la lumière ceux que la société condamne à la noirceur » (Biron 2010 : 38), peu ont souligné le rôle qu’elle joue dans l’établissement d’une mémoire représentative de la diversité des expériences vécues par les membres des groupes marginalisés. Comme l’explique bell hooks (1984 : 43-44), les femmes n’affrontent pas toutes les mêmes épreuves : « The idea of “ common oppression ” [is] a false and corrupt platform disguising and mystifying the true nature of women’s varied and complex social reality. » Même si la communauté universitaire et la critique journalistique emploient des termes génériques (par exemple, les « victimes », les « opprimés », les « exclus ») pour désigner les personnages marginalisés du cycle – vu leur nombre, il est difficile de faire autrement –, ceux-ci ne forment pas un bloc monolithique. Pour cette raison, ils ne revendiquent pas tous le même legs.
Dans le cycle Soifs, Blais ne se contente pas de substituer une filiation à une autre. Elle oppose à l’hégémonie masculine une pluralité de voix et d’héritages dans l’objectif de sortir de l’oubli des figures historiques qui sont doublement, voire triplement marginalisées, car elles se trouvent à l’intersection de plusieurs systèmes d’oppression (Blais 1997 : 149-150) :
Leurs photographies dans les journaux étaient entourées d’un trait de cendres, elles étaient de retour dans ces limbes de la ségrégation, de l’oubli, où elles avaient toujours vécu, […] née en 1823, Mary Ann Schadd Cary avait été la première femme journaliste noire du continent nord-américain, elle avait publié au Canada le premier journal contre l’esclavage […], mais sous les visages de Mary Ann Schadd Cary, la première journaliste noire, comme sous les photographies de Crystal Bird Fauset, spécialiste des relations raciales en 1938, leader d’un parti démocratique à Philadelphie, ou d’Ida B. Wells Barnett, l’éditrice d’un journal pour la liberté d’expression, de Nina Mae McKinney, première actrice noire dans les théâtres de New York, d’Ida Gray, première femme chirurgien-dentiste noire à Cincinnati, pourquoi tous ces visages entourés d’un trait de cendres étaient-ils encore violentés au-delà de la mort, comme ils l’avaient été pendant leur vie, […] ces visages exigeaient que l’outrage fût réparé.
Mélanie et Renata ne sont pas les seules à tenter de préserver l’héritage féminin. Dans le cycle Soifs, plusieurs personnages issus de la communauté noire comme Vénus, Marie-Sylvie et Jenny, dont le flux de conscience est reproduit dans l’extrait ci-dessus, joignent leur voix à celles des femmes blanches. Leurs interventions se révèlent d’autant plus nécessaires qu’elles comblent les lacunes laissées par des protagonistes dont le statut social privilégié fait en sorte qu’elles ne sont pas toujours bien placées pour exposer la diversité des formes d’oppression ou pour mesurer l’importance des figures issues d’autres groupes marginalisés. Jenny le dit : « pour les Blancs », les héroïnes dont elle fait la liste ne sont « que des vestiges » (Blais 1997 : 149-150).
Dans l’extrait ci-dessus, le discours intérieur de la jeune fille remplit une double fonction. D’une part, il permet de dénoncer le traitement réservé par les Blancs aux femmes noires, dont l’oubli est comparé à un « retour dans [l]es limbes de la ségrégation ». Très forte, l’image choisie évoque à la fois un espace qui, dans l’univers de Blais, connote l’enfer[2] et une période extrêmement sombre de l’histoire américaine. Elle met ainsi en lumière la violence des entreprises de commémoration, toujours susceptibles de reproduire l’oppression dès lors qu’elles ne s’accompagnent pas d’une prise en considération des perspectives minorisées, mais aussi d’une remise en question de l’histoire officielle et des fondements épistémologiques qui guident sa construction. D’autre part, les propos de Jenny contribuent à réparer l’outrage subi. Comme Mélanie, elle inclut des données biographiques sur des personnages historiques féminins pour lutter contre leur effacement, mais sa démarche se distingue quelque peu de celle de son aînée. Contrairement à cette dernière, Jenny ne convoque pas des figures de proue du mouvement suffragiste (Emmeline Pankhurst) ou de la lutte contre le racisme aux États-Unis (Rosa Parks). Elle donne une seconde vie à des militantes qui ont ouvert le chemin à plusieurs générations de femmes noires, mais dont le nom n’est pas aussi connu malgré leur rôle pionnier. Les nombreuses figures évoquées, de même que la diversité des lieux dont elles sont issues, prouvent que le phénomène dénoncé par Jenny n’est pas isolé. En effet, l’extrait montre que le manque de reconnaissance dont souffre la communauté noire touche même des femmes actives dans des espaces historiquement considérés plus libéraux comme le Canada ou le Nord-Est américain. Il brise ainsi le mythe, bien ancré dans le récit national canadien, voulant que le racisme anti-noir sévisse principalement dans les États conservateurs du sud des États-Unis.
À l’évidence, les personnages du cycle Soifs ne sont pas tous habités par les mêmes préoccupations. Ils adoptent différentes perspectives sur les luttes féministes, dont ils permettent d’appréhender le renouvellement continu des enjeux et des tactiques. Dans Mai au bal des prédateurs, par exemple, Blais (2010 : 321) décrit la troupe de drag queens d’un talentueux directeur artistique prénommé Yinn. Défini par « sa céleste androgynie, sa parfaite ambiguïté », Yinn revendique un héritage queer dont il assure la transmission par l’intermédiaire du travail de mémoire qu’il effectue, mais aussi de sa pratique de drag queen. Yinn, en effet, ne se contente pas de tapisser le Saloon Porte du Baiser d’images de ses danseuses décédées (ibid. : 37-38) ou de célébrer « les noms de ses héros, héroïnes militantes, Del Martin, sa partenaire Phyllis Lyon, consacrant leur vie entière à ce combat acharné pour l’égalité de tous » (ibid. : 203). Il réitère leur critique de la société hétéronormative par la promotion qu’il fait d’une culture – le drag – dont la visée est notamment de contester la rigidité, voire l’existence même des catégories de sexe et de genre (Butler 2006 : 187). Sa présence dans le cycle, par conséquent, n’engage pas seulement une réflexion sur la convergence des mouvements queers et féministes ou sur leur lutte commune contre les rôles de genre. Yinn et « ses filles » (Blais 2010 : 63) montrent qu’il existe plusieurs manières d’assurer la continuité de l’héritage. Pour les artistes du Saloon Porte du Baiser, l’idée n’est pas uniquement de commémorer la mémoire des personnes qui innovent, qui ouvrent la voie : encore faut-il poursuivre les luttes dont elles sont les instigatrices.
Au sein de la troupe dirigée par Yinn, tous les membres n’adoptent pas les mêmes stratégies pour perpétuer la culture drag (Anctil-Raymond 2019 : 22-23). Herman, par exemple, performe à l’extérieur des murs du cabaret où ses collègues et lui se produisent tous les soirs : il « traverse toute la ville, dans ses bottes, sous ses perruques outrées, pour annoncer le spectacle » (Blais 2010 : 109), chose que Yinn désapprouve. De nature prudente, Yinn craint qu’Herman, « habitué à des années de vie de comédien à New York », soit attaqué par cette « foule dont il ne connaît ni la haine ni l’antipathie » (ibid. : 109) et préfère que ses filles travaillent au Saloon Porte du Baiser, là où il peut veiller sur elles. Lors du défilé organisé par Herman, où d’anciennes danseuses aux corps rongés par le sida sont invitées à parader « dans la rue, dans la dignité de leurs costumes de jadis » (ibid. : 209), Yinn reste sans cesse à l’affût du danger. Il admet, à la requête d’Herman, que le spectacle était « magnifique », mais il s’empresse aussitôt de demander à ceux et celles qui y ont pris part « de ne pas faire autant de bruit afin que les policiers ne se ramassent pas autour d’eux tous » (ibid.). La conscience aiguë de la menace posée par « cette humanité pourrie » (ibid. : 110) qu’Herman espère encore « ressusciter » (ibid. : 109) empêche Yinn de participer aux célébrations publiques que son ami organise. Si les romans illustrent des tensions au sein de la communauté queer, l’absence de consensus quant à la manière de célébrer le legs et de continuer la bataille contre le sexisme et l’homophobie ne dénote pas une fragilisation des liens de solidarité entre les personnages. Au contraire, comme l’explique Camille Anctil-Raymond (2019 : 24) dans son article consacré aux pratiques artistiques subversives de la troupe, les désaccords observés montrent plutôt que « le Saloon constitue […] un lieu où peuvent coexister des opinions et des idéaux divergents sans que les voix dissidentes ne soient muselées ou assimilées ».
La même chose pourrait être dite du cycle Soifs, où la diversité des points de vue est telle que les romans comportent même des voix narratives favorables au reniement de l’héritage. Si Mélanie est convaincue qu’« on ne peut pas vivre décemment sans la mémoire de ce qui s’est passé avant nous » et exige, de ce fait, que « [s]es enfants se souviennent de tout », d’autres, comme Esther, aspirent à « ne plus penser à toutes ces folies du monde » (Blais 2001 : 218). Chez Blais, la remémoration du passé est un processus douloureux, un sacrifice dont le pouvoir rédempteur n’est pas toujours assuré. L’observation du devoir de mémoire ne garantit pas le salut dans le cycle Soifs : pour cette raison, plusieurs personnages envisagent la possibilité que la connaissance historique ne soit « qu’un mal dont il faudrait se débarrasser » (Roy 2007 : 265). Dans cette perspective, la décision de « laiss[er] aux cercles de l’enfer du passé ce qui appartient au passé » (Blais 1997 : 262) ne doit pas être perçue comme un affront aux victimes, mais comme un geste de compassion envers les dépositaires de leur mémoire. En effet, par ces voix pour qui « il n’y a qu’aujourd’hui » (Blais 2005 : 239), le cycle reconnaît que le rejet partiel ou total de l’héritage n’est pas forcément une marque d’insolence ou d’indifférence. Il montre qu’une rupture avec le passé s’avère parfois nécessaire pour guérir et surmonter les traumatismes intergénérationnels. C’est là tout le tour de force du cycle Soifs : l’oeuvre présente à la fois des filiations diversifiées et des personnages dont le rapport au passé varie.
Conclusion
Pour reconstituer le legs des héritières, Blais fait appel à trois stratégies. D’abord, elle souligne les ruptures dans la filiation. Faute de pouvoir combler les innombrables vides laissés par l’histoire officielle, elle signale les absences. Plus précisément, elle dénonce le rôle du système patriarcal dans l’effacement de la mémoire féminine, système qu’elle accuse à la fois de minimiser la contribution sociale des femmes et de dissimuler la violence – physique et symbolique – perpétrée à leur endroit pour maintenir l’hégémonie masculine. Puis, afin d’éviter que d’autres femmes ne subissent le même sort, Blais procède à la création de traces et intègre, dans le flux de conscience de ses personnages, les données biographiques de figures historiques.
Cette préoccupation pour la survie des héritages féminins s’accompagne d’un souci de la diversité. Dans le cycle Soifs, l’écrivaine déploie une écriture polyphonique et fait intervenir un ensemble hétérogène de voix narratives. Bien entendu, aussi ambitieux soit-il, le projet romanesque de Blais a ses limites. Par exemple, quoiqu’il traite des tensions religieuses et raciales auxquelles les États-Unis sont en proie et que la tragédie du 11 septembre 2001 soit intégrée au récit dès le troisième tome, le cycle aborde peu l’expérience des personnes issues de la communauté islamique. Seuls Caridad et Lazaro, dont les apparitions sont rares et succinctes, sont de religion musulmane.
Cela dit, si les romans du cycle Soifs comportent des angles morts, il n’en demeure pas moins qu’ils proposent un autre principe d’écriture de la mémoire. En effet, Blais ne se contente pas de substituer le point de vue des femmes à celui des hommes. Elle ne se borne pas à changer le contenu des discours; elle renouvelle leur structure pour inclure une pluralité de voix et ainsi permettre l’avènement d’un régime mémoriel représentatif de la diversité des expériences et des héritages qui en découlent.
Parties annexes
Note biographique
Stéphanie Proulx est étudiante de troisième cycle en études françaises à l’Université de Toronto et travaille sous la direction de Barbara Havercroft. Elle prépare une thèse intitulée Vers une poétique du care : les représentations de la maladie dans les écrits contemporains des femmes en France et au Québec.
Notes
-
[1]
Le cycle Soifs est parsemé de « curiosités ononmastiques » (Roy 2011 : 104). Plusieurs personnages, comme Mélanie, Luc et Jacques, ont des prénoms à consonnance francophone alors qu’ils vivent aux États-Unis et sont anglophones. D’autres sont désignés par un prénom francisé, comme Brillant (Bryan), ou encore par un surnom dérivé d’un calque de l’anglais, comme Petites Cendres (Ashley). Les noms des lieux subissent le même traitement : la ville de Rosewood est appelée « Bois-des-Rosiers » (Blais 1997 : 194) et l’école secondaire de Columbine, l’« école de la Prairie » (Blais 2001 : 198). Roy (2011 : 104) émet l’hypothèse que « ces éléments ont […] la fonction d’irréaliser l’espace (américain?) et de dérégler le temps romanesque pour mieux nous reporter vers l’universel ».
-
[2]
Dans le cycle Soifs, Blais fait de très nombreuses références intertextuelles à l’oeuvre du poète italien Dante Alighieri, pour qui les limbes constituent le premier cercle de l’Enfer.
Références
- ANCTIL-RAYMOND, Camille, 2019 « Précarité, performativité, communauté. L’impulsion performative dans Mai au bal des prédateurs et quelques autres opus du cycles Soifs de Marie-Claire Blais », dans Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Séminaire « Lecture de Soifs (Marie-Claire Blais) ». Montréal, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises-Université de Montréal : 9-30.
- BEAULIEU, Julie, Adrien RANNAUD et Lori ST-MARTIN, 2018 Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes. Québec, Codicille éditeur.
- BIRON, Michel, 2010 « La compassion comme valeur romanesque : l’exemple de Marie-Claire Blais », Études françaises, 46, 1 : 27-39.
- BLAIS, Marie-Claire, 2018 Une réunion près de la mer. Montréal, Boréal.
- BLAIS, Marie-Claire, 2010 Mai au bal des prédateurs. Montréal, Boréal.
- BLAIS, Marie-Claire, 2008 Naissance de Rebecca à l’ère des tourments. Montréal, Boréal.
- BLAIS, Marie-Claire, 2005 Augustino et le choeur de la destruction. Montréal, Boréal.
- BLAIS, Marie-Claire, 2001 Dans la foudre et la lumière. Montréal, Boréal.
- BLAIS, Marie-Claire, 1997 Soifs. Montréal, Boréal [1re éd. : 1995].
- BUTLER, Judith, 2006 Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge [1re éd. 1990].
- CELLARD, Karine, et Martine-Emmanuelle LAPOINTE (dir.), 2011 Transmission et héritage de la littérature québécoise. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- COLLIN, Françoise, 2014 Anthologie québécoise 1977-2000. Montréal, Les éditions du remue-ménage.
- DEMANZE, Laurent, 2009 « Les possédés et les dépossédés », Études françaises, 45, 3 : 11-23.
- DION, Robert, 2020 « Venir après : filiation et héritage », dans Robert Dion et Andrée Mercier (dir.), La construction du contemporain : discours et pratique du narratif au Québec et en France depuis 1980. Montréal, Presses de l’Université de Montréal : 133-160.
- HOOKS, bell, 1984 Feminist Theory from Margin to Center. Boston, South End Press.
- INKEL, Stéphane, 2011 « Mémoire du présent : double dette et forme d’une politique à venir dans le cycle Soifs », Voix et Images, 37, 1 : 87-98.
- LEDOUX-BEAUGRAND, Évelyne, 2013 Imaginaires de la filiation : héritage et mélancolie dans la littérature contemporaine des femmes. Montréal, XYZ.
- PICH-PONCE, Eva, 2013 « La transmission de la mémoire dans les romans de Marie-Claire Blais », Conserveries mémorielles, 13, [En ligne], [journals.openedition.org/cm/1391] (24 mars 2022).
- ROY, Nathalie, 2011 « Narration et traitement des personnages : du visible à l’“ espace derrière ” dans le cycle Soifs », Voix et Images, 37, 1 : 99-112.
- ROY, Nathalie, 2009 « Retrouver la “ continuité de la mémoire du monde ”. Histoire et remémoration dans la trilogie Soifs, de Marie-Claire Blais », Cahier Figura, 21 : 23-36.
- ROY, Nathalie, 2007 De l’ironie romantique au roman contemporain : l’esthétique réflexive comme philosophie dans la trilogie Soifs de Marie-Claire Blais. Thèse de doctorat. Montréal, Université du Québec à Montréal.
- SAINT-MARTIN, Lori, et Ariane GIBEAU (dir.), 2014 Filiations du féminin. Montréal, Institut de recherche et d’études féministes, coll. « Agora ».
- VIART, Dominique, et Bruno VERCIER, 2005 La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Paris, Bordas.
- WOOLF, Virginia, 2014 A Room of One’s Own. London, Penguins Classic [1re éd. : 1929].

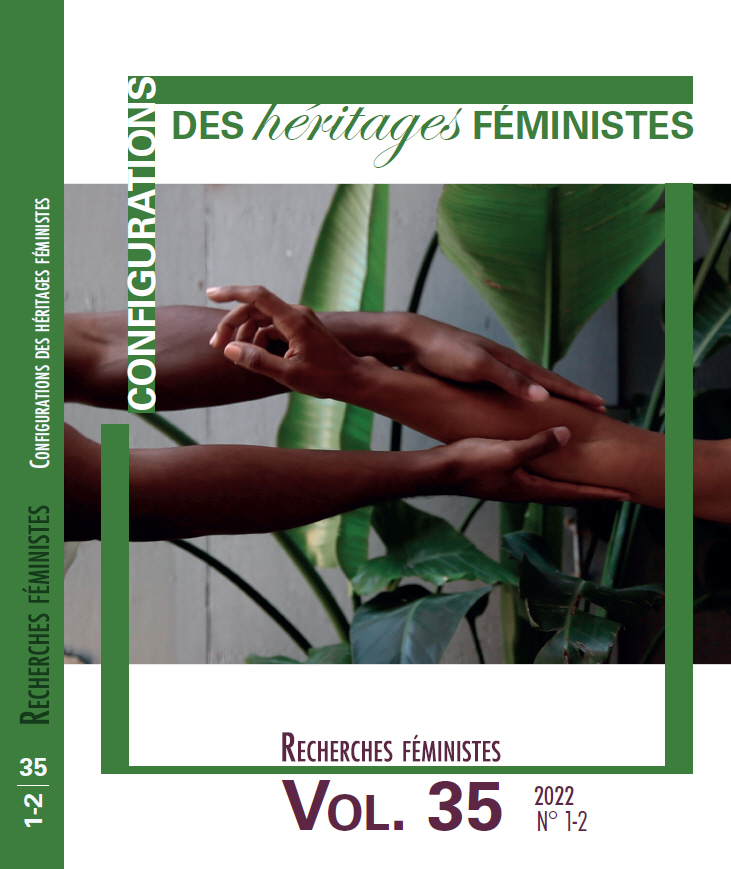
 10.7202/039814ar
10.7202/039814ar