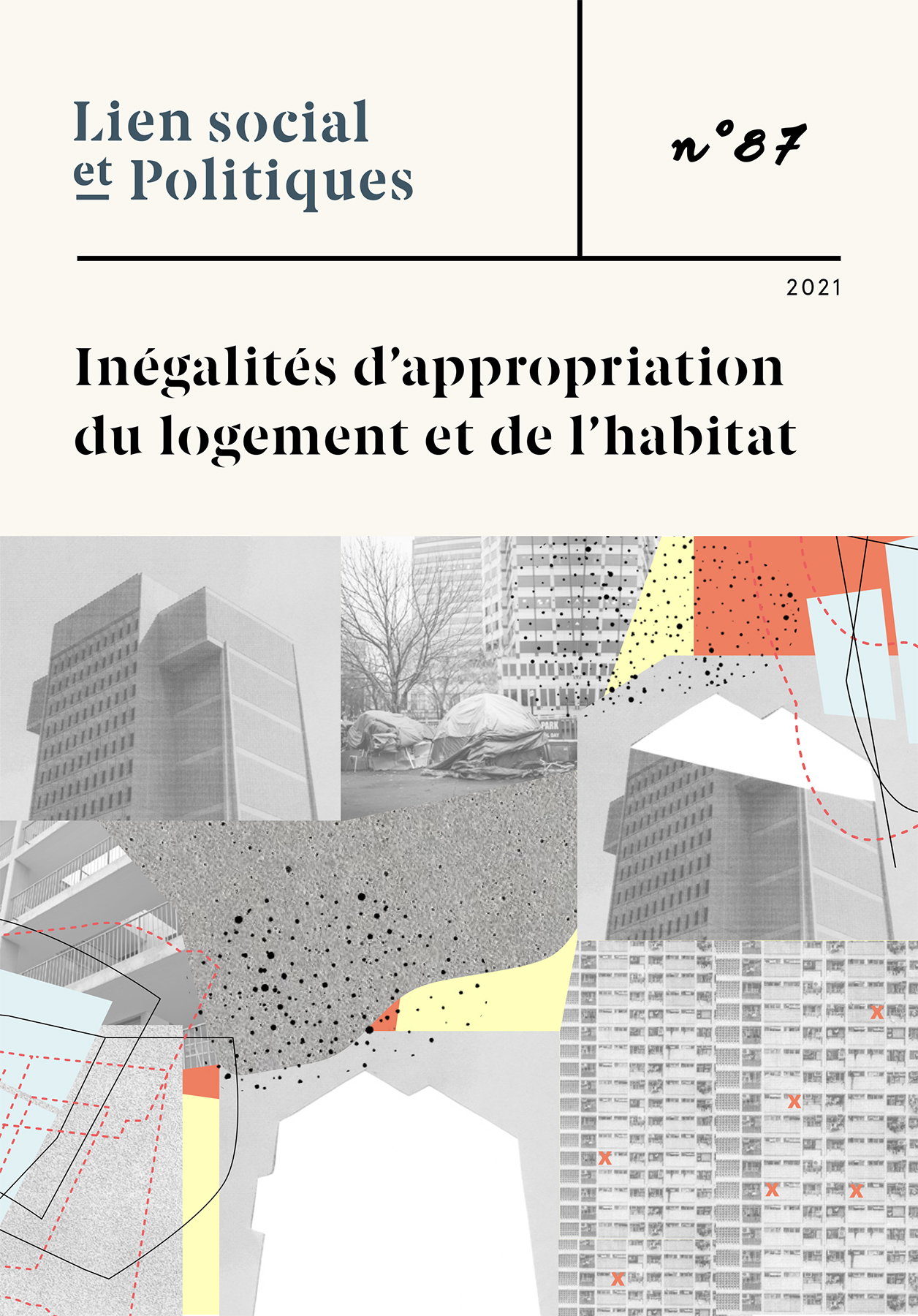Abstracts
Résumé
Le rééquilibrage territorial en matière de logement social s’est imposé depuis les années 2000 comme un nouvel outil de l’action publique pour lutter contre la ségrégation urbaine. Dans les grandes métropoles soumises au renchérissement des prix immobiliers, des logements sociaux sont construits au coeur des quartiers bourgeois où leur part est historiquement faible. À partir de trois sources de données (fichiers administratifs de relogement, recensements à l’échelle infracommunale, monographies de familles relogées), cet article livre une analyse quantitative et qualitative des modalités et des conditions d’insertion des ménages relogés dans les quartiers bourgeois parisiens. Les populations relogées se distinguent non seulement des populations résidantes par des écarts de niveaux de vie et par des différences d’origine (phénomène déjà bien documenté), mais aussi du point de vue de leur structure familiale et des normes de genre. Nombreuses à être relogées dans ces quartiers, les femmes à la tête de familles monoparentales se trouvent confrontées au modèle de la famille nucléaire stable, prépondérante dans ces arrondissements, qui contrarie leurs chances et leurs expériences d’insertion locale.
Mots-clés :
- logement social,
- politique de logement,
- ségrégation urbaine,
- structure familiale,
- normes de genre
Abstract
Since the 2000s, the objective of territorial rebalancing in terms of social housing has become a new tool of public intervention to fight against urban segregation. In large metropolises subject to rising housing prices, social housing is being built in well-off neighborhoods where its share is historically low. Based on three sources of data (administrative re-housing files, censuses on an infra-municipal scale, monographs of re-housed families), this article provides a quantitative and qualitative analysis of the modalities and conditions of integration of re-housed households in Parisian well-off districts. The re-housed populations are distinguished not only from the resident populations by differences in standards of living and origin (a phenomenon already well documented), but also by differences in family structure and gender norms. Women at the head of single-parent families, many relocated in these neighborhoods, are in reality confronted on a daily basis with the norm of the stable nuclear family, which is prevalent in these districts, and which thwarts their chances and experiences of local integration.
Keywords:
- social housing,
- housing policies,
- poverty,
- segregation,
- family structure,
- gender
Article body
Depuis les années 1990, la mixité sociale est devenue un référentiel central des politiques urbaines et du logement. Présentée comme un outil de lutte contre la ségrégation urbaine, elle justifie l’intervention de la puissance publique sur la répartition des groupes sociaux dans l’espace (Bacqué et Fol, 2006 ; Tissot, 2007 ; Launay, 2011 ; Desage, Morel-Journel et Sala Pala, 2014). Ces politiques de déségrégation territoriale ont d’abord été mises en oeuvre dans les quartiers anciens centraux (politiques de rénovation et requalification de l’habitat ancien) et dans les grands ensembles d’habitat social (politiques de démolition-reconstruction) pour rééquilibrer leur population in situ. En France, depuis la fin des années 2000, l’échelle d’intervention s’est élargie aux quartiers aisés des métropoles, en privilégiant la construction de logements sociaux en leur sein.
Sur la base d’une hypothèse — l’existence d’« effets de quartier[1]» (Gilbert, 2011 ; Sampson, 2019) —, les politiques de déségrégation oscillent entre deux types d’approches selon les pays et les orientations politiques : l’approche people, centrée sur le relogement des habitants en dehors des quartiers pauvres (dispersal), s’inscrit dans une tradition libérale visant à agir sur les trajectoires individuelles ; l’approche place privilégie le développement économique et social endogène des quartiers pauvres par des politiques d’infrastructures et d’équipement, et par le développement communautaire. En France, la promulgation de la Loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000[2] et la mise en place du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) en 2003 marquent un tournant dans la manière dont l’action publique entend intervenir sur la composition sociale des espaces disqualifiés et sur les dynamiques de pauvreté (Epstein, 2013). À l’objectif de diversification in situ de l’habitat et des statuts d’occupation, s’ajoute désormais l’idée d’une diffusion du logement social au sein des grandes agglomérations.
C’est dans ce cadre que la politique de rééquilibrage territorial en matière de logement social a vu le jour sur le territoire de Paris en 2001, à la suite de l’élection du maire socialiste Bertrand Delanoë. En 2014, avec l’élection d’Anne Hidalgo, cette politique se trouve dotée de nouveaux moyens et objectifs. Les programmes de logements sociaux doivent désormais être construits ou conventionnés prioritairement dans les arrondissements où le taux de logements sociaux est inférieur à 5 % : les VIe, VIIe, VIIIe et XVIe arrondissements de Paris (cf. carte 1). Ces arrondissements, dont les maires appartiennent aux partis situés à droite de l’échiquier politique, regroupent l’essentiel des « beaux quartiers » parisiens (Pinçon et Pinçon-Charlot, 1989 ; Préteceille, 2009) et possèdent les indices de ségrégation socioéconomiques les plus élevés de la capitale — indices en augmentation depuis deux décennies.
Carte 1
Les logements sociaux au titre de la Loi SRU à Paris en 2015
Paris est en effet marquée par l’accentuation des écarts de conditions de vie entre les deux extrémités de l’échelle sociale : paupérisation et spécialisation du parc d’habitat social[3] d’une part ; hausse des niveaux de revenus dans le haut de la distribution et concentration croissante des ménages les plus aisés dans l’espace résidentiel d’autre part (APUR, 2020). Le revenu des ménages a progressé de manière plus importante qu’à l’échelle régionale dans de nombreux quartiers qui comptaient déjà parmi les plus aisés en 2001 — c’est le cas des Ier, Ve, VIIe, VIIIe et IXe arrondissements. Ce contexte, qui laisse penser que l’écart entre le niveau de vie des populations relogées et celui des autres habitants des beaux quartiers se creuse, appelle à prolonger les analyses des politiques et les expériences de déségrégation.
Les recherches en sciences sociales se sont largement focalisées sur les écarts de niveaux et de styles de vie entre les catégories de populations, ainsi que sur les processus de racialisation dans les quartiers ciblés par les politiques de déségrégation (Chamboredon et Lemaire, 1970 ; Bacqué et al., 2011 ; Launay, 2014). Le relogement offre de meilleures conditions d’habitat que le parc locatif privé, où la hausse des prix a été la plus forte, mais il aboutit à la formation de frontières sociales et raciales à l’échelle du quartier, de la rue, voire de l’immeuble, qui compromettent les processus d’insertion locale (Launay, 2011). En outre, les populations relogées sont exposées à des situations de « surclassement résidentiel » (Dietrich-Ragon, 2013) produites par un statut social qui semble ne pas être « à la hauteur » du nouveau statut résidentiel, l’expérience quotidienne de l’écart des niveaux de vie tendant à générer un sentiment persistant de « ne pas être à sa place ».
Sans évacuer la question des rapports sociaux de classe et de race, qui sont très largement imbriqués, cet article propose un nouvel éclairage des politiques de déségrégation territoriale en analysant la manière dont les différences de structures familiales et de normes de genre conditionnent le rapport au quartier. D’un côté, les beaux quartiers parisiens sont marqués par la prégnance des normes familiales traditionnelles (Lenoir, 2003). De l’autre côté, les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les ménages logés en HLM par la politique municipale (Loones, 2010). Nous faisons donc l’hypothèse qu’au-delà des rapports de classe et de race, ces différences de structures familiales contribuent de manière centrale à la stigmatisation des femmes vivant seules avec des enfants. Pour ce faire, nous nous focalisons sur les trajectoires et expériences de relogement de ménages dans le cadre de la politique de déségrégation territoriale de la Ville de Paris en accordant une attention particulière aux mères de familles monoparentales. Figures historiques de la déviance sexuelle et morale (les « filles-mères »), puis des populations « vulnérables » visées par l’État social (Lefaucheur, 1991), ces femmes sont plus fortement exposées que les autres relogés aux interactions avec les familles bourgeoises, notamment sur la scène scolaire. Dans le même temps, alors que l’accès à la parentalité constitue une voie privilégiée d’accès à la respectabilité des femmes en milieu populaire (Masclet et al., 2020), du fait notamment de l’effritement et de la dégradation des conditions d’emploi des moins qualifiées, elles se trouvent au contraire confrontées, dans les quartiers bourgeois, à la remise en question de leur statut de mère : ce qui était considéré comme une ressource symbolique devient un stigmate.
Ainsi, après avoir caractérisé les populations relogées dans les beaux quartiers et souligné leurs spécificités au regard des populations locales, nous analyserons l’expérience des femmes avec enfants, qui sont le plus souvent en situation de monoparentalité, en nous intéressant tout particulièrement à leurs difficultés d’insertion sur la scène scolaire.
1. Ménages relogés et habitants des quartiers bourgeois : des populations et des espaces doublement atypiques
La comparaison des données infracommunales du recensement et des données de la DRIHL sur le relogement permet d’objectiver le phénomène de double écart morphologique qui caractérise la situation des ménages relogés : celui qui distingue les locataires relogés des habitants des arrondissements bourgeois dans lesquels ils sont placés, d’une part ; celui qui distingue les habitants des beaux quartiers du reste de la population de Paris, d’autre part. Considérer ces deux dimensions simultanément permet d’appréhender l’ampleur de la distance sociale qui sépare les deux groupes de populations mis en présence par les politiques de relogement, du point de vue sociodémographique, mais aussi au regard du rapport au logement et à l’espace.
1.1. Ménages relogés et ménages bourgeois : deux populations singulières
La population des ménages relogés, comme celle des habitants des beaux quartiers, se distingue tout d’abord par sa structure et ses ressources (voir tableau 1). Les relogés et, plus encore, les familles monoparentales sont en moyenne moins âgés que les ménages parisiens et, a fortiori, que ceux des beaux quartiers. Ils ont moins fréquemment à leur tête une personne de référence âgée de plus de 55 ans, alors que c’est l’inverse pour les habitants des beaux quartiers (dans le XVIe arrondissement, la part des ménages de plus de 55 ans représente par exemple plus du tiers des ménages). La part des différentes catégories socioprofessionnelles des habitants des beaux quartiers est également atypique, avec une nette surreprésentation des cadres et des professions intellectuelles supérieures du secteur privé, relativement à la moyenne parisienne. Le niveau des revenus des ménages relogés apparaît très inférieur à celui des habitants des beaux quartiers : leur revenu fiscal médian est ainsi près de deux fois inférieur à la moyenne parisienne (18 500 euros contre 30 340 euros), qui est elle-même largement inférieure à celle des résidents des quatre arrondissements déficitaires en logement social (44 196 euros).
Tableau 1
Âge, revenu fiscal et nationalité des ménages
La population des beaux quartiers se distingue en outre par la structure de ses revenus, marquée par l’importance des revenus du patrimoine dans les ressources des ménages (qui représentent 19 % de ces ressources contre seulement 4 % chez les ménages résidant dans les arrondissements populaires où le taux de logements sociaux dépasse 10 % – les XIIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements).
Outre l’âge et les ressources économiques, les ménages relogés se différencient également par leur origine. En effet, 25 % des ménages relogés (et, parmi eux, 31 % des familles monoparentales) sont de nationalité étrangère (et, dans l’immense majorité des cas, de nationalité extra-européenne), un pourcentage nettement supérieur à la moyenne parisienne et à celle des beaux quartiers. Certes, les étrangers ne sont traditionnellement pas absents des beaux quartiers parisiens, comme en témoigne la présence de la communauté espagnole dans le XVIe arrondissement, mais cette dernière est souvent liée à des rapports d’employés/employeurs et implique une ségrégation résidentielle verticale, marquée par l’installation des employés dans des chambres de bonnes ou dans des loges de concierges (Taboada-Leonetti, 1987). La présence étrangère dans le XVIe arrondissement est aussi liée aux migrations aisées nord-américaines, australiennes et néo-zélandaises, très éloignées des ménages immigrés relogés (Préteceille, 2009).
Enfin, les différences de composition des ménages accentuent la ségrégation sociale observée, en creusant les écarts de niveaux et de styles de vie. En effet, les centres-villes sont devenus le lieu privilégié des ménages de petite taille (célibataires, divorcés, veufs), et les banlieues et communes périurbaines, le refuge dominant des familles avec enfants. Or, les beaux quartiers parisiens et, spécifiquement, le XVIe arrondissement abritent au contraire une part importante de couples avec enfants en leur sein. Le tableau 2 montre la sous-représentation des familles monoparentales au sein de la population des beaux quartiers et, inversement, leur surreprésentation parmi les ménages relogés. Les familles monoparentales représentent près d’un ménage relogé sur quatre[5] alors qu’elles ne constituent que 6,5 % des ménages résidant dans les beaux quartiers et 8,3 % des ménages à l’échelle de Paris.
Tableau 2
Composition familiale des ménages relogés et parisiens en 2016 (en %)
Plusieurs indicateurs statistiques révèlent enfin la prégnance d’une « morale familiale traditionnelle » dans les espaces bourgeois (Lenoir, 2003), caractérisée par le primat de la vie en union stable et cohabitante, par l’importance de la parentalité, ainsi que par une relative spécialisation fonctionnelle des rôles féminins et masculins au sein du couple. En effet, lorsque l’on compare le statut matrimonial des personnes de 15 ans ou plus à Paris et dans le XVIe arrondissement, on observe que 44,3 % des habitants du XVIe sont mariés contre seulement 32,7 % des Parisiens. Dans le même temps, l’emploi féminin y apparaît moins élevé qu’ailleurs alors même que les femmes sont plus diplômées : 62 % des femmes du XVIe arrondissement sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, mais leur taux d’emploi est plus faible que la moyenne féminine parisienne[6] (61,5 % dans le XVIe en 2016, contre 66,5 % à Paris). En revanche, le taux d’emploi des hommes est similaire dans le XVIe et à Paris, confirmant l’hypothèse d’un rapport à la norme d’activité professionnelle féminine différent dans cet arrondissement.
Ainsi, la particularité des ménages relogés s’ajoute à celle des arrondissements bourgeois par rapport au reste du territoire parisien, et contribue à creuser les écarts.
1.2 Le fort ancrage résidentiel des habitants des beaux quartiers
Les modes d’inscription territoriale des habitants des quartiers historiques de la bourgeoisie parisienne constituent une autre dimension susceptible d’affecter l’insertion locale des ménages relogés. En effet, dans les quatre arrondissements étudiés, la part des résidences principales occupées par des propriétaires atteint 40 % (45 % dans le XVIe), contre 33 % à l’échelle de Paris. En outre, les habitants des beaux quartiers se caractérisent aussi par un fort ancrage résidentiel. L’écart d’ancienneté résidentielle entre les propriétaires occupants et les locataires du parc social est bien plus fort dans ces arrondissements bourgeois que dans les quatre arrondissements les plus populaires de la capitale (XIIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements, dont le taux de logement social dépasse 10 %). Dans les premiers, les propriétaires restent en moyenne 20 ans dans leur logement, contre 10 ans pour les locataires du parc social. Dans les arrondissements populaires, l’ancienneté moyenne des propriétaires dans leur logement est de 17 ans et de 15 ans pour les locataires du parc social. En d’autres termes, dans les beaux quartiers, les écarts de mobilité résidentielle entre propriétaires et locataires HLM sont nettement plus marqués que dans les quartiers populaires. L’ancrage résidentiel des classes supérieures dans les beaux quartiers a été bien documenté par les travaux de sociologie urbaine, qui ont montré comment celui-ci répondait à des logiques de transmission du patrimoine immobilier au sein des lignées, à des stratégies familiales de reproduction sociale, et étaient nourris plus récemment par l’intensification de la compétition scolaire (Pinçon et Pinçon-Charlot, 1989 ; Pfirsch, 2011 ; Oberti, 2007). L’ancienneté résidentielle des habitants façonne en retour le sentiment d’être chez soi et rend plus légitime le contrôle exercé sur autrui, en particulier sur les nouveaux venus.
La singularité des beaux quartiers nous conduit ainsi à prendre en compte les écarts multiformes qui séparent les ménages relogés des habitants de ces espaces. En dépit de leurs différenciations internes, les arrondissements bourgeois apparaissent comme des espaces résidentiels de plus en plus à part dans la métropole parisienne en raison de la concentration croissante du patrimoine dans ces secteurs. Sur place, les relogés se trouvent confrontés à des résidents installés de longue date, qui entretiennent des liens d’interconnaissance et ont des styles de vie en décalage avec les leurs. Le stigmate de la monoparentalité vient alors s’ajouter à autres formes de mises à l’écart.
2. Expériences minoritaires : faire face à la morale familiale des beaux quartiers
Les familles, en particulier monoparentales, sont surreprésentées parmi les ménages relogés. Ayant le plus souvent à leur tête des femmes, elles constituent un public cible des politiques de relogement, ce qui n’est pas surprenant au regard de la centralité historique des mères célibataires dans la construction et les transformations de l’État social (Lefaucheur, 1991 ; Castel, 2009). L’analyse de leur expérience permet de mettre au jour un pan peu documenté des dynamiques d’intégration/exclusion urbaine : la manière dont les différentes formes d’écart dans les structures familiales et les normes de genre dominantes au sein de l’espace local (ici caractérisées par la division sexuée du travail domestique, la parentalité intensive, la conjugalité cohabitante durable) jouent dans les processus d’intégration. Ces normes familiales, qui régissent l’accès à la respectabilité des beaux quartiers, s’éprouvent plus fortement dans le cadre de l’espace scolaire, autour duquel nous avons décidé de concentrer nos analyses.
2.1 L’école comme lieu de confrontation aux normes familiales
Les familles monoparentales relogées, essentiellement des femmes, présentent plusieurs spécificités. Elles sont dans une situation économique encore plus précaire que les autres ménages relogés (comme nous l’avons vu dans le tableau 1). En outre, les femmes enquêtées ont en commun d’occuper une position subalterne sur le marché du travail en raison de leur statut d’emploi plus souvent précaire ou non déclaré, l’importance du temps partiel et les horaires atypiques. La plupart travaillent en effet dans le secteur des services à la personne (comme aides à domicile, femmes de ménage, gardes d’enfants, etc.) et aux entreprises (agentes d’entretien et de nettoyage, etc.). Une fraction plus faible de femmes rencontrées, seules ou à la tête de familles monoparentales, appartient aux petites classes moyennes salariées et occupe des emplois de secrétaires administratives, d’assistantes de direction, etc. Nombre d’entre elles, enfin, sont issues de l’immigration extra-européenne ou appartiennent à des minorités ethnoraciales. Ainsi, dans le VIIIe arrondissement, les femmes relogées sont toutes de nationalité étrangère et originaires du continent africain (Algérie, Tunisie, Mali, Guinée et Sénégal).
Au-delà de l’expérience minoritaire liée à leur statut social subalterne et à leur origine étrangère, plusieurs femmes relogées dénoncent au cours de l’entretien le stigmate qui pèse sur leur condition de mère célibataire : les mères de famille qui ne cohabitent pas avec leur conjoint, de manière régulière ou occasionnelle, ou qui sont séparées de leur ancien compagnon, se sentent soupçonnées d’un faible investissement éducatif et affectif envers leurs enfants, comme l’illustre le cas de Karine. Âgée de 43 ans, ancienne infirmière en invalidité qui, à la suite de son divorce, a dû quitter l’appartement familial du XVIe arrondissement transmis à son mari, Karine a été relogée par un Office HLM public d’aménagement et de construction (OPAC) dans un trois-pièces de l’arrondissement, où elle vit aujourd’hui seule avec ses deux filles. Attentive à son apparence (entretien du corps, maquillage, habillement), elle ne supporte pas de se voir dénier l’accès à certaines formes de respectabilité auxquelles elle a pu être habituée lors de sa précédente vie quand elle était en couple. Le mépris de classe se combine avec la suspicion d’être une mauvaise mère :
C’est pesant ce regard des commerces et des habitants. On vous regarde comme une bête curieuse. On n’essaie pas de savoir ce qu’il y a derrière, on vous met une étiquette « OPAC égal cas social ». […] Oui, je suis divorcée et seule avec mes filles, mais j’ai une vie. Les gens nous regardent de haut. J’ai appris jusque chez ma pédicure qu’on était des indigents. Les gens du quartier ont fait un scandale ! Je n’apprécie pas du tout, c’est injustifié ! On n’a pas à vous juger parce qu’il y a écrit OPAC devant la porte. Ça me dérange qu’il y ait écrit OPAC, les gens disent que ce n’est pas normal qu’on habite ici, ils n’ont pas d’argent et ils prennent la place des riches. Ça nous pénalise parce que même bon, à l’école, j’ai entendu dire qu’on était des cas sociaux[7] !
Karine, infirmière en invalidité, mère de deux enfants
Ce sentiment de stigmatisation se nourrit également des interactions quotidiennes tendues avec certains voisins pour lesquels l’absence visible de pères jette le discrédit sur ces mères. Ali, expert-comptable à la retraite, blâme sa voisine du dessus dont le mode de vie, qu’il juge trop bruyant, serait lié à son incapacité supposée à prendre en charge seule ses enfants :
La voisine du dessus, là, maintenant, elle est seule avec deux enfants parce qu’elle a encore accouché l’année dernière. Il n’y a pas de père, elle ne travaille pas et il n’y a pas de père, comment voulez-vous que ça fonctionne ?! Pfff. […] Son bébé, il crie tout le temps, il crie même à deux heures du matin. Pourquoi un bébé crie à deux heures du mat ? C’est pas normal, c’est que le bébé, il n’est pas propre ou il a faim, on ne s’occupe pas bien de lui, c’est pour cela qu’il crie. Et son autre enfant de cinq ans, il fait aussi du bruit. Sa chambre est au-dessus de la mienne, je ne sais pas ce qu’il fait le matin, il tape, je ne sais pas, il fait un bruit, c’est fou, on dirait qu’il déménage sa chambre. Mais quand on s’habille, on ne fait pas autant de bruit ! Je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais il ne comprend pas, il continue.
Ali, expert-comptable à la retraite, marié et père de trois enfants
Le discrédit jeté sur les mères célibataires se cumule à celui lié à l’étiquette de « locataire HLM » ou « cas social ». Entre attitudes de retrait et processus de mise à l’écart, les interactions quotidiennes semblent alors réduites à leur expression minimale (« bonjour-bonsoir »). Les familles relogées sont aussi exclues des cercles fermés des familles bourgeoises (elles ne sont ainsi jamais invitées au domicile de ces dernières, ni dans les centres de loisirs privés, etc.) Les femmes seules avec enfants sont particulièrement visées par ces exclusions. Elles perçoivent explicitement leur situation familiale comme un facteur de mise à l’écart.
Parmi l’ensemble des scènes sociales où s’éprouve l’indignité des familles relogées, en particulier pour les femmes célibataires avec enfants, la scène scolaire occupe une place centrale. Le dispositif de sectorisation scolaire constitue un des leviers utilisés par de nombreuses collectivités locales pour promouvoir ou, à l’inverse, limiter les situations de « mixité sociale » (Oberti, 2007). Dans la partie sud du XVIe arrondissement, où de grandes opérations de logements sociaux ont vu le jour, la municipalité, qui détient la compétence de sectorisation pour le niveau primaire, tenterait, selon les familles relogées, de limiter leur insertion en les concentrant dans une même école publique, pourtant plus éloignée de leur domicile. Caroline, mère de deux enfants, employée dans un grand magasin en CDI (contrat à durée indéterminée), logée par le 1 % patronal, et qui n’avait auparavant jamais vécu dans un logement social, fait part de ce sentiment de discrimination institutionnelle :
L’école est très loin, ça, c’est un fait exprès du maire. […] La sectorisation des écoles primaires est décidée par la municipalité. Il y a une volonté de Goasguen (Mairie du XVIe arrondissement) de regrouper socialement et de freiner la mixité. […] Les personnes qui vont dans cette école sont souvent défavorisées, elles ont une moins bonne maîtrise de la langue. C’est une volonté claire et affichée.
Caroline, employée de commerce, mère de deux enfants
Quels que soient les modes d’aménagement de la carte scolaire, l’école reste pour les familles relogées à la fois le lieu de la découverte de la grande bourgeoisie (qui continue pour partie de scolariser ses enfants dans le secteur public) (Poupeau et François, 2008 ; Merle, 2011), et celui de l’apprentissage des écarts de classe. Dans ces arrondissements ségrégés, où les adultes sont fortement mobilisés dans la reproduction du statut social familial, l’école fait l’objet d’un investissement intense. Son caractère collectif et organisé (par le biais d’associations notamment) renforce le sentiment d’infériorité des familles relogées et rend plus difficiles encore les stratégies interindividuelles de rapprochement social. Qu’elles soient élues aux conseils d’administration ou aux conseils d’école, qu’elles soient membres des associations de parents d’élèves, qu’elles occupent des postes clés dans les réseaux d’anciens élèves, financent les activités culturelles de l’établissement, les familles établies sont en effet très présentes dans la vie de l’école. Le marquage social de l’école apparaît aussi, dans les récits d’entretien, à travers l’aménagement des lieux (la galerie de portraits, l’annuaire des anciens élèves, la stèle sur les monuments aux morts rappellent par exemple le patronyme des lignées importantes) ou encore dans les modes d’interaction avec le personnel éducatif (certains directeurs d’établissement ont pu suivre, en raison de l’ancrage résidentiel des familles, certains ascendants d’élèves actuels). Quoique minoritaires au sein des établissements, les parents mobilisés dans l’institution scolaire, qui sont également souvent très insérés dans l’espace local, « donnent le ton » et peuvent contribuer, indirectement ou directement, par leur hexis corporelle, leur omniprésence et leurs rappels à l’ordre, à l’exclusion des nouveaux venus.
Or, l’école constitue le premier point d’entrée dans le quartier des ménages nouvellement installés. C’est dans l’enceinte scolaire que les familles relogées engagent les premiers contacts avec les habitants du quartier et qu’elles font l’expérience déroutante de la forte présence des parents d’élèves les plus aisés et les plus insérés localement. Nadia, une assistante maternelle âgée de 47 ans, de nationalité marocaine, qui élève seule ses deux garçons, témoigne de ce sentiment de rejet de la part des familles du quartier, même si elle cherche à l’euphémiser comme pour mieux s’en protéger :
Pour l’instant moi, je ne connais pas encore de familles dans le quartier. On a eu des réunions à l’école, avec les autres parents d’élèves, bon pour l’instant, ils sont réticents, ils me regardent […]. Ils ne me parlent pas. Vous savez, moi, je suis maghrébine, je suis toute seule avec mes enfants, alors bon ils ne viennent pas vers moi, mais j’espère que ça viendra, il faut un peu de temps pour connaître les autres, ils vont s’habituer…
Nadia, assistante maternelle, mère de deux enfants
Pour cette mère, dont l’immeuble dans lequel elle louait un minuscule appartement insalubre a été frappé d’un arrêté de péril, la déception est d’autant plus grande qu’elle voyait en ce changement de lieu de vie une opportunité, pour elle et pour son fils, de nouer de nouvelles relations sociales. Karine, dont le cas a été évoqué précédemment, ne décolère pas face au mépris dont elle s’estime victime et envisage même de changer d’établissement scolaire :
La mienne [ma fille] est à l’école là, elle a changé d’école quand on est arrivés et ils ne sont pas gentils avec elle, pas vraiment, ils se moquent d’elle. Elle voulait aller en seconde ici, mais c’est hors de question ! Elle ira à la Légion d’honneur. On a rendez-vous bientôt. Je suis désolée pour les gens du quartier qui la verront passer en uniforme le vendredi. J’espère que ça va les remettre un peu à leur place ! Voilà ! Ils nous jugent comme des cas sociaux, c’est vrai. À l’école, ils se demandent combien se sont inscrits dans l’école. La question a été posée. C’est bizarre ! On a une étiquette, on est différents, on est des cas sociaux.
Karine, infirmière en invalidité, mère de deux enfants
À la différence des immigrés espagnols (Taboada-Leonetti, 1987) ou des prostituées (Geay, 2015) du XVIe, dont la présence dans le quartier était liée à des liens de subordination économique, certaines femmes relogées rejettent l’injonction à l’auto-invisibilisation qui pèse sur les dominés dans ces espaces résidentiels. Elles semblent toutefois peu nombreuses et beaucoup d’entre elles optent plutôt pour la discrétion.
L’intégration des parents dans les réseaux scolaires et périscolaires peut dès lors se révéler plus ou moins difficile selon les configurations résidentielles locales (lieu d’implantation dans l’arrondissement, densité des programmes de logements sociaux dans le voisinage) et les effets d’établissement (composition sociale des écoles, sensibilité politique des professeurs). Tandis que les contours de la sociabilité enfantine débordent de ceux de leurs parents (Rivière, 2017), les obstacles à l’établissement d’une sociabilité franchissant trop ostensiblement les frontières de classe apparaissent nombreux : rappel à l’ordre des parents, contrôle des invitations (anniversaires, goûters), choix d’activités périscolaires distinctives, parfois basées sur la revendication de différences culturelles, linguistiques ou religieuses, naturalisées. À cela s’ajoutent les contraintes professionnelles de nombreuses mères relogées, aux horaires de travail non standards, qui contribuent à les rendre peu visibles sur la scène scolaire, par exemple le matin ou en fin de journée.
2.2 Vers de nouvelles sociabilités d’entraide ?
Si l’invisibilité des ménages populaires dans les quartiers de classes supérieures conjugue des formes actives d’exclusion et des stratégies d’évitement (Pattillo, 1999 ; Elguezabal, 2015), les conditions d’emploi différenciées produisent également des effets propres sur les formes de coprésence dans l’espace local. L’invisibilité des femmes relogées dans le quartier, en particulier leur absence des formes ritualisées de la vie scolaire (entrées et sorties d’école, sorties de classe, carnaval, etc.), tient en effet également à la nature spécifique des emplois qu’elles occupent et à l’importance des horaires non standards de travail[8] (Létroublon et Daniel, 2018). Elles exercent des métiers d’exécution, et travaillent plus fréquemment tôt le matin, le week-end ou au rythme d’horaires fragmentés leur offrant peu de marges d’ajustement en cas d’imprévu. Leur situation contraste ainsi fortement avec celle des cadres et des salariés qualifiés (Pailhé et Solaz, 2009), surreprésentés dans les arrondissements bourgeois de Paris, dont l’autonomie d’horaire permet d’être présents aux événements de la vie scolaire jugés importants (conseil de classe, fête, etc.).
Moins en phase avec les rythmes sociaux ordinaires définis par l’école et les grandes institutions, ces femmes modestes ont souvent perdu, dans les beaux quartiers, la proximité avec la « famille-entourage locale », alors que cette dernière joue un rôle fondamental dans la gestion de la vie quotidienne (Schwartz, 1990 ; Bonvalet, 2003). Plus isolées, elles font alors face à de nouvelles difficultés organisationnelles qui pèsent sur l’articulation des temps de vie. Leurs ressources financières limitées empêchent d’externaliser le travail de garde (assistante maternelle, nourrice, baby-sitter, etc.), tandis que les horaires des structures collectives de garde (crèches municipales ou associatives) sont peu compatibles avec le travail en horaires décalés et l’irrégularité des cycles.
Dans les immeubles sociaux des beaux quartiers, les liens tissés avec d’autres locataires permettent toutefois de réaménager des formes d’entraide et de réassurance. Ces relations de voisinage s’établissent souvent selon des critères d’origines géographiques et s’appuient directement sur l’expérience commune du stigmate dans l’espace local. Il en va ainsi des échanges de bons procédés entre Fatoumata (âgée de 30 ans, de nationalité malienne, sans emploi et vivant seule avec ses 3 enfants, expropriée de son logement du XVIIIe arrondissement) et sa voisine Mariam (âgée de 31 ans, femme de ménage non déclarée, également de nationalité malienne, mariée et mère de trois enfants, qui a vécu avec sa famille dans un squat du XVIIIe arrondissement). Mariam peut compter sur la première pour les sorties d’école :
Mes enfants, ils vont à l’école du quartier, sauf la dernière qui est trop petite, elle reste avec moi. Moi, je suis au travail très tôt, et j’y vais aussi le soir. C’est les autres mères africaines qui les emmènent quand mon mari part au travail tôt. Il s’occupe d’eux et les laisse à la voisine d’à côté (Fatoumata) qui les emmène. Il y a aussi les parents de la famille de dessus, ils viennent à l’école. Le soir, c’est lui qui revient avec eux et avec les autres voisines des fois. [Vous vous arrangez à cause des horaires de travail ?] Oui, je peux pas rester avec eux le matin et aller à l’école, et la nounou c’est trop cher. Ma voisine, elle veut bien m’aider et mon mari aussi l’aide. Il l’aide pour les papiers, pour l’internet et le téléphone.
Mariam, femme de ménage, mariée avec trois enfants
Mariam travaille en horaires décalés et de manière discontinue au cours de la journée, ce qui la contraint à se rendre très tôt le matin et en fin d’après-midi dans le quartier de la Défense, loin de son domicile. Les amitiés tissées entre certains enfants du voisinage permettent de faire le lien entre l’école et la maison, par exemple lorsqu’un enfant est malade. Amira, mère d’un nourrisson, qui vit dans un logement devenu exigu avec sa mère et son jeune frère, regrette que seule une camarade de classe, résidant aussi dans l’immeuble HLM, accepte de lui transmettre les devoirs de son frère : « C’est bien, on demande les devoirs quand il est malade, mais c’est juste avec elle, parce que sinon, personne ne vient donner les devoirs. » (Amira, sans emploi, mère d’un enfant)
Ces arrangements quotidiens restent cependant relativement fragiles tant ils reposent sur la bonne entente entre voisins, toujours réversible, et qu’ils sont soumis aux aléas de l’organisation du travail salarié, sur laquelle les résidents ont peu de prise.
Conclusion
Alors que la ségrégation urbaine continue d’être majoritairement appréhendée dans le débat public à partir des quartiers populaires et des grands ensembles d’habitat social (Wacquant, 2006 ; Gilbert, 2011), les dynamiques d’entre-soi apparaissent en réalité particulièrement prégnantes dans les beaux quartiers. La politique de déségrégation territoriale de l’offre de logement social qui se développe à Paris, à la suite d’autres métropoles nord-américaines, conduit ainsi les familles relogées à faire l’expérience d’un double écart qui ne se limite pas aux domaines des inégalités de revenus ou des styles de vie, ni à l’expérience de l’altérisation raciale, mais qui se joue également sur le terrain des structures et des normes familiales.
Les beaux quartiers parisiens se distinguent par la surreprésentation statistique et la prééminence symbolique des familles traditionnelles (marquées par des formes spécifiques de conjugalité et de parentalité), qui agissent comme un facteur d’exclusion des ménages relogés qui dérogent à ces dernières. De ressource symbolique et pratique dans les quartiers populaires, la maternité peut ainsi devenir un stigmate lors de l’installation dans ces espaces bourgeois, en particulier pour les femmes élevant seules leurs enfants, ou pour celles dont les conjoints masculins sont absents ou invisibles au quotidien. Pour les ménages relogés, l’expérience des écarts de conditions et de styles de vie n’est en effet pas sans conséquence. Elle inscrit les populations dans des jeux de classement et d’autoclassement qui contribuent à façonner la perception de la place occupée par chacun dans la hiérarchie sociale : « les catégories les moins favorisées peuvent se trouver dans une situation encore plus précaire où le rapprochement et la confrontation avec des groupes plus favorisés nourrissent le sentiment de relégation et l’impression de n’être pas à la hauteur des exigences du logement nouveau » (Chamboredon et Lemaire, 1970 : 22). Elle semble aussi favoriser une interprétation individualisée des écarts de styles de vie, plus rarement pensés en termes d’inégalités structurelles. Le discours de la « bonne » et de la « mauvaise » parentalité l’emporte en effet très souvent sur la critique des inégalités de conditions, et la morale familiale agit finalement comme un vecteur efficace de naturalisation de l’ordre social.
D’autres enquêtes longitudinales devraient permettre de saisir l’évolution à plus long terme des trajectoires des ménages relogés et les éventuels effets de lieu qui pourraient produire un changement dans leurs aspirations scolaires ou encore les conduire à nouer des relations avec des personnes issues de familles plus aisées qui participeraient à la formation d’un capital social local. De telles données restent encore trop rares à l’heure actuelle.
Appendices
Annexe
La politique de rééquilibrage territorial à Paris : principes et instruments
Les opérations de construction de logements sociaux dans les arrondissements déficitaires de Paris représentent un volume total de logements limité. En effet, à l’exception du XVIe arrondissement qui, en raison de sa grande superficie, offre encore des opportunités de développement, les réserves foncières dans les beaux quartiers parisiens sont particulièrement rares et chères.
Deux autres instruments sont ainsi mobilisés par la municipalité pour distiller du logement social dans les espaces bourgeois : d’une part, la procédure d’acquisition-conventionnement et de réhabilitation d’immeubles déjà existants, appliquée dans le cadre du droit de préemption de la municipalité ; d’autre part, la Vente en état futur d’achèvement (VEFA) qui permet aux promoteurs immobiliers privés d’inclure la production de logements sociaux dans le cadre des opérations neuves qu’ils réalisent, en échange de facilités à l’obtention du permis de construire.
Dans le cadre de la procédure d’acquisition-conventionnement, la Ville de Paris, en collaboration avec les organismes HLM (et spécifiquement le bailleur historique Paris Habitat), se porte acquéreur d’immeubles et conventionne les logements vacants (ou devenus vacants à la suite du départ des locataires en place) en logements sociaux, pour accueillir des demandeurs issus des commissions d’attribution. Les locataires résidant dans ces immeubles au moment de l’achat et dont les revenus leur permettent de prétendre à un logement social peuvent se voir proposer un bail HLM. Ceux dont les revenus dépassent les plafonds HLM conservent un bail privé jusqu’à leur départ et s’acquittent d’un montant de loyer identique à celui appliqué lors du rachat.
Parallèlement à la procédure d’acquisition-conventionnement, un travail minutieux sur les attributions des logements sociaux est effectué sur la base du principe d’« adaptabilité sociale » des futurs locataires à leur nouvel environnement résidentiel (Launay, 2011). Les ménages résidant et/ou travaillant déjà dans ces quartiers sont supposés disposer d’une plus grande capacité à s’insérer localement.
Au total, la part de logements sociaux dans le XVIe arrondissement est passée de 1 % en 2001 à plus de 7 % en 2018 selon l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Toutefois, « seules » 4 822 unités supplémentaires ont été bâties sur la période, dans un territoire qui compte 82 945 résidences principales et 165 446 habitants (Insee, RP 2016).
Notes
-
[1]
Selon cette théorie, l’exposition quotidienne des pauvres à des populations plus aisées constituerait un facteur d’ascension sociale individuelle grâce à l’accès aux infrastructures et aux opportunités économiques de ces quartiers, à l’accumulation de capital social, et à l’élévation des aspirations scolaires et professionnelles des enfants via l’adoption de modèles d’identification positive (Bacqué et Fol, 2006).
-
[2]
L’article 55 de la loi SRU oblige ainsi les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) à atteindre le seuil de 20 % (aujourd’hui 25 %) de logements sociaux sur leur territoire, sous peine de sanctions financières. Le taux a été porté à 25 % par la Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, dite Loi Duflot I.
-
[3]
Voir le rapport de la Cour des comptes. 2017. Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés.
-
[4]
Les données agrégées issues du système national d’enregistrement de la demande de logement social, publiées en ligne, se concentrent sur les demandes au niveau communal : https://www.data.logement.gouv.fr/statistiques/.
-
[5]
Les familles monoparentales avec des femmes à leur tête représentent 93 % des familles monoparentales relogées (100 sur 108 ménages).
-
[6]
Si la plus faible activité féminine observée dans le XVIe arrondissement s’explique en partie par un effet d’âge, d’autres facteurs sociologiques entrent en jeu, comme le montre la proportion de femmes sans activité professionnelle plus élevée dans cet arrondissement qu’à l’échelle de Paris (25 % contre 19 %).
-
[7]
Les passages en italique sont soulignés par les auteurs.
-
[8]
En France, selon l’enquête Conditions de travail-RPS (DARES, 2016), 34 % des ouvrières et 13,2 % des employées travaillent habituellement le matin entre 5 h et 7 h, contre seulement 0,9 % des femmes cadres. Les différents types d’horaires atypiques (le soir, la nuit, le samedi et le dimanche) ont par ailleurs tendance à se cumuler au sein d’univers professionnels.
Bibliographie
- APUR (Atelier parisien d’urbanisme). 2020. Évolution des revenus dans la Métropole du Grand Paris, note n° 183.
- APUR (Atelier parisien d’urbanisme). 2016. Les chiffres du logement social à Paris, début 2016, note n° 107.
- Bacqué, Marie-Hélène, Yankel Fijalkow, Lydie Launay et Stéphanie Vermeersch. 2011. « Social mix policies in Paris : discourses, policies and social effects », International Journal of Urban Regional Research, 35, 1 : 256-273.
- Bacqué, Marie-Hélène et Sylvie Fol. 2006. « Effets de quartier : enjeux scientifiques et politiques de l’importation d’une controverse », dans Jean-Yves Authier, Marie-Hélène Bacqué et France Guérin-Pace (dir.). Le Quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales. Paris, La Découverte : 181-193.
- Bonvalet, Catherine. 2003. « La famille-entourage locale », Population, 56, 1 : 9-43.
- Castel, Robert. 2009. La montée des incertitudes. Paris, Seuil.
- Chamboredon, Jean-Claude et Madeleine Lemaire. 1970. « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie, 1 : 3-33.
- Cour des comptes. 2017. Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés, rapport.
- Desage, Fabien, Christelle Morel-Journel et Valérie Sala Pala. 2014. Le peuplement comme politique(s). Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Dietrich-Ragon, Pascale. 2013. « Classement, déclassement, reclassement sur le marché résidentiel, l’exemple des occupants de logements dégradés parisiens », Revue française de sociologie, 2, 54 : 369-400.
- Elguezabal, Eleonora. 2015. Frontières urbaines : les mondes sociaux des copropriétés fermées. Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Epstein, Renaud. 2013. La rénovation urbaine. Démolition-reconstruction de l’État, Paris, Presses de Sciences Po.
- Geay, Kevin. 2015. « Aux marges des beaux quartiers : Membres du Racing et prostituées au Bois de Boulogne », Genèses, 99 : 8-27.
- Gilbert, Pierre. 2011. « Ghetto », « relégation », « effets de quartier ». Critique d’une représentation des cités. https://metropolitiques.eu/Ghetto-relegation-effets-de-quartier-Critique-d-une-representation-des-cites.html. Page consultée le 1er mars 2021.
- Launay, Lydie. 2014. « Les classes populaires "racisées" face à la domination dans les beaux quartiers de Paris », Espaces et Sociétés, 156-157 : 37-52.
- Launay, Lydie. 2011. Les politiques de mixité par l’habitat à l’épreuve des rapports résidentiels. Quartiers populaires et beaux quartiers à Paris et à Londres. Thèse de doctorat en sociologie, Université Paris-Ouest.
- Lefaucheur, Nadine. 1991. « La famille monoparentale et l’État : petite généalogie du traitement social des “risques familiaux” », dans François De Singly et Franz Schultheis (dir.). Affaires de famille, affaires d’État. Nancy, Éditions de l’Est : 117-130.
- Lenoir, Rémi. 2003. Généalogie de la morale familiale. Paris, Seuil.
- Létroublon, Catherine et Catherine Daniel. 2018. « Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail ? », DARES Analyses, 30 : 1-12.
- Loones, Anne. 2010. « Le parc social, refuge des familles monoparentales », Crédoc, Consommation et modes de vie, n° 233.
- Masclet, Olivier, Thomas Amossé, Lise Bernard, Marie Cartier, Marie-Hélène Lechien, Olivier Schwartz et Yasmine Siblot. 2020. Être comme tout le monde. Employées et ouvriers dans la France contemporaine. Paris, Raisons d’agir.
- Merle, Pierre. 2011. « La carte scolaire et son assouplissement. Politique de mixité sociale ou de ghettoïsation des établissements ? », Sociologie, 2 : 37-50.
- Oberti, Marco. 2007. L’école dans la ville, ségrégation-mixité-carte scolaire. Paris, Presses de Sciences Po.
- Pailhé, Ariane et Anne Solaz. 2009. Entre famille et travail : des arrangements de couple aux pratiques des employeurs. Paris, La Découverte.
- Pattillo, Mary. 1999. Black Picket Fences: Privilege and Peril Among the Black Middle Class. Chicago, University of Chicago Press.
- Pinçon Michel et Monique Pinçon-Charlot. 1989. Dans les beaux quartiers. Paris, Seuil.
- Poupeau, Franck et Jean-Christophe François. 2008. Le sens du placement. Ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire. Paris, Raisons d’agir.
- Préteceille, Edmond. 2009. « La ségrégation ethno-raciale a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne ? », Revue française de sociologie, 50, 3 : 489-519.
- Pfirsch, Thomas. 2011. « La localisation résidentielle des classes supérieures dans une ville d’Europe du Sud : Le cas de Naples », L’Espace géographique, 40, 4 : 305-318.
- Rivière, Clément. 2017. « La fabrique des dispositions urbaines. Propriétés sociales des parents et socialisation urbaine des enfants », Actes de la recherche en sciences sociales, 216-217, 1-2 : 64-79.
- Sampson, Robert. 2019. « Neighbourhood effects and beyond: Explaining the paradoxes of inequality in the changing American metropolis », Urban Studies, 56, 1 : 3-32.
- Schwartz, Olivier. 1990. Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord. Paris, Presses universitaires de France.
- Taboada-Leonetti, Isabelle. 1987. Les immigrés des beaux quartiers. La communauté espagnole dans le XVIe. Paris, Ciemi-L’Harmattan.
- Tissot, Sylvie. 2007. L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique. Paris, Seuil.
- Wacquant, Loïc. 2006. Parias urbains. Ghetto – banlieues – État. Paris, La Découverte.
List of figures
Carte 1
Les logements sociaux au titre de la Loi SRU à Paris en 2015
List of tables
Tableau 1
Âge, revenu fiscal et nationalité des ménages
Tableau 2
Composition familiale des ménages relogés et parisiens en 2016 (en %)