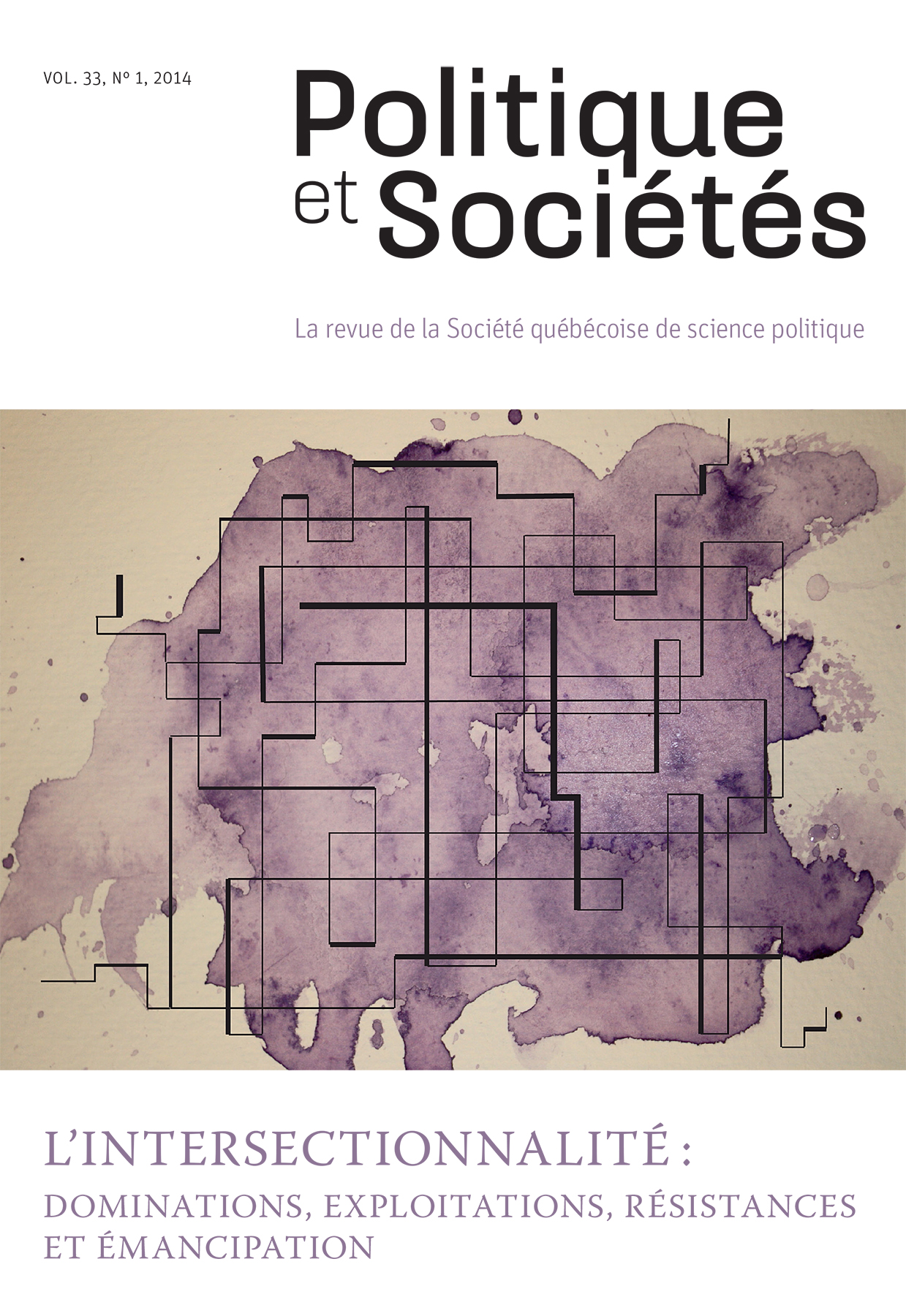Article body
Cet ouvrage collectif est né d’une rencontre franco-japonaise à Tokyo le 11 juillet 2010, laquelle interpellait les conférenciers sur la possibilité d’une société conviviale avancée. Avec quatre chapitres et deux annexes qui complètent la démonstration, Alain Caillé, Marc Humbert, Serge Latouche et Patrick Viveret introduisent une idéologie nouvelle : le convivialisme. Ce présent ouvrage préfigure ainsi Pour un manifeste du convivialisme d’Alain Caillé, publié au cours de la même année aux éditions Le Bord de l’eau. Toutefois, ce premier livre n’est nullement un brouillon du second, mais plutôt une bouture qui ambitionne de répondre à des questions précises. Sous la forme d’un dialogue entre le convivialisme à ses balbutiements avec d’autres théories, notamment celles formées dans le sillage des forums sociaux comme le bien-vivre (buen vivir) ou la décroissance, les auteurs livrent une analyse des plus pertinentes de la société actuelle.
Mais qu’est-ce que le « convivialisme » auquel ils se réfèrent ?
L’espoir des auteurs placé dans une société conviviale avancée provient d’un constat. La collusion entre la démocratie représentative et le capitalisme dans son observance néolibérale crée une « insoutenable démesure » (p. 25), comme l’énonce Patrick Viveret. Politique, elle établit des rapports de pouvoir qui n’ont rien à envier au totalitarisme. Économique, elle produit artificiellement de la rareté au prix d’une surexploitation des ressources naturelles et humaines. La modernité occidentale réside ainsi « dans un double processus de domination […] et de chosification » (p. 35). Si Viveret rejoint par endroit la théorie de la décroissance, ce dernier estime qu’elle est « une provocation utile pour déconstruire l’ancien monde, mais cela ne suffit pas pour en construire un nouveau » (p. 39).
Serge Latouche complète et précise cette démonstration, donnant un aperçu du nouveau monde souhaité par Viveret. En plus de la démesure, l’économiste estime que le néolibéralisme colonise notre système de valeurs avec une « idéologie du bonheur quantifié » (p. 44). Le meilleur exemple de cette pratique est la course effrénée au produit intérieur brut (PIB). Cependant, cet indicateur présente des failles insidieuses. Latouche rappelle qu’il exclut les transactions hors marché et qu’il n’introduit pas les externalités négatives. La croissance prônée et promue par les économies occidentales repose ici sur le déni des solidarités effectives et sur l’altération ou la perte du patrimoine naturel. Le PIB est donc une chimère qui augure notre propre destruction. Sur ce constat, l’auteur estime qu’il faille opérer une « redéfinition du bonheur comme ‘abondance frugale dans une société solidaire’ [laquelle] correspond à la rupture créée par le projet de la décroissance » (p. 60). Aussi est-il nécessaire de lutter contre l’esprit du capitalisme qui marchandise artificiellement le travail, la terre et la monnaie. Selon l’économiste, cette lutte passe par des « entreprises mixtes où l’esprit du don et la recherche de la justice tempèrent l’âpreté du marché » (p. 65).
En héritier de Marcel Mauss, Alain Caillé plaide également pour l’esprit du don. Il reproche aux idéologies traditionnelles – libéralisme, communisme, socialisme, voire anarchisme – d’être « autant de modalités d’une philosophie politique utilitariste tenant la croissance indéfinie de la prospérité matérielle pour l’alpha et l’oméga » (p. 20). Il en va de même de solutions plus contemporaines, telles que les théories de la justice ou les théories de la reconnaissance inspirées des travaux de John Rawls. Également, le sociologue attaque la théorie de la décroissance qu’il juge, malgré elle, sacrificielle. La critique de ces théories est sévère, d’autant plus qu’elle semble bien lapidaire. Donnons toutefois le bénéfice du doute à Caillé, lequel souligne que ces mêmes théories ne se préoccupent pas de la disparition croissante de l’esprit du don et ses corolaires : la montée de l’esprit gestionnaire, l’impossibilité d’améliorer sa condition de vie et « une forme de totalitarisme inversé, dans un parcellitarisme qui induit une fragmentation généralisée » (p. 87). Plutôt que de s’attaquer aux conséquences de ces maux à l’instar des théories précédemment citées, le convivialisme se propose d’opérer une vraie rupture sur leur cause première : l’utilitarisme ambiant. Rupture qui s’appuie sur le principe « de la commune humanité et de la commune socialité de tous les êtres humains » (p. 21). À l’inverse de ce que ce principe suggère, Caillé se défend de verser dans l’utopie. Reprenant les mots de Mauss, il estime qu’il faut apprendre à savoir « nous oppos[er] sans nous massacrer » (p. 72). C’est pourquoi il présente le convivialisme comme « un socialisme universalisé et radicalisé » (p. 89). Par socialisme, il entend « une forme de subordination de la vie économique aux objectifs conscients de la société » (p. 90). Il devient « universalisé » en imposant une solidarité mondialisée en dehors du cadre ténu de l’État et « radicalisé » en combattant la démesure du capitalisme néolibéral, notamment en décrétant « hors-la-loi » (p. 95) la spéculation financière. Pour ce faire, Caillé espère qu’une société civile associationniste s’émancipe du pouvoir politique afin de peser de tout son poids sur la démocratie telle qu’elle est pratiquée.
Outre Marcel Mauss, le convivialisme s’inspire d’Ivan Illich, dont Marc Humbert tient à souligner l’apport. Dès 1973, avec la publication de son livre Tools for Conviviality (Marion Boyars Publishers Ltd., 2001), Illich soulignait la nécessaire autolimitation de l’économie mondiale. Toutefois, estimait-il, « l’État ne peut plus jouer son rôle politique pour organiser le changement radical qui s’impose » (p. 106). Celui-ci étant contraint au rôle d’observateur par le poids démesuré des grandes entreprises dans l’économie capitaliste, seule la société civile peut encore intimer un changement de production. C’est dans la « théorie de la création et du partage des ressources » (p. 112-129) qu’elle peut puiser des solutions en faveur d’une société conviviale avancée. En effet, Illich constatait que les « outils » de la société – c’est-à-dire les biens et les institutions – ne sont pas prompts à la convivialité. Par conséquent, il importe de rompre avec ceux qui asservissent l’homme plus qu’ils ne le libèrent, à l’exemple de la bureaucratie. Illich proposait ainsi de « redonner à l’activité humaine sa dimension créatrice – prosaïque ou artistique – librement exercée afin de fournir des ressources qui ont une valeur d’usage pour l’ensemble de la société » (p. 118). Cette phrase prend tout son sens à la lecture de la biographie d’Ivan Illich par Denis Clerc, à l’annexe I. En plus d’une clarification de ses concepts clés, on y apprend qu’il avait été ordonné prêtre. Devenu économiste, sa critique du christianisme admet paradoxalement le rôle émancipateur de son message.
Cette dimension religieuse « sécularisée » se retrouve dans les contributions des auteurs du collectif. À ce titre, Alain Caillé précise : « Le convivialisme, qui hérite de tous les acquis de ces grandes idéologies politiques des XVIIIe et XIXe siècles (et, plus largement, de l’éthique de base de toutes les grandes religions), pose la question de savoir comment bien vivre ensemble » (p. 20). De même, Serge Latouche estime : « la voie c’est le tao de Lao-Tseu, c’est le do du Zen japonais, mais c’est aussi le dharma des Hindous et l’ethos d’Aristote » (p. 71). Toutefois, il ne s’agit pas d’un oecuménisme attrape-tout ou d’un syncrétisme tiède. Le convivialisme présente une architecture idéologique propre, s’appuyant sur une éthique suffisamment compréhensive pour agréger chaque strate de la société civile. En replaçant le don au centre de la société, les auteurs espèrent restreindre les rapports de force. Toutefois, on reprochera à ceux-ci d’user d’un flou artistique lorsqu’il s’agit d’apprécier l’avènement d’une société conviviale. À ce titre, Patrick Viveret rapporte l’existence d’« expérimentations anticipatrices » (p. 36-41) et Michel Renault, à l’annexe IIb, cherche à élaborer un nouvel indicateur économique. Malgré les bonnes intentions, les mesures transitoires ou expérimentales peinent à décrire le convivialisme au-delà de son architecture paradigmatique. De même, les acteurs – présentés comme les futurs instigateurs d’un mouvement global en faveur d’un changement drastique de société – disparaissent au profit de controverses académiques. Mais insistons, il s’agit là d’une bouture à un plus vaste projet intellectuel, une réponse en somme aux théories contemporaines. Si ce livre laisse probablement le lecteur sur sa faim, il lui présente avec clairvoyance les enjeux actuels et les solutions de demain.