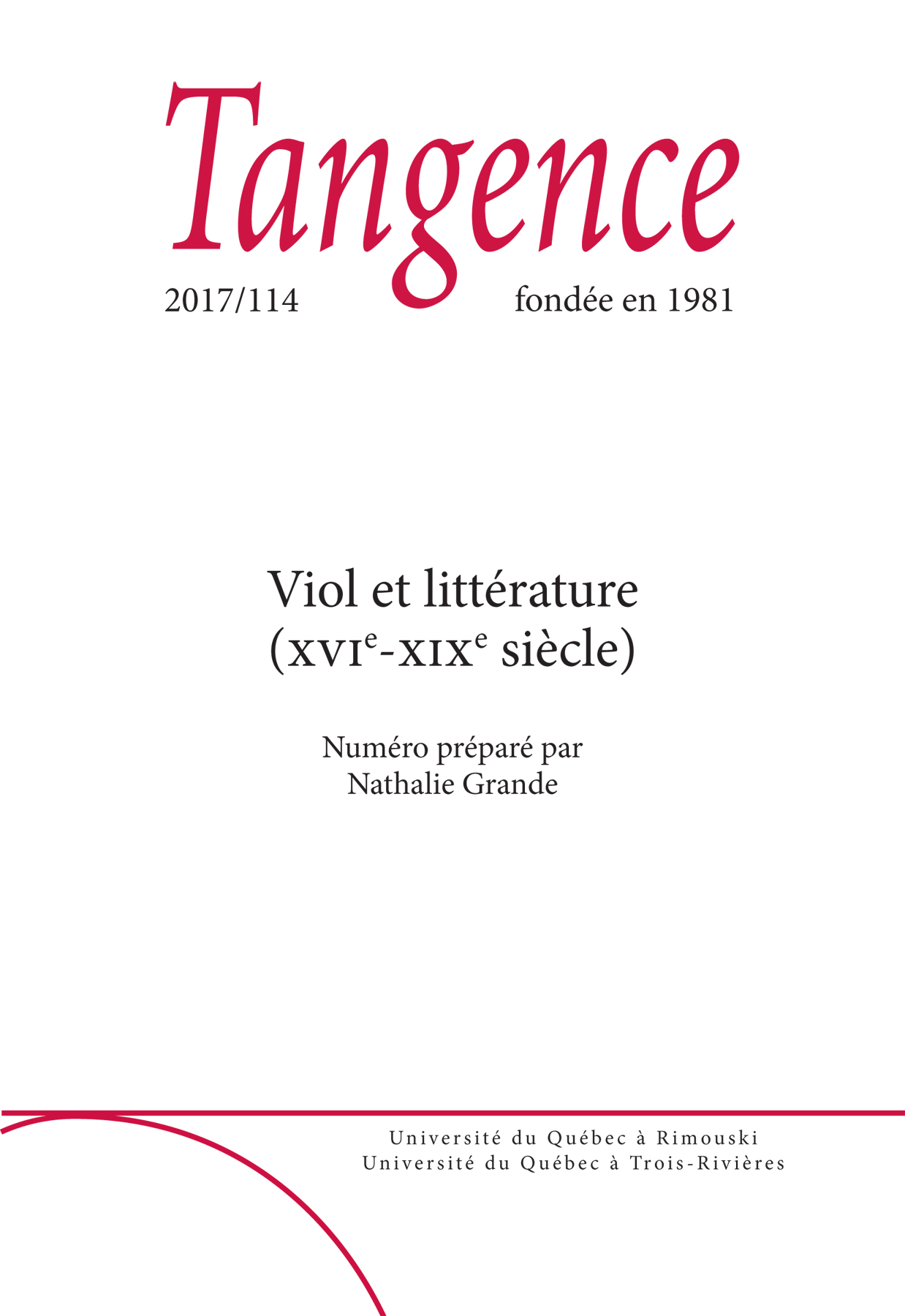C’est un joli tableau conservé à La Haye dans la collection de la Mauritshuis, tout près de La jeune fille à la perle de Vermeer. On y voit une femme endormie ; elle s’est cachée derrière un rocher, à l’abri de la végétation, pour profiter d’un moment de repos. Toute son attitude est relâchée, son corps détendu, sa tête renversée, ses yeux clos : elle est visiblement fatiguée de la chasse qui a dû l’entraîner jusque-là, puisqu’on remarque son arc, son carquois et ses flèches déposés à ses côtés. Elle a tort de s’être ainsi dépouillée de ses armes, car le spectateur voit ce qu’elle ne voit pas : dans son dos, derrière le rocher, deux hommes, dont l’un se retourne vers l’autre pour lui faire signe et lui désigner la proie offerte. Et le spectateur devine ce qui va suivre, ce que le tableau insinue, et invite sans doute à imaginer : la surprise, l’effraction dans le sommeil et dans le corps de la belle endormie. Le viol, s’il n’est pas représenté, est suggéré, attendu pour ainsi dire. Que cette peinture figure, sous un titre euphémistique charmant (« Een slapende jachtnimf » : une nymphe chasseresse endormie) dans les collections d’un prince, dit assez combien la perception de la violence sexuelle a pu varier au fil du temps. Car ce que le tableau révèle, c’est la nature foncièrement ambivalente du viol : violence pour les un-e-s, jouissance pour les autres. Ce qui fait aujourd’hui l’objet d’une condamnation unanime, dans les sociétés où les femmes ont obtenu reconnaissance des droits de leur personne, est loin d’avoir toujours fait l’objet d’une réprobation virulente. Il faut du moins distinguer entre, d’une part, un discours moral, d’origine chrétienne, où la valorisation de la chasteté amène logiquement à condamner ce trouble du comportement qui consiste pour un individu à ne pas être capable de maîtriser ses désirs ; et, d’autre part, des mentalités où la valorisation d’une virilité toute-puissante amène à expliquer et même à excuser le viol, au point que la victime, celle qui n’a pas eu la force de résister, peut devenir objet de mépris. Ainsi, on doit comprendre que l’Ancien Régime a eu du mal à admettre la réalité même du viol, comme les usages linguistiques aussi bien que les pratiques juridiques peuvent en témoigner. Dans l’histoire de la langue, on constate en effet que le terme « viol », déverbal directement issu du latin classique violare (« traiter avec violence, faire violence à » selon le Dictionnaire de Gaffiot), n’est attesté qu’en 1647, l’usage lui ayant longtemps préféré « violement ». Or, ce dernier a principalement un sens large, et désigne tout tort fait à quelqu’un ou à quelque chose : la désignation de l’attentat sexuel est donc dissoute dans un terme générique qui, en ne permettant pas de reconnaître la spécificité du crime, gomme sa particulière violence. Au plan juridique, le constat est du même ordre : dans les archives du Parlement de Paris, on ne trouve la trace que d’une cinquantaine de viols pour la période qui va de 1540 à 1692. Faut-il en déduire pour autant la rareté de ce crime, et en conclure que la société française actuelle, par exemple, où on considère que 100 000 viols environ sont commis chaque année, est infiniment plus violente que ne l’était la société des xvie et xviie siècles ? Sans doute pas ; et de même qu’aujourd’hui on sait que les victimes sont loin de toujours porter plainte, les travaux de l’historien Georges Vigarello ont permis de comprendre combien sont difficiles à surmonter les pressions et …
Liminaire[Record]
…more information
Nathalie Grande
Université de Nantes