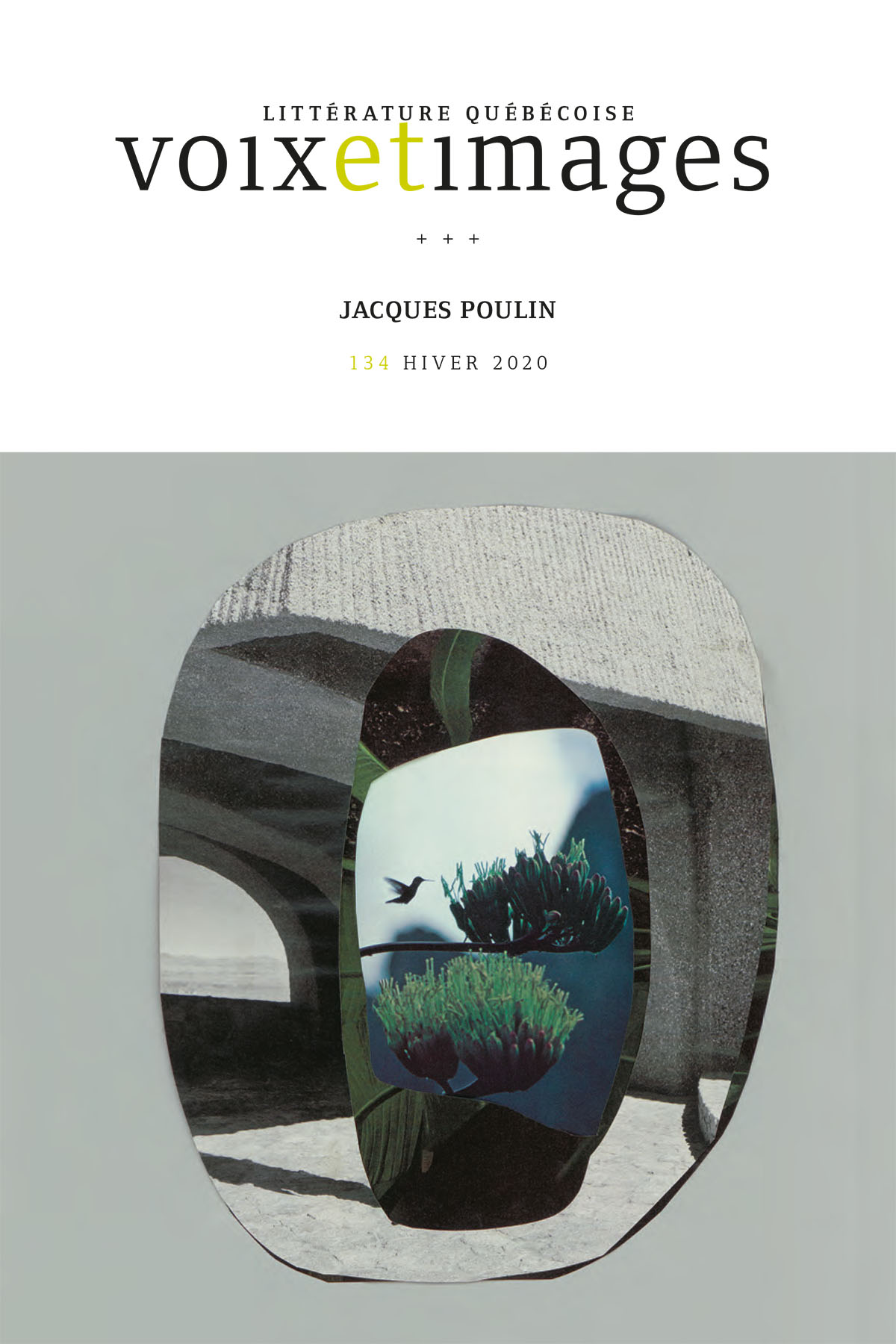Abstracts
Résumé
Il y a, dans le roman Volkswagen Blues, cette image du complexe du scaphandrier pour décrire une période de replis sur soi vécue par le personnage de Jack Waterman. Dans le chapitre où il en est question, Waterman pose sa condition d’écrivain comme une condition qui le pose en marge de la vie qui passe et qui amène avec elle les gens qu’il aime sans qu’il s’en rende compte. La description fait certainement référence au rapport que Jack entretient avec son frère Théo, mais on peut aussi l’appliquer aux protagonistes des romans qui précèdent Volkswagen Blues, des êtres marginalisés qui se coupent du monde qui les entoure. À la sortie de sa crise, Jack Waterman précise que le mouvement de replis sur soi, d’isolement, que représente l’image du scaphandrier a cependant ceci de rassurant qu’il sait que quelqu’un reste à la surface pour veiller sur soi et pour actionner la pompe qui donne de l’air. Si dans les premiers romans, l’isolement semble complet, conduisant certains à une sorte de suicide social, il n’en est rien dans Volkswagen Blues puisque la Grande Sauterelle reste à la surface pour prendre soin de lui. À partir de ce moment, on relève dans l’oeuvre un changement dans son rapport du soi avec le monde. Tout se passe comme s’il y avait un désir plus marqué d’aller vers l’autre, d’accepter le besoin que le soi a de l’autre et que cet autre a de soi.
Abstract
In the novel Volkswagen Blues, the image of the deep-sea diver’s complex is used to describe a period of withdrawal experienced by Jack Waterman. In the chapter where this occurs, Waterman defines his condition as a writer as one that puts him on margins of life; life, as it passes by, brings him the people he loves without him realizing it. This description clearly refers to Jack’s relation with his brother Théo, but it can also be applied to protagonists of earlier novels: marginalized people who cut themselves off from the world around them. As he emerges from his crisis, Jack Waterman says that the movement toward withdrawal and isolation represented by the image of the deep-sea diver has something reassuring about it, because he knows there is someone at the surface who is watching over him and who will activate the pump that gives him air. In previous novels, isolation appears to be complete, leading some characters to a kind of social suicide, but this is not the case in Volkswagen Blues where Grande Sauterelle stays at the surface to take care of him. From this point on, there is a change in the relation of self to world as depicted in Poulin’s work. There seems to be a stronger desire to go towards the other, accepting the other’s need for oneself and one’s own need for the other.
Resumen
Existe, en la novela Volkswagen Blues, esta imagen del complejo del buzo para describir un periodo de repliegue sobre sí mismo que vive el personaje de Jack Waterman. En el capítulo en el cual se trata este tema, Waterman plantea su condición de escritor como una condición que lo sitúa al margen de la vida que pasa y trae consigo a la gente a la que él ama sin que se dé cuenta de ello. No cabe duda que la descripción se refiere a la relación que mantiene Jack con su hermano Théo, pero también se puede aplicar a los protagonistas de las novelas anteriores a Volkswagen Blues, unos seres marginalizados que se aíslan del mundo que los rodea. Al salir de su crisis, Jack Waterman precisa que el movimiento de repliegue sobre uno mismo, de aislamiento, que representa la imagen del buzo, tiene sin embargo algo que tranquiliza: sabe que alguien permanece en la superficie para velar sobre uno y accionar la bomba que proporciona aire. Si bien en las primeras novelas el aislamiento parece total, conduciendo seguramente a una especie de suicidio social, no hay nada de esto en Volkswagen Blues, puesto que, al igual que La Grande Sauterelle (La Langosta Grande, apodo que le da el protagonista a una mestiza que tiene las piernas largas), permanece en la superficie para cuidar de él. A partir de este momento, se observa en la obra un cambio en su relación del uno con el mundo. Todo sucede como si hubiera un deseo más marcado de ir hacia el otro, de aceptar la necesidad que el uno tiene del otro y que este otro tiene de uno.
Article body
— Ça va mieux ?
— À moitié, dit-il.
— Alors je crois que je vais me prendre pour une grande psychologue encore une fois…
— Pourquoi ?
— Parce que… on est deux. On est ensemble. On ne peut pas vivre comme si on était séparés[1].
VB, 147
Ce dialogue, qui met en scène les personnages de Jack Waterman et de Pitsémine, dite la Grande Sauterelle, apparaît en ouverture d’un chapitre intitulé « Le complexe du scaphandrier », vers le milieu du roman Volkswagen Blues. Le malaise qu’éprouve Jack à ce moment, et qu’il explique à la Grande Sauterelle en trois points, lui vient d’un sentiment de profonde solitude qu’il rattache à sa condition d’écrivain. Il y a d’abord que l’écriture lui apparaît comme une « façon de ne pas vivre », alors qu’il s’est mis à écrire « à l’âge où les gens commencent à vivre pour vrai » (VB, 147) : « Je veux dire : vous vous enfermez dans un livre, dans une histoire, et vous ne faites pas très attention à ce qui se passe autour de vous et un beau jour la personne que vous aimez le plus au monde s’en va avec quelqu’un dont vous n’avez même pas entendu parler. » (VB, 148) Aussi, cette coupure pourrait bien être le signe pour Jack qu’il n’a jamais aimé personne. Il va même plus loin en affirmant : « [J]e pense que je n’aime pas la vie et que je ne m’aime pas moi-même. » (VB, 148) Finalement, Théo, le frère disparu depuis plusieurs années, l’objet de sa quête à travers l’Amérique, ne représente peut-être que l’expression de son désir de se trouver lui-même : « [J]e ne l’ai pas vu depuis une vingtaine d’années, alors il est à moitié vrai et à moitié inventé. Et s’il y avait une autre moitié… […] c’est-à-dire la partie de moi-même qui a oublié de vivre. » (VB, 149) Ce douloureux constat amène Jack à se refermer sur lui-même au point où, un matin, après avoir appris que son frère Théo avait été soupçonné du vol d’une carte géographique dessinée en 1840 par un jésuite d’origine française, il refuse de se lever. Ce n’est que trois jours plus tard qu’il sort enfin de sa torpeur, moment où il explique à la Grande Sauterelle qu’il était pris du « complexe du scaphandrier », qu’il définit ainsi :
[C]’est… un état pathologique dans lequel on se renferme quand on est en présence de difficultés qui paraissent insurmontables. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe, on agit d’une manière… instinctive. On sent qu’il est absolument nécessaire de se protéger, alors on s’enferme dans le scaphandre : on commence par revêtir l’énorme combinaison de caoutchouc imperméable qui ressemble au costume du bonhomme Michelin, ensuite on met le casque en cuivre qui est rond comme une boule et qui est muni de trois petites fenêtres quadrillées, et finalement on doit mettre les lourdes semelles de plomb sinon…
[…]
Ensuite on descend lentement dans l’eau par l’échelle du bateau. On est à l’abri dans le scaphandre. L’eau ne paraît pas trop froide. On descend de plus en plus et la lumière diminue. La pénombre est très agréable et c’est très réconfortant aussi de savoir qu’il y a quelqu’un à la surface de l’eau qui veille sur nous et actionne la pompe servant à nous fournir de l’air. On se sent en sécurité et on continue à descendre.
VB, 159-160
Le chapitre se clôt sur cette image du scaphandrier, de Jack qui plonge au centre de lui-même et de Pitsémine qui, à la surface, veille sur lui.
Au coeur de ce chapitre, il y a très certainement le rapport que Jack entretient avec l’image de son frère Théo, un rapport qui a abondamment été commenté. Mais il y a aussi l’importance que revêt la cohabitation des deux protagonistes : entre l’affirmation de Pitsémine — « On ne peut pas vivre comme si on était séparés » — et l’explication de Jack, qui suggère que le repli sur soi est possible justement grâce au sentiment de confiance qu’amène la présence de l’autre, il semble se produire un changement fondamental dans la manière dont Jack définit ce repli. L’écriture, qui l’empêche de vivre comme les autres, se fait dans un geste qui ne tient absolument pas compte de l’autre, tandis que le complexe du scaphandrier n’est possible que s’il y a la présence d’un autre en qui on a confiance. À cet égard, Volkswagen Blues constitue un roman charnière de l’oeuvre de Jacques Poulin en ceci que ses personnages, à partir de ce roman, parviennent à briser leur solitude et à s’ouvrir à l’autre, même si cette ouverture reste assez minimale dans certains cas. Il faut noter aussi que ce changement des rapports interpersonnels intervient à un moment où l’écriture comme la figure de l’écrivain se nourrissent de plus en plus des histoires qu’ils racontent à d’autres ou que d’autres leur racontent. Ces histoires proviennent de lectures, de souvenirs et d’anecdotes qui se font écho et permettent au soi de trouver une certaine complétude dans l’autre. Jean Morency remarque justement que, à partir du roman Le vieux Chagrin, « [l]a seule autorité narrative digne de ce nom appartient désormais aux avatars modernes de l’écrivain : l’écrivain public (Chat sauvage), le commis de librairie (Les yeux bleus de Mistassini), le traducteur de métier (La traduction est une histoire d’amour) et le lecteur professionnel (L’anglais n’est pas une langue magique)[2] ». Liste à laquelle il faut ajouter le libraire mobile (La tournée d’automne) et l’écrivain fantôme (L’homme de la Saskatchewan). Si Jean Levasseur[3] plaçait les personnages des premiers romans de Poulin sous le signe d’un « mal de vivre », il semble que les nouvelles formes du récit permettent de repenser la posture qu’ils occupent dans leur espace social en les amenant à reconstruire un réseau de communication fondé sur la rencontre intime entre subjectivités.
J’aimerais, dans la suite de cet article, mettre en évidence certaines traces de ce changement dans les rapports interpersonnels qui se produit au sein de l’oeuvre de Poulin en m’intéressant particulièrement aux deux extrémités du spectre de sa production romanesque, soit en m’attardant à l’isolement premier du personnage tel qu’il apparaît dans Mon cheval pour un royaume, puis à l’équilibre qui s’installe entre le repli sur soi que suppose l’acte d’écrire et la nécessaire sociabilité du sujet dans Un jukebox dans la tête. Je me questionnerai sur l’évolution, entre ces deux romans, de la mise en communication des protagonistes qui devient possible à partir de l’intervention de la Grande Sauterelle. Je proposerai, en outre, de lire cet équilibre à travers la mise en opposition du concept du « scaphandrier » que décrit Jack avec la figure de la statue de pierre qui hante la première partie de l’oeuvre.
L’ISOLEMENT DU SOI AU COEUR DE SA CARAPACE
Simon croit en la nécessité de renouveler le passé ; il dit qu’il faut « lui faire prendre l’air ». Moi, c’est le présent plutôt qui pour le moment m’intéresse, parce qu’il m’échappe un peu et qu’il faut bien commencer par là.
MCR, 41
Les premiers romans de Jacques Poulin, de Mon cheval pour un royaume aux Grandes marées, mettent en scène des personnages qui ont certaines difficultés à prendre part à un présent qui, la plupart du temps, leur échappe. Tout se passe comme si, ne pouvant pas se définir adéquatement en tant que soi, ils n’arrivent jamais à intégrer complètement leur espace de sociabilité. Comment, en effet, habiter l’espace et établir un véritable contact avec les autres lorsque le soi ne semble jamais sûr de la place qu’il occupe ou qu’il peut occuper dans cet espace ? Cette incertitude du soi se trouve particulièrement bien illustrée par certains personnages emblématiques de Poulin, comme Jimmy, du roman éponyme, et Teddy, dans Les grandes marées : le premier, victime de l’effondrement de la cellule familiale, seul lieu de sociabilité de l’enfant, perd toute emprise sur le réel qui l’entoure ; le second, qui cherche la solitude d’une île déserte pour travailler, ne parvient jamais à intégrer la petite société qui prend forme autour de lui. Pour les deux personnages, il se crée un mouvement d’exclusion, volontaire ou non, qui amène le soi à partir à la dérive, littéralement, ce qu’illustrent l’effondrement du chalet lors des grandes marées, dans Jimmy, et l’acte de la petite société de l’île qui oblige Teddy à nager malgré les courants du fleuve jusqu’à l’île voisine. Cette image d’une dérive, d’un rejet et d’un isolement du soi apparaît également centrale dans les autres romans de cette période et conduit les protagonistes à un isolement funeste qui se traduit soit par la folie (Mon cheval pour un royaume), le suicide (Le coeur de la baleine bleue) ou l’immobilité (Faites de beaux rêves), autant de fins qui provoquent la disparition du soi.
Dans son ouvrage Jacques Poulin. La création d’un espace amoureux, Pierre Hébert suggère que Mon cheval pour un royaume peut être considéré comme un réservoir de sens, un « pré-texte », faisant de ce premier roman un texte fondateur de l’oeuvre poulinienne[4]. Or, la crise du soi apparaît dès l’ouverture de ce roman, alors que le protagoniste, Pierre, un écrivain, rencontre le responsable du groupe terroriste le Front, qu’il souhaite intégrer. Pendant la discussion, le responsable affirme avoir trouvé dans le roman de Pierre des idées intéressantes sur la Révolution tranquille et donne du mérite aux idéaux politiques de son personnage. À ces remarques qui veulent confirmer la cohérence entre ses idées et celles du groupe terroriste pour lequel il s’engage à commettre un crime — poser une bombe sur la statue de pierre d’un soldat anglais —, Pierre rétorque en affirmant, deux fois plutôt qu’une : « Ça n’a pas de rapport […]. » (MCR, 23) Étonnante réponse pour un personnage qui mettra pourtant de l’avant, tout au long du roman, sa condition d’intellectuel lucide. L’engagement de Pierre ne serait donc pas politique ? Mais le responsable, pas plus que le lecteur d’ailleurs, n’en apprendra pas davantage sur le sens de ce « non-rapport » entre l’idéologie de son roman et l’acte qu’il accepte de commettre, puisque Pierre n’ajoute aucune explication, s’efforçant « de sourire pour ne pas le vexer » (MCR, 24) : « Encore le trou, par ma faute. Le délégué pense que je suis un révolutionnaire ; à sa place, je penserais la même chose. » (MCR, 24) Si le délégué se lance alors dans un discours révolutionnaire sur la nécessaire participation des citoyens à la lutte que mène le Front au Québec, l’idéologie qu’il veut mettre de l’avant tombe à plat, la narration coupant court à son discours lorsque le narrateur dérive à l’intérieur de lui-même : « Il poursuit son idée, marchant les mains dans le dos et paraissant suivre avec précaution une ligne du plancher. Je ne lui dirai pas que je n’ai pas de préoccupations sociales, ni politiques. » (MCR, 24) Il ajoute : « Je pense seulement que je ne me comprends pas moi-même […]. » (MCR, 25) Avec le narrateur, c’est tout le roman qui dérive vers le soi, lequel en devient le véritable centre, le véritable lieu où se joue la quête de libération. D’ailleurs, le seul autre discours idéologique sur la libération provient d’un étudiant en sociologie soûl, discours dont le sens politique ne se trouve que dans une sorte de reconstitution narrative de Pierre, qui réinvente la scène à mesure qu’elle se produit en l’imaginant dans un bar du Château Frontenac plutôt que dans le bar La Chapelle, situé au sous-sol d’un édifice au coeur de la ville :
Ma bière prendrait le goût du champagne. Le plancher rude, les chaises de bois se changeraient en tapis épais et fauteuils moelleux. Ces gens qui discutent bruyamment de liberté seraient des personnages importants. Cet étudiant en sociologie que je connais bien et qui cherche à se mettre debout sur sa chaise serait un député prêt à faire un discours. Il n’aurait pas tant de mal à se hisser sur sa chaise et à dominer les applaudissements. Il ne vacillerait pas autant en s’écriant : « La liberté, messieurs, c’est une chose qu’il faut choisir aussi grande qu’on est capable de la supporter ! » Son estrade improvisée ne s’écroulerait pas. Il ne roulerait pas bêtement sous la table.
MCR, 93-94
La recomposition de la scène s’arrête cependant là et n’ouvre jamais sur un discours idéologique concernant la société québécoise. Après la chute de l’étudiant, le narrateur avoue ne plus être capable de changer le décor, de reconstruire la scène pour lui donner un sens politique, puisque la simple mention de la liberté le renvoie à son propre emprisonnement à l’intérieur de sa carapace d’intellectuel faussement lucide. Le passage au soi, au drame intime, s’opère d’ailleurs aussi pour l’étudiant qui somnole finalement sur une chaise et dont les marmonnements permettront de comprendre, à travers les mots qui s’entremêlent, « qu’une femme est partie » (MCR, 98), le laissant avec une liberté qui prend plutôt la forme d’un isolement dans sa solitude. Le récit au potentiel idéologique n’était donc que le fragment d’un drame intime qui se superpose au rêve qu’entretient Pierre de se libérer de sa carapace.
Si cette carapace semble l’empêcher de prendre part au discours idéologique, au mouvement social, elle ne lui permet pas davantage d’intégrer le présent de sa propre intimité. On le voit dans le rapport qu’il entretient avec Nathalie et Simon, où il n’est toujours qu’un observateur passif qui, incapable de communiquer avec les autres, attend systématiquement que quelqu’un prenne la parole pour comprendre ce qui se passe, sans quoi il accepte de rester dans une sorte d’ignorance docile. Le roman contient d’ailleurs plusieurs affirmations du narrateur allant en ce sens : « Je ne sais à quoi elle pense, n’ayant pas comme elle cette faculté de lire dans la pensée ; il me faut un mot, un signe. J’attends. » (MCR, 52) ; « Nathalie regarde d’abord Simon. Longuement et avec beaucoup de douceur, il me semble. Je suppose qu’il est question de moi ; il ne m’est pas possible de vérifier. Ma carapace. » (MCR, 53) ; « Il me présente [Nathalie] ; je ne comprends pas encore qu’il me l’offre. Je mets toujours du temps à comprendre. Les mots, je les adapte à ma carapace. » (MCR, 106) Il est aussi significatif que, lorsque la représentante du Front lui donne les indications pour prendre possession de la bombe, il ait une discussion avec elle en marchant dans les rues de la ville, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’elle n’est plus à ses côtés, qu’il parlait « seul, inutilement » (MCR, 130). Plus tard, marchant avec Nathalie vers la gare du Palais où il doit prendre possession de la bombe, il n’arrive pas à trouver les mots pour lui expliquer la raison de leur promenade nocturne et, encore moins, ses intentions : « [P]ersonne plus qu’elle n’est prêt à écouter, comprendre, approuver. Seulement, les mots finissent par perdre leur sens. » (MCR, 148) Ainsi, l’enfermement du sujet dans sa carapace d’intellectuel, prisonnier de sa fausse lucidité, empêche une véritable communication avec l’autre ; non pas l’étranger, mais l’intime qui cohabite, en quelque sorte, dans l’espace du soi. Le seul moment où la carapace se laisse véritablement percer, c’est lorsque Pierre fait l’amour avec Nathalie, et que cette dernière se glisse lentement sous lui pour lui permettre d’atteindre la liberté d’un soi qui se laisse emporter par « l’anarchie » de ses désirs. Mais dès que Nathalie a repris sa place hors de la carapace, Pierre replonge au centre de lui-même : « Mes pieds et mes mains commencent à refroidir. Il me semble qu’on pourrait avoir le droit de ne pas devenir soi-même. Ce serait plus régulier si on avait le choix : c’est la seule remarque que je me permettrai en qualité de simple spectateur. » (MCR, 116) Que serait alors le véritable désir de ce spectateur passif, sinon de prendre part à l’action et, peut-être, d’être plus en mesure d’entrer véritablement en communication avec Nathalie afin de réduire enfin la distance qui les sépare, même après la mort supposée de Simon qui revient, du moins dans le regard de Nathalie, sous la forme de Mathieu ?
La symbolique de l’enfermement du sujet à l’intérieur de lui-même est d’ailleurs à peine subtile puisque c’est justement la « pierre », ici, qui provoque le sentiment d’étouffement du sujet. Lorsqu’il se promène dans la ville, Pierre a effectivement l’impression que les murs de pierre se referment de plus en plus sur lui. L’extérieur (des murs ou de soi ?) devient ainsi le lieu du fantasme puisque, remarque Pierre, « c’est à l’extérieur que se produisent les choses rares » (MCR, 128). Et même s’il se reprend immédiatement pour souligner la superficialité de cette remarque, il n’en demeure pas moins prisonnier du banal et de l’ordinaire qu’il associe au vide de la vie à l’intérieur des murs. Du moins, de ses murs, puisque le narrateur en arrive à se confondre lui-même avec la ville : « C’est par la peau que nous nous comprenons, moi et cette ville qui avons une peau semblable. » (MCR, 130) L’écriture, le travail de l’intellectuel, apparaît alors comme une tentative de remplir le vide que créent les murs en coupant le sujet du monde extérieur. Pierre n’est cependant pas dupe et comprend, à l’instar de Jack dans Volkswagen Blues, que l’écriture n’est qu’une manière de s’enfermer encore plus au coeur de sa carapace, de ne pas avoir de véritable emprise sur le réel, bref, de ne pas vivre : « Dans une vie aussi vide que la nôtre, derrière les murs où rien d’autre ne se passe que les histoires que nous nous racontons, les rites sont essentiels. » (MCR, 55) Or, comme on l’a vu avec la scène dans le bar La Chapelle, Pierre n’arrive plus à se réinventer, prisonnier de son désir de sortir des murs. L’acte terroriste prend tout son sens lorsque l’on comprend que ce qui est visé par la bombe est moins la pierre de la statue que Pierre lui-même. Il revient d’ailleurs à la statue, qui regarde Pierre au moment où il passe à l’action, de mettre en lumière la crise intérieure qu’il vit :
MCR, 174-175Peut-être lui-même ignore-t-il encore ce qu’il veut.
Qu’il prenne son temps. Avec une carapace, il faut beaucoup de temps pour reconnaître ses propres désirs ; beaucoup de temps et beaucoup de patience. Surtout qu’il prenne tout son temps. Souvent même, on n’y arrive jamais : seule nous reste alors l’action aveugle et gratuite. Qu’il soit patient avec lui-même.
C’est à ce moment que Pierre glisse la bombe entre les jambes de la statue et tente de s’enfuir. La narration, après l’explosion, se recentre sur le soi, sur Pierre qui gît dans les débris de pierre et qui, malgré la douleur, semble redécouvrir son propre corps, dégagé de sa carapace, et redécouvrir la ville à travers sa chair[5] : « Quelque chose en moi s’est dégagé et se meut à l’aise, une vieille chose accoutumée et familière, une bête sortant d’un long sommeil qui regarderait autour d’elle calmement, une lueur allumée au fond des yeux, comme cette lumière qui passe en douce les murs du château. » (MCR, 184) Toutefois, si Pierre semble se défaire de la carapace qui l’enfermait en lui-même, « l’action aveugle et gratuite » — pour reprendre les mots de la statue du soldat anglais — s’avère un échec puisqu’il termine seul, enfermé entre d’autres murs.
Le parcours que suit Pierre tout au long du roman constitue donc une tentative de briser la carapace qui enferme le soi en lui-même. Cette tentative n’aboutit pas, cependant, puisque le récit de la libération de Pierre, à l’image du discours de l’étudiant en sociologie, reste du domaine de la fabula, de l’invention. Du moins, il est permis de douter de la parole du narrateur, puisqu’elle est mise entre parenthèses par son enfermement en institution ; le prologue et l’épilogue permettent effectivement de percevoir l’action de Pierre comme étant de l’ordre du désir uniquement. Dans le prologue, le narrateur affirme d’emblée qu’il ment, qu’il doit trouver un récit afin de justifier les barreaux de sa fenêtre puisque, « rendus plausibles, peut-être un jour disparaîtront-ils » : « Je vais remplacer mes souvenirs perdus. Je vais me construire un passé capable de rendre légitime la présence des barreaux. » (MCR, 11) Des paroles qui annoncent déjà la position du philosophe Simon, cité plus haut, qui « croit en la nécessité de renouveler le passé », de « lui faire prendre de l’air » (MCR, 41), pour permettre au sujet de définir son présent. Dans l’épilogue, c’est le vide de la communication qui apparaît alors que le narrateur remarque le silence du narrataire à son récit : « J’en arrive à me demander si vous existez vraiment. Vous ne dites jamais rien. Existez-vous réellement ou vous ai-je inventé comme je l’ai fait pour mon passé ? Ou alors si vous existez, me suis-je inventé moi-même ? Ne suis-je qu’un être inventé ? » (MCR, 190) Déjà pointe, dans l’incertitude existentielle de Pierre, le doute de Jack Waterman sur sa véritable personnalité, sur la part de lui-même qu’il cherche dans la recomposition de la figure de Théo : et si la quête de Jack ne reposait que sur un vide ? Il y a cependant une différence fondamentale entre Pierre et Jack, à savoir que ce dernier trouve en Pitsémine une interlocutrice qui l’aide à donner un sens aux mots et, par la même occasion, à faire prendre l’air à un passé qui ne lui permet plus de comprendre son présent.
LE SCAPHANDRIER OU LE NOUVEAU LIEU DE SOCIABILITÉ DU SOI
Chacun de nous était absorbé par ce qu’il faisait, en apparence tout seul au monde, et pourtant nous étions reliés les uns aux autres par un réseau de fils invisibles. C’est ce qui s’appelle, j’imagine, la famille.
UJT, 53
Le cloisonnement de Pierre est donc lié à son incapacité à entrer en communication avec l’autre, à établir un contact qui permettrait au soi de se raconter, de se doter d’une raison de participer à l’action et, ultimement, de trouver un sens aux mots qui définissent sa présence dans le monde. Sa carapace n’a rien du scaphandre de Jack puisque, enfermé dans la pierre, à l’instar de la statue, Pierre ne peut être qu’un témoin passif qui se fond dans l’espace, dans le décor, de manière à disparaître aux yeux des autres[6], rompant du même coup les voies de communication. Autrement dit, la statue ne permet pas ce lien avec l’autre que le scaphandrier implique avec son câble qui le rattache à la surface et sert à lui fournir l’oxygène nécessaire pour survivre dans les profondeurs qu’il explore. Il résulte de ce défaut de communication un effacement du soi, dont le sens part à la dérive puisqu’il ne trouve rien à quoi se rattacher.
Cette impossibilité à communiquer qui conduit à l’effacement du sujet est au coeur des romans qui précèdent Volkswagen Blues, où l’isolement des personnages apparaît comme autant d’échos à l’enfermement de Pierre. On retrouve la même difficulté à nommer le monde, à donner un sens aux mots qui le décrivent et permettent de décrire sa propre présence au monde. Jimmy peut bien affirmer que « ce qui est important, crotte de chat, c’est qu’on se parle » (J, 85), il appert que la communication entre le sujet et le monde conduit inévitablement au silence parce qu’elle passe difficilement dans le réseau en raison d’un brouillage des ondes — comme Jimmy en fait d’ailleurs lui-même l’expérience lorsqu’il s’écrit qu’il « a envie de PARLER AVEC QUELQU’UN » (J, 179) et qu’il se met au poste de radio pour lancer sur les ondes du trafic naval un S.O.S qui se perd dans les interférences : « BESOIN DE TENDRESSE, CROTTE DE CHAT ! BESOIN DE TENDRESSE ! Over. » (J, 181) L’appel reste sans réponse, et l’isolement n’en est que plus évident. Les personnages qui peuplent les premiers romans sont ainsi aux prises avec une incapacité à se sortir de leur isolement[7] et à établir de véritables contacts avec les autres pour éviter de sombrer dans une dérive intérieure. Prisonniers en eux-mêmes, ces personnages sont toujours dans le refoulement de leurs désirs ou de leurs sentiments, ce qui les amène à s’inventer autrement par des histoires qu’ils se racontent à eux-mêmes, sans jamais les partager avec les autres. Loin de leur permettre de prendre pied dans le réel, ces récits intérieurs finissent par les engloutir au point de les exclure totalement du monde, qu’ils n’arrivent plus à habiter à la fin des romans.
Les grandes marées, à travers le destin de Teddy, vient en quelque sorte fermer la boucle de cette écriture de la dérive du soi, Volkswagen Blues permettant enfin au héros de repenser, notamment grâce à l’image du scaphandrier, la place qu’il occupe dans le monde. Les grandes marées met en scène la construction d’une société sur une île où Teddy, qui l’habite d’abord seul pour se consacrer à son travail de traducteur, doit s’accommoder de l’arrivée d’autres personnages que son patron envoie pour lui tenir compagnie, mais dont il ne souhaitait pas d’emblée la présence. Autour de ces personnages se définit lentement une société qui repose sur des valeurs d’engagement, d’unité et d’utilité sociale. L’incapacité de Teddy à s’engager envers les autres, à participer à l’effort collectif et à justifier son utilité aux yeux des autres provoquera son exclusion de l’île. En effet, Teddy n’arrive jamais à s’adapter au contexte social qui prend forme autour de lui, à traduire (pour faire l’analogie avec son travail) sa présence au monde de manière à faire sens avec les autres, avec son contexte. À ce sujet, il n’est pas étonnant que, à partir du moment où les autres personnages arrivent sur l’île et exigent une participation active de sa part, Teddy n’arrive plus à trouver les bons mots pour donner à ses traductions le sens adéquat. Le roman reprend alors un questionnement qui apparaît dès Mon cheval pour un royaume et qui reste irrésolu dans les romans qui suivent : comment définir un monde qui nous échappe au point d’y être étranger ? L’incapacité de Teddy à trouver le bon sens à ce monde l’amène à être rejeté de la société[8] : d’abord, il apprend que son travail ne sert à rien puisqu’il a été remplacé par un « cerveau électronique » qui s’occupe désormais, et de manière plus efficace, de faire les traductions au journal où il travaille ; ensuite, il souffre d’un engourdissement des membres qui réduit sa mobilité, c’est-à-dire sa capacité à participer aux tâches collectives. Lors de la répartition des tâches, le groupe explique à Teddy que la « répartition ne prévoit rien pour ceux qui sont affligés d’une incapacité physique temporaire ou permanente » (GM, 215). Pourtant, l’Animateur affirmait plus tôt que, dans le groupe, « [n]ul n’est une île », et que chaque habitant, particulièrement les plus marginaux, possède « une réserve d’énergie vitale » (GM, 175) au maintien de la société. Or, l’inutilité de Teddy amènera les autres à le mettre en exil, lui faisant valoir qu’il est non seulement hors de la norme, mais qu’il est « même en dehors de la marge » (GM, 206). La petite société de l’île l’oblige alors à affronter les courants du fleuve et à nager jusqu’à l’île voisine, où il découvre un vieil homme changé en pierre, rappel de l’état d’immobilité de Pierre, qui confirme du même coup l’exclusion provoquée par le manque d’engagement du héros dans la société qu’il habite avec difficulté[9].
Dans Volkswagen Blues, ce rapport au monde change grâce à la rencontre de la Grande Sauterelle, avec qui Jack établit une communication, ce qui lui permet de ne pas sombrer, à l’inverse des personnages qui le précèdent, dans l’effacement du soi. Jack n’est jamais enfermé dans la pierre, il est dans le scaphandre qui maintient un contact avec le monde extérieur, avec le monde réel. Ce contact ne repose cependant pas sur le rapport du sujet avec une représentation collective du monde, comme c’est le cas dans Mon cheval pour un royaume ou Les grandes marées, mais plutôt sur l’intimité des personnages : Jack et la Grande Sauterelle échangent, discutent, dialoguent dans l’espace exigu du vieux Volks, acceptant du même coup de se dévoiler, de se penser à travers le regard de l’autre et de se laisser altérer par le récit de cet autre. En ce sens, il est significatif que le personnage qui s’efface dans Volkswagen Blues soit celui de Théo, c’est-à-dire le personnage qui, tant dans Faites de beaux rêves que dans les souvenirs de Jack, porte en lui les grandes figures héroïques qui donnent une représentation monolithique du grand récit américain. Sans pourtant affirmer qu’il n’est pas le héros qu’il dit être dans Faites de beaux rêves[10], il est possible de douter du véritable caractère héroïque de Théo, d’autant plus que, dans Volkswagen Blues, il apparaît à la fin du roman comme un homme diminué physiquement, en fauteuil roulant, et même intellectuellement, puisqu’il a perdu l’usage de sa langue maternelle. Il représente celui qui, à force de se laisser porter par l’histoire des grands héros américains, finit par oublier qu’au-delà du mythe, le récit est fragmenté en histoires intimes, celles plus vraies des héros ordinaires. Il revient d’ailleurs à un travailleur social de poser cet effritement du grand récit alors qu’il explique à Jack que son frère souffre d’une maladie nommée « creeping paralysis », qui le paralyse, et que Jack et la Grande Sauterelle associent à une image en complète opposition avec celle du début du roman : « [L]’image d’un homme rampant sur le sol comme un insecte. » (VB, 315) Plus encore, l’apparition d’un Théo diminué vient confirmer l’identité qu’on lui attribue sur une photo du Café Trieste de San Francisco, soit celle d’un unidentified man, un homme sans identité ou plutôt à l’identité atrophiée, oubliée, inconnue[11]. Dans son introduction à Faites de beaux rêves, Pierre Filion remarque que « Théo occupe toute l’avant-scène à lui seul, menant beaucoup de tapage pour se convaincre et convaincre les autres de sa propre existence » (FBR, 6) ; il joue un jeu de rôle que son frère Amadou accepte d’emblée pour éviter d’affronter sa propre vérité. Filion précise que, ce faisant, les personnages passent à côté de leur vie : « Incapables de supporter leur vision du monde, ces personnages inventent, jouent des personnages eux-mêmes à l’intérieur de leur propre errance, se construisent un lieu auquel ils finissent par croire, parce que la parole peut faire tout exister et tout disparaître, et qu’ainsi tout est possible. » (FBR, 6-7) En d’autres mots, les personnages se réfugient derrière une carapace qui les amène à perdre pied et à dériver dans le monde de l’imaginaire, ce qui ne se produit pas dans le cas de Jack grâce à la présence de la Grande Sauterelle qui lui permet de s’ancrer dans le réel. En fait, dans ce parcours, Pitsémine joue un rôle d’une importance capitale puisqu’elle oblige Jack, par ses récits et par ses réactions à ceux de Jack, à nuancer son rapport au monde : elle intervient constamment dans le récit de Jack, l’empêchant de sombrer définitivement dans une sorte de complaisance du soi. Contrairement à Amadou qui refuse de poursuivre la discussion remettant en question ce qu’on sait de Théo, Jack accepte d’établir un dialogue même s’il doit pour cela repenser les fondements de son identité. Ainsi, bien que le roman, comme ceux qui le précèdent, s’ouvre sur la même menace de dérive du personnage[12], Jack progresse ici au fil de la narration en se détachant d’une image mythifiée du monde et en se réconciliant avec ses vérités intimes.
Ce changement qui intervient dans le rapport qu’entretient Jack avec son entourage, la mise en dialogue de son récit avec celui de l’autre, modifie la posture du personnage, qui n’est plus cette entité socialement inutile des romans précédents, puisque la société elle-même s’efface derrière la fragmentation du grand récit. Cela se traduit par une redéfinition ouverte du sujet, de l’individualité, comme le remarque Jack lui-même en qualifiant la nouvelle identité de Pitsémine lorsqu’elle affirme n’être rien, ni une Blanche ni « une vraie Indienne ». Jack se dégage effectivement des a priori qui forment les identités, il n’est plus question de Blancs, d’Indiens ou d’entre-deux identitaire, mais d’une identité métissée dont la formation repose sur la rencontre avec d’autres individus : « Je trouve que vous êtes quelque chose de neuf, quelque chose qui commence. » (VB, 247) Le désir de Pistémine de rester à San Francisco s’explique ainsi par la volonté qu’elle démontre de mieux saisir cette identité qui prend désormais acte de la fragmentation de l’Histoire en histoires : « elle pensait que cette ville, où les races semblaient vivre en harmonie, était un bon endroit pour essayer de faire l’unité et de se réconcilier avec elle-même » (VB, 317-318), ce qui paraît impossible pour les personnages des romans précédents[13]. À l’isolement du sujet face à une société à laquelle il n’adhère pas qu’on trouve dans les premiers romans, Volkswagen Blues oppose la volonté des personnages de se réconcilier avec eux-mêmes dans un monde fragmenté. Si Jack revient à sa vie tranquille de Québec pour écrire, ce n’est pas sans d’abord s’être laissé porter par le récit de l’autre qui s’est avéré, en dernière analyse, être aussi le sien.
À partir de ce moment, les personnages de Poulin ne restent plus en marge du récit, ils ne sont plus de simples spectateurs, mais prennent part à l’action — même si ce n’est jamais de manière grandiose[14] —, donnant ainsi une nouvelle profondeur, intime, au monde qu’ils habitent. Cette inscription du sujet dans le récit repose en grande partie sur son ouverture à entrer en communication avec les personnages qu’il croise, à écouter leurs histoires et à les mettre en lien avec les siennes, à l’instar de Shéhérazade qui sauve sa vie et celle de sa soeur par la multiplication des récits. Par exemple, dans Le vieux Chagrin, même si Jim n’arrive jamais à établir un réel contact avec Marika, et ce, malgré plusieurs tentatives, son incapacité à communiquer et son sentiment d’abandon — qui se superpose au récit de sa séparation — ne le poussent pas à l’effacement du soi puisqu’en fin de parcours, une voie de communication parallèle finit par s’imposer à travers son dialogue avec la Petite, dont l’histoire intime rejoindra la sienne. Il importe par ailleurs de souligner que Jim, à l’instar de Jack, craint de partir à la dérive lorsque le radeau gonflable dans lequel il s’est endormi est emporté par la marée[15], vers la fin du récit. Au moment de cette fausse dérive, il croit apercevoir dans la brume l’ombre du voilier de Marika qui glisse sur l’eau, ce dont il doutera une fois revenu sur le rivage : « [J]e ne savais plus très bien si j’avais réellement aperçu le voilier de Marika. » (VC, 173) Ce dernier quitte finalement la baie peu de temps après cet événement, et le vide laissé par l’absence de la femme — pourtant jamais rencontrée — qu’il associe à sa moitié féminine[16] sera vite comblé par la présence de la Petite, qu’il adopte. En fait, Marika aura été le prétexte à un recentrement de Jim sur cette moitié féminine qui lui permettra de ne pas sombrer entièrement dans sa solitude.
À la suite de Volkswagen Blues, il semble donc que les personnages parviennent à trouver leur alter ego, du moins un moyen de redéfinir le sens du soi dans l’autre, même si la figure qui s’impose n’est pas toujours celle que les personnages recherchent ou que le lien qui se crée reste parfois assez mince. À la fin, le héros ne sombre plus dans une solitude funeste et, aussi profond qu’il plonge en lui-même, il maintient un lien avec la surface qui le garde en vie. Ainsi, La tournée d’automne et Les yeux bleus de Mistassini illustrent parfaitement cette évolution de l’univers narratif de Poulin : le premier roman met en scène un personnage, le Chauffeur, qui garde, dans un coffre du bibliobus qu’il conduit à travers les régions de l’est de la province, un « tuyau flexible en matière ignifuge dont la longueur était suffisante pour relier le pot d’échappement à la glace de la portière du conducteur » (TA, 71) ; dans le second, on retrouve un Jack Waterman obsédé par son inutilité en tant qu’écrivain, qui n’arrive plus à écrire et qui, pour remédier au problème, réclame qu’on lui donne la petite poussée nécessaire pour mettre fin à ses jours le moment venu[17]. La présence de Marie pendant la tournée des villages du Chauffeur, le rapport qui s’établit entre elle et lui, permettra à ce dernier d’envisager une nouvelle tournée à l’automne et, par le fait même, de renoncer au suicide. Plutôt que de se laisser mourir asphyxié dans la bulle fermée du minibus, il décide d’ouvrir ce dernier à la fraîcheur de l’air extérieur que représente Marie. Dans Les yeux bleus de Mistassini, c’est la présence du duo Jimmy/Mistassini qui va permettre à Jack de trouver un nouveau sens à sa présence au monde. Mistassini accepte de prendre en charge la librairie de Jack, tandis que Jimmy accepte de se mettre à l’écriture sous l’égide de ce dernier :
Et puis je t’apprendrai les trucs utilisés par Hemingway. Je te montrerai comment, si on veut mettre une histoire en marche, il suffit d’écrire la phrase la plus vraie que l’on connaisse ; comment on doit s’efforcer d’écrire uniquement sur les choses que l’on connaît le mieux ; comment il faut laisser une phrase en suspens quand on termine sa journée, pour avoir un élan, le lendemain, au moment de se remettre au travail…
YBM, 199
Que ce soit à la librairie ou dans l’écriture, il reste quelque chose de Jack sans pour autant le fixer dans le temps — comme Théo qui s’efface dans un passé démythifié —, car il s’agit toujours d’aller de l’avant. D’ailleurs, Mistassini avoue avoir « déjà quelques idées pour que les gens se sentent tout à fait comme chez eux » (YBM, 198), alors que Jimmy pose d’emblée son écriture à venir sous le signe de sa sensibilité propre : « [T]out à coup l’idée me vint que, désormais, je ne serais plus vraiment malheureux, car il me serait toujours possible de mettre mes chagrins dans une histoire et de les attribuer à un personnage. » (YBM, 200) Tout cela n’est cependant possible qu’à travers la présence du vieux Jack.
Il ressort de ces romans que la solitude des personnages ne prend plus la forme d’un enfermement du soi à l’intérieur de lui-même, puisque le monde se construit désormais sur des fragments de récit et qu’ils parviennent toujours à trouver quelqu’un avec qui se raconter des histoires. Ce sont ces histoires, remarque Jean Morency, qui deviennent finalement le fondement du récit, puisque l’écrivain, « plutôt que de raconter des histoires, […] préfère se raconter des histoires[18] ». L’écrivain ne disparaît pas de l’oeuvre de Poulin, mais l’écriture apprend à se nourrir de ces histoires qu’on se raconte et qui deviennent le moteur de l’imaginaire, comme le fait remarquer l’éditeur à Jack en lui rappelant la méthode de travail d’Hemingway : « [J]e dis seulement qu’il vaut mieux s’arrêter entre deux livres, prendre le temps de vivre. Comme faisait Hemingway. C’est une façon de renouveler l’inspiration. » (YBM, 65) Jack donnera d’ailleurs sa version de ce conseil à Jimmy quelques pages plus loin, lorsqu’il lui dit qu’il devrait voyager pour se « mettre du plomb dans la tête ! » (YBM, 81) :
Ça sert quand on veut faire un travail d’invention (c’est le mot qu’il employait le plus souvent au lieu de création qui lui semblait prétentieux). Les images qu’on invente, par exemple en écrivant, sont le reflet de celles qui dorment dans notre mémoire. C’est comme si on avait un miroir au fond de nous-mêmes.
YBM, 82 ; l’auteur souligne
Le travail de l’écrivain, tel que le décrit ici Jack, reprend donc l’image du scaphandrier, de l’homme qui plonge dans l’écriture avec l’assurance, d’une part, qu’il y a quelqu’un qui s’inquiète et veille sur lui pendant les phases d’inspiration et, d’autre part, qu’il peut périodiquement remonter à la surface pour rétablir le contact avec le monde, avec son monde. La figure de l’écrivain dans les derniers romans, particulièrement dans Un jukebox dans la tête, confirme bien cette transition posturale entre la carapace de pierre et le scaphandrier.
LA PLONGÉE DE L’ÉCRIVAIN EN SCAPHANDRIER
La vérité, dit-il avec une colère rentrée qui ne lui était pas coutumière, c’est que le travail de l’écrivain n’a rien à voir avec la communication. Au contraire, l’écriture est une activité tout à fait égocentrique, et ceux qui s’y adonnent ne s’intéressent qu’à eux-mêmes et à la satisfaction de leurs propres besoins.
YBM, 67
Dans Le coeur de la baleine bleue, Noël affirme avant de mourir que, « quand on arrête [d’écrire], ça fait du tort à tous les autres » (CBB, 155), mais il appert, à partir de Volkswagen Blues, que c’est l’acte de raconter comme lieu d’une communication et d’une communion avec l’autre aussi bien qu’avec soi-même qui représente le meilleur moyen de faire du bien à l’autre autant qu’à soi. L’écrivain, comme le fait remarquer Jean Morency, cède alors la place à « des avatars modernes de l’écrivain » qui prennent en charge la narration du récit. Pourtant, il ne disparaît pas complètement de l’oeuvre de Poulin, pas plus, d’ailleurs, que la grande solitude que Jack rattache justement, dans Volkswagen Blues, à sa condition d’écrivain. L’écriture n’apparaît cependant plus comme un moyen de ne pas vivre, de s’effacer du monde et de s’enfermer à l’intérieur de soi, dans les profondeurs de sa carapace. En fait, fondée davantage sur le principe du scaphandrier, l’écriture deviendrait plutôt un moment d’introspection pour l’écrivain, lequel cherche dans sa mémoire les matériaux nécessaires à la construction d’un monde qui trouverait tout son sens dans l’espace réel qu’il habite, mais qui permettrait du même coup de donner du sens à ce dernier. La présence de Jack dans les derniers romans relève d’ailleurs de ce mouvement qui pose l’écrivain entre les moments d’introspection liés à son écriture — qui ne représentent jamais une rupture aussi complète qu’il ne le laissait paraître dans Volkswagen Blues — et ceux de sociabilité. En ce sens, Jack met en pratique la méthode d’écriture d’Hemingway, faisant du confinement de l’écrivain dans l’écriture une plongée en scaphandre au coeur des souvenirs, des expériences, des récits, tant les siens que ceux des autres, pour en sortir une histoire — dont le lecteur réel ne prendra évidemment jamais connaissance.
Cette plongée est d’ailleurs bien décrite dans Volkswagen Blues, même si Jack n’y associe pas clairement écrivain et scaphandrier, à travers la figure de l’« écrivain idéal » : celui-ci, lorsque lui vient une idée de roman, et même s’il passe alors une soirée avec des amis dans un bar du centre-ville, s’excuse et s’isole devant sa table d’écriture jusqu’à ce que le roman soit terminé et que, épuisé, il perde connaissance. Ce sont des amis inquiets qui le trouvent allongé au milieu d’un tas de feuilles qui n’est rien d’autre que le roman écrit d’un jet. Dans ce scénario, la première lecture du roman se fait pendant les trois jours que l’écrivain passe dans les pommes, et lorsqu’il revient à lui, c’est pour se faire dire par une amie : « C’est la plus belle histoire que j’aie jamais lue ! » (VB, 53) Le rapport avec l’écrivain reste donc assez distant et, à aucun moment, les commentaires des lecteurs ne vont aussi loin que l’interprétation révolutionnaire formulée par le représentant du Front au sujet des romans de Pierre dans Mon cheval pour un royaume : il s’agit toujours de compliments timides qui montrent que les protagonistes ont lu et apprécié les romans de l’écrivain. Les quelques fois où le lecteur de Poulin a accès à l’histoire que l’écrivain du roman écrit, elle avorte faute d’intérêt ou, plutôt, de concordance de sens entre la fiction et la réalité, comme dans Le coeur de la baleine bleue ou Le vieux Chagrin. Jean Morency le remarquait à la suite de sa lecture du Vieux Chagrin : ce sont plutôt les histoires intimes qui se posent désormais au coeur du récit, reléguant à l’arrière-plan le travail de l’écrivain.
Cette représentation de l’écrivain en « scaphandrier » se manifeste particulièrement dans les derniers romans de Poulin. Elle est souvent mise en lumière par la présence d’un autre qui intervient pour appuyer l’écrivain dans son processus d’écriture, pour lui fournir l’aide/l’oxygène nécessaire à sa survie pendant la plongée. Francis, par exemple, le petit frère de Jack, affirme à quelques reprises que, avec la Petite Soeur, ils veillent sur ce dernier pendant ses périodes d’écriture. Il explique notamment à quel point « Jack est un maniaque du travail », que le roman qu’il écrit « engloutit sa vie » et qu’il doit régulièrement faire appel à lui pour combler ses trous de mémoire : « Du haut de la Tour, il m’appelle de plus en plus souvent pour que je lui rafraîchisse la mémoire. Par exemple, il oublie les dates des principaux événements qui jalonnent l’histoire du Canada et des États-Unis. Je dresse des listes et des tableaux afin qu’il les affiche sur les murs de son appartement. » (ALM,45) Ailleurs, lorsque Jack manque d’inspiration et qu’il téléphone à Francis pour lui expliquer son désarroi, c’est à ce dernier et à la Petite Soeur que revient la tâche de trouver une solution : ils décident alors « qu’un aller-retour en Beauce pouvait lui permettre de retrouver ses racines et, du même coup, la source de son écriture » (HS, 53). Stratégie qui fonctionne puisque Jack, confronté à ses souvenirs, trouve de quoi nourrir son écriture : « Une lumière, qui partait de ses yeux, éclairait son visage ridé. Je crus deviner ce qui se passait : il avait résolu d’inclure ses souvenirs amoureux dans l’histoire qu’il était en train d’écrire, et cette idée allait probablement relancer son roman. » (HS, 58) Ainsi, l’isolement de l’écrivain, voire le caractère solitaire des personnages, n’a rien de funeste dans ces romans puisqu’il repose en grande partie sur une certaine sociabilité liée à l’écriture : si l’écriture est égoïste et qu’elle n’a rien à voir avec la communication, comme le signale Jack dans Les yeux bleus de Mistassini, sa mise en oeuvre, elle, a tout à voir avec le récit social, pris dans sa fragmentation en histoires intimes, qui entoure l’écrivain.
La scène où Francis et la Petite Soeur amènent Jack en Beauce illustre particulièrement bien le maintien de ce lien qui existe entre l’écrivain et le monde, un lien qui trouve moins son sens dans l’utilité sociale de l’écriture que dans l’intimité des rapports interpersonnels. Dans Un jukebox dans la tête, son dernier roman à ce jour, Poulin pose clairement ce rapport à l’écriture qui se dessine depuis Volkswagen Blues alors qu’on assiste véritablement au travail de l’écrivain en scaphandrier, c’est-à-dire en plongeur qui affirme son double besoin d’isolement et de sociabilité. Ainsi, au fil de ses rencontres avec Mélodie, qui apparaît, selon le récit qu’elle lui fait de sa vie, comme une personne solitaire éprise de liberté individuelle, Jack en vient à son tour à affirmer son besoin d’isolement dans l’écriture. Ce besoin de solitude et d’indépendance crée entre eux une certaine complicité en même temps qu’il les conduira à suivre leur route individuelle à la fin, comme Jack et la Grande Sauterelle. Aussi, c’est parce qu’il a été le témoin passif des histoires de Mélodie, qu’il a écoutée lui livrer les détails de son adolescence, de ses fuites, du temps passé dans le garage de Boris le bouncer et de la tentative de ce dernier de l’agresser, que Jack est amené à s’impliquer effectivement dans l’action, à être partie prenante du récit, lorsqu’ils découvrent que le nouveau voisin de Jack est le Boris en question. Ce type d’implication de la part du personnage n’est pas unique à ce roman puisque Jim, dans Le vieux Chagrin, et Jack, dans Chat sauvage et La traduction est une histoire d’amour, viennent aussi en aide à de jeunes adolescentes en fuite. Or, Mélodie n’est plus adolescente au moment de sa rencontre avec Jack et se présente en quelque sorte comme la figure adulte de ces adolescentes venue remercier le vieux Jack avant de reprendre le contrôle de sa vie. Le récit de Mélodie a aussi un autre effet sur Jack : bientôt, c’est à son tour de raconter une histoire, et de se dévoiler. Fidèle à son habitude, Jack refuse de parler du livre qu’il est en train d’écrire puisque, explique-t-il, « ça porte malheur » (UJT, 50), ce à quoi Mélodie répond : « D’accord. Racontez-moi comment la vie se passait quand vous étiez petit. Comment c’était d’avoir une famille, d’être avec des frères et soeurs… » (UJT, 50) L’exigence de Mélodie entraîne Jack à la confidence et, lentement, ses récits se portent non pas sur le roman qu’il écrit, mais sur le rapport qu’il entretient avec le monde pendant ses périodes d’écriture. Jack explique ainsi que, lorsqu’il écrit, il a une « intolérance aux bruits de voisinage » (UJT, 65), ce qui l’oblige régulièrement à changer d’endroit parce qu’il n’arrive pas à écrire dans les lieux habités. Paradoxalement, ces moments de refus de l’extérieur ne sont pas des moments d’isolement complet et, que ce soit à Paris, dans un village de la France ou en Californie, l’horaire de Jack prévoit des périodes de sociabilité. C’est d’ailleurs grâce à des amis qu’il peut aisément changer d’endroit, trouver des lieux d’écriture qui lui conviennent et maintenir une vie sociale, nécessaire à l’écrivain. À Collioure, par exemple, Jack explique comment sa vie, avant l’arrivée des touristes, se passait dans un parfait équilibre entre l’isolement de l’écrivain et la vie sociale de l’homme : « Non seulement j’arrivais à travailler, mais en plus je m’étais fait des amis. Nous allions ensemble voir les pêcheurs à Port-Vendres, ou bien flâner dans les rues étroites de Collioure. » (UJT, 64-65) Jack, en écrivain, cherche donc à s’isoler, à se couper du bruit ordinaire de la vie des voisins, mais en conservant une vie sociale minimale qui lui permet de se sortir de l’écriture et de faire le point lorsque nécessaire.
Le roman repense ainsi la condition de l’écrivain entre la double obligation du retrait dans l’écriture et de la rencontre de l’autre. On sait que Jack poursuit l’écriture de son roman en l’absence de Mélodie, puisqu’il y a des traces de cette écriture dans la narration, mais aussi que leurs rencontres nourrissent cette écriture. Jack en vient même à associer sa relation avec Mélodie à « un conte célèbre, celui qui mettait en scène un roi perse et la brillante Shéhérazade dans les Mille et une nuits » (UJT, 40) — livre qui est d’ailleurs au coeur du roman Le vieux Chagrin —, ce qui donne un caractère vital, d’une part, à la rencontre entre le soi et l’autre et, d’autre part, à la mise en récit de leur individualité. À force de se raconter, les protagonistes en arrivent à se rapprocher au point de se reconnaître dans l’autre, jusqu’à ce que s’établisse entre eux une véritable connexion :
Je m’étais rendu compte d’une chose importante : les récits en alternance avaient le don, presque magique, de nous rapprocher. Comment pouvait-on expliquer ce phénomène ? N’étant expert ni en linguistique ni en psychologie, je n’en savais rien. Mais je sentais que chacune de nos histoires faisait battre nos coeurs à l’unisson. C’était comme si nous partagions la chaleur d’un feu de bois.
UJT, 72
Les personnages finissent effectivement par se laisser habiter par le récit de l’autre, comme ils habitent également le récit de l’autre : Jack, lorsque Mélodie lui relate sa fuite après la tentative d’agression de Boris, affirme qu’il aurait voulu être avec elle dans le train, ce à quoi elle répond : « [C]’est comme si c’était fait. » (UJT, 116) L’implication de Jack, dès lors, dépasse l’espace des récits qu’elle lui fait puisqu’il va jusqu’à prendre Boris en filature une nuit. La poursuite se termine mal, et Jack reçoit un percutant uppercut qui lui fracture la mâchoire et l’empêche de parler pendant quelque temps. Plutôt que de sombrer dans son silence, de se laisser couler vers les profondeurs du soi, Jack trouve le moyen de communiquer en utilisant un calepin. L’écriture supplée alors à la parole et trouve son utilité au même titre que la lettre écrite par l’écrivain public (Chat sauvage) ou la biographie que rédige l’écrivain fantôme (L’homme de la Saskatchewan).
Comme c’est souvent le cas dans les romans de Poulin, la rencontre suppose d’emblée une séparation, puisque l’écrivain finira par retourner à sa solitude pour se replonger dans l’écriture tandis que les femmes qui l’accompagnent un moment reprendront leur vie de femmes indépendantes. Ainsi, Mélodie refuse de s’établir avec Jack dans une maison de l’île d’Orléans, non pas dans un mouvement de rejet, mais plutôt pour rester en accord avec elle-même tout en n’exigeant pas de Jack qu’il rompe avec sa propre nature : « Elle ne se serait pas sentie très utile. Sans cesse, elle aurait eu peur de me déranger et de me sortir de mon univers. L’écriture était plus que la moitié de ma vie. » (UJT, 145) À l’instar de Jack et de la Grande Sauterelle dans Volkswagen Blues, chacun suit le chemin qui est tracé pour lui et qui correspond à ce qu’il est au fond de lui-même, acceptant que la rencontre de l’autre, comme une parenthèse, influence sa manière d’être et le fasse progresser dans la vie. La séparation n’est pas rupture complète cependant, et le lien d’amitié persiste, comme on le constate avec le retour de la Grande Sauterelle dans L’homme de la Saskatchewan.
LE SOI ET L’UNIVERSEL
Volkswagen Blues constitue un roman charnière de l’oeuvre que construit Jacques Poulin depuis la parution en 1967 de Mon cheval pour un royaume. Si les protagonistes des premiers romans sont aux prises avec un certain étouffement social, le sujet n’arrivant pas à communiquer avec les autres parce qu’incapable d’accorder son caractère solidaire avec la pression d’un engagement social, Volkswagen Blues amène les personnages à redéfinir leur identité au-delà de cette pression sociale, c’est-à-dire en acceptant le caractère éclaté, fragmenté, individualisé, de la société contemporaine. Le roman, comme l’ont souligné plusieurs chercheurs, prend ainsi acte des changements sociaux et culturels que le Québec connaît au début des années 1980, soit au lendemain de l’échec du premier référendum pour la souveraineté. Pierre Nepveu remarque que le roman de Poulin, à travers sa relecture de l’histoire du continent au fil d’une traversée qui sert en quelque sorte à remplir l’espace de son véritable sens, peut se lire « comme une métaphore de la nouvelle culture québécoise : indéterminée, voyageuse, en dérive, mais “recueillante”[19] ». Pierre L’Hérault, reprenant la lecture de Jean Levasseur[20] et de Nepveu, constate pour sa part que Volkswagen Blues dirige l’oeuvre de Poulin vers une nouvelle réflexion identitaire :
Rapprochée de l’interprétation de Jean Levasseur qui voit tous les romans de Jacques Poulin caractérisés par le mal de vivre dans une société moderne qui rejette totalement le rêve, mal de vivre qui, dans Volkswagen Blues, se transforme en virtuelle quête d’identité, la proposition de Nepveu, d’une part, montre ce que ce dernier roman ajoute aux précédents, en quoi il les explicite et, d’autre part, indique à quel point il apparaît pertinent à l’actualité québécoise, si l’on veut bien entendre par là ce questionnement du discours identitaire et culturel, de plus en plus présent et explicite depuis le début des années 80. Car, traitant du rapport à l’Amérique, à la fois perte et possession, oubli et mémoire, passé et présent, imaginaire et réel, il s’inscrit dans l’exploration d’une culture et d’une identité qui ne peuvent plus être vues comme pures, mais nécessairement métisses, non contraintes en des frontières étanches, mais en quelque sorte transfrontalières, lieux de croisement, de confluence[21].
Depuis l’engagement politique manqué de Pierre, dans Mon cheval pour un royaume, en passant par l’incapacité des personnages à habiter l’espace social dans les romans qui précèdent Volkswagen Blues, jusqu’à l’atteinte d’une certaine harmonie de l’écrivain avec le monde qu’il habite dans Un jukebox dans la tête, il aura fallu aux personnages de Poulin un lieu où le soi peut se replier sans toutefois briser le mince équilibre qu’il a établi avec l’espace social, sans se perdre dans un imaginaire intime qui frôle la folie et qui porte le soi à la limite de l’implosion.
La figure du scaphandrier offre à l’écrivain ce lieu sécuritaire d’où il peut maintenir un contact bienfaiteur avec le monde extérieur. En un sens, lorsqu’il définit le « complexe du scaphandrier », Jack Waterman pose les bases d’une sociabilité nouvelle ne reposant plus sur des formes identitaires traditionnelles qui dictent la place du soi, mais reconnaissant au contraire la diversité individuelle, ce que confirme la Grande Sauterelle dans Volkswagen Blues et qui se reflète dans les rapports interpersonnels qui se mettent en place dans les romans suivants. L’Hérault note que
le propre d’un Volks, même vieux, c’est d’être increvable, de rouler toujours, non de s’arrêter. Ainsi en est-il du texte de Poulin qui avance sans se nier ou s’arrêter sur une forme donnée, qui traverse et enregistre les discours, les langages, les images québécoises, sans pourtant s’enfermer dans une formule figée comme à l’intérieur de frontières qu’on aurait imaginées, à la suite d’un traumatisme (celui du référendum, par exemple ?), trop étanches pour être traversées[22].
Ainsi, à partir de Volkswagen Blues, il n’est plus question de rupture à la fin des romans, car cette rupture est déjà là ; or, il ne s’agit plus d’une coupure franche qui isole, mais plutôt d’un retrait temporaire et nécessaire au cours duquel les personnages acquièrent leur liberté individuelle et apprennent à naviguer dans une société qui repose désormais sur cette liberté. Jack, dans Un jukebox dans la tête, laisse d’ailleurs partir Mélodie parce qu’il comprend qu’elle tient trop à sa liberté individuelle, à son indépendance. Il s’agit alors moins d’une question nationale, celle de la posture québécoise de l’après-référendum, que d’un questionnement qui ouvre à l’universel et positionne l’individu dans un réseau plus large que la « société nationale ». Il semble alors que Jean Morency a vu juste en affirmant que « Le vieux Chagrin (1989) pourrait être considéré comme une oeuvre qui d’une certaine façon inaugure, en même temps que la chute du mur de Berlin, le troisième millénaire[23] ». D’une certaine manière, ce n’est qu’à partir du moment où les personnages de Poulin arrivent à assumer et à affirmer cette liberté du soi, cette posture universelle de l’individu dans le monde, qu’ils parviennent aussi à prendre toute la mesure de ce qu’affirmait l’étudiant en sociologie, dans Mon cheval pour un royaume : « La liberté, messieurs, c’est une chose qu’il faut choisir aussi grande qu’on est capable de la supporter ! » (MCR, 94)
Appendices
Note biographique
JIMMY THIBEAULT est professeur agrégé au Département des études françaises de l’Université Sainte-Anne où il est titulaire, depuis 2013, de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones. Il enseigne les littératures acadienne, québécoise, franco-ontarienne et francophone de l’Ouest. Ses travaux portent sur la représentation des enjeux identitaires, individuels et collectifs, dans les espaces culturels francophones du Canada. Il s’intéresse également aux transferts culturels en contexte de migration, de continentalité et de mondialisation. En 2015, il a fait paraître Des identités mouvantes. Se définir dans le contexte de la mondialisation (Éditions Nota bene, Prix Gabrielle-Roy 2015), un ouvrage qui aborde ces problématiques. Il a aussi publié de nombreux articles savants et chapitres d’ouvrages collectifs sur les littératures francophones du Canada. Il a codirigé des dossiers spéciaux de revue dans Voix et Images (2011), @nalyses (2011), Québec Studies (2012) et Francophonies d’Amérique (2014-2015), ainsi que deux ouvrages collectifs dont le plus récent, Marguerite-A. Primeau, première femme de lettres du Far Ouest canadien, avec Pamela V. Sing, qui est paru aux Éditions David en 2019.
Notes
-
[1]
Afin d’alléger le système de notes, les références aux oeuvres de Jacques Poulin mentionnées dans cet article seront indiquées par les sigles respectifs qui suivent accompagnés du folio, et placées entre parenthèses dans le texte : Mon cheval pour un royaume (MCR), Montréal, Leméac, coll. « Poche. Québec », 1987 [1967], 192 p. ; Jimmy (J), Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2016 [1969], 180 p. ; Le coeur de la baleine bleue (CBB), Montréal, Leméac, coll. « Poche. Québec », 1987 [1970], 200 p. ; Faites de beaux rêves (FBR), Montréal, Bibliothèque québécoise, coll. « Littérature. BQ », 1988 [1974], 200 p. ; Les grandes marées (GM), Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2015 [1978], 208 p. ; Volkswagen Blues (VB), Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2015 [1984], 323 p. ; Le vieux Chagrin (VC), Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2016 [1989], 187 p. ; Les yeux bleus de Mistassini (YBM), Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2015 [2002], 199 p. ; L’anglais n’est pas une langue magique (ALM), Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2009, 155 p. ; L’homme de la Saskatchewan (HS), Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2011, 120 p. ; Un jukebox dans la tête (UJT), Montréal, Leméac, 2015, 146 p..
-
[2]
Jean Morency, « Une histoire dont vous n’êtes pas le héros. Le vieux Chagrin de Jacques Poulin », Frances Fortier et Andrée Mercier (dir.), La transmission narrative. Modalités du pacte romanesque contemporain, Québec, Nota bene, coll. « Contemporanéités », 2011, p. 97.
-
[3]
Jean Levasseur, « L’ambiguïté temporelle dans Jimmy de Jacques Poulin », Les Cahiers de l’APFUCC, série III, no 2, 1989, p. 39-52.
-
[4]
Pierre Hébert, Jacques Poulin. La création d’un espace amoureux, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Oeuvres et auteurs », 1997, p. 25.
-
[5]
« Je lèche le sang. Le goût du sang, mêlé dans ma bouche à celui de la terre, est lourd, plein, en même temps suave et salin. Il y a des années que je n’avais goûté de mon sang. » (MCR, 180) Il ajoute plus loin : « L’escalier s’immobilise./Jamais je ne l’avais vu d’aussi près, touché avec mes mains, ma figure, mon ventre ; je l’avais regardé avec les pieds et croyais le connaître. » (MCR, 180)
-
[6]
Contrairement au personnage d’action qu’est Simon qui, même dans la mort, existe dans le regard de Nathalie sous la forme de Mathieu.
-
[7]
L’isolement des personnages prend différentes formes : l’imagination d’un enfant, une cage imaginaire, le mauvais fonctionnement d’une radio ou une île déserte.
-
[8]
Teddy éprouve le même doute à l’égard de la place qu’il occupe dans la société qu’en ce qui concerne sa traduction d’un passage de la bande dessinée Peanuts où il est question de conférences, sans savoir sur quoi repose ce doute, qui reste finalement innommable : « “Toutes les conférences au monticule sont annulées jusqu’à nouvel ordre” fut la traduction qui s’imposa tout de suite à son esprit. Puis il éprouva un doute. Ce n’était rien de précis, mais une sorte d’intuition : il y avait une faute quelque part dans la phrase. Il relut la traduction et le doute persista, toujours aussi vague. Il fit les cent pas durant quelques minutes. Quand il revint jeter un coup d’oeil à la phrase, il n’était pas plus avancé ; il ne savait même pas où se trouvait la difficulté. » (GM, 149)
-
[9]
Il est intéressant de noter que la description du vieil homme n’est pas sans rappeler l’image du patriote de 1837 : « L’homme, qui se tenait à l’orée du bois, était vieux et très maigre. Il portait un fusil sur la hanche. Il avait des lunettes. Il ne faisait aucun mouvement. » (GM, 208) Comme si, finalement, Teddy, faisant écho à Pierre, et de manière quelque peu prémonitoire, constatait du même souffle l’effritement du sens de la cause nationaliste qui restait ambiguë dans Mon cheval pour un royaume.
-
[10]
Jane demande effectivement à Amadou : « Il est vraiment pilote, ton frère Théo ? » (FBR, 195) Elle précise : « Parce que les courses de formule 3 en Europe sont pas terminées. C’est lui-même qui l’a dit et ensuite il a dit tabarnak et il s’est mis à m’engueuler pour rien. » (FBR, 195) La question reste cependant en suspend puisque Amadou coupe court à cette discussion : « Mon frère Théo passe son temps à dire tabarnak et il engueule tout le monde pour rien. Ça ne veut rien dire. » (FBR, 195)
-
[11]
Cette description de Théo rappelle le destin des protagonistes des romans précédents, appelés à disparaître dans leur isolement, à devenir anonymes et socialement inutiles. Théo a d’ailleurs ceci en commun avec Teddy que les deux souffrent de paralysie.
-
[12]
Dès sa rencontre avec Pitsémine, Jack, lui expliquant les raisons de son voyage, évoque la même impression de dérive qu’on retrouve chez les protagonistes des romans précédents : « Il y a des jours où vous avez l’impression que tout s’écroule… en vous et autour de vous, dit-il en cherchant ses mots. Alors vous vous demandez à quoi vous allez vous raccrocher… » (VB, 12)
-
[13]
Voir à ce sujet Jimmy Thibeault, « L’invention de la Franco-Amérique. La relecture de l’Histoire en histoires chez Antonine Maillet et Jacques Poulin », Québec Studies, no 53, avril 2012, p. 9-27, et Des identités mouvantes. Se définir dans le contexte de la mondialisation, Montréal, Nota bene, coll. « Terre américaine », 2015, 393 p.
-
[14]
Dans Le vieux Chagrin, par exemple, Jim sait très bien qu’il ne sera jamais un héros de la trempe d’Hemingway, qui « se serait dirigé vers elle en nageant d’un seul bras tenant hors de l’eau une bouteille de champagne et des verres, ses vêtements étant roulés en boule et retenus sur sa tête par la ceinture de ses pantalons » (VC, 27-28). Les protagonistes peuvent bien se prendre pour Humphrey Bogart à l’occasion, ils ne seront jamais des personnages d’action au sens des films d’action. Pourtant, ils acquièrent un surplus d’existence en s’engageant dans la vie des autres comme le fait Jim avec la Petite, qu’il finit par adopter.
-
[15]
« [L]orsque j’ouvris les yeux et me redressai, subitement inquiet, je constatai que je ne voyais plus la maison ni même le rivage. Par tempérament, je suis enclin à m’énerver en de telles circonstances, mais cette fois je conservai tout mon calme, sachant très bien que le coffre imperméable contenait une boussole et que je pouvais regagner la rive en quelques coups d’avirons. » (VC, 170-171)
-
[16]
Jim s’interroge sur la nature de Marika, il se demande si elle ne serait pas, en fait, sa moitié féminine, inatteignable : « Marika n’existait pas vraiment, elle n’était que la projection d’un désir, une partie de moi-même, ma moitié féminine, ma douce moitié. » (VC, 184)
-
[17]
Ce désir de suicide de Jack est effectivement directement lié à l’idée de l’inutilité lorsque Jimmy découvre dans un tiroir de l’appartement de Jack une citation d’Épictète : « La fête a une fin. Sors, retire-toi, reconnaissant et discret. Laisse la place à d’autres. Il faut aussi que d’autres naissent, comme toi aussi tu es né, et qu’une fois nés, ils aient de la place, des maisons et le nécessaire. Si les premiers ne se retirent pas, que reste-t-il aux autres ? Pourquoi es-tu insatiable, impossible à satisfaire ? Pourquoi encombres-tu le monde ? » (YBM, 195-196)
-
[18]
Jean Morency, « Une histoire dont vous n’êtes pas le héros. Le vieux Chagrin de Jacques Poulin », p. 109.
-
[19]
Pierre Nepveu, L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1988, p. 216.
-
[20]
Jean Levasseur, « L’ambiguïté temporelle dans Jimmy de Jacques Poulin ».
-
[21]
Pierre L’Hérault, « Volkswagen Blues : traverser les identités », Voix et Images, vol. XV, no 1, automne 1989, p. 28 ; l’auteur souligne.
-
[22]
Ibid., p. 41.
-
[23]
Jean Morency, « Une histoire dont vous n’êtes pas le héros. Le vieux Chagrin de Jacques Poulin », p. 109.