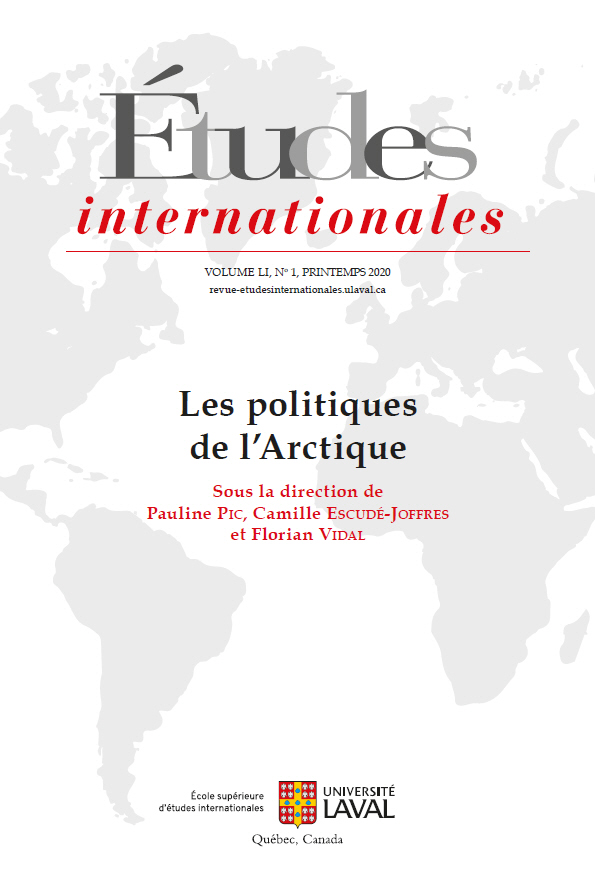Résumés
Résumé
Cet article propose d’analyser la recherche scientifique comme étant la principale voie d’intégration d’États extérieurs à la région arctique. Nous montrons que, pour un ensemble d’États européens et asiatiques, leur engagement scientifique en Arctique a été le moteur de leur insertion dans le système politique régional, en particulier dans la gouvernance, dont la structure principale est le Conseil de l’Arctique depuis 1996. Uniquement composé des huit États reconnus comme souverains dans la région et de six organisations autochtones, le Conseil a intégré treize États au statut d’« observateurs ». Nous nous intéressons ainsi dans cet article à l’activité scientifique de ces États observateurs et à la dimension plus large de la science comme instrument de diplomatie, pour une participation à la gouvernance. Cependant, le seul cadre du Conseil de l’Arctique est limité et nous montrons que la science est en réalité la voie vers d’autres formes d’intégration.
Mots-clés:
- Science,
- diplomatie scientifique,
- gouvernance,
- coopération,
- États observateurs,
- Arctique
Abstract
This article proposes to analyze scientific research as the main path for the integration of states outside the Arctic region. We show that for a set of European and Asian states, their scientific involvement in the Arctic has been the driving force behind their integration into the regional political system especially in governance, and whose main structure has been the Arctic Council since 1996. Composed solely of the eight States recognized as sovereign in the region and six indigenous organizations, the Council has incorporated thirteen States with “observer” status. In this article, we, therefore, focus on the scientific activity of these Observer states and the broader dimension of science as an instrument of diplomacy, for participation in governance. However, the Arctic Council framework alone is limited and we show that science is the path to other forms of integration.
Keywords:
- Science,
- science diplomacy,
- governance,
- cooperation,
- Observer states,
- Arctic
Corps de l’article
En Arctique, la recherche scientifique n’occupe pas autant les discours géopolitiques associés à la région que le développement des routes maritimes, l’exploitation des ressources et la supposée fin de « l’exceptionnalisme arctique »[1]. Pourtant, le réchauffement de la région et l’ensemble des bouleversements environnementaux qui lui sont associés élèvent l’Arctique en enjeu scientifique central, à l’échelle du monde. Si l’extraction des ressources et le développement des routes maritimes polaires sont avant tout une question infrarégionale et concerne de manière limitée des pays extra-arctiques, le changement climatique et ses enjeux scientifiques se projettent à une échelle internationale. La recherche scientifique en Arctique, qui se déploie principalement en réponse aux bouleversements du climat et des écosystèmes arctiques, est ainsi un dénominateur commun des États, arctiques ou non arctiques. L’Arctique est un espace stratégique pour la science et la science est une activité stratégique en Arctique.
L’objectif de cet article est d’étudier la recherche scientifique comme une activité à haute dimension politique en Arctique. Un tel questionnement n’a émergé que récemment dans la littérature relative à la région. Il s’est centré autour de deux approches. La première, plutôt historique, s’est intéressée au rôle de la science comme instrument de souveraineté dans une région encore à explorer, à revendiquer et à exploiter et participant à une compétition entre nations (Sörlin 2013; Doel et al. 2014; Roberts et Paglia 2016). L’autre s’est constituée autour de la notion de « diplomatie scientifique » (science diplomacy) en Arctique (Turekian et Neureiter 2012; Berkman 2014; Binder 2016; Babin 2019; Bertelsen 2019). L’idée de diplomatie scientifique a émergé dans le vocabulaire des relations internationales au début des années 2000 et jouit d’un certain effet de mode (Ruffini 2015). Elle est surtout définie autour de trois dimensions complémentaires, d’après un rapport publié par la Royal Society de Londres et l’American Association for the Advancement of Science (Royal Society et aaas 2010). Il s’agit, tout d’abord, de « la science dans la diplomatie », c’est-à-dire de l’utilisation de l’expertise et du conseil scientifique dans la politique étrangère; de « la diplomatie dans la science », qui s’entend comme la promotion de la communauté scientifique nationale, l’aide politique de l’État au développement des réseaux de chercheurs dans le monde et leur mobilité; et enfin, de « la science pour la diplomatie », qui renvoie au rôle des relations scientifiques pour aider à maintenir ou restaurer les liens entre des pays, pour prévenir ou substituer d’autres canaux d’échanges (Ruffini 2015). Au final, Ruffini définit la diplomatie scientifique d’un pays comme « l’ensemble des pratiques dans lesquelles s’articulent l’action des chercheurs et celle des diplomates » (Ruffini 2015 : 16). Or les régions polaires, et ici en particulier l’Arctique, peuvent être perçues comme des « laboratoires » par excellence de la diplomatie scientifique (Ruffini 2015; Bertelsen 2019).
La science, bien qu’elle ne soit pas, comme nous l’avons rappelé au début de cet article, au coeur de l’analyse politique et géopolitique de l’Arctique, est au coeur de sa gouvernance. Le Conseil de l’Arctique, principal organe de la gouvernance régionale, s’est constitué en 1996 autour de la nécessité pour les huit États membres (le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Russie et la Suède) d’ouvrir les canaux de dialogue et de développement de projets de coopération autour de questions environnementales et scientifiques (Escudé 2017). Des programmes ambitieux de protection environnementale conjoints ont émané de la coopération et des échanges scientifiques permis par le Conseil de l’Arctique, comme, en 2004, l’Arctic Climate Impact Assessment (Acia) (Nilsson 2009), qui évalue l’ampleur des changements climatiques en Arctique et dresse une série de recommandations à destination des politiques. Il est le premier symbole d’une collaboration étroite en Arctique entre la sphère politique et la sphère scientifique. Par ailleurs, le Conseil de l’Arctique n’est pas seulement ouvert aux États côtiers de la région et à six associations autochtones bénéficiant du statut de participant permanent. Treize États, extérieurs à la région, bénéficient du statut d’État « observateur ». L’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni ont obtenu ce statut dès 1998, la France en 2000, l’Espagne en 2006, la Chine, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud et Singapour en 2013, puis la Suisse en 2017. Si la question du rôle de la science dans la gouvernance arctique, en particulier dans le Conseil de l’Arctique, a été plusieurs fois analysée, le rôle des États observateurs dans ce système est resté à la marge de la littérature universitaire sur l’Arctique. Or, la recherche scientifique a été un facteur fondamental de l’obtention de leur statut (Chater 2016) et elle reste encore aujourd’hui leur principale voie d’insertion dans la région.
Alors que l’Arctique est traversé par des enjeux scientifiques sans précédent, qui se projettent bien au-delà des limites de la région, les activités liées à la recherche scientifique tendent à s’y développer et la science est portée comme le lien unificateur entre les États, arctiques et non arctiques. Dans cet article, j’interprète la science non pas comme une activité neutre qui s’inscrit dans l’idéal de « bien commun », repris par les États observateurs pour justifier et légitimer leur activité scientifique dans la région, mais comme un outil de leur diplomatie qui vise à les inscrire à la fois dans le système de gouvernance régionale et dans l’ensemble des acteurs de l’Arctique. Le seul cadre du Conseil de l’Arctique n’est pas suffisant pour l’ambition des observateurs d’être des acteurs actifs dans la région, puisqu’ils ne peuvent y exercer, par définition, qu’un pouvoir consultatif. D’autres canaux scientifiques contribuent à leur stratégie en Arctique et leur permettent de se forger une identité et une légitimité dans la région.
Cette réflexion s’organise autour de trois parties. La première s’intéresse à la science comme une porte d’entrée vers la région arctique. Une deuxième partie présente les modalités de l’engagement scientifique des observateurs en Arctique à travers quatre cas d’étude. Enfin, une troisième partie analyse le rôle de la diplomatie scientifique pour l’insertion des États observateurs dans la gouvernance régionale.
I – La science, entre rivalités et coopération, une porte d’entrée vers l’Arctique
A – L’exploration et la connaissance, un enjeu de souveraineté en Arctique
L’Arctique a longtemps été un espace de déploiement d’expéditions, dans le cadre des tentatives d’exploration du monde initiées à partir du 16e siècle. Dès 1594-1597, le Hollandais Wilhem Barentsz explore la mer au nord de l’Europe, à laquelle il a donné son nom, et l’archipel du Svalbard. Les activités scientifiques en Arctique ont été, jusqu’au 20e siècle, surtout portées par cette course à l’exploration et à l’exploit, ce qu’illustrent bien les nombreuses tentatives des aventuriers d’atteindre le pôle Nord ou encore de mettre à jour des voies de navigation. Pour citer quelques exemples, le Suédois Otto Nordenskjöld traverse en 1878-1879 le passage du Nord-Est et le Norvégien Roald Amundsen le passage du Nord-Ouest en 1903-1906. L’Américain Robert Peary prétend en 1909 être le premier homme à atteindre le pôle Nord, plus tard survolé en dirigeable, en 1926, par Amundsen et l’italien Umberto Nobile. C’est à partir du 20e siècle que se développent de véritables expéditions à but scientifique en Arctique, qui s’articulent avec la volonté des États riverains de réclamer leur souveraineté sur un espace encore sans juridiction (Sörlin 2013). L’histoire de la science en Arctique montre bien que les activités scientifiques dans la région se sont développées en lien avec des revendications géopolitiques. Pour Sverker Sörlin, « la science et la pratique scientifique constituent une présence majeure dans l’Arctique, la relative faiblesse du peuplement, de l’agriculture, des villes et des institutions conférant à la science un rôle disproportionné en tant que marqueur de la présence étatique » (2013 : 6, traduction libre). Les États riverains de l’océan polaire ont utilisé la science comme un mode privilégié de présence spatiale, d’exigence de souveraineté et de diplomatie. Dès les années 1930, l’urss a ainsi par exemple pour enjeu, grâce à l’activité scientifique, de mieux maîtriser l’immensité de son territoire, de développer une expertise pour l’exploitation de ses ressources et d’entretenir un récit de sa puissance (Doel et al. 2014). Pour les États nordiques, la science s’est révélée être une bonne voie de coopération et de dialogue avec des puissances voisines, tout en étant le porte-voix de revendications territoriales. C’est le développement des premières stratégies de diplomatie scientifique dans la région, symbolisée par exemple par le personnage de Hans Ahlmann, glaciologue suédois travaillant pour la Norvège, qui mit en place des programmes conjoints de recherche entre les deux pays scandinaves afin d’apaiser la compétition scientifique qui s’était instaurée entre eux au début du 20e siècle, tout en portant les intérêts du pays pour lequel il officiait (Sörlin 2011).
L’Arctique est donc un espace où la recherche s’est étroitement articulée avec des enjeux politiques, pour les États régionaux. Cependant, l’exploration de l’Arctique ne s’est pas restreinte aux seuls États riverains. L’une des premières expéditions majeures de la région, celle qui permit en 1596 la découverte de l’archipel du Svalbard, fut entreprise par un navigateur hollandais. Au 18e siècle, des navigateurs espagnols comme Alejandro Malaspina ou José Bustamente y Guerra explorent les côtes de l’Alaska. En 1868, l’Allemagne organise une exploration approfondie du Groenland, suivie d’un ensemble d’autres programmes scientifiques sur le territoire (Murphy 2002). La volonté de connaître cette région lointaine et mystérieuse, de collecter des données scientifiques, de réaliser des exploits techniques, mais aussi l’idée d’y exprimer des revendications de souveraineté et d’en exploiter les ressources fut le moteur d’un ensemble d’entreprises d’explorations de l’Arctique menées par des États géographiquement éloignés. Si la région est aujourd’hui un espace complètement sous souveraineté des huit États arctiques, la science fut la première prise de contact de ces quelques États européens avec ce « désert blanc » (Baudelle 2003) lointain et méconnu.
B – Une recherche arctique fortement internationalisée : le cas des États observateurs
Il convient désormais de s’intéresser précisément à l’activité scientifique de ces États extérieurs à l’Arctique et qui prennent pourtant part à la production de connaissances sur la région. Nous ne nous intéressons qu’aux treize États observateurs du Conseil de l’Arctique, mais un grand nombre d’autres États dans le monde participent à la recherche arctique, à l’instar de la Tchéquie, qui possède deux bases de recherche dans l’archipel norvégien du Svalbard. La perspective historique révèle comment la science a été pour ces États leur première et principale voie d’insertion en Arctique, mais elle ne permet pas d’appréhender leur engagement scientifique dans son ensemble. D’autres indicateurs sont à considérer, détaillés dans les trois tableaux présentés ci-dessous. Ils permettent de comprendre en quoi la science est, en Arctique, une activité internationalisée où les États observateurs ont su se ménager une place.
Le tableau 1 ci-dessous reprend les principales modalités de l’engagement scientifique des treize États observateurs. Les cinq indicateurs sélectionnés sont la présence d’une station de recherche en Arctique, le déploiement d’un navire de recherche dans la région, l’institution en charge de la gestion de l’activité scientifique, le document officiel publié par les États explicitant leur politique de recherche dans la région[2] et le nombre d’organisations scientifiques dont ils sont membres. Ainsi il est possible de comprendre par quels canaux se déploie l’activité scientifique des treize États observateurs en Arctique.
Tableau 1
Principales caractéristiques de l’engagement scientifique des Observateurs dans la recherche arctique [3]
La participation aux principales organisations de coopération scientifique internationales est détaillée dans le tableau 2. Si la science est en Arctique une activité stratégique, source de rivalité entre nations, elle a aussi été le moteur d’une coopération scientifique régionale et internationale. L’augmentation des activités de recherche et du nombre de nations impliquées a impulsé une volonté de coordonner la science dans une région où, du fait des conditions climatiques extrêmes, n’importe quel programme scientifique peut devenir très coûteux. La principale organisation internationale de coopération scientifique en Arctique est l’International Arctic Science Committee (iasc), fondé en 1990 et qui comprend 22 pays membres, dont quinze États situés hors de la région – et tous les États observateurs (sauf Singapour, qui n’a pas d’engagement scientifique polaire). Elle a pour objectif d’encourager et de faciliter la coopération de tous les pays engagés dans la recherche arctique et dans tous les domaines. Elle promeut et soutient une recherche multidisciplinaire et des programmes internationaux, propose des opportunités de communication et d’accès aux infrastructures, le tout afin de réunir une compréhension scientifique globale de la région arctique et de son rôle dans le système terrestre (Callaghan et al. 2015). Elle se divise en cinq groupes de travail spécialisés dans la recherche terrestre, la cryosphère, les écosystèmes marins et les sciences humaines et sociales. L’iasc produit des rapports sur le changement climatique en Arctique et ses impacts, en collaboration avec les groupes de travail du Conseil de l’Arctique, dont l’Acia en 2005, une référence pour la recherche environnementale en Arctique (Nilsson 2009). L’iasc et le Conseil de l’Arctique se sont également associés pour coordonner le réseau Sustained Arctic Observing Network (Saon), constitué pour formuler une série de recommandations sur la manière dont doivent être menées les activités d’observation à l’échelle de l’Arctique à long terme, afin de fournir des données gratuites, ouvertes, et de haute qualité pour les décideurs du monde et les sociétés. Outre ces organisations à grande échelle, nous prenons en compte des initiatives plus localisées, mais témoignant néanmoins de la dynamique de coopération internationale au sein de la recherche arctique, à laquelle participent les États observateurs. En Europe, deux organisations visent la coordination et le développement de programmes conjoints, l’European Polar Board et eu-Polar Net, créées respectivement en 1995 et 2015. Autour de l’archipel norvégien du Svalbard, qui comprend des stations de recherche de quatorze nations dans le monde, dont douze non arctiques, la Norvège a mis en place depuis 2008 le système de coordination Sios auquel participent six des États observateurs. Il permet de coordonner les activités scientifiques menées sur l’archipel et le partage d’informations entre les vingt-trois institutions membres. Enfin, les États asiatiques ont aussi mis en place leurs propres organisations de coopération scientifique en Arctique, à l’instar du Pacific Arctic Group, groupe de dialogue et de coordination entre les instituts de recherche d’États asiatiques comme le Japon, la Corée et la Chine, et des États arctiques tels que les États-Unis, le Canada et la Russie, mis en place sous la direction de l’iasc. L’Asian Forum for Polar Sciences (Afops) réunit depuis 2004 six pays asiatiques, certains n’ayant pas de statut d’observateur au Conseil de l’Arctique, comme la Malaisie ou la Thaïlande. L’étude des organisations de coopération scientifique en Arctique montre bien l’intérêt scientifique international pour la région et l’engagement des États observateurs dans la recherche, la coordination et le partage de données.
Tableau 2
Principales institutions de coopération scientifique en Arctique dont sont membres les Observateurs
Le tableau 3 explore une autre modalité de l’engagement des États observateurs dans la science arctique, à travers leur production scientifique. Il s’appuie sur un ensemble de données bibliométriques, issues de trois bases rendant compte, d’une part, des publications relatives à l’Arctique (d’après les rapports d’Aksnes et al. 2016 pour UArctic et d’Aksnes 2017 pour le Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education – Nifu); et d’autre part, du nombre de projets menés au Svalbard, à partir de la base de données Research in Svalbard (Strouk 2020). Ainsi sont pris en compte la production scientifique des États observateurs, tant au sein du pays lui-même par le nombre de publications, que dans l’Arctique par le nombre de projets au Svalbard, où dix des treize observateurs ont une station de recherche. Le cas du Svalbard permet d’avoir une idée, bien qu’incomplète, de l’action scientifique engagée par les observateurs sur le terrain, et pas seulement dans les documents politiques ou dans les institutions de coopération internationales. Enfin, pour permettre de comprendre et d’évaluer l’intensité de la production scientifique des observateurs, nous avons renseigné leur classement, parmi tous les États et parmi les seuls États observateurs, pour chaque indicateur bibliométrique. Si, en considérant tous les États, même les États arctiques, les observateurs ne sont pas les principaux contributeurs scientifiques, certains pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine se situent en tête des publications et projets au Svalbard, devançant régulièrement des États arctiques. Ainsi, le Royaume-Uni est, d’après le rapport Nifu 2017, le quatrième État en termes de publications, devant le Danemark, la Russie, la Suède et la Finlande (Aksnes 2017).
Tableau 3
Comparaison bibliométrique – nombre de publications relatives à l’Arctique et nombre de projets au Svalbard des Observateurs [4], [5], [6], [7], [8]
II – Deux catégories d’États observateurs engagés dans la recherche arctique
Les États observateurs sont donc des contributeurs majeurs à la production de connaissances et à l’activité scientifique en Arctique. Deux catégories d’États observateurs peuvent être pris en compte, selon leur engagement dans la recherche arctique. D’une part, un groupe d’États européens, dont l’engagement scientifique historique dans la région est la base d’un réseau d’institutions et de chercheurs développé et actif, tant sur le plan national qu’international. L’autre groupe est constitué d’États majoritairement asiatiques, dont l’expertise polaire s’est d’abord développée en direction du pôle Sud avant de se tourner vers le Nord. Ce décalage historique est marqueur de différences dans leur engagement scientifique, mais les États asiatiques témoignent d’un intérêt croissant et rapide pour l’Arctique. Afin de comprendre plus précisément comment se déploie leur engagement scientifique, nous nous intéresserons en particulier au cas de quatre États, représentant les deux groupes évoqués ci-dessus : la France et la Pologne d’une part, la Chine et le Japon d’autre part.
A – Les États « européens » : les cas de la France et de la Pologne
Sept États sont compris dans cette catégorie : l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse. Bien qu’ils soient tous localisés sur le continent européen, ce n’est pas leur situation géographique qui a été le critère déterminant pour ce premier groupe d’États observateurs. Il s’agit de pays anciennement (par-là, nous entendons depuis le 19e ou la première moitié du 20e siècle) engagés dans la science arctique. À l’initiative d’expéditions scientifiques qui ont participé à l’appréhension de la région, ils ont tous, à l’exception de la Suisse, obtenu le statut d’État observateur du Conseil de l’Arctique entre 1998 et 2000. Aujourd’hui, ils témoignent d’un réseau scientifique développé et dynamique, dont la légitimité repose sur son ancienneté, une production relativement importante et des collaborations nombreuses. Nous nous appuierons en particulier sur les exemples français et polonais.
La France
La présence de la France dans le Grand Nord remonte à la première expédition exploratrice et scientifique menée en 1902 par l’explorateur français Jean-Baptiste Charcot, qui a navigué autour de l’Islande et est remonté au-dessus du cercle polaire, près de la banquise arctique. Puis, en 1905, 1906 et 1907, le duc Philippe d’Orléans organise, avec le capitaine Adrien Gerlache de Gomery et son équipage, trois expéditions autour du Spitzberg jusqu’au Groenland. C’est alors non seulement l’occasion de réaliser un exploit technique français, en se rendant pour la première fois à des altitudes aussi septentrionales, en faisant le relevé de nouvelles terres, mais aussi de réaliser une série de collectes de données sur les espèces locales. La première campagne scientifique française officielle en Arctique est menée en 1948-1953 au Groenland par l’explorateur et ethnologue Paul-Émile Victor, alors à la tête des « Expéditions polaires françaises » (epf), structure créée en 1947 pour organiser les expéditions du pays dans les pôles. Jusqu’en 1992, plus de cent cinquante campagnes scientifiques sont organisées sous l’égide de l’epf. Autour de ces initiatives se structure un réseau de chercheurs spécialistes de la région arctique, tant dans les sciences sociales que dans les sciences naturelles. La France se dote en 1963 de sa première station en Arctique, la base Jean Corbel, dans le Kongsfjorden, au Svalbard. Utilisée par le géographe comme pied-à-terre lors de ses terrains de recherche dans l’archipel, la base menace d’être abandonnée à sa mort en 1970. Elle est réinvestie en 1976 par une équipe de géographes de Besançon, qui entament sa rénovation et sa réhabilitation pour l’accueil de nouvelles expéditions polaires. Depuis 1999, l’infrastructure de recherche française en Arctique est complétée par une station dans le village de Ny-Ålesund, à 5 km de la base Corbel. La station Rabot fusionne en 2003 avec la station allemande Koldewey, formant aujourd’hui la base conjointe Awipev.
La recherche arctique française est aujourd’hui essentiellement représentée par l’Institut polaire Paul-Émile Victor (Ipev), groupement d’intérêt public fondé en 1992. Celui-ci est en charge de la gestion de ses deux bases arctiques et des activités de recherche françaises dans la région. Il dispose chaque année d’un budget de 16 millions d’euros pour le déploiement de programmes scientifiques en Arctique, en Antarctique et dans le subantarctique. En 2020, 79 projets de recherche étaient soutenus par l’Ipev, dont 26 en Arctique. Si l’Ipev constitue la principale représentation scientifique française dans la région, elle représente en réalité simplement le cadre opérationnel d’un réseau scientifique déployé dans le pays et tourné vers les problématiques de l’Arctique. Plusieurs laboratoires de recherche sont ainsi explicitement orientés vers l’étude des régions polaires, à la fois d ans les sciences naturelles et dans les sciences humaines. Citons par exemple dans le premier cas le laboratoire cnrs-Théma de Besançon, qui n’est pas exclusivement consacré à l’étude de l’Arctique, mais dans lequel une équipe de recherche effectue des études approfondies en géomorphologie et glaciologie sur le Svalbard – ce sont d’ailleurs eux qui ont relancé dans les années 1970 la base Jean Corbel. Les sciences sociales, si elles représentent une part moindre de l’activité scientifique française en Arctique, restent notamment représentées par le laboratoire Cearc (Cultures, Environnement, Arctique, Représentations, Climat) de l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Université Paris-Saclay. L’étude de la région arctique reste encore en France un champ à la marge, mais on constate néanmoins un intérêt scientifique développé au sein d’un petit réseau d’instituts de recherche. La recherche française en Arctique se déploie aussi, de manière encore plus marginale, par un appui explicitement politique. Depuis 2016, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (dgris), rattachée au ministère des Armées, a mandaté le groupe de réflexion (think tank) Fondation pour la recherche stratégique (frs) pour coordonner un « Observatoire de l’Arctique » qui, dans des bulletins mensuels et trimestriels, fait intervenir un ensemble de chercheurs spécialistes des différents acteurs et thématiques de l’Arctique, pour analyser l’actualité de la région et réfléchir au positionnement de la France.
Enfin, la recherche arctique française n’est pas uniquement déployée à l’échelle du pays, mais s’inscrit dans des réseaux internationaux, en particulier par l’intermédiaire des organisations de coopération scientifique en Arctique. La France participe à cinq des plus importantes d’entre elles, à savoir iasc, saon, eu-Polar Net, epb et uarctic. Elle ne rejoint cependant pas les deux organisations mises en place pour la coordination de ses stations arctiques, Interact et Sios. Ainsi, après avoir accepté d’être un observateur de Sios au Svalbard, elle quitte le système de coordination, invoquant un risque d’ingérence norvégienne dans ses activités, et le coût financier d’une telle participation (Strouk 2020).
En termes de production scientifique, la France est un contributeur important, se situant, tous pays confondus, parmi les dix principaux États publiant sur l’Arctique ou ayant des projets de recherche au Svalbard. Elle n’est cependant pas située en tête des différents classements présentés dans le tableau 3. Si l’engagement scientifique de la France est ancien et développé sur plusieurs fronts, l’Arctique n’est pas une priorité pour la recherche française.
La Pologne
L’activité scientifique de la Pologne en Arctique débute dès le 19e siècle, lorsque des scientifiques et explorateurs polonais comme Jan Czerski, Aleksander Czekanowski et Benedykt Dybowski explorent les terres les plus septentrionales de l’Empire russe. La première expédition polonaise en Arctique est lancée en 1932-1933 à l’occasion de la deuxième Année polaire internationale (API). Dans ce cadre, une équipe de chercheurs polonais se rend sur l’île de Bjørnøya, au sud de l’archipel norvégien du Svalbard. Lors de la troisième édition de l’api en 1957-1958, la Pologne monte à nouveau une expédition scientifique au Svalbard, cette fois-ci au sud de l’île du Spitzberg, autour du fjord de Hornsund. Une station scientifique polonaise est ouverte et accueille des programmes scientifiques dès 1958. La base Hornsund tombe cependant à l’abandon jusqu’en 1972, où elle est peu à peu relancée dans le cadre d’un projet de recherche interministériel, jusqu’à devenir une station permanente en 1978. Depuis, le réseau d’infrastructures scientifiques de la Pologne en Arctique a été complété en 1984 et 1995 par deux bases saisonnières au Svalbard, l’une gérée par l’Université Adam Mickiewicz de Poznán, l’autre par l’Université Nicolaus Copernicus de Torún. La recherche polonaise se déploie aussi sur les mers depuis 1985, date à laquelle elle met en service un navire de recherche, la goélette Oceania, géré par l’Institut d’océanographie et utilisé essentiellement dans les eaux du Svalbard et de la Baltique.
La Pologne n’a pas d’institut polaire comme la France, mais sa recherche est coordonnée par le Committee on Polar Research (cpr) de l’Académie polonaise des Sciences (pas), mis en place en 1977. Il comprend un réseau d’une vingtaine d’institutions, tant dans les sciences naturelles que les sciences sociales. Outre la coordination des activités scientifiques, le comité est chargé depuis 1980 de la publication de la revue en accès libre Polish Polar Research, qui présente les résultats de recherche des programmes scientifiques polonais dans les régions polaires. Depuis 2012, la science polonaise en Arctique est aussi coordonnée par le Polish Polar Consortium, composé de seize institutions, et visant à approfondir la coopération scientifique dans le pays. La recherche polonaise en Arctique est multidisciplinaire, mais essentiellement tournée vers les sciences naturelles, de par l’engagement de l’Institut des sciences de la terre et l’Institut d’océanographie de la pas, à Varsovie. Elle bénéficie d’un budget annuel estimé à deux millions d’euros (2,3 millions de dollars américains) (Luszczuk et al. 2015).
Le cpr a aussi pour rôle de déployer des délégués scientifiques polonais dans plusieurs organismes de recherche arctique internationaux dont la Pologne est membre. Le tableau 2 lui comptabilise une participation à six organisations de coopération scientifique majeures dans la région. Son intégration scientifique internationale est donc profonde, puisqu’elle participe aux principales organisations de coopération, si l’on exclut celles où sa participation n’aurait pas de sens, comme le pag ou l’Afops. Malgré cet engagement scientifique déployé sur plusieurs fronts, tant au sein d’un réseau national que dans les organisations internationales, la Pologne publie relativement peu sur l’Arctique, si on la compare aux autres États et aux autres observateurs (tableau 3). Au Svalbard, où se situe sa station Hornsund, elle est néanmoins la quatrième nation à y développer des projets de recherche, témoignant d’une certaine activité sur le terrain.
B – Les États « asiatiques » : les cas de la Chine et du Japon
Nous distinguons cette première catégorie d’États engagés dans la science arctique des États, en majorité localisés en Asie, qui ont témoigné d’une activité de recherche plus récente dans la région. La Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon sont ainsi compris dans ce groupe. Mais nous ajoutons aussi l’Espagne, pays qui, malgré quelques expéditions lancées au 18e siècle autour de l’Alaska, a surtout développé sa recherche polaire vers l’Antarctique. Enfin, Singapour n’est pas pris en compte, n’ayant pas de véritable engagement scientifique en Arctique, comme en témoignent les tableaux 1, 2 et 3. Ainsi, ces cinq États ne se sont engagés que tardivement dans la recherche arctique, si on les compare aux États de la première catégorie. D’abord tournés vers l’Antarctique à partir de la seconde moitié du 20e siècle, l’Arctique n’a suscité chez eux un véritable intérêt scientifique qu’à partir des années 1990, avec l’augmentation des enjeux régionaux, en particuliers climatiques, perçus comme des préoccupations d’ordre international. Nous développerons ici en particulier les cas de la Chine et du Japon.
La Chine
L’intérêt scientifique de la Chine est un phénomène récent qui émerge à partir de la fin des années 1980 (Alexeeva, Lasserre et Huang 2015). La fondation en 1989 de l’Institut chinois de recherches polaires à Shanghai marque le lancement du programme officiel chinois de recherche arctiques. Avant cela, quelques chercheurs chinois produisent des travaux de recherche sur l’Arctique et, en 1988, l’Académie chinoise des sciences publie sa propre revue consacrée aux régions polaires, le Chinese Journal of Polar Research. En 1992, la Chine organise son premier programme de recherche scientifique dans l’océan Arctique durant cinq ans, en partenariat avec les universités allemandes de Kiel et Brême (Alexeeva, Lasserre et Huang 2015). Le pays fait l’acquisition en 1994 d’un brise-glace, le Xuelong, mobilisé dans le cadre de six expéditions en Arctique entre 1999 et 2014[9], coordonnées par la Chinese Arctic and Antarctic Administration (caa), fondée en 1981 (quand la recherche polaire chinoise était alors surtout tournée vers le pôle Sud). Un deuxième brise-glace, cette fois-ci de construction chinoise, le Xue Long 2, est opérationnel depuis 2019. Les équipements et infrastructures chinois en Arctique comprennent également depuis 2004 une station de recherche, Yellow River, située dans le village scientifique international de Ny-Ålesund, au Svalbard. En 2018, la Chine ouvre conjointement avec l’Islande une base de recherche en Islande, le China-Iceland Arctic Research Observatory, spécialisé dans l’analyse de l’atmosphère et l’étude des aurores boréales. Cette infrastructure conjointe est le prolongement d’un partenariat initié depuis 2013 entre la Chine et les pays nordiques, dont le principal symbole est la fondation la même année du China-Nordic Arctic Research Center à Shanghai, qui marque la volonté chinoise de développer une expertise arctique reposant aussi sur des partenariats internationaux, en particulier avec les pays arctiques eux-mêmes. La Chine rejoint également plusieurs organisations de coopération scientifique internationales pour la région arctique, comme l’iasc en 1996, ou encore l’Afops, à sa fondation en 2004.
Aleexeva, Lasserre et Huang (2015) ont analysé la production académique chinoise consacrée à l’Arctique et comptabilisent depuis les années 1980 plusieurs centaines d’articles, la majorité dans le domaine des sciences exactes et, depuis 2007, une part croissante de publications dans les sciences humaines. D’une part, la Chine s’intéresse aux problématiques liées aux changements climatiques et environnementaux dans la région, perçues comme relevant d’une potentielle menace pour sa propre sécurité nationale; d’autre part, elle manifeste un intérêt croissant pour les questions de souveraineté et d’analyse des politiques arctiques et des perspectives économiques. La Chine s’est imposée en une vingtaine d’années comme l’une des principales nations publiant sur l’Arctique. Ainsi, comme le rapporte le tableau 3, elle se classe 3e ou 4e en nombre de publications relatives à la région et en nombre de projets au Svalbard. D’après l’étude du Nifu, ses publications sur l’Arctique ont augmenté de 250 % entre 2006 et 2015, passant de moins de 200 à plus de 600 productions (Aksnes 2017). Cependant l’Arctique n’est pas la priorité du programme de recherche polaire chinois, qui consacre encore près de 80 % de son budget à l’Antarctique (Alexeeva, Lasserre et Huang 2015).
Le Japon
Dès le début du 20e siècle, quelques chercheurs japonais, comme le physicien Torahiko Terada, nouent des coopérations avec des chercheurs de pays arctiques et montent des programmes de recherche (Kamikawa et Hamachi 2016). En 1957, dans le cadre de la troisième API, le physicien et glaciologue Ukichiro Nakaya se rend au Groenland, comme membre d’une expédition américaine. La recherche polaire du Japon reste cependant essentiellement tournée vers l’Antarctique jusque dans les années 1990, avec l’allocation de budgets plus importants, l’organisation de plusieurs expéditions et la création de bases scientifiques. Elle se réoriente vers le Grand Nord dans les années 1990, et en particulier autour de la question de la navigation arctique et de la Route maritime du Nord (nsr). Le Japon organise conjointement avec la Norvège et la Russie un projet de recherche sur cette thématique, l’International Northern Sea Route Programme, entre 1993 et 1999. Pour Julie Babin, cette étude marqua un tournant pour l’engagement japonais en Arctique : le pays, qui n’avait jusqu’alors aucune politique pour l’Arctique, prenait part à un programme qui cherchait à démontrer l’intérêt de la navigation dans la région pour le commerce international (2019). L’étude est poursuivie de 2002 à 2005, centrée cette fois uniquement sur l’intérêt de la nsr pour la navigation japonaise. Par ailleurs, entre 1983 et 1988, sept expéditions scientifiques sont organisées par le Japon au Svalbard, avec le soutien de l’Institut polaire norvégien (Paglia 2019).
Dans le cadre de l’engagement du Japon en Antarctique, un institut polaire avait été fondé dès 1973, le National Institute of Polar Research (nipr). Il est complété, spécifiquement pour la région arctique, par l’Arctic Environment Research Center, établi par le nipr pour promouvoir l’étude de l’environnement arctique. Dans la foulée, le Japon fonde sa propre station scientifique arctique à Ny-Ålesund, au Svalbard, en 1991, tournée vers les sciences environnementales, l’étude de l’atmosphère et des glaciers (Paglia 2019). Le pays s’engage aussi dans les réseaux scientifiques arctiques internationaux, rejoignant par exemple en 1992 l’iasc et s’intégrant à des groupes scientifiques régionaux comme l’AFoPS et le Pacific Arctic Group. Le Japon continue de multiplier les initiatives de recherche en Arctique, créant en 2016 le Japan Arctic Network Center (J-Arc Net), destiné à renforcer les études interdisciplinaires, tant dans les sciences naturelles qu’humaines, que dans les domaines de l’industrie, du politique et de l’enseignement supérieur, en Arctique. Il accueille en 2015 à Toyama l’Arctic Science Summit Week, l’occasion d’inviter sur le territoire des chercheurs de toutes disciplines et de promouvoir l’expertise japonaise en Arctique, en particulier sur la question des interactions hommes-milieux et la prise en compte des peuples autochtones. Cependant, en termes de production scientifique, le Japon reste un contributeur moyen, tant en considérant tous les États que seulement les observateurs : si son engagement scientifique en Arctique s’est développé et continue de se renforcer, il ne se déploie que de manière limitée dans une véritable production de connaissances.
III – De la science à la politique : la diplomatie scientifique, un levier efficace vers la gouvernance?
L’engagement scientifique des États observateurs en Arctique n’est pas seulement le résultat d’un intérêt pour les problématiques scientifiques de la région, en particulier les changements environnementaux rapides auxquels elle fait face et qui deviennent des problématiques internationales. Il est aussi la voie vers une autre forme d’intégration, dans le système de gouvernance arctique, symbolisé en premier lieu par le Conseil de l’Arctique. La science est utilisée comme un argument de légitimité et un outil diplomatique en Arctique, vers une intégration dans ce dernier.
A – La science au coeur de la diplomatie des États observateurs en Arctique
Nous avons vu que la science a représenté, pour tous les observateurs (à l’exception, encore une fois, de Singapour), leur première et principale voie d’insertion dans la région arctique. C’est par l’intermédiaire de programmes scientifiques, d’explorations, d’institutionnalisation de la recherche polaire, de publications et de participation à des organisations de coopération scientifique, qu’ils ont construit et montré leur intérêt pour l’Arctique. Or, l’Arctique ne représente pas seulement une région aux problématiques scientifiques préoccupantes : c’est aussi une région d’opportunités économiques, commerciales et stratégiques (Lasserre 2013). Dans ce cadre, les États non arctiques, qui se sont intégrés à la région par la science, cherchent à utiliser cette activité comme un levier vers une intégration plus profonde dans le jeu politique arctique. La science est en effet une activité réputée neutre et nécessaire à l’heure de l’urgence climatique en Arctique. Pour la Chine, la recherche arctique et les différentes collaborations scientifiques qu’elle peut mettre en place sont devenues un moyen de s’intégrer à la région de manière non provocatrice et qui ne suscite pas d’inquiétudes parmi les États arctiques (Bertelsen, Li et Gregersen 2016). Alors que le pays s’intègre de plus en plus aux discussions internationales et est perçu par les acteurs régionaux comme une possible menace (Sun 2020), utiliser la science comme un levier vers le dialogue et la coopération permet à la Chine de s’insérer en Arctique malgré tout. C’est là le troisième volet de la diplomatie scientifique tel que nous l’avons défini dans l’introduction : la « science pour la diplomatie ». Ainsi, les États nordiques se montrent méfiants envers les intentions chinoises dans la région, et les tensions diplomatiques entre ces pays et la Chine ont été plusieurs fois importantes, comme lorsque la Chine projeta en 2012-2013 des dizaines de millions de dollars d’investissements au Groenland, suscitant des désaccords au Danemark (Bertelsen 2019). Mais l’établissement du China-Nordic Arctic Research Center à Shanghai en 2013 a permis à la Chine d’ouvrir un canal parallèle de dialogue, apaisé. Dans le cadre de cette coopération sino-nordique, le pays développe des échanges de chercheurs et d’étudiants avec des institutions scientifiques nordiques, des partenariats, des programmes de recherche conjoints et organise des conférences communes. La knowledge-based cooperation est ainsi l’un des piliers de la stratégie chinoise en Arctique (Bertelsen 2019). La diplomatie scientifique chinoise s’exprime aussi par la participation, et surtout l’organisation, de conférences scientifiques portant sur l’Arctique. Ainsi, elle envoie des délégués lors de forums de dialogues tels que l’Arctic Circle de Reykjavik ou l’Arctic Frontier de Tromsø. Et la Chine a accueilli elle-même, à Shanghai en 2019, une édition de l’Arctic Circle au cours de laquelle elle a mis en avant son engagement scientifique, à travers des expositions sur ses expéditions arctiques, sa station sino-islandaise, ou encore les programmes de recherche menés par son institut polaire. Une visite de l’Institut polaire chinois, le Pric, a même été organisée pour les visiteurs. Des conférences faisant intervenir des scientifiques et des politiques, chinois ou de pays arctiques, ont abordé des thématiques relatives à la science, mais surtout relatives aux opportunités commerciales dans la région. En particulier, quatre sessions de conférences ont été consacrées à la « route de la soie polaire ». La coopération scientifique internationale devient donc une plateforme vers d’autres enjeux et intérêts chinois en Arctique.
La diplomatie scientifique est en réalité un outil développé par tous les États non arctiques, en particulier ceux qui ont obtenu le statut d’observateurs du Conseil de l’Arctique. Si l’on s’intéresse aux documents politiques publiés par ces États relatifs à leur stratégie arctique, on constate une omniprésence de la science comme un pilier de leur politique dans la région. Reprenant les onze documents présentés dans la quatrième colonne du tableau 1, le tableau 4 montre que la recherche scientifique est le seul thème qui revient dans tous les documents de stratégie arctique en tant que voie d’action prioritaire dans la région.
Tableau 4
Piliers des stratégies arctiques des treize Observateurs
B – Une porte d’entrée vers le Conseil de l’Arctique
Le principal cadre de dialogue politique en Arctique est, depuis 1996, le Conseil de l’Arctique. Pour les États non arctiques, y obtenir le statut d’« observateur » est le gage d’une certaine intégration dans la gouvernance de la région (Chater 2016). Or, leur obtention de ce statut n’a reposé que sur leur participation à la science arctique, puisque c’est là non seulement le pilier de leur intégration à la région, mais aussi la raison d’être du Conseil de l’Arctique. Celui-ci, dès sa création, reposait sur la possibilité d’initier des formes de dialogue entre pays parfois rivaux, mais mus par un intérêt commun pour la protection d’un environnement menacé qu’ils partageaient tous (Escudé 2017). Ainsi, au Conseil, pas de dialogues autour de l’ouverture des routes arctiques, de l’exploitation du pétrole ou du gaz, ou des rivalités croissantes entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Seul l’environnement et la production de connaissances communes relatives à l’environnement et sa protection sont des sujets de dialogue et de coopération jugés valables.
Puisque des États, en particulier ceux que nous avons classés dans le groupe des « Européens », ont participé à cette production de savoirs scientifiques en Arctique, ils ont obtenu à partir de 1998 le statut d’« observateur » au Conseil de l’Arctique (Chater 2016). Celui-ci leur permet d’assister à une partie des réunions des membres du Conseil de l’Arctique, les Senior Arctic Officials (sao), auxquelles ils sont conviés. Ainsi, certaines de ces réunions se tiennent à huis clos, et ils n’en reçoivent qu’une retranscription partielle. La principale contribution des observateurs au Conseil de l’Arctique est leur participation aux différents groupes de travail et forces opérationnelles (task forces). Le Conseil de l’Arctique comprend six working groups portant sur la coopération scientifique autour des questions environnementales : l’Arctic Contaminants Action Programme (Acap), l’Arctic Monitoring and Assessment Programme (Amap), le Conservation of Arctic Flora and Fauna (Caff), l’Emergency Prevention, Preparedness and Response (eppr), le Protection of the Arctic Marine Environment (Pame) et le Sustainable Development Working Group (sdwg). Dans ce cadre, les observateurs ont la possibilité, et c’est même un devoir inhérent à leur statut (Chater 2016), de participer aux travaux de ces différents groupes. Ils y envoient des chercheurs et déploient leur expertise, formulent des recommandations scientifiques et contribuent financièrement aux programmes de recherche. Par la suite, les travaux et rapports produits par les groupes de travail sont transmis, à titre consultatif, aux membres du sao qui élaborent des normes et des politiques contraignantes pour les membres du Conseil de l’Arctique. C’est là la principale contribution des observateurs au Conseil, et en théorie la seule.
Les observateurs ne participent pas à ces groupes d’expertise scientifique dans le seul but de produire de la connaissance sur les problématiques environnementales de la région. Leur implication dans les groupes de travail du Conseil de l’Arctique est la principale composante de leur diplomatie scientifique en Arctique. Dans son analyse de la diplomatie scientifique du Japon en Arctique, Julie Babin identifie le rôle de « médiateur potentiel », de « force constructive » du Japon au Conseil, comme le principal volet de sa politique en Arctique (Babin 2019 : 129). Cette stratégie repose sur une série de recommandations généralistes, à caractère scientifique, et préconise d’approfondir davantage l’envoi d’experts scientifiques dans les groupes de travail du Conseil de l’Arctique. Dans sa « Feuille de route » pour l’Arctique publiée en 2016, la France fait de sa contribution scientifique au Conseil de l’Arctique une voie d’action prioritaire, à renforcer, et présentée comme un indicateur de sa « légitimité » (Gouvernement français 2016 : 20). Cependant, si la diplomatie scientifique au Conseil de l’Arctique est l’un des principaux volets de la stratégie arctique des Observateurs, elle est loin d’être satisfaisante. Pour Andrew Chater, les États observateurs sont des « acteurs faibles » dans le Conseil de l’Arctique (2016 : 173). Il constate qu’en réalité, ils ne participent que peu aux travaux des working groups. Le statut d’observateur est davantage un marqueur symbolique de l’intérêt et de l’engagement des États extérieurs en Arctique qu’un véritable levier vers une participation à la gouvernance. Pour revenir sur le cas du Japon, Julie Babin (2019) identifie trois limites qui font que le pays n’a qu’un pouvoir consultatif au Conseil : il ne participe qu’aux groupes de travail et forces opérationnelles, il ne peut proposer de projets que par l’intermédiaire d’États membres ou de participants permanents (les associations autochtones), et enfin, sa contribution financière ne doit pas dépasser celle des États arctiques. Ces limites s’appliquent à tous les observateurs.
Bénéficier d’un statut d’observateur au Conseil de l’Arctique n’est donc pas synonyme d’une véritable participation à la gouvernance de la région. Il relève davantage du symbole et de la légitimité que d’un véritable pouvoir politique. Pour quelques pays, ce statut s’avère satisfaisant : leur intérêt pour l’Arctique reste limité et ils n’ont pas d’ambitions autres que scientifiques de s’intégrer dans le dialogue régional. À ce titre, on constate pour des pays comme la Suisse ou l’Espagne (tableau 4), que leur stratégie arctique s’arrête aux enjeux scientifiques et environnementaux. Le Conseil de l’Arctique reste, pour les treize observateurs, le principal cadre en Arctique dans lequel ils peuvent user de leur diplomatie, par la science. Rappelons par ailleurs que, bien qu’ils n’aient qu’un rôle d’observation et de consultation pendant les réunions du Conseil, celles-ci sont surtout l’occasion pour les représentants des observateurs de mener un ensemble de discussions diplomatiques informelles (Escudé 2017).
Conclusion
Si le statut d’observateur ne garantit pas une voix dans la gouvernance, quel est le rôle d’une diplomatie scientifique en Arctique? En réalité, ce qui compte pour ces États, c’est de bénéficier d’une légitimité en Arctique, par la science. Cette légitimité s’exprime surtout par une participation aux travaux et réunions du Conseil de l’Arctique, mais elle est aussi une stratégie diplomatique englobante, qui se déploie à travers d’autres canaux. La légitimité scientifique est le principal levier de la diplomatie des États observateurs en Arctique. Et la diplomatie scientifique représente la principale forme de dialogue et de coopération des États extérieurs avec les États arctiques, comme l’illustre par exemple le cas de la Chine (Bertelsen, Li et Gregersen 2016). La diplomatie scientifique en tant que stratégie englobante ne s’exprime donc pas seulement au sein du Conseil de l’Arctique. Par des partenariats scientifiques bilatéraux d’abord, comme le cnarc sino-nordique; par la participation à des organisations de coopération scientifique, comme l’iasc, UArctic ou l’European Polar Board; ou encore, par la participation et l’organisation de conférences scientifiques sur l’Arctique, comme l’Arctic Circle de Shanghai en 2019 ou l’Arctic Science Summit Week de Toyama en 2015.
Mais l’échelle de l’État n’est pas la seule à prendre en considération pour comprendre l’engagement scientifique des observateurs en Arctique. Celui-ci s’exprime surtout par l’action de scientifiques, qui nouent des collaborations, forment un réseau national et international de recherche sur l’Arctique, publient et développent des programmes d’envergure. C’est l’encadrement de ces réseaux par les instituts polaires et le dialogue avec les gouvernements, puis leur utilisation à des fins de légitimité et d’intégration dans le jeu régional, qui constitue la diplomatie scientifique des États observateurs. La recherche scientifique, parce qu’elle est la première voie d’intégration des États extérieurs en Arctique, parce qu’elle fait accéder la région à l’espace international, représente un premier levier vers la gouvernance et le Conseil de l’Arctique; une porte d’entrée vers d’autres ambitions.
Parties annexes
Remerciements
Je voudrais remercier Camille Escudé, Pauline Pic et Florian Vidal pour l’organisation de ce colloque novateur en décembre 2019 au ceri -Sciences Po, qui fut l’occasion d’échanges riches autour des politiques de l’Arctique, et qui se poursuivent aujourd’hui dans cette publication. Je remercie également la rédaction de la revue Études internationales de proposer un numéro dédié à cette question qui émerge dans le champ des études politiques, ainsi que les évaluateurs pour leurs commentaires riches et constructifs.
Note biographique
UMR 8504 Géographie-Cités, CNRS et Département de géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France; Science, Technology and Innovation Studies (STIS), Department of Social and Political Science, University of Edinburgh, Édimbourg, Royaume Uni.
Notes
-
[1]
Idée selon laquelle l’Arctique est une région de paix et de coopération, au-delà des tensions qui peuvent sous-tendre les relations entre les huit États souverains (Heininen, Exner-Pirot et Plouffe 2015).
-
[2]
Il s’agit, soit d’un document de « stratégie arctique », c’est-à-dire abordant dans son ensemble les axes de l’engagement politique du pays dans la région et publié par un ministère, soit d’un document de « politique scientifique », publié par la principale institution en charge de la recherche arctique et détaillant les perspectives scientifiques du pays dans les régions polaires (ou spécifiquement en Arctique).
-
[3]
Sources : Gouvernement britannique (2019), Gouvernement chinois (2018), Gouvernement coréen (2013), gouvernement espagnol (2016), Gouvernement fédéral d’Allemagne (2019), Gouvernement français (2016), Gouvernement indien (2013), Gouvernement italien (2015), Gouvernement japonais (2015), Gouvernement suisse (2015), Netherland Organisation for Scientific Research (2014).
-
[4]
Données extraites du rapport Nifu (Aksnes 2017). Elles prennent en compte le nombre de publications scientifiques relatives à l’Arctique publiées par des institutions de chacun des pays présentés, entre 2012 et 2014. Ces données numériques sont extraites d’un traitement statistique réalisé par Nifu à partir de la base de données Web of Science. Se référer au rapport pour plus de précisions méthodologiques.
-
[5]
Données extraites du rapport UArctic (Aksnes et al. 2016). Elles prennent en compte le nombre de publications scientifiques relatives à l’Arctique publiées par des institutions de chacun des pays présentés, en 2015. Ces données numériques sont extraites d’un traitement réalisé par les auteurs du rapport à partir de la base de données Scopus. Se référer au rapport pour plus de précisions méthodologiques.
-
[6]
Données extraites de la base de données Research in Svalbard au 11 janvier 2020. Est compté comme projet d’un pays un projet issu d’une institution de ce pays, indépendamment de la nationalité des chercheurs participants.
-
[7]
Classement prenant en compte l’ensemble des États comptabilisés.
-
[8]
Classement prenant en compte les treize pays observateurs du Conseil de l’Arctique.
-
[9]
En 1999, 2003, 2008, 2010, 2012 et 2014.
Bibliographie
- Aksnes Dag, Igor Osipov, Olga Moskaleva et Lars Kullerud, 2016, Arctic Research Publication Trends: A Pilot Study, UArctic et Elsevier.
- Aksnes Dag, 2017, Norwegian Polar Research & Svalbard Research, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (Nifu).
- Babin Julie, 2019, « Diplomatie scientifique et engagement du Japon dans l’Arctique. L’exemple du Conseil de l’Arctique », Relations internationales, vol. 178, n° 2 : 119-133.
- Baudelle Guy, 2003, Géographie du peuplement, Paris, Armand Colin.
- Berkman Paul Arthur, 2014, « Stability and Peace in the Arctic Ocean through Science Diplomacy », Science & Diplomacy, vol. 3, n° 2. Consulté sur Internet (https://www.sciencediplomacy.org/perspective/2014/stability-and-peace-in-arctic-ocean-through-science-diplomacy) le 23 septembre 2020.
- Bertelsen Rasmus Gjedssø, Xing LI et Mette Højris Gregersen, 2016, « Chinese Arctic Science Diplomacy: An Instrument for Achieving the Chinese Dream? », dans Elena CONDE et Sara IGLESIAS SANCHEZ (dir.), Global Challenges in the Arctic Region: Sovereignty, Environment and Geopolitical Balance, New York, Routledge : 442-460.
- Bertelsen Rasmus Gjedssø, 2019, « The Arctic as a Laboratory of Global Governance: The Case of Knowledge-Based Cooperation and Science Diplomacy », dans Matthias Finger et Lassi Heininen (dir.), The Global Arctic Handbook, New York, Springer : 251-267.
- Binder Clemens, 2016, « Science as Catalyst for Deeper Arctic Cooperation? Science Diplomacy and The Transformation of The Arctic Council », Arctic Yearbook : 127-139.
- Callaghan Terry V. et al., 2004, « Environmental Changes in the North Atlantic Region: Scannet as a Collaborative Approach for Documenting, Understanding and Predicting Changes », Ambio : 39-50.
- Chater Andrew, 2016, « Explaining Non-Arctic States in the Arctic Council », Strategic Analysis, vol. 40, n°3 : 173-184.
- Doel Ronald E., Robert M. Friedman, Julia Lajus, Sverker Sörlin et Urban Wråkberg, 2004, « Strategic Arctic Science: National Interests in Building Natural Knowledge – Interwar Era through the Cold War », Journal of Historical Geography, vol. 42 : 60-80.
- Escudé Camille, 2017, « Le Conseil de l’Arctique, la force des liens faibles », Politique étrangère, n° 3 : 27-36.
- Gouvernement britannique, 2019, Beyond the Ice. UK Policy towards the Arctic, Polar Regions Department, Foreign and Commonwealth Office, Royaume-Uni.
- Gouvernement chinois, 2018, China’s Arctic Policy, State Council Information Office of the People’s Republic of China.
- Gouvernement coréen, 2013, Arctic Policy of the Republic of Korea, pluri-ministériel.
- Gouvernement espagnol, 2016, Guidelines for a Spanish Polar Strategy, ministère des Affaires étrangères.
- Gouvernement fédéral d’allemagne, 2019, Germany’s Arctic Policy Guidelines: Assuming Responsibility, Creating Trust, Shaping the Future.
- Gouvernement français, 2016, Le Grand défi de l’Arctique. Feuille de route nationale sur l’Arctique, ministère des Affaires étrangères.
- Gouvernement indien, 2013, India and the Arctic, Ministry of External Affairs.
- Gouvernement italien, 2015, Towards an Italian Strategy for the Arctic, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
- Gouvernement japonais, 2015, Japan’s Arctic Policy, The Headquarters for Ocean Policy.
- Gouvernement suisse, 2015, Swiss Polar Research. Pioneering Spirit, Passion and Excellence, ministère des Affaires étrangères.
- Netherlands Organisation for Scientific Research, 2014, Pole Position – NL 2.0 Strategy for the Netherlands Polar Program 2016-2020.
- Heininen Lassi, Heather Exner-Pirot et Joel Plouffe, 2015, « Governance and Governing in the Arctic: An Introduction to the Arctic Yearbook 2015 », dans Lassi Heininen, Heather Exner-Pirot et Joël Plouffe, Artic Yearbook 2015: Governance and Governing : 13-25.
- Kamikawa Yoko et Tomoko Hamachi, 2016, « Japan’s Evolving Efforts toward Sustainable Development of the Arctic », Science & Diplomacy, vol. 5, n° 3. Consulté sur Internet (https://www.sciencediplomacy.org/perspective/2016/japans-evolving-efforts-toward-sustainable-development-arctic) le 28 septembre 2020.
- Lasserre Frédéric, 2013, « Enjeux géopolitiques et géoéconomiques contemporains en Arctique », Géoéconomie, vol. 2, n° 65 : 135-152.
- Lasserre Frédéric, Olga V. Alexeeva et Linyan Huang, 2015, « La stratégie de la Chine en Arctique : agressive ou opportuniste? », Norois, n° 236 : 7-24.
- Luszczuk Michal, Piotr Graczyk, Adam Stepien et Malgorzata Smieszek, 2015, Poland’s Policy towards the Arctic: Key Areas and Priority Action, Polish Institute of International Affairs, Policy Paper no 11.
- Murphy David T., 2002, German Exploration of the Polar World: A History (1870-1940), Lincoln, University of Nebraska Press.
- Nilsson Annika, 2009, « A Changing Arctic Climate: Science and Policy in the Arctic Climate Impact Assessment », dans Timo Koivurova, Carina Keskitalo et Nigel Bankes, Climate Governance in the Arctic, New York, Springer : 77-95.
- Paglia Eric, 2019, « A Higher Level of Civilisation? The Transformation of Ny-Ålesund from Arctic Coalmining Settlement in Svalbard to Global Environmental Knowledge Center at 79° North », Polar Record, vol. 56 : 1-13.
- Roberts Peder et Eric Paglia, 2016, « Science as National Belonging: The Construction of Svalbard as a Norwegian Space », Social Studies of Science, vol. 46, no 6 : 894-911.
- Royal Society et aaas, 2010, New Frontiers in Science Diplomacy, Londres, The Royal Society Science Policy Centre.
- Ruffini Pierre-Bruno, 2015, Science et Diplomatie. Une nouvelle dimension des relations internationales, Paris, Éditions du Cygne.
- Strouk Mayline, 2020, Un archipel de l’Arctique, territoire de la science internationale. Géographie de la recherche scientifique au Svalbard, mémoire de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Sun Yun, 2020, « Defining the Chinese Threat in the Arctic », The Arctic Institute. Consulté sur Internet (https://www.thearcticinstitute.org/defining-the-chinese-threat-in-the-arctic/) le 12 octobre 2020.
- Sörlin Sverker, 2011, « The Anxieties of a Science Diplomat: Field Coproduction of Climate Knowledge and the Rise and Fall of Hans Ahlmann’s “Polar Warning” », Osiris, vol. 26, no 1 : 66-88.
- Sörlin Sverker (dir.), 2013, Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region: Norden Beyond Borders, Stockholm, Routledge.
- Turekian Vaughan C. et Norman P. Neureiter, 2012, « Science and Diplomacy: The Past as Prologue », Science & Diplomacy, vol. 1, n° 1. Consulté sur Internet (https://www.sciencediplomacy.org/sites/default/files/science_and_diplomacy.pdf) le 27 août 2020.
Liste des tableaux
Tableau 1
Principales caractéristiques de l’engagement scientifique des Observateurs dans la recherche arctique [3]
Tableau 2
Principales institutions de coopération scientifique en Arctique dont sont membres les Observateurs
Tableau 3
Comparaison bibliométrique – nombre de publications relatives à l’Arctique et nombre de projets au Svalbard des Observateurs [4], [5], [6], [7], [8]
Tableau 4
Piliers des stratégies arctiques des treize Observateurs