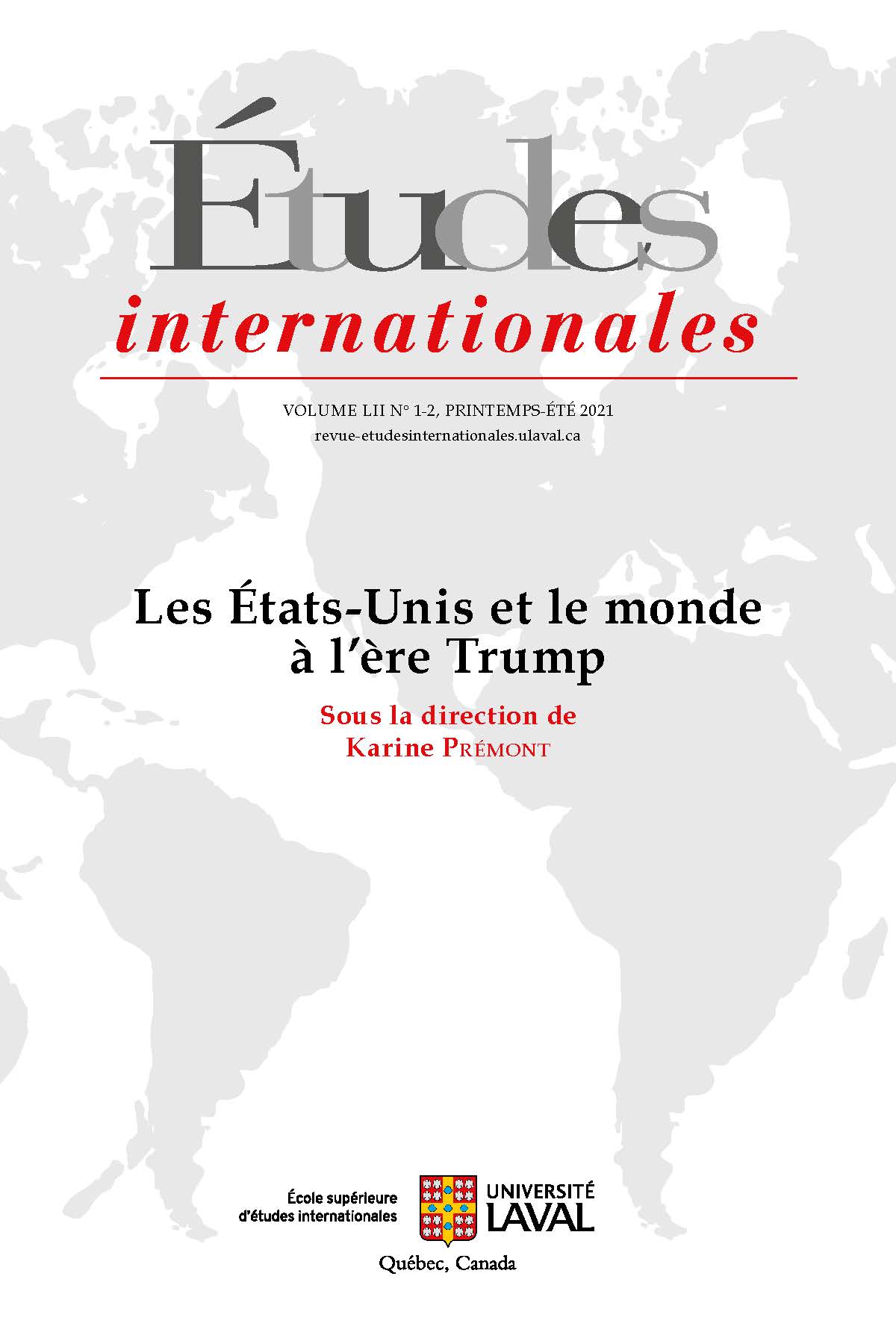Résumés
Résumé
La politique étrangère américaine ne vise plus la quête d’un « intérêt national » et des objectifs internationaux fondés sur l’appréciation au mérite mais relève plutôt de calculs politiques et de considérations électoralistes. Cette réalité n’est pas nouvelle mais elle s’est grandement accentuée sous la présidence de Trump. La question est de savoir si le président Biden pourra enrayer cette tendance. Tout indique que non. Plusieurs dimensions internes auront pour effet de miner considérablement sa politique étrangère et de contrer les espoirs d’un « retour » des États-Unis au rang de leader internationaliste, comme cela fut largement le cas après la fin de la guerre froide. La politique étrangère américaine est désormais soumise aux aléas de la politique intérieure.
Mots clés:
- Présidence américaine,
- Joe Biden,
- Trump,
- politique étrangère des États-Unis,
- facteurs domestiques
Abstract
U.S. foreign policy no longer aims at the pursuit of a “national interest” and international goals based on merit, but is essentially a result of political calculus and electoral considerations. This reality is not new but has greatly increased under the presidency of Donald Trump. The question is whether President Biden can stop this trend. The short answer is no. Several domestic factors will affect American foreign policy and undermine hopes of a “return” of the United States as internationalist leader, the way it has been after the end of the Cold War. U.S. foreign policy is now clearly subject to the vagaries of domestic politics.
Key words:
- American presidency,
- Joe Biden,
- Trump,
- foreign policy of the United States,
- domestic politics
Corps de l’article
Introduction
Lorsqu’on évoque le rôle du président des États-Unis, la thèse classique d’Aaron Wildavsky (1966) est souvent présentée comme une référence encore utile : le président aurait en fait deux rôles différents, l’un en politique intérieure et l’autre en politique étrangère. Alors que le premier rôle est difficile à mettre en oeuvre car régulièrement contesté dans l’espace public, le second serait bien plus profitable pour l’occupant de la Maison-Blanche parce qu’il dispose d’une plus grande marge de manoeuvre pour mener à bien des objectifs qui servent « l’intérêt national ». Cela a pour résultat, affirme Wildavsky (1966 : 9), « que les préoccupations de politique étrangère ont tendance à exclure celles de politique intérieure ». Si cela était peut-être vrai il y a soixante ans, ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui. La politique étrangère est en effet plus que jamais soumise aux contraintes de politique intérieure et le rôle de la présidence dans les affaires extérieures doit constamment tenir compte des dimensions domestiques. La thèse classique des « deux présidences » a dû être remise en cause. Il n’y a plus de politique extérieure distincte de la politique intérieure. Les deux n’en font maintenant qu’une et la priorité est de préserver celle-ci aux dépens de celle-là. « Les conditions qui ont mené Wildavsky à spéculer sur les différences entre les contextes domestique et international [...] n’existent plus » concluent Fleisher et al. (2000 : 21). La théorie « poliheuristique » d’Alex Mintz et Karl DeRouen (2010 : 78) juge prioritaire les répercussions domestiques des décisions de politique étrangère, notamment les risques associés aux coûts politiques des options décisionnelles : « [q]uoique les facteurs internationaux soient importants, les considérations domestiques se retrouvent au coeur de la prise de décision ». La politique étrangère ne poursuivrait donc plus un « intérêt national » et des objectifs internationaux fondés sur des critères au mérite, mais elle relèverait essentiellement de calculs politiques et de considérations électoralistes. Cette réalité n’est certes pas nouvelle dans la mesure où tous les présidents de l’ère contemporaine ont affronté des contraintes et des obstacles liés à la politique intérieure, notamment celles et ceux associés aux délibérations du Congrès, dans la formulation de leur politique étrangère. Comme on le souligne assez souvent, l’hyperpolarisation au sein de la législature a remplacé l’approche bipartisane qui prévalait durant la guerre froide. À partir des années 1980 cette approche s’est beaucoup effritée, et c’est d’ailleurs Bill Clinton qui estima à son arrivée à la Maison-Blanche que sa politique étrangère devait être subordonnée aux dimensions intérieures et économiques (David 2004). Cette tendance s’est par la suite accentuée et a atteint son paroxysme avec la présidence de Trump (David 2020 ; David et Vallet 2020). La question est de savoir si le président Biden pourra enrayer cette tendance. Jusqu’à maintenant tout indique que non.
C’est pourtant le candidat Biden qui scandait, durant la campagne électorale, que « l’Amérique serait de retour » sur la scène internationale et qu’il renverserait la plupart des décisions de Trump (ce qu’il accomplira en partie). « L’Amérique mènerait par la force de son exemple autant que par l’exemple de sa puissance ». La question était de savoir si la nouvelle équipe de politique étrangère voudrait minimalement réformer celle-ci ou souhaiterait entièrement la restaurer au stade où elle était avant l’ère Trump. Et profiter du fait qu’avec Biden les États-Unis ont élu le président le plus expérimenté dans les affaires internationales depuis G.H.W. Bush, il y a de cela plus de trente ans. Hélas, pour la plupart des observateurs, ce « retour » s’avère une chimère. « Un retour au statu quo pré-Trump n’est pas envisageable », affirme Jessica Matthews (2021 : 10). Selon Robert Kagan (2021 : 28), l’enjeu actuel de la politique étrangère américaine n’est pas que ses aspirations dépassent ses capacités mais plutôt que celles-ci dépassent celles-là, une condition assez rare dans l’existence d’une grande puissance – à tel point que « la politique étrangère est reléguée au second plan ». La désillusion est d’ailleurs palpable parmi les courants de pensée qui animent les débats sur le rôle des États-Unis dans le monde, tant chez les conservateurs que chez les libéraux qui estiment que ce rôle doit être diminué (tout en souhaitant préserver les intérêts américains dans le monde). L’engagement global est remis en question par une approche qui favorise, sauf exception, des formes de repli ou de retenue – lesquelles sont soutenues par une proportion grandissante de l’opinion publique (Kupchan 2021 ; Ashford 2021a).
Un facteur qui contribue au désenchantement est associé à ce que Walter Russell Mead (2021) surnomme la « récession wilsonienne ». L’ordre international est de moins en moins libéral et s’éloigne du modèle wilsonien, ce qui force ainsi la présidence américaine à adopter davantage le modèle « réaliste », ce qui a pour effet de lier encore plus politique intérieure et politique extérieure. Le défi pour un président est de s’assurer que tout objectif de politique étrangère sert la cause de la politique intérieure – et d’en convaincre son opinion publique. « Il est temps de répondre à la demande populaire pour faire moins de construction de la nation dans le monde mais plus en Amérique », prévient Wertheim (2021), un porte-parole influent de la stratégie de repli. Le ténor Stephen Walt (2021a) est du même avis : « le danger le plus évident est que Biden et Cie voudront reculer l’horloge à 2016 et mettre en oeuvre une grande stratégie d’hégémonie libérale lite ». Selon lui, Biden doit se préoccuper en priorité du pourrissement de la vie politique interne s’il souhaite préserver un rôle utile pour les États-Unis sur la scène internationale. Après tout, rappellent Kupchan et Trubowitz (2021 : 101), « ce qui a fait de F.D. Roosevelt un véritable grand chef d’État fut son habileté à décrypter le terrain politique national ». Si Biden veut ainsi réussir sur le plan international, il devra s’inspirer de son prédécesseur. Le problème est que plusieurs dimensions internes auront pour effet de miner considérablement sa politique étrangère et de contrer les espoirs d’un « retour » des États-Unis au rang de leader internationaliste, comme cela fut le cas largement après la fin de la guerre froide. La politique étrangère américaine est désormais soumise aux aléas de la politique intérieure et ce pour quatre raisons.
I – La dimension électorale
Deux raisons fondamentales, notamment durant la dernière décennie, ont contribué à subordonner les objectifs de politique étrangère aux impératifs de politique intérieure : la fatigue de la guerre et l’hyperpolarisation entre les partis politiques, avec pour résultat que l’action internationale des États-Unis est fortement teintée par des contraintes domestiques.
La première, la fatigue de la guerre, a été scellée par le retrait américain d’Afghanistan le 31 août dernier. Pour John Mueller (2021 : 25) rien de nouveau sous le soleil ! « La Corée, le Viêt Nam, la Somalie, l’Afghanistan, l’Irak et la Libye sont autant de résultats certainement peu reluisants : culs-de-sac épuisants, défaites avérées, retraits précipités et vastes legs de misère ». En pourchassant démesurément des « monstres à détruire », les États-Unis ont trop souvent recouru à l’intervention militaire pour accomplir leurs objectifs politiques et cela a fini par se retourner contre eux, estime Mueller. La prudence et la complaisance face à l’usage de la force auraient été selon lui une attitude plus éclairée. Adopter une approche passive à la Coolidge (le président américain durant les années 1920) aurait pu ainsi mieux servir l’intérêt national. Pourtant, l’idée de la « nation indispensable » et la volonté d’exercer le rôle de shérif sur la scène internationale ont poussé les présidents après la fin de la guerre froide, surtout G.W. Bush, à initier des interventions et des guerres coûteuses pour lesquelles l’opinion publique a perdu patience. Non seulement l’Irak et l’Afghanistan ont été les guerres les plus longues de l’histoire américaine, mais elles ont aussi entaché la réputation des États-Unis et elles ne leur ont pas permis d’accomplir leurs objectifs à long terme (instaurer la démocratie, entre autres). Le désenchantement et la volonté de changement expliquent largement l’élection d’Obama puis de Trump, opposés à la continuation des « guerres sans fin ». Si bien que la profonde méfiance et la contestation de celles-ci sont désormais bien ancrées dans la psyché électorale américaine. Joe Biden lui-même en est convaincu puisqu’il a pris la décision ferme de mettre un terme à l’engagement des États-Unis en Afghanistan. Prendre la décision contraire aurait constitué à ses yeux un risque politique énorme (malgré le retrait bâclé et précipité qui a terni sa présidence). Il est vrai aussi que Biden demeure grandement sceptique face aux interventions militaires et s’est opposé plusieurs fois sous Obama au déploiement de troupes supplémentaires en Afghanistan, privilégiant davantage le recours à une « diplomatie intelligente » plutôt qu’aux armes intelligentes (Hurlburt 2021 ; Perry 2021). En raison de cette dimension interne, non seulement une forme de réalisme continuera sans doute de prévaloir, mais l’inaction aussi. Par exemple, le désengagement américain des conflits au Moyen-Orient va en s’accentuant depuis une décennie (Simon 2021). L’appétit pour de longues interventions semble exclu pour un bon moment. « La fatigue bipartisane de la guerre reflète celle des électeurs », conclut Ackerman (2021 : 72). Celui-ci estime que le seuil acceptable pour justifier le recours à la force est sans doute plus élevé qu’il ne l’a jamais été (depuis Coolidge). À titre d’exemple, il cite un sondage récent montrant que plus de la moitié des Américains s’opposeraient à une guerre avec la Chine si celle-ci envahissait Taïwan.
La seconde raison, l’hyperpolarisation, est abondamment évoquée et étudiée en raison des élections âprement disputées et contestées (par le camp républicain). Son effet toutefois sur la formulation de la politique étrangère est peu abordé et pourtant il est omniprésent. Une forme de « tribalisme », particulièrement chez les élites et parmi les groupes de pression, a infecté le lien entre politique intérieure et extérieure. La seconde ne peut plus être appréciée indépendamment de la première, ce qui réduit considérablement la marge de manoeuvre du président américain et sape la confiance envers le leadership des États-Unis (en plus de forcer Biden à tenir compte des humeurs du Congrès). « Le tribalisme a diminué l’influence de la diplomatie américaine de même que sa puissance souple », écrit Brigety (2021 : 43). Démocrates et Républicains sont campés sur leurs positions et font de moins en moins de concessions pour trouver des compromis et cela affaiblit la politique étrangère. Les institutions américaines, selon lui, ne sont plus en mesure de contenir les influences tribales qu’il associe aux divisions politiques et aux guerres culturelles. « La croissance des affrontements partisans engendre l’incertitude sur l’avenir de la politique extérieure américaine », renchérit Myrick (2021). « Que se passerait-il si un autre Trump ou l’un de ses clones reprenait la Maison-Blanche dans quatre ans ? », se demande le Guardian (Smith 2021a : 11). La présidence et le Congrès sont en outre constamment à couteaux tirés, même sur l’action des États-Unis à l’étranger. Biden doit composer constamment avec cette réalité, dans la foulée des années tumultueuses de Trump (Tourreille 2021). Par exemple, toutes les décisions importantes concernant Israël et la Palestine sont soumises aux calculs électoralistes. C’est sans nul doute la raison pour laquelle « Joe Biden ne fonde pas de grands espoirs sur le dossier du Proche-Orient et ne voudra pas y consacrer les efforts prioritaires de États-Unis » (Razoux 2021 : 60). L’équipe du nsc assignée à la région a même été réduite. L’indifférence face aux représailles israéliennes en mai 2021 a été tout particulièrement notable, dans la mesure où Biden, qualifié de « frileux » (Taillefer 2021), n’a démontré aucun intérêt à s’impliquer personnellement pour résoudre la crise entre Tel Aviv et le Hamas, ou agir comme médiateur. Une telle posture, dans le contexte partisan pro et anti-israélien, ne lui offrirait aucun avantage politique selon The Economist (Lexington 2021a). Le même scénario s’est répété lors des contestations du régime cubain à La Havane, un enjeu sur lequel Biden n’a pas voulu se prononcer, craignant de perdre un électorat important en Floride pour le parti démocrate.
II – La dimension démocratique
Deux facteurs sur le plan démocratique constituent un problème pour la politique étrangère américaine. En premier lieu, la « récession démocratique » observée depuis quinze ans affaiblit à la fois le système politique des États-Unis et la promotion par ceux-ci des valeurs démocratiques. L’ordre international est menacé par une « vague illibérale » qui affecte tous les domaines : la défense des droits de la personne, la sauvegarde des économies de marché et les interventions dites humanitaires (Cooley et Nexon 2021). Cette vague fragilise grandement les normes qui prévalent, particulièrement celles qui relèvent du libéralisme (pour la première fois en vingt ans, les formes autoritaires de gouvernement sont majoritaires dans 92 pays). Afin d’éviter un retour aux années 1920 et contrer cette récession, les États-Unis doivent viser « l’abandon de la “promotion démocratique” en faveur de la “protection démocratique” », de l’avis de Mounsk (2021 : 164). Dans la foulée de la présidence de Trump, cette protection prend un double sens : protéger la démocratie américaine et contribuer à protéger celle de toutes les démocraties, deux objectifs qui se renforcent mutuellement (d’où la tenue du sommet des démocraties par Biden). Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si le recul démocratique dans le monde est lié à celui des États-Unis. « Le développement le plus dommageable à la cause démocratique serait la chute de son champion [...]. Ce qui surviendra pour la démocratie américaine aura pour conséquence de déterminer le sort de la démocratie dans le monde et la perspective que le recul ne puisse être enrayé », prévient Diamond (2021). En ce sens, le problème est justement que les États-Unis sont de moins en moins démocratiques et attractifs : leur participation électorale a glissé au 26e rang dans le monde, le pays est désormais au 44e rang dans l’index mondial de la liberté de la presse et se retrouve au 28e rang dans l’index du progrès social, en plus d’avoir baissé de catégorie, passant de « démocratie à part entière » à « démocratie imparfaite » (Traub 2021a). Sans surprise, une enquête Pew a révélé que 80 % des personnes interrogées dans 16 pays estiment que le système politique américain n’est plus le modèle à suivre (plus des deux tiers des Républicains aussi, qui continuent de croire que l’élection de Biden était frauduleuse). Les choses peuvent changer, d’autant que Biden est très apprécié à l’échelle internationale (environ 74 % d’appui comparativement à 16 % pour son prédécesseur) (Wike 2021). Ainsi, l’un des éléments de la « doctrine Biden » est justement la relance et la consolidation de la démocratie aux États-Unis et dans le monde en tablant sur l’espoir qu’une meilleure gouvernance de la démocratie américaine aura un impact positif sur la gestion de la crise démocratique à l’étranger – et vice-versa (Brands 2021). En cela, rappellent Adesnik (2021) et Traub (2021b, 2021c), Biden perçoit le monde tel Truman et sa croisade pour sauver les démocraties assiégées et combattre l’autoritarisme. Au-delà de la rhétorique, la question demeure, ainsi que se le demande Ashford (2021b) : « [c]omment Washington peut-il promouvoir la démocratie et s’ériger en exemple si le pays donne l’impression d’être ingouvernable et dysfonctionnel ? » (Ajoutons à cela la fermeture annoncée, mais encore inachevée, par Obama comme Biden, de la prison de Guantanamo.) Démocratie et diplomatie vont de pair mais ne pourront réussir que si les fondements démocratiques des États-Unis sont préservés.
Le second facteur qui influence la démocratie à l’intérieur comme à l’extérieur des États-Unis est celui de l’ingérence des puissances étrangères. La Russie figure au premier plan de tels agissements et la lutte contre son implication dans les cyberattaques est vivement dénoncée et appuyée par les principaux acteurs politiques américains. Biden a d’ailleurs traité Poutine d’assassin, ce qui lui a valu le fort soutien du Congrès. Lors de son sommet avec lui, en juin dernier, le président lui a communiqué clairement, apparemment, sa détermination que cessent les attaques contre les infrastructures américaines et pour lesquelles les groupes criminels auraient des liens avec le Kremlin (Bremer 2021). De telles actions sont dangereuses non seulement pour l’économie américaine mais pour la stabilité de ses institutions (financières, énergétiques, hospitalières, commerciales). Le cyberespace ne fait pas toujours bon ménage avec la démocratie et Poutine en est bien la preuve pour la Maison-Blanche. Les intrusions virtuelles et directes dans les affaires intérieures américaines, qui incluent maintes tentatives de désinformation, ont augmenté exponentiellement et nourrissent entre autres la propagande populiste qui mine la stabilité de la démocratie. Dreyfus (2021 : 36) conclut à cet égard : « [a]u-delà de la réalité de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, que le rapport du procureur spécial Robert Mueller établit formellement, c’est peut-être davantage sa portée considérable dans le débat public américain que l’histoire retiendra ».
III – La dimension économique
S’il se trouve un thème sur lequel la politique extérieure est fort bien alignée sur la politique intérieure, c’est celui de la Chine. Quasiment deux-tiers des Américains (60 %) ont au printemps 2021 une opinion défavorable de la Chine, le plus haut niveau atteint depuis que Pew a posé la question en 2005. En outre, presque la moitié d’entre eux (45 %), selon Gallup, considèrent désormais la Chine comme le plus grand ennemi des États-Unis (contre 26 % pour la Russie). Voilà l’un des legs importants des années Trump (en 2019, avant la pandémie, le score était de 22 %). Biden sur ce thème ne se démarque pas de son prédécesseur et en rajoute, en réclamant dans un discours en avril dernier que « nos éoliennes soient construites à Pittsburgh et non à Beijing ». La politique étrangère relève ici clairement de la politique domestique. La compétition stratégique contre la Chine est à l’ordre du jour et plaît aux électeurs américains, convaincus déjà par Trump que celle-ci représente une menace économique et qu’elle abuse des règles commerciales. Une stratégie visant à contrer l’ascension de la Chine fait désormais consensus chez les démocrates comme chez les républicains. D’autant que « les deux pays s’inscrivent de plus en plus dans une logique de compétition de système contre système » (Bondaz 2021 : 44), ce qui rappelle la lutte idéologique de la guerre froide. Il n’y aucun doute dans ce contexte que « les républicains décimeraient le président s’il adoucissait sa position face à la Chine » (Mahbubani 2021). « Aucun retour possible aux jours précédant 2016 », opine The Economist (Rennie 2020 : 51). Biden a, sur les relations sino-américaines, transformé le parti de la mondialisation en parti de la compétition (et les États-Unis doivent prévaloir !). Cela a des implications à trois niveaux.
Au niveau commercial, le patriotisme économique est de mise face à la Chine. Le Buy American Act (baa) en est la preuve indubitable, puisqu’il force les compagnies américaines et étrangères à privilégier leurs achats de pièces produites aux États-Unis. Les accords commerciaux envisagés sous Obama sont relégués aux oubliettes et le multilatéralisme quasiment oblitéré. « La prégnance du narratif nationaliste [entérine] aussi bien sa rupture avec la doctrine de libéralisation que le conflit économique avec la puissance chinoise » (Velut 2021 : 24). Dans sa première adresse au Congrès, Biden affirme que « les États-Unis gagneront le 21e siècle », une référence à peine voilée au défi posé par la Chine, et réitère sa détermination de protéger l’économie américaine, America First with a brain (Alden 2021), « l’Amérique d’abord avec le sourire, un protectionnisme trumpien sans Trump », résume Hirsh (2021a : 35). Un jeu à somme nulle semble ainsi s’instaurer sur le plan commercial ainsi que technologique, avec pour objectif de sauver la classe moyenne américaine qui subit la concurrence de l’innovation ainsi que des salaires très bas que reçoivent les travailleurs chinois de leur gouvernement, ce qui engendre de sérieuses iniquités. Les électeurs apprécient ainsi le baa (de même que les sanctions et les tarifs imposés à la Chine) car ils estiment que de telles actions sauvegardent des centaines de milliers d’emplois (une affirmation que contestent les économistes qui mettent en garde contre l’augmentation des prix à la consommation et l’inflation qui en découle). Il n’empêche que « l’équipe Biden partage les convictions de Trump sur la nécessité de restaurer l’industrie manufacturière américaine pour qu’elle se tienne debout de manière plus efficace devant la Chine [...]. La révolution qu’a entamée Trump est ainsi bien portante et vivante – seulement elle se perpétue entre des mains plus expertes », conclut Alden (2021).
Au niveau stratégique, quelle stratégie adopter qui puisse réconcilier à la fois les intérêts de politique étrangère et de politique intérieure ? La Chine est le compétiteur le plus redoutable que les États-Unis aient affronté en plus de trente ans, et elle sera peut-être un jour un concurrent militaire semblable à l’urss. C’est du moins la thèse d’Allison (2021 : 16) qui estime qu’elle lance « le défi international le plus déroutant que doivent affronter les États-Unis en 244 ans d’histoire ». Il est clairement pessimiste sur les chances des deux grandes puissances d’éviter l’affrontement, ce qui à ses yeux rendra le travail de Biden et de ses successeurs très difficile. Car le choix de la grande stratégie (opposition ou entente avec la Chine) aura des répercussions immenses sur la vie et l’avenir des Américains. S’entendront-ils sur ce choix et fera-t-il l’objet d’un consensus ou attisera-t-il plutôt les divisions politiques ? Comment ce choix sera-t-il présenté par le président afin de les rallier et d’éviter que les États-Unis perdent encore davantage de leur puissance, voire de leur prospérité ? D’autant, comme le souligne Walt (2021b), que « le plus grand danger est que la Chine acquière graduellement une influence plus grande sur les règles qui régiront la politique et l’économie mondiale et placeront les États-Unis dans une situation désavantageuse permanente ». Il recommande une stratégie d’équilibrage (en Asie de l’Est) et de gestion par la diplomatie de la montée en puissance de la Chine. Cette méthode s’apparente aux recettes de la guerre froide. En revanche, la très grande interdépendance économique entre les deux pays (une donnée qui ne s’appliquait pas à la rivalité entre Washington et Moscou) rend improbable, sinon peu désirable, un affrontement militaire. Selon Christensen (2021), « les États-Unis ont énoncé une prophétie auto-réalisatrice : en déclarant une guerre froide contre la Chine, Washington en créera une inutilement ». Il juge plus sage de gérer la compétition par le multilatéralisme – justement une stratégie contraire à celle qui prévaut actuellement... « Un découplage de l’économie chinoise par les États-Unis, dans le style de la guerre froide, serait non seulement irréaliste, mais imprudent », conclut-il. La cooptation, et non l’endiguement, demeure encore pour Christensen la meilleure option, une recommandation que partagent d’autres spécialistes, comme Medeiros (2021). Le débat reste entier mais on peut conclure sur deux remarques de The Economist dans son édition du 17 juillet dernier. D’abord, Trump puis Biden ont opéré ensemble le changement diplomatique le plus spectaculaire des cinq dernières décennies, depuis que Nixon s’est rendu en Chine. Ensuite, sur la motivation de ce changement de cap, les deux présidents semblent avant tout vouloir exploiter la menace chinoise pour promouvoir leur agenda domestique plutôt que de chercher avec leurs partenaires à conserver ou redéfinir les règles de fonctionnement du système international (Walt 2021c).
Entre-temps, au niveau politique, Biden veut faire tout ce qui est en son possible pour mettre en oeuvre, tel que promis maintes fois durant sa campagne présidentielle, une doctrine de politique étrangère visant à « servir la classe moyenne ». « Aucun thème ne fut aussi prééminent », rappelle d’ailleurs Matthews (2021 : 14). C’est le fil conducteur de sa vision. Celle-ci est énoncée dès son premier discours, début février dernier : « [i]l n’y a plus de frontière claire entre la politique étrangère et la politique domestique. Toutes les actions que nous entreprendrons sur la scène internationale doivent tenir compte du sort des travailleurs américains et de leurs familles » (cité par Hirsh 2021b). Le conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan précise : « la classe moyenne exige que nous allions de l’avant sur une nouvelle voie [...]. Nous ne sommes pas Trump, ni Obama non plus » (cité par Labott 2021). Autrement dit, la doctrine Biden est « d’apprendre à faire moins ». Certains estiment que celle-ci est bien trop floue pour indiquer exactement en quoi consistera la politique étrangère et les choix difficiles que celle-ci effectuera ; d’autres pensent au contraire qu’elle met l’accent sur les priorités : désengagement militaire, économie, commerce, immigration, adaptation aux changements climatiques (Shapiro 2021 ; Jeffries 2021). Il s’agira de voir si Biden pourra reconnecter les objectifs de l’action internationale avec les besoins réels de la classe moyenne. Mais son message est clair : la politique étrangère doit servir la politique domestique, celle-ci a désormais préséance sur celle-là, et elle constitue une forme de police d’assurance contre le retour possible du trumpisme.
IV – La dimension identitaire
Cette dimension se retrouve au coeur des élections présidentielles mais elle affecte aussi la politique étrangère. L’acuité de la question polémique énoncée il y a plus de quinze ans par Huntington (2005) demeure : qui sont les États-Unis et quelles valeurs ceux-ci promeuvent-ils ? Notamment sur l’immigration, sur les frontières, sur les droits de la personne. Le président Biden peut-il aujourd’hui se démarquer de son prédécesseur qui a décliné, sur tous ces thèmes, l’idée d’une Amérique blanche assiégée par des forces multiethniques et multiculturelles qui dilueraient son identité ?
Le « mur » frontalier est devenu l’illustration la plus manifeste de cette volonté de préservation à travers la mise en oeuvre de cette politique de fortification. C’est aussi la preuve la plus évidente de l’influence de la politique intérieure sur la politique extérieure. Dès le début de sa présidence, Biden a voulu trancher avec les politiques frontalières de l’administration précédente, avançant l’idée d’une politique migratoire à visage « humain », qui s’est traduit notamment par l’abrogation du programme « Remain in Mexico », par le rétablissement du programme pour les mineurs d’Amérique centrale, par la mise sur pied d’un groupe de travail pour assurer la réunification des familles séparées et par le retour des programmes d’aide à l’Amérique centrale. Toutefois, la frontière demeure fermée. L’administration Biden continue d’appliquer les procédures d’expulsion expéditive instaurées par son prédécesseur (comme le Titre 42 qui, sous couvert de protection sanitaire en temps de pandémie, a permis d’expulser un très grand nombre d’individus et de familles), voire des procédures d’expulsion accélérée pour les unités familiales qui ne pourraient pas l’être sur la base du Titre 42 (Meyer et Isaacson 2021). Le mur, quant à lui, et malgré les annonces de son arrêt au début de la présidence Biden, continue d’être érigé au cours de l’été 2021, notamment le long de la frontière texane (Bissonnette, Bourgeon et Vallet 2021).
À court terme, des politiques drastiques comme celles de Trump peuvent ralentir, voire très brièvement enrayer les flux. Cela a été le cas au début de sa présidence. Toutefois, dès l’année 2018-2019, des records d’affluence étaient de nouveau atteints. L’été 2021 semble montrer de nouveau une tendance importante à la hausse, alimentée notamment par l’instabilité sanitaire, économique et ce faisant sécuritaire induite par la pandémie. Ceci a pour effet d’alimenter la controverse sur cet enjeu de l’immigration, parmi les plus polarisants des dernières années.
De toute évidence, Biden veut éviter la confrontation entre l’aile xénophobe républicaine et l’aile progressiste démocrate, en gouvernant au centre. Il a ainsi demandé aux immigrants provenant du Mexique et d’Amérique centrale, en mars dernier, « de ne pas venir », puis sa vice-présidente a prévenu, lors de son voyage au Guatemala, que « les États-Unis continueront à appliquer leurs lois et à sécuriser leurs frontières. Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulés » (afp : 2021). L’habileté de Biden à faire voter un projet de loi d’immigration (comme Obama avait tenté de le faire) est par conséquent totalement subordonnée à la fermeté dont il fera preuve pour contrer celle taxée « d’illégale » par la droite américaine, dont Trump a fait son cheval de bataille politique lorsqu’il a déclaré « l’état d’urgence ». Ainsi, et sans surprise, les infrastructures et les contrôles à la frontière continuent d’être renforcés, les budgets de la sécurité intérieure sont augmentés. Ainsi que l’expliquent Bissonnette, Bourgeon et Vallet (2022), « [l]a présidence Biden a plus tranché sur la forme que sur le fond dans ce domaine en optant pour le maintien d’une politique d’externalisation des contrôles migratoires, bien loin de la ligne de démarcation frontalière [...]. Bien que Biden ait promis lors de sa campagne présidentielle de mettre fin à la détention des familles, la pratique continue toujours ». La « crise de la frontière » n’est pas près de s’estomper et représente l’enjeu « intermestique » (« international-domestique ») par excellence de la politique étrangère américaine.
L’autre effet de la dimension identitaire est la transformation du parti républicain. Il y a un avant et un après-Trump. Le message de celui-ci, « pas de mur, pas de pays » a contribué à substantiellement métamorphoser l’idéologie, de même que l’orientation internationaliste, de son parti. Celle-ci avait déjà commencé à changer avant Trump mais il l’a durablement détruite. Comme l’explique Zakaria (2021 : 9), « la guerre en Irak est venue à bout de l’establishment internationaliste républicain, de la même façon que la guerre au Viêt Nam est venue à bout de l’establishment démocrate. C’est là un facteur important qui explique l’ascension de Donald Trump ». Le parti adhère désormais très majoritairement à sa vision hyper-nationaliste du rôle des États-Unis dans le monde, à son aversion au multilatéralisme, à sa dénonciation de la contribution des traités et des organisations internationales, et à son approche mercantile des rapports commerciaux. Bien que le parti républicain appuie les politiques fermes à l’égard de la Russie et la Chine (ce que Biden ne manque pas d’exploiter), sur le reste c’est un parti très radicalisé et loyal à Trump. Entre autres, cela mène plus d’un législateur à croire aux faits alternatifs, aux messages véhiculés par les évangéliques chrétiens, et aux visions manichéennes des relations internationales qui font peu de place à la promotion ou à la défense des libertés et des droits humains dans le monde (ceci explique d’ailleurs la frilosité en ce domaine de la politique étrangère de Biden). Enfin, le patriotisme républicain, comme l’explique Heurtebize (2021 : 14), adhère « à l’idée que le monde est mieux gouverné par des États souverains que par des institutions supranationales [tout en mettant l’accent] sur la défense de la sécurité, des intérêts, des droits, des valeurs et du mode de vie américains ». Cela est presque à s’y méprendre conforme à la vision de Biden.
Conclusion
Domestic politics is foreign policy. La politique étrangère américaine semble bien alignée sur les humeurs de l’opinion publique et elle ne risque pas de vouloir contredire celle-ci. La thèse fondamentale d’une politique étrangère soumise aux aléas de la politique intérieure n’est donc pas près de changer. Le retrait de l’Afghanistan, malgré les déboires sérieux de la stratégie de sortie, en est la confirmation. Plus significatif encore est le fait que les experts de politique étrangère accordaient après 100 jours au pouvoir une note très élevée (plus de 80 %) à l’administration Biden (Etringer et Blanes 2021). Reste à voir si cette tendance sera maintenue. À moins d’événements charnières comme le 11 Septembre ou une grave crise internationale, il faut croire que l’intérêt national continuera d’être largement subordonné à l’intérêt politique.
Parties annexes
Note biographique
Charles-Philippe David
Professeur titulaire, Département de science politique, Président de l’Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand, Université du Québec à Montréal, et Fulbright Senior Scholar (2021-2022).
Références
- Ackerman Elliot, 2021, « Winning Ugly : What the War on Terror Cost America », Foreign Affairs, vol. 100, no 5 : 66-74.
- Adesnik David, 2021, « Biden Revives the Truman Doctrine », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/03/29/biden-truman-doctrine-russia-china-national-security-strategic-guidance-global-fight-freedom/) le 29 mars 2021.
- afp-Agence France-Presse 2021, « Harris porte un message d’entraide et d’espoir au Guatemala », Le Devoir, 8 juin, consulté sur Internet (https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/608685/immigration-clandestine-harris-porte-un-message-d-entraide-et-d-espoir-au-guatemala), 8 juin 2021.
- Alden Edward, 2021, « Bidenomics Is “America First With a Brain” », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/06/18/biden-bidenomics-economy-america-first-trump-trade-supply-chains-industrial-policy-china-reshoring-protectionism/), le 18 juin 2021.
- Allison Graham, 2021, « Grave New World », Foreign Policy, vol. 50, no 1 : 15-17.
- Ashford Emma, 2021a, « Strategies of Restraint: Remaking America’s Broken Foreign Policy », Foreign Affairs, vol. 100, no 5 : 128-141.
- Ashford Emma, 2021b, « America Can’t Promote Democracy Abroad: It Can’t Even Protect It at Home », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/01/07/america-cant-promote-protect-democracy-abroad/), le 7 janvier 2021.
- Bissonnette Andréanne, Mathilde Bourgeon et Élisabeth Vallet, 2022, « Ruptures et continuités. Les dynamiques migratoires en Amériques de Trump à Biden », dans Annuaire français des relations internationales, Paris, La documentation française.
- Bondaz Antoine, 2021, « Chine-États-Unis : entre coopération, compétition et confrontation », Diplomatie, no 61 : 42-45.
- Brands Hal, 2021, « The Emerging Biden Doctrine », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-29/emerging-biden-doctrine), le 29 juin 2021.
- Bremer Ian, 2021, « What Game Is Putin Playing? », Time, vol. 197, nos 23-24, 21-28 juin : 11-12.
- Brigety Reuben, 2021, « The Fractured Power: How to Overcome the Tribalism », Foreign Affairs, vol. 100, no 2 : 40-46.
- Christensen Thomas, 2021, « There Will Not Be a New Cold War », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-03-24/there-will-not-be-new-cold-war), le 24 mars 2021.
- Cooley Alexander et Daniel Nexon, 2021, « The Illiberal Tide: Why the International Order Is Tilting Toward Autocracy », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-03-26/illiberal-tide), le 26 mars 2021.
- David Charles-Philippe, 2004, « “Foreign Policy Is Not What I Came Here to Do” – Dissecting Clinton’s Foreign Policy-Making: A First Cut », Occasional Paper, no 1, Centre for United States Studies, Raoul-Dandurand Chair, octobre.
- David Charles-Philippe, 2020, L’effet Trump. Son impact sur la politique étrangère des États-Unis, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- David Charles-Philippe et Élisabeth Vallet, 2020, Comment Trump a-t-il changé le monde ? Le recul des relations internationales, Paris, cnrs éditions.
- Diamond Larry, 2021, « A World Without American Democracy? The Global Consequences of the United States’ Democratic Backsliding », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2021-07-02/world-without-american-democracy), le 2 juillet 2021.
- Dreyfus Emmanuel, 2021, « Quelles perspectives pour les relations entre Washington et Moscou ? » Diplomatie, no 61 : 35-37.
- Etringer Irene et Garcia Blanes, 2021, « Poll : Biden Gets High Mark for Foreign Policy », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/05/14/poll-biden-foreign-policy-climate-china-russia/), le 14 mai 2021.
- Fleisher Richard, Jon Bond, Glen Krutz et Stephen Hanna, 2000, « The Demise of the Two Presidencies », American Politics Quarterly, vol. 28, no 1 : 3-25.
- Heurtebize Frédéric, 2021, « Le réalignement du parti républicain en politique étrangère », Diplomatie, no 61 : 14-16.
- Hirsh Michael, 2021a, « How Bidenomics Came to Be », Foreign Policy, vol. 50, no 3 : 32-39.
- Hirsh Michael, 2021b, « “America Is Back”, Biden Says », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/02/04/biden-foreign-policy-speech-america-is-back-diplomacy/), le 4 février 2021.
- Huntington Samuel, 2005, Who Are We ? The Challenges to America’s National Identity, New York, Simon & Schuster.
- Hurlburt Heather, 2021, « Inside Joe Biden’s Brain », Foreign Policy, vol. 50, no 1 : 35-40.
- Jeffrey James, 2021, « Can Biden Do Everything », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-23/can-biden-do-everything), le 23 juin 2021.
- Kagan Robert, 2021, « A Superpower, Like It or Not: Why Americans Must Accept Their Global Role », Foreign Affairs, vol. 100, no 2 : 28-39.
- Kupchan Charles, 2021, « The Case for A Middle Path », Foreign Policy, vol. 50, no 1 : 18-22.
- Kupchan Charles et Peter Trubowitz, 2021, « The Home Front: Why an Internationalist Foreign Policy Needs a Stronger Domestic Foundation », Foreign Affairs, vol. 100, no 3 : 92-101.
- Labott Elise, 2021, « The Sullivan Model », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/04/09/the-sullivan-model-jake-nsc-biden-adviser-middle-class/), le 9 avril 2021.
- Lexington, 2021a, « Joe’s Modest Middle-East Medecine », The Economist, vol. 439, no 9246, 22 mai : 26.
- Mahbubani Kishore, 2021, « China: Biden Has Constrained His Own Options », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/07/23/biden-foreign-policy-agenda-six-month-progress-report-china-russia-india-europe-africa-latin-america/) le 23 juillet 2021.
- Matthews Jessica, 2021, « Present at the Re-creation ? u.s. Foreign Policy Must Be Remade, Not Restored », Foreign Affairs, vol. 100, no 2 : 10-17.
- Medeiros Evan, 2021, « How to Craft a Durable China Strategy », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-03-17/how-craft-durable-china-strategy), le 17 mars 2021.
- Meyer Maureen et Adam Isacson, 2021, « High Levels of Migration are Back: This Time, Let’s Respond Without a Crackdown », wola (Washington Office on Latin America), 5 août, consulté sur Internet (https://www.wola.org/analysis/high-levels-of-migration-are-back-this-time-respond-without-a-crackdown/), le 5 septembre 2021.
- Mintz Alex et Karl Derouen, 2010, Understanding Foreign Policy Decision-Making, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mounk Yascha, 2021, « Democracy on the Defense: Turning Back the Authoritarian Tide », Foreign Affairs, vol. 100, no 2 : 163-173.
- Myrick Rachel, 2021, « America Is Back – But for How Long? », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-06-14/america-back-how-long), le 14 juin 2021.
- Mueller John, 2020, The Stupidity of War : American Foreign Policy and the Case for Complacency, Cambridge, Cambridge University Press.
- Perry Mark, 2021, « This Is Not a Drill », Foreign Policy, vol. 50, no 2 : 36-39.
- Razoux Pierre, 2021, « Décryptage de la relation usa-Israël », Diplomatie, no 61 : 58-60.
- Rennie David, 2020, « Still a Contender », The Economist, numéro thématique The World in 2021, 13 novembre : 51-52.
- Russell Mead Walter, 2020, « The End of the Wilsonian Era: Why Liberal Internationalism Failed », Foreign Affairs, vol. 100, no 2 : 123-137.
- Shapiro Jeremy, 2021, « Biden’s Everything Doctrine », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-04-22/bidens-everything-doctrine), le 22 avril 2021.
- Simon Steven, 2021, « Turning Away from the Middle East », The New York Review of Books, vol. 68, no 6 : 45-47.
- Smith David, 2021, « Can We Talk? », The Guardian Weekly, vol. 204, no 25 : 10-12.
- Taillefer Guy, 2021, « Biden en président frileux », Le Devoir, 21 mai : A7.
- Tourreille Julien, 2021, « Vers un rééquilibrage du pouvoir en matière de politique étrangère en faveur du Congrès ? », Diplomatie, no 61 : 17-20.
- Traub James, 2021a, « Could the United States Still Lead the World If It Wanted to? », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/07/15/could-the-united-states-still-lead-the-world-if-it-wanted-to/), le 15 juillet 2021.
- Traub James, 2021b, « The Biden Doctrine Exists Already », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2020/08/20/the-biden-doctrine-exists-already-heres-an-inside-preview/), le 20 août 2021.
- Traub James, 2021c, « The Meaning of Biden’s ‘America First’ Doctrine », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/09/07/the-human-rights-opportunism-of-the-biden-doctrine/), 7 septembre 2021.
- Velut Jean-Baptiste, 2021, « Je t’aime moi non plus : l’Amérique et la (dé)mondialisation », Diplomatie, no 61 : 22-25.
- Walt Stephen, 2021a, « A Face Lift Can’t Fix the State Department », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/01/21/a-face-lift-cant-fix-the-state-department/), le 21 janvier 2021.
- Walt Stephen, 2021b, « What Comes After the Forever Wars », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/04/28/what-comes-after-the-forever-wars/), le 28 avril 2021.
- Walt Stephen M., 2021c, « Is Biden’s Foreign Policy Failing? », Foreign Policy, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/09/30/is-bidens-foreign-policy-failing/), 30 septembre 2021.
- Wertheim Stephen, 2021, « Delusions of Dominance : Biden Can’t Restore American Primacy – and Shouldn’t Try », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-25/delusions-dominance), le 25 janvier 2021.
- Widalvsky Aaron, 1966, « The Two Presidencies », Transaction, vol. 4, no 2 : 7-14.
- Wike Richard, 2021, « The World Hasn’t Given Up on America », Foreign Affairs, consulté sur Internet (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-10/world-hasnt-given-america), le 10 juin 2021.
- Zakaria Fareed, 2021, « America and the World : How to Build Back Better » (conversation avec Jonathan Tepperman), Foreign Policy, vol. 50, no 1 : 4-14.