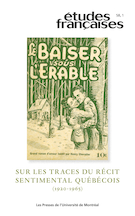Volume 37, numéro 2, 2001 La littérature africaine et ses discours critiques Sous la direction de Josias Semujanga
Sommaire (12 articles)
-
Présentation : la littérature africaine et ses discours critiques
-
Constructions identitaires et stratégies d’émergence : notes pour une analyse institutionnelle du système littéraire francophone
Pierre Halen
p. 13–31
RésuméFR :
À défaut d’un champ littéraire francophone proprement dit, il existe un système francophone dont le fonctionnement peut être analysé à partir de la relation réciproque de centre à périphérie. Au sein de ce système, on peut distinguer, par rapport au centre franco-parisien, différentes positions qui déterminent certaines stratégies rhétoriques de la part des auteurs de la périphérie, lesquelles agissent à leur tour sur le mode de réception de ces oeuvres par le centre (assimilation ou exotisation). Parmi toutes les stratégies rhétoriques employées, le discours identitaire apparaît à la fois comme un vecteur privilégié et comme une condition de reconnaissance par le centre, dont la demande pour l’exotisme est fort importante à l’égard de certaines zones périphériques.
EN :
If it is difficult, if not impossible, to define francophone literature as a precise litterary field, we must nonetheless recognize the existence of a francophone literary system, which is determined by instances both of production on the part of the peripheral areas and of reception on that of the centre. According to the position they occupy in the margins, authors choose different rhetorical strategies which, in turn, determine the way they are received by Paris (assimilated or considered as exotic). The rhetoric of identity seems, in this case, to be an effective strategy as well as a condition of recognition by the centre, whose demand for exotic productions on the part of certain peripheral areas seems quite great.
-
La littérature africaine et les paramètres du canon
Kom Ambroise
p. 33–44
RésuméFR :
On le sait, la littérature africaine est un produit de la rencontre entre les pays impériaux d’Europe et le continent noir. Mais il s’agit d’une littérature qui a du mal à s’instituer et à élaborer des canons qui lui soient propres. Cet article tente de faire le point sur les controverses qui opposent écrivains et critiques au sujet du statut de cette nouvelle tradition littéraire et propose quelques pistes quant à la question de son autonomisation.
EN :
As we know, modern African literature is a product of an encounter between imperial Europe and the Black Continent. That new tradition has yet to create its institutions as well as its own canons. The following article is an attempt to deal with the controversies that oppose writers and critics on the subject of the status of African literature. It also points to a certain number of possibilities regarding its autonomy.
-
De l’écrit à l’oral : la transformation des classiques du roman africain
Christiane Ndiaye
p. 45–61
RésuméFR :
Il est bien connu que la première histoire littéraire de l’Afrique avait retenu l’engagement, le témoignage « fidèle » et le réalisme comme critères pour décider de ce qui était « digne d’intérêt ». Mais lorsque s’est fait entendre la voix de la critique africaine, à partir des années 1970 (M. Kane, A. Koné, Makouta-Mboukou, etc.), on a réclamé un « retour aux sources ». Est alors devenu « significatif » ce qui relève de « l’esthétique négro-africaine », soit les oeuvres qui s’inspirent des conventions de la tradition orale. Il importe à cette critique que les moyens linguistiques et les modèles narratifs mis en oeuvre par les écrivains s’articulent à partir de l’héritage culturel africain. Mais qu’est-ce que l’oralité ? La « tradition africaine » ne serait-elle pas aussi une invention occidentale, comme le suggère Bernard Mouralis ?
EN :
Those who first wrote African literary history considered political and social engagement, bearing testimony to real events, and literary realism to be the criteria according to which one decides what is « worthy of interest ». But when the voice of African criticism began to be heard, in the seventies (M. Kane, A. Koné, Makouta-Mboukou, etc.), a return to African sources was advocated. For these critics, « significant » works became those that can be related to the aesthetics of African oral tradition. It is important for this current of critical thinking that the language and narrative models used by African authors belong to African cultural heritage. But what exactly is « oral literature » ? This « African tradition » so highly acclaimed, could it not also be a Western invention, as suggested by Bernard Mouralis ?
-
Un leader de la critique africaine, Mohamadou Kane
Fernando Lambert
p. 63–77
RésuméFR :
Mohamadou Kane a été un tenant de la thèse de la spécificité de la littérature africaine. Ses premiers travaux ont porté sur le conte africain qu’il a défini en lui accordant un double statut : celui de conte traditionnel et celui de conte moderne écrit. Sa principale contribution a été d’établir que le roman africain se situe dans le prolongement de la tradition orale, en dégageant les formes traditionnelles présentes dans le roman et en étudiant plus largement les modèles de la tradition dans leurs rapports féconds avec l’écriture romanesque africaine. Il a également posé les jalons d’une véritable histoire littéraire africaine.
EN :
Mohamadou Kane was a strong supporter of the thesis of the specificity of African literature. His first works were devoted to the African folk tale, which he defined both as traditional oral tale and written modern folk tale. His main contribution was to establish that the sources of the African novel can be found in the African story-telling tradition. He accomplished this by identifying traditional story-telling forms in the novel and by carrying out a wider study of traditional models and their relationship to the African novel. He also laid down the basis for a true African literary history.
-
Écriture féministe ? écriture féminine ? Les écrivaines francophones de l’Afrique subsaharienne face au regard du lecteur/critique
Béatrice Gallimore Rangira
p. 79–98
RésuméFR :
Consacré aux auteures et aux critiques de la littérature « féministe » de l’Afrique francophone subsaharienne, cet article revient sur les controverses dont cette littérature a fait l’objet. Le féminisme, originaire de l’Occident, a une connotation négative en Afrique parce qu’il s’accorde mal avec les réalités de ce continent. Les écrivaines africaines qui adoptent le féminisme comme une voie possible de libération de la femme africaine, de son écriture et de son corps doivent faire face à la censure du lecteur/critique qui lui-même conditionne leurs écrits et les force à s’engager dans un processus perpétuel de négociations discursives. Malgré la controverse qui entoure cette écriture, les écrivaines et les critiques féministes africaines s’entendent pour dire que le mouvement féministe est porteur de valeurs socioculturelles proprement occidentales. Aussi faut-il faire preuve de beaucoup de circonspection lorsqu’on applique les théories féministes aux textes de la littérature africaine.
EN :
This article gives voice to feminine and « feminist » writers and critics of Subsaharian Francophone African literature. It shows how this literature has been the object of many controversies. Feminism, as a Western movement, has a negative connotation in Africa because it doesn’t quite befit this continent’s reality. African women writers who choose feminism as a means to liberate the African woman, her body and her writing must constantly deal with the censorship of the reader/critic, which conditions their writing and forces them to engage in an ongoing process of discursive negotiations. This article also shows that in spite of the controversy which surrounds such writings, women writers and critics agree on the fact that the feminist movement implies mostly western sociocultural values. Thus, it seems important to be most cautious when applying feminist theories to African texts.
-
Gardiens et voleurs : enjeux de la négociation identitaire
Suzanne Crosta
p. 99–114
RésuméFR :
Cette étude examine la rhétorique de la critique africaine anglophone des années 1970 et 1980, notamment les figures (gardiens, voleurs, chasseurs, proies, etc.) qu’elle a créées, transformées ou projetées pour identifier la culture et la race des actants, leur engagement politique et/ou leur conscience sociale et leurs prises de positions dans certains débats. À partir d’une analyse du discours critique, on tente ici de mettre en lumière la présence, tantôt forte tantôt faible, des institutions et des organes dirigés par des Africains et des Américains ; les tensions qui s’y jouent renvoient à un certain nombre de questions éthiques et esthétiques soulevées par la critique africaine anglophone dans le but d’élargir les termes du débat tout en proposant, par le biais des alliances interdisciplinaires et intercommunautaires, des stratégies de résistance plus efficaces et/ou des transformations visant un changement social réel.
EN :
The present article examines the rhetoric of English language African literary criticism used in the 1970’s and 1980’s, in particular the literary figures (gardians, larcerners, hunters, preys, etc.) which it has created, transformed or projected in order to identify critics in terms of their race and/or their class origins, their political commitment, their social conscience as well as their critical positions on cultural nationalist discourses. What is also notable in their respective discourses is the lack of continued institutional support in Africa or the tensions inherent in defining their place in foreign literary institutions. These questions point to ethical and aesthetic concerns in African literary criticism related to their attempts at extending the terms of future debates and at underlining the need for coalition-building across disciplines and communities. The scope is twofold : negotiate more resistant cultural strategies and transform social and economic relations of inequality.
-
Une lecture à rebrousse-temps de l’oeuvre de Ken Bugul : critique féministe, critique africaniste
Inmaculada Díaz Narbona
p. 115–131
RésuméFR :
Nous proposons ici une lecture « à rebrousse-temps » de l’oeuvre de cette auteure, considérée jusqu’à présent comme une écrivaine « féministe », entendu au sens qu’on lui accorde en Occident. Son dernier roman nous montre en effet la nécessité de nuancer cette catégorisation. Si Le baobab fou était plutôt le roman de l’expérience, de la douleur de la parole, Riwan ou le chemin de sable porte à son terme la libération annoncée à la fin de Cendres et braises : les « Harmonies célestiales » sur lesquelles se terminent le second roman sont confirmées dans le dernier par l’atteinte d’un certain équilibre de la part de l’auteure-narratrice, par le fait qu’elle trouve sa place dans un milieu paisible au sein duquel règne l’Ordre tant recherché, même si cet ordre représente précisément une option inattendue dans laquelle, d’un point de vue idéologique, tout un pan de la critique ne se reconnaît pas.
EN :
This article proposes a « backward » reading of the works of Bugul who has, up till now, been considered a feminist writer, in the western sense of the term. When we take into account her latest novel, this once seemingly appropriate categorisation no longer seems so accurate. If Le baobab fou was the novel of experience, of the pain related to the word, Riwan ou le chemin de sable brings to a conclusion the liberation announced at the end of Cendres et braises : the « celestial harmonies » that close the second novel are confirmed in the third one by the fact that the author-narrator acquires a certain equilibrium as well as a place in a peaceful setting ruled by the Order she longed for, although such Order represents an unexpected option which, from an ideological point of view, a substantial part of the critic does not share.
-
De l’africanité à la transculturalité : éléments d’une critique littéraire dépolitisée du roman
Josias Semujanga
p. 133–156
RésuméFR :
Cet article tente de réévaluer le discours de la critique africaine pour esquisser ensuite une réflexion sur la question de l’écriture et de son rapport avec la dynamique des genres dans le roman africain. Il s’agit de déplacer le débat de l’africanité des textes vers celui de l’écriture romanesque afin d’élargir le cadre de réception des textes. En effet, si d’aucuns évoquent les références aux récits folkloriques qu’on rencontre dans certains textes africains pour dire que le roman africain est un simple prolongement de la littérature traditionnelle (critique afrocentriste), d’autres soutiennent que le roman africain est une pâle copie du roman européen (critique eurocentriste). Pourtant, la vie culturelle de ce début du IIIe millénaire, caractérisée par plusieurs modes et moyens de communication, fait se rencontrer diverses cultures, de telle sorte que ces éléments puisés ailleurs participent de l’esthétique romanesque elle-même, dont on sait, au moins depuis Bakhtine, qu’elle est polyphonique. Cette analyse tient compte du fait que le roman africain participe du paradoxe de la création esthétique voulant qu’une oeuvre ne puisse ni se passer de la référence aux genres et aux modèles canoniques ni les reproduire totalement.
EN :
This study proposes to reevaluate African criticism by emphasizing the relationship between the role enjoyed by the novel in opening up literary genres and the basic principle of literary writing. After having defined the notion of transcultural and transgeneric esthetics advocated by the great African novelists, I will show how this notion shapes the meaning of some novels. I will try to demonstrate how African criticism is characterized by the ideological thinking of africanity and europeanity and then describe how some African novelists abolish the borders that criticism usually erects between African texts and those of other areas in the world. My hypothesis is that, because African novels are polyphonic, like many others produced throughout the world, it seems more accurate to approach these texts by placing them in the more general context of the beginning of this third millennium, which is characterized by transcultural and transgeneric writing.
Exercices de lecture
-
Chamoiseau : l’écriture merveilleuse
François Lagarde
p. 159–179
RésuméFR :
Le drame, dans l’oeuvre de Chamoiseau, est historique (de la traite des Noirs au « pays dominé »), personnel (mélancolie du retour au pays natal ou maternel) et linguistique (la diglossie entre créole et français). Un style « merveilleux », dont les principaux traits sont l’amplification et l’écart, vient suppléer aux manques et aux trahisons. L’écart peut être perçu comme le résultat de la diglossie et de l’antagonisme entre la parole et l’écriture, alors que l’amplification renvoie au fantasme du sujet dominé, à son émerveillement. Le petit de la mère semble aspirer, par là, au « grand nom ».
EN :
One can caracterize Chamoiseau’s writings as an historical (from the slave trade to today’s domination), personal (a melancholy wrought by exile from the native country and the mother) and linguistic (the French-Creole diglossia) drama. A « marvelous » style, mainly made up of amplification and difference (écart), supplements such losses and betrayals. The difference can be seen as a result of the diglotic situation as well as the antagonism between the spoken word (parole) and writing, while the amplifications point to the dominated subject’s phantasm, his marvelling at himself and at the world. These linguistic alterations are perhaps, for the mother’s son, so many ways of forging a « Great name » for himself.
-
Le réalisme au risque de Balzac : témoignage et récit dans Adieu
Scott Lee
p. 181–202
RésuméFR :
L’opinion reçue veut que le Balzac « réaliste » soit celui qui émerge au moment des Études de moeurs et du Père Goriot, celui qui délaisse les excès de ces premiers textes philosophiques. Il est possible, toutefois, de concevoir ce débordement du vraisemblable comme faisant partie de l’esthétique réaliste, du moment que l’on tient pour acquis l’impossibilité de la représentation du réel dans son intégralité. La nouvelle « Adieu », publiée en 1830 et rangée parmi les Études philosophiques, permet de constater la permanence et l’ambivalence du réalisme balzacien : le protagoniste, dans le but de guérir sa maîtresse de sa folie et de son amnésie, « re-présente » justement l’événement réel qui est censé être à la source de sa maladie. L’échec de la guérison, tout en mettant en cause le projet réaliste, permet également de le repenser selon une logique qui ne serait pas mimétique, mais linguistique : la mise en échec du référent et du savoir des témoins oculaires témoignent de cette absence structurelle qui hante le réel et le réalisme, et souligne l’impossibilité d’un savoir ou d’une représentation qui ne serait pas d’ordre textuel.
EN :
Received opinion has it that the « realist » Balzac is the one who emerges at the time of the Études de moeurs and Le père Goriot, the one who leaves behind the excesses of his first philosophical textes. It is possible, however, to envisage this overflowing of the verisimilar as forming an integral part of the realist esthetic, provided we assume the impossibility of representing the real in its integrity. The short story « Adieu », published in 1830 and placed in the Études philosophiques, allows us to affirm the permanence and the ambivalence of Balzacian realism : the protagonist, seeking to cure his mistress of her madness and amnesia, represents, precisely, the real event which is presumed to be the cause of her illness. The failure of the cure, while putting the realist project into question, also enables us to rethink it according to a linguistic, rather than a mimetic, logic : the undermining of the referent and of the eyewitnesses’ knowledge is a testament to the structural absence haunting the real and realism, and highlights the impossibility of a knowledge or of a representation which could be other than textual.