Résumés
Résumé
Ce texte s’intéresse aux travaux féministes récents qui ont porté sur les questions de différence, notamment aux courants de l’analyse intersectionnelle et du féminisme postcolonial. La première partie du texte propose une synthèse des textes canoniques de ces deux courants et fait état des résistances présentes au sein des féminismes de la francophonie à l’endroit d’une analyse décentrée d’un sujet-femme universel. La deuxième partie aborde le projet politique du féminisme postcolonial et montre comment ce genre d’analyse permet de rendre compte de l’influence des legs coloniaux sur les rapports de pouvoir présents au sein des féminismes de la francophonie.
Abstract
This text discusses recent feminist works on issues of difference, notably intersectional analysis and postcolonial feminism. The first part of the text presents some of the canonical texts of these two currents and exposes some of the resistance found within Francophone feminisms towards an analysis that is decentred from a universal subject-woman. The second part discusses the political project of postcolonial feminism and shows how such an analysis uncovers the influence of colonial heritage on power dynamics found within Francophone feminisms.
Corps de l’article
Je soumets ici un récit imaginaire à deux grilles conceptuelles. Le récit pourrait commencer ainsi : elles reviennent de la République dominicaine, où elles ont séjourné dans un hôtel tout compris, le Coconut Beach. Malgré le soleil et la mer, l’expérience n’a pas exactement été agréable. Elles ont été assaillies d’invitations trop insistantes de la part du personnel masculin, qui les avait repérées. Deux femmes seules, sans homme, un tableau connu et propice pour cette chasse. Un employé les a reluquées avec insistance et elles ont pensé que c’était bien là une autre expression du machisme que peuvent exercer les hommes envers chaque femme, en vertu de l’inégalité de leurs rapports, parce que le patriarcat est une structure qui octroie des privilèges à tout homme dans une forme qui constitue un modèle transhistorique et universel. Voilà la première version du récit, où la situation a été mise sous la loupe des concepts de genre et de patriarcat.
Le récit se transforme lorsqu’elles soumettent à la preuve de nouveaux éléments. Observons la position des sujets. Elles ont beau venir du Québec, d’une société qui continue de se percevoir comme une nation conquise et colonisée, lorsqu’elles traversent dans l’univers des resorts, elles occupent la position du dessus. Elles jouissent du privilège de la couleur de peau, celui de la femme blanche, elles ont le droit de voyager et d’avoir un passeport et, même si elles occupent des emplois très moyens ici au Québec, elles ont assez d’argent pour se payer ce genre de paradis éphémère une semaine par année. Elles peuvent exercer leurs privilèges sur un milieu qui, après la colonisation, s’est fait imposer le tourisme de masse comme stratégie de développement économique, une industrie polluante, extractrice des ressources naturelles, pensons seulement à toute l’eau douce qui est drainée pour maintenir à flot les cinq piscines du Coconut Beach Resort. La population locale se fait offrir des emplois dans l’industrie du tourisme à des salaires minimes, les profits du tourisme sont drainés à l’extérieur des communautés locales et les employés ont l’interdiction de fréquenter les lieux en dehors des heures de travail.
Les positions respectives de femme blanche et d’homme de couleur ont été structurées par le colonialisme, qui a imposé la traite des esclaves vers les îles de la Caraïbe, voilà pourquoi s’y retrouve aujourd’hui une population de couleur. Les mouvements de l’économie mondialisée joints aux politiques d’immigration du Canada, plus spécialement le programme d’aides domestiques, ont fait en sorte que les femmes de la région qui veulent échapper à l’emprise des emplois minables de l’industrie touristique locale se font offrir comme alternative de venir au Canada, à Montréal, pour devenir bonnes dans des familles blanches de la classe moyenne supérieure. Un tel programme d’immigration temporaire ne donne pas le droit à ces femmes de faire venir enfants et mari au Canada et leurs compétences maternelles seront détournées pour faire d’elles des mères de substitution pour enfants québécois. Par exemple, au Canada, en tant qu’employée domestique nourrie et logée, une de ces femmes reçoit le salaire minimum et son mari gagne quelques dollars par jour pour son travail au Coconut Beach Club. Ils ont trois enfants et la combinaison des deux salaires permet à la famille d’éduquer les enfants et de payer des soins médicaux de base. Ainsi, les rapports de pouvoir entre cet homme et les touristes blanches vont au-delà d’une simple interaction de genre, où il est l’homme et celui qui a tous les privilèges dans un système patriarcal universel et elles, femmes, donc victimes. Une analyse intersectionnelle révèle les dynamiques de race et de classe et une analyse postcoloniale permet de situer ces rapports de genre, de race et de classe dans le continuum du colonialisme, dont le tourisme est l’une des pratiques contemporaines.
Cette mise en situation permet de mettre en relief la question de la construction du sujet-femme ainsi que les enjeux liés à la conceptualisation des dynamiques de pouvoir dans l’analyse féministe. Dans ce texte, je m’intéresse aux travaux féministes récents qui ont porté sur les questions de différence. Souvent regroupés sous l’appellation d’analyse intersectionnelle, ces travaux proposent d’enrichir l’analyse féministe en développant une perspective qui va au-delà du genre et d’une condition féminine universelle. Je réfléchis au projet du féminisme postcolonial et je montre en quoi il diffère de l’intersectionnalité dans la lecture politique qu’il propose. Enfin, j’examine les résistances à l’endroit d’une analyse féministe décentrée du sujet-femme universel, au sein des féminismes francophones, en France et au Québec.
De l’analyse de genre à l’analyse intersectionnelle
Les emprunts conceptuels faits par l’approche féministe intersectionnelle aux théories de la race et des classes sociales ont apporté une nouvelle complexité à la compréhension des hiérarchies et des rapports de domination. Des femmes qui avaient été historiquement marginalisées en raison de leur position de race, de classe, ont revendiqué la pleine visibilité de leurs expériences. Quelles sont ces voix, d’où viennent-elles et que disent-elles ? Quel est l’apport des femmes migrantes et racisées ainsi que celui de leurs descendantes au féminisme, sur le plan théorique et au niveau de l’organisation des luttes ? Aujourd’hui plus que jamais cohabitent au sein du féminisme des récits, des analyses et des pratiques qui témoignent de l’hétérogénéité des conditions de vie des femmes.
Le concept d’intersectionnalité a été introduit dans la littérature féministe qui circule en anglais il y a déjà plusieurs décennies. Kimberlé Crenshaw a proposé le concept d’intersectionnalité en 1989 afin de saisir la variété des interactions des rapports de genre et de race, au plus près de la réalité même des expériences des femmes afro-américaines. Cette auteure a montré comment l’intersectionnalité politique des rapports de domination est une structure de la domination elle-même qui empêche ou affaiblit les discours contre le sexisme ou le racisme. L’intersectionnalité des rapports de pouvoir produit en effet des tensions, des conflits et des effets destructeurs et déstructurants dans les processus de mobilisation des mouvements sociaux.
Nancy Fraser pour sa part a observé le cheminement de l’analyse féministe vers l’intersectionnalité, au cours des années 1980, lorsque la polarisation sur la différence de genre a cédé la place à une focalisation sur les différences entre femmes pour inaugurer une nouvelle phase dans les débats féministes :
Ce virage a surtout été le fait des lesbiennes et des féministes « de couleur ». Celles-ci protestaient depuis de nombreuses années contre les formes de féminisme qui ne leur offraient aucune perspective d’analyse sur leurs propres vies et qui ne prenaient pas en compte leurs problèmes propres. Les Afro-Américaines, par exemple, ont invoqué leur histoire de l’esclavage et de leur résistance à l’oppression, leur travail salarié et leur militantisme communautaire pour contester l’hypothèse d’une dépendance universelle des femmes à la sphère domestique. Dans le même temps, des féministes latino-américaines, juives, amérindiennes et américaines d’origine asiatique s’élevaient contre la référence implicite faite aux blanches anglo-saxonnes dans la majorité des textes de référence du mouvement féministe. Les lesbiennes, enfin, avaient démasqué les présupposés de l’hétérosexualité normative présents dans les textes féministes classiques traitant de la maternité, la sexualité, l’identité de genre et la reproduction.
Fraser, 2005 : 35
Plusieurs ouvrages ont marqué ce changement de paradigme. Publié en 1981, This Bridge Called My Back : Writings by Radical Women of Color, sous la direction de Cherrie Moraga et Gloria Anzaldua, décrit comment ce qui a débuté par une réaction au racisme des féministes blanches est rapidement devenu une quête autour du travail des féministes de couleur à définir leur propre féminisme, établissant par le fait même l’idée d’une coexistence de différents féminismes ainsi que celle de différences entre femmes. L’ouvrage aborde le thème de l’appropriation culturelle, soit le processus par lequel des intellectuels blancs s’immiscent dans des champs culturels autres avec l’effet de marginaliser davantage les personnes de ces cultures et les savoirs qui y sont produits. Women, Race and Class, d’Angela Davis (1981), propose de comprendre la condition des femmes afro-américaines à partir de l’héritage de l’esclavage et ouvre sur la nécessité d’articuler trois niveaux de contradiction, la race, la classe et le sexe, pour comprendre les luttes pour la libération des femmes. Le manifeste du Combahee River Collective, lancé en 1977, fait partie de ces textes fondateurs. Dans sa déclaration, le collectif fait état de l’imbrication des oppressions de race, de classe et de sexe :
La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme suit : nous sommes activement engagées dans la lutte contre l’oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe et nous nous donnons comme tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrées, basées sur le fait que les principaux systèmes d’oppression sont imbriqués.
Combahee River Collective, 2007 : 59-60
Plusieurs théoriciennes afro-américaines ont contribué au renouveau du féminisme en documentant les réalités propres aux femmes de couleur qui vivent aux États-Unis ; je pense plus particulièrement à trois d’entre elles, Audre Lorde, bell hooks et Patricia Hill Collins. Dans ses écrits, Lorde a abordé la question de la race et du racisme comme une expérience centrale de son point de vue de féministe noire, mère et lesbienne, et elle a également mis en garde contre le fait d’ignorer les différences de race entre les femmes et les répercussions d’une telle approche sur les possibilités de mobilisation commune des femmes. Dans un texte publié en 1984, elle dénonçait la prétention à l’homogénéité de l’expérience d’être femme dans l’idée de sororité. Abordant les questions de privilèges liés à la blanchité, elle a écrit que parce que les femmes blanches ignorent les privilèges inhérents à la blanchité et définissent le terme femme selon leur propre expérience, les femmes de couleur deviennent secondaires, elles dont l’expérience et la tradition sont trop étrangères pour être comprises (Lorde, 1984 : 117). À travers son oeuvre foisonnante, comptant plus d’une trentaine de publications, bell hooks a écrit sur les rapports complexes entre féminismes et femmes noires aux États-Unis. Selon elle, rien n’a plus changé le visage du féminisme américain que la demande de prise en compte de la réalité de la race et du racisme dans l’analyse féministe, alors que toute femme blanche est consciente du privilège qu’elle possède dans cette société (hooks, 2000 : 55). Patricia Hill Collins a publié en 1990 Black Feminist Thought, un ouvrage dans lequel elle reprend le concept d’intersectionnalité qui circule depuis peu pour décrire l’entrecroisement des oppressions de race, de classe, de genre et de sexualité.
Le contexte dans lequel émerge l’analyse intersectionnelle est balisé, sur le plan théorique, par les théories postmodernes, postcoloniales, mais aussi par les théories queer et antiracistes ; cependant, les grilles de compréhension des processus de racialisation à l’oeuvre dans une société donnée ne sont pas toutes au même stade de développement, rendant parfois difficile la tâche d’intégrer les questions de race à l’analyse féministe dans le cas où ce travail n’est pas avancé. L’exercice d’intégrer les dimensions raciales à l’analyse féministe est beaucoup plus complexe lorsqu’il n’existe pas déjà de métarécit sur ces questions dans un contexte national donné. En Grande-Bretagne, tout comme aux États-Unis, les féminismes ont rapidement pu composer et intégrer des perspectives sur la race dans des contextes où ces analyses existaient déjà et le paradigme déjà bien développé des race relations a permis au féminisme d’articuler une analyse genre et race. Aux États-Unis, la démarche de la théorie critique de la race (critical race theory) a été développée dans les années 1980 en réponse aux modèles libéraux d’analyse, lesquels évacuaient complètement les questions de race dans leur discours sur les questions de droits individuels. L’un des arguments était de montrer l’inadéquation de l’analyse libérale pour comprendre l’oppression systémique de la population afro-américaine et le fonctionnement du privilège lié à l’appartenance à la race blanche. La théorie critique de la race a permis de former un corpus montrant les fondements du privilège blanc et de son pouvoir (Seiler, 2003). Par ailleurs, la présence d’intellectuelles en provenance des ex-colonies et proches de la théorie critique de la race et de la théorie postcoloniale dans les institutions universitaires américaines et britanniques a aussi contribué à donner de la visibilité aux questions de race.
Sur le plan théorique, les efforts visant à la déconstruction de la catégorie « femmes » sont à mettre en rapport avec les succès de la théorie poststructuraliste, dont on peut percevoir l’influence sur les Cultural Studies et les études postcoloniales (Lépinard, 2005 : 121). D’autres éléments ont contribué au renouveau des analyses féministes, comme la mondialisation de l’économie et l’avènement de moyens de communication virtuelle planétaire facilement accessibles pour les mouvements sociaux. C’est le constat que font Chandra Talpade Mohanty (2003a) ainsi qu’Allyson Mitchell et Lara Karaian (2005). Le malaise exprimé à l’endroit des grands modèles théoriques universalistes du féminisme occidental de la deuxième vague se cristallise à travers les nouveaux discours féministes produits à la périphérie, mais il faut également reconnaître que le féminisme occidental de la deuxième vague n’a pas été qu’universaliste dans son approche et que des propositions pour penser l’oppression des femmes au-delà du genre seulement ont fait partie de ce féminisme de la fin du vingtième siècle. Cependant, ces voix venues de la marge qui appellent à une prise en compte des différences n’ont pas apporté de théorie unifiée, de concepts stabilisés qui permettraient de nommer et de définir l’intersection des rapports de pouvoir (Lépinard, 2005 : 108).
L’intersectionnalité dans le féminisme français
En France, les analyses sur le genre et la race n’émergent que beaucoup plus récemment. Horia Kebabza écrivait en 2006 à propos du contexte français :
[S]i les études féministes, soutenues par le mouvement des femmes, ont réussi à imposer de haute lutte intellectuelle une rupture épistémologique à propos des structures de la domination masculine, la prise de conscience équivalente en ce qui concerne le racisme structurel reste à faire, aussi bien pour le sens commun, que dans la recherche en France.
Kebabza, 2006 : 168-169
Alors que dans les pays anglo-saxons les questions de race occupent très tôt le devant de la scène, dans le contexte français les questions de classe sont davantage présentes, tout en cohabitant avec un féminisme universaliste focalisé principalement sur l’oppression de genre. Éléonore Lépinard écrivait d’ailleurs que l’une des caractéristiques des théories féministes françaises est « le statut privilégié, voire le monopole, qui est accordé à la différence sexuelle dans l’analyse théorique » (2005 : 110). Selon elle, si la question de l’intersection entre les rapports sociaux de classe et les rapports de genre a mobilisé l’attention théorique des féministes, la question de la race tout comme celle des minorités postcoloniales sont restées largement absentes des débats. Eleni Varikas avait déjà fait une observation similaire dans un texte paru en 1993 dans lequel elle soulignait les dynamiques différentes entre les féminismes français et américains sur les questions de race et de classe :
Il suffit de voir […] combien l’irruption dans la scène politique et universitaire des femmes noires (mais aussi chicanas ou asiatiques) a marqué la méfiance des théories féministes américaines envers les abstractions universalistes. Il est significatif qu’en France (mais aussi dans d’autres pays européens comme l’Italie ou la Grèce), le point autour duquel se sont concentrées dès le début, les polémiques sur la conceptualisation politique de la catégorie femmes (à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement féministe), fut immédiatement les rapports de classes. À suivre les débats américains, on a l’impression que le facteur de classe, comme élément déstabilisateur d’une homogénéité présumée des femmes, n’acquiert une visibilité qu’à partir des débats sur le racisme.
Varikas, 1993 : 12
Si des féministes françaises comme Colette Guillaumin et Nicole-Claude Mathieu s’intéressent dès les années 1980 à l’articulation des rapports sociaux de sexe avec d’autres catégories, ces dernières continuent de penser les femmes comme un groupe homogène, une classe :
On cite souvent l’analyse de Colette Guillaumin comme précurseur en matière d’articulation des rapports sociaux de sexe et de « race », pourtant, si elle met en regard ces deux formes d’oppression et les mécanismes similaires qui les naturalisent, […] elle n’analyse pas pour autant l’intersection de ces deux rapports de pouvoir. Bien au contraire, les femmes sont pensées sur le mode de la classe […] Guillaumin définit ainsi les femmes comme uniques et homogènes en tant que classe appropriée.
Lépinard, 2005 : 116
Pour sa part, Danièle Kergoat propose dès les années 1970 « les concepts de consubstantivité et de coextensivité pour rendre compte autrement que de façon mécanique, des pratiques sociales des hommes et des femmes confrontés à la division sociale du travail dans sa triple dimension : de classe, de genre et Nord/Sud » (Kergoat, 2009 : 111). La consubstantialité est l’entrecroisement dynamique complexe des rapports sociaux, chacun imprimant sa marque sur les autres, alors que la coextensivité renvoie au dynamisme des rapports sociaux et rend compte du fait que les rapports sociaux se coproduisent mutuellement (ibid. : 120).
De fait, selon Lépinard, les féministes matérialistes françaises Colette Guillaumin, Christine Delphy et Nicole-Claude Mathieu ont en commun dans leurs travaux parus à la fin du vingtième siècle l’utilisation du terme femmes comme une catégorie homogène, alors que toute référence à la différence ne signifie que la différence sexuelle et que les autres différences, celles qui pourraient exister entre les femmes, ne sont jamais l’objet de l’analyse. Les questions de classe ont été présentes chez certaines analystes féministes, par exemple Kergoat, mais, de façon plus large, selon Claude Zaidman, le féminisme a particulièrement tardé à prendre en compte les questions de diversité des situations et des intérêts des femmes ; cette dernière faisait l’analyse suivante :
La référence à l’universalisme républicain jointe à l’oubli de l’histoire coloniale de la France a longtemps contribué à obscurcir la réflexion sur la diversité des situations et des vécus des femmes […] Les quelques luttes et réflexions sur l’immigration des années quatre-vingt ont été occultées par le débat entre identité et différence, entre universalisme et particularisme, qui a fort occupé les féministes.
Zaidman, 2004 : 20
Pour Danielle Juteau, « ce qui a manqué en France, c’est la reconnaissance des rapports sociaux ethniques et raciaux, qui furent exclus de l’espace théorique et politique » (2010 : 180-181).
Intersectionnalité et théorie féministe postcoloniale
Il demeure une série d’obstacles concernant la théorisation des questions de différence que l’approche intersectionnelle n’a pas réussi à régler. En premier lieu, il y a le problème de l’absence de théorie unifiée. Se pose également le problème des emprunts conceptuels faits à d’autres théories. L’importation qu’ont faite les féministes de théories sur la race et sur les classes sociales – le fait de plaquer une grille marxiste des classes sociales à une analyse féministe, par exemple, sans redéfinir les classes sociales en fonction des réalités des femmes, constitue un autre problème important pour le féminisme actuel qui tente d’intégrer des analyses sur la race et la classe aux questions de genre. Finalement, comment est-il possible de s’organiser avec des catégories identitaires instables, aux entrecroisements souvent éphémères ?
L’intersectionnalité permet de révéler une réalité plus complexe que l’analyse qui ne s’appuie que sur le genre comme catégorie d’analyse. Utilisée comme méthodologie dans certaines études sur le terrain (Yuval-Davis, 2006), elle permet d’enrichir la recherche, mais, faute d’une compréhension approfondie des rapports de domination, il en résulte une lecture qui tend à additionner les oppressions plutôt qu’à montrer comment celles-ci interagissent de façon dynamique. Comme le souligne Elsa Dorlin, l’intersectionnalité est un outil d’analyse qui « stabilise des relations en des positions fixes, qui sectorise les mobilisations, exactement de la même façon que le discours dominant naturalise et enferme les sujets dans des identités altérisées » (2005, 92). Par ailleurs, il demeure de nombreux points de tension dans les théorisations actuelles de l’intersectionnalité, dont celui des catégories, de leur hiérarchisation et de leur stabilité ; l’intersectionnalité est-elle suffisante comme théorie pour analyser tout ce à quoi elle aspire (Bilge, 2009 : 80) ? Il manque à l’analyse intersectionnelle un véritable projet politique orienté vers le dépassement des systèmes qui organisent la domination. Ici, l’analyse postcoloniale est en quelque sorte le chaînon manquant pour organiser la compréhension des dynamiques de pouvoir au sein des féminismes.
Si penser les oppressions des femmes à partir d’une approche intersectionnelle a fait l’objet de travaux importants avant les courants post, au sein du féminisme, ce qui s’y est ajouté avec les féministes antiracistes et postcoloniales est une proposition identifiant l’intersection de certains rapports de pouvoir, une vision des privilèges conférés aux femmes par leur appartenance de race et de classe, une réflexion sur la responsabilité des femmes blanches dans l’oppression des femmes de couleur et celles du tiers-monde, une idée qui se fonde sur l’exercice, par les femmes blanches, de privilèges liés à leur blanchité. L’analyse postcoloniale utilise les catégories de l’analyse intersectionnelle pour proposer une lecture politique des rapports de pouvoir produits par le genre, la race ou la classe sociale. Le travail de réflexion sur les différences entre les femmes et la mise en contexte de ces différences à l’intérieur de formations politiques marquées par le colonialisme et le néocolonialisme a permis de révéler des formes d’« agentivité » (agency) propres aux féministes en situation coloniale. Ce travail de nature théorique a conduit à une réflexion sur les rapports de pouvoir entre féministes, ainsi qu’à une critique des prises de position et des actions des féministes occidentales à l’endroit des femmes du tiers-monde.
Le féminisme postcolonial place l’expérience du colonialisme au centre de son analyse, dans une perspective qui inclut à la fois les femmes de l’Ouest et les femmes du tiers-monde. En quoi l’héritage du colonialisme façonne-t-il le monde d’aujourd’hui ? L’histoire coloniale est le terrain où le projet de construction de la culture occidentale a instrumentalisé l’Autre et sa différence, figures nécessaires à cette entreprise, avance Uma Narayan (1997 : 80). Parmi les auteures qui ont contribué à définir le féminisme postcolonial, citons les travaux de Gayatri Spivak et ceux de Chandra Talpade Mohanty. Spivak est connue pour ses travaux sur la déconstruction et son introduction, aux États-Unis, des Subaltern Studies, courant de pensée associé aux études postcoloniales. Dans son texte « Can the Subaltern Speak ? », publié en 1988, elle critique les représentations que les féministes occidentales entretiennent à propos des femmes du tiers-monde et dénonce les processus d’infériorisation culturelle à l’oeuvre dans ces représentations, cet empressement de l’homme blanc à sauver la femme de couleur de l’homme de couleur (Spivak, 1988). On doit à Spivak la critique du déploiement, dans les théories féministes, d’une grille d’intelligibilité occidentale, grille qui contient des présupposés, des termes et des logiques à l’aune desquels l’Occident pense les femmes qu’il nomme du « tiers-monde » et leurs conditions d’existence (Bacchetta, 2006 : 190). Pour cette philosophe, le terme subalterne désigne celui ou celle qui occupe une position marginale et qui appartient à une classe sociale inférieure, et qui n’est pas dans la position d’exercer son propre impérialisme culturel sur les autres, ce qui l’empêche d’être entendu.
Quant à Mohanty, elle avance que les mouvements sociaux progressistes des années 1970 ont fourni les outils théoriques pour questionner l’idée d’une condition féminine universelle en montrant l’inégalité des rapports entre les femmes. Les analyses produites par ces mouvements sociaux ont illustré la nécessité de penser au-delà d’une analyse du genre, lui opposant l’intersection des positions de genre avec la classe et la race, un processus qui rend visibles d’autres relations de domination, comme celles qui s’exercent entre femmes. Il y a eu des changements paradigmatiques majeurs dans la théorie féministe occidentale, écrit Mohanty (1998), depuis ces années, alors que les féministes des années 1990 se sont inspirées, pour situer leur pensée, des mouvements gais, lesbiens, décoloniaux et pour l’égalité raciale, ainsi que des luttes paysannes, du marxisme, de la psychanalyse, de la déconstruction et du poststructuralisme. Celle-ci, comme Spivak, s’insurge contre un certain discours féministe occidental et universitaire qui crée les femmes du tiers-monde comme leur propre faire-valoir et absout les femmes de l’Ouest de toute responsabilité dans les processus de domination. Elle voit par ailleurs émerger une politique féministe de transformation à travers les critiques formulées par les féministes noires et tiers-mondistes et elle se réjouit de la jonction des études féministes, antiracistes, tiers-mondistes et postcoloniales, processus générateur de changements importants (Mohanty, 1998).
Dans Under Western Eyes, Mohanty s’intéresse aux représentations dominantes des femmes du tiers-monde dans le monde occidental, lesquelles sont réduites au statut de victimes passives de cultures et de religions rétrogrades à travers des analyses qui créent une figure homogène de la femme du tiers-monde. De nombreux écrits du féminisme occidental ont colonisé, sur le plan discursif, l’hétérogénéité historique et matérielle des conditions de vie des femmes non occidentales, produisant une représentation composite : « la femme du tiers-monde », une image construite arbitrairement, marquée par le discours occidental humaniste. Les femmes du tiers-monde sont ainsi décrites comme des victimes du contrôle des hommes et des traditions culturelles, alors que peu d’attention est donnée à l’histoire, aux différences entre femmes du tiers-monde et aux interventions des féministes qui s’y activent. Le féminisme occidental fonctionne comme la norme contre laquelle le tiers-monde est jugé, laissant les femmes du tiers-monde sans voix.
La relecture qui provient de la prise de parole des féministes migrantes et du tiers-monde constitue un point de rupture avec certaines analyses du féminisme de la deuxième vague, celles qui ont été construites autour de la figure dominante de la femme universelle. La notion de tiers-monde est utilisée dans les travaux des féministes postcoloniales pour désigner l’ensemble des femmes « autres » dans l’anthropologie et le féminisme occidental. Mohanty définit le tiers-monde selon la géographie : les États-nations de l’Amérique latine, de la Caraïbe, de l’Afrique sub-saharienne, de l’Asie du Sud et du Sud-Est, de la Chine, de l’Afrique du Sud et de l’Océanie constituent les paramètres du tiers-monde non occidental. Les Noirs, les Latinos, les Asiatiques et les populations indigènes des États-Unis, d’Europe et d’Australie se définissent aussi comme des peuples du tiers-monde. Cette féministe théoriste postcoloniale utilise également les termes femmes du tiers-monde et femmes de couleur pour désigner une même réalité (Graves, n.d.). Les travaux des féministes postcoloniales de même que ceux des féministes antiracistes ont été à l’avant-garde de la remise en question de certains narratifs du féminisme de la deuxième vague en formulant des questionnements sur la race, l’ethnicité et l’identité nationale pour penser les oppressions des femmes. Ils se situent en continuité avec les travaux précurseurs d’une autre génération de féministes qui ont réfléchi à l’articulation des rapports de genre avec ceux de race et de classe, tout en constituant une certaine rupture sur le plan de la théorisation et de la compréhension des rapports de pouvoir à l’oeuvre. Ces travaux proposent de penser les différences autrement. Alors que la pensée libérale aborde la race comme un trait non significatif de l’identité, les travaux de plusieurs féministes réfutent précisément cette vision libérale d’un monde qui serait neutre et objectif sur les questions de race et s’attardent à montrer le fonctionnement des privilèges invisibles de la couleur et de la localisation pour les femmes comme pour les hommes ; c’est ce que sous-tend le concept de blanchité (whiteness). La blanchité est une catégorie fictive et non biologique, mais elle est également un fait social qui comporte des conséquences réelles en termes de privilèges. Son importance se fonde dans le changement de perspective qu’elle suggère : aussi longtemps que les Blanches et les Blancs ne seront pas nommés et perçus comme un groupe « racial » au même titre que tous les autres groupes, alors le « Blanc » sera la norme, le standard, l’universel : « les autres sont racialisés, alors que nous les personnes blanches ne sommes que des personnes » (Dyer, cité dans Kebabza, 2006 : 152), les autres groupes d’éternelles minorités renvoyant au particulier, au spécifique.
Un des facteurs qui ont alimenté les féminismes dits postcoloniaux et tiers-mondistes a été la dénonciation de l’impérialisme discursif d’un certain féminisme occidental de la seconde vague et de son discours de victimisation des « autres » femmes. La prise de parole de femmes du tiers-monde et la circulation de leurs idées à l’échelle internationale a révélé des compréhensions inédites des conditions d’oppression des femmes. Ce processus a été difficile, mais il a contribué à changer à tout jamais le visage des féminismes en forçant la reconnaissance de l’hétérogénéité des expériences des femmes. Les féministes du tiers-monde ont, dans leurs écrits, dénoncé le regard eurocentrique dominant dans nombre d’analyses faites par des féministes occidentales sur les femmes d’autres cultures, où les normes et les valeurs occidentales étaient implicitement perçues comme normes universelles et où les actions des mouvements féministes non occidentaux étaient reléguées au champ de l’invisible. La contribution des féministes du tiers-monde à la définition d’un nouveau féminisme est multiple : elles ont produit des analyses originales sur leur oppression, elles se sont définies comme sujets de leurs propres analyses, ont ouvert la voie à penser la différence entre femmes de l’Ouest et femmes du tiers-monde selon des termes non hiérarchiques et elles ont développé un discours critique autour d’un certain féminisme occidental, lui reprochant son amnésie de l’histoire coloniale et sa tendance à reproduire des modèles coloniaux de représentation (Weedon, 2002).
Féminismes, francophonie et postcolonialisme
La francophonie ne peut être comprise sans que l’on ne se penche sur les complexes rapports de pouvoir qui la constituent. La langue est l’arme du colonisateur, mais elle constitue un territoire impensé au sein des féminismes de la francophonie (Maillé, 2012). En quoi l’appartenance à la francophonie confère-t-elle une personnalité propre aux analyses féministes, ainsi qu’aux réseaux féministes et à leurs stratégies d’intervention ? Quelles sont les stratégies féministes élaborées autour des rapports de pouvoir légués par le passé colonial de la francophonie et comment cela influence-t-il la conceptualisation des questions de différence ? Quelles traces le processus colonisateur complexe qui a régné au sein de la francophonie a-t-il laissées sur les analyses féministes et sur la façon de définir les questions de différence entre les femmes ?
De quelle façon la réalité politique de la francophonie, soit le jeu de la grande diplomatie entre la France et la périphérie, joue-t-elle dans les rapports qui s’exercent entre féministes de la francophonie ? Comment aborder la question de la langue des pratiques féministes et cerner l’importance de cette question ? À l’intérieur de l’espace francophone, deux éléments ont eu une influence prépondérante sur l’élaboration des féminismes : la domination de la théorie féministe française au sein des féminismes de la francophonie et la prédominance d’un discours universaliste au sein de la théorie féministe française. Ces éléments ont assis un modèle de compréhension de l’oppression des femmes qui reflète surtout les réalités des femmes françaises blanches tout en reléguant à un statut marginal les réalités des femmes de la périphérie. Ainsi, si le discours de l’universel a longtemps été la position théorique dominante dans les féminismes de la francophonie, c’est largement dû à l’hégémonie de la théorie féministe française, elle-même imprégnée d’une culture politique française allergique au multiculturalisme à l’américaine et résistante à l’idée de nommer les différences, particulièrement celles liées à la race, qu’elle met toujours entre guillemets. Lorsque les questions de différence ont été abordées dans les féminismes qui ont utilisé le français comme langue de contact, ce ne sont pas les rapports de pouvoir produits par le colonialisme qui ont été placés au centre de l’analyse. La question posée en 1988 par Spivak – Can the Subaltern Speak ? – n’a pas eu la même résonance dans les féminismes de la francophonie et dans les féminismes qui circulent en anglais, et ce, alors que le discours de la subalternité s’est largement construit autour de deux intellectuels de la francophonie, Frantz Fanon et Albert Memmi. Selon Juteau, une des explications à donner à cette distanciation propre à la France envers l’analyse des rapports postcoloniaux tient dans la domination ethnique qui y est marquée, « une dynamique spécifique enracinée dans des structures politiques et idéologiques comme le jacobinisme et le républicanisme, un universalisme qui ignore son point d’ancrage, qui tait le colonialisme ou le rattache à sa mission civilisatrice » (2010 : 81).
La francophonie est un objet postcolonial intéressant. Comment des nations et des cultures qui ont colonisé et été colonisées avec brutalité peuvent-elles coexister au sein de la francophonie ? La francophonie se définit comme un universalisme positif, une vision du monde où la langue française est partagée plutôt qu’imposée (Milhaud, 2006). Comment justifier l’idée d’une identité francophone commune alors que les rapports de pouvoir entre les différentes constituantes de cette francophonie sont complètement asymétriques bien qu’ils ne soient jamais nommés ? Certains voient dans la francophonie le terme contemporain pour désigner l’empire colonial français et son modèle universel et républicain. La francophonie a constitué un lieu de résistance à l’analyse intersectionnelle ainsi qu’à la théorie postcoloniale. La notion de différence a longtemps été synonyme dans le féminisme français de la position des féministes essentialistes, désignées comme féministes de la différence, qui défendaient l’idée d’une différence liée au genre, sans ouverture pour réfléchir sur des propositions centrées davantage autour des différences entre les femmes (Maillé, 2010 : 56).
Ainsi, la francophonie, par sa nature et par l’emprise exercée par la France, a résisté à l’intersectionnalité et à la théorie postcoloniale, vues comme des propositions reflétant le multiculturalisme et les valeurs du monde anglo-saxon. Ce n’est que très récemment que l’on peut observer un véritable changement sur cette question au sein du féminisme français et c’est ce que souligne Dorlin lorsqu’elle identifie un nouveau mouvement vers une épistémologie renouvelée de la domination. Dans l’introduction du collectif sous sa direction, Black Feminism : Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, paru en 2008, celle-ci se demande comment s’est posée et se pose la question du sujet politique du mouvement féministe français, qui est ce « Nous » ? Est-il blanc, est-il ignorant de sa propre blanchité ? Dans son article « De l’usage épistémologique et politique des catégories de ‘sexe’ et de ‘race’ dans les études sur le genre » (2005), Dorlin écrit au sujet du féminisme français que la question du rapport entre féminisme et racisme a suscité un profond malaise politique, malaise créé par l’impression de la désintégration du sujet même du féminisme – Nous les femmes – si l’on en venait à différencier à outrance la condition des femmes selon leur classe, leur race, leur religion, leur nationalité, leur sexualité. Selon cette philosophe spécialiste des questions de genre, en France, la République a toujours fait bon ménage avec une pensée « raciologique », insistant sur la fusion organique dans un seul peuple de plusieurs familles ou races. En 2009, dans son introduction à l’ouvrage Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination, elle écrit que la pensée féministe française s’est historiquement attachée à montrer que le rapport de classe n’épuise pas l’expérience de la domination vécue par les femmes et, plus généralement, par les minorités sexuelles. Elle relève que la réflexion sur l’imbrication des rapports de pouvoir s’est complexifiée en France sous l’influence récente des travaux nord et sud-américains, caribéens et indiens.
Certaines voix s’élèvent pour dénoncer l’invisibilité des féministes minoritaires dans la construction de ce nouveau féminisme, en France et au Québec. On fait le constat que les voix des femmes provenant des groupes minoritaires continuent d’être reléguées à la périphérie du féminisme, même de ce féminisme qui a pris le tournant de composer avec les identités multiples des femmes. Fatima Ait Ben Lmadani et Nasira Moujoud observent que si le Black Feminism a fait une entrée remarquée en France au début des années 2000, il n’en demeure pas moins que les travaux français qui s’y réfèrent « ont en commun d’occulter l’histoire coloniale française », tout en se développant sous le joug de l’« invisibilisation » des savoirs de minoritaires ex-colonisés, « qui ont très peu de places dans les listes d’auteur-e-s, références, citations, comités scientifiques, colloques […] » (2012 : 13-14). Au Québec, Délice Mugabo se questionne sur l’écoute qu’elle a en tant que féministe noire au sein des États généraux du féminisme québécois :
[L]e plus éprouvant est de parfois me demander si j’ai vraiment été entendue, ou, simplement écoutée. Est-ce que ma voix pèsera dans la balance ou sera- t-elle une musique de fond ? Les perspectives féministes queer, anti-racistes, ou anti-capacitistes seront-elles reflétées dans les analyses produites par ces États généraux, ou seront-elles noyées dans les notes de bas de page ?
2013 : 14
Le féminisme québécois de la majorité a été marqué par son affiliation aux féminismes de la francophonie. Il a été sous l’emprise de la domination de la théorie féministe française et s’est caractérisé par l’absence d’un corpus théorique original pour refléter les enjeux propres à la société québécoise. Le champ féministe littéraire fait ici exception, où le travail d’auteures comme Nicole Brossard, Madeleine Gagnon et Marie-Claire Blais a permis l’élaboration d’un véritable corpus théorique (Maillé 2010 : 51). Le féminisme québécois a importé, souvent de façon non critique, certains débats issus du féminisme français, par exemple celui sur la laïcité comme enjeu important pour l’égalité des femmes, en réaction à la présence de femmes arborant des signes religieux de confession musulmane dans l’espace public et dans les bureaux gouvernementaux. Cette question est devenue une cause, et les féministes québécoises de la majorité se sont alliées au gouvernement et même aux partis politiques les plus progressistes comme Québec solidaire pour exiger un débat sur la laïcité tout en demandant une loi pour prohiber le port de signes religieux dans certains contextes et interdire à celles qui veulent recevoir des soins de santé ou aller à l’école de porter un voile couvrant le visage (Maillé et Salée, 2013). L’idée de laïcité évoquée est celle de la laïcité républicaine française, bien qu’elle ne corresponde en rien aux traditions politiques propres à la société québécoise (Sharify-Funk, 2011 : 140). Le cadre de la francophonie dans lequel se situe le féminisme de la majorité au Québec demeure un espace où les rapports de pouvoir entre femmes demeurent encore largement non problématisés, qu’il s’agisse de l’hégémonie de la théorie féministe française et de son impensé sur les questions de race ou encore des rapports de pouvoir constitutifs d’un discours de la majorité au Québec qui confine les réalités des femmes « autres » à un amalgame, niant les dynamiques de pouvoir présentes entre femmes de la majorité et celles occupant des espaces à la périphérie.
Les grands récits identitaires québécois demeurent ancrés dans des représentations où ni la race ni le racisme ne semblent exister, et la question autochtone, au centre du processus colonisateur propre à la société québécoise, est demeurée à la marge du féminisme québécois. Pourtant, la configuration colonisateur-colonisé qui est propre au Québec en fait une formation politique unique dans son ambiguïté constitutive (Mills, 2010 : 60) : nation conquise, mais également nation complice d’un Occident triomphant, adhérant au récit des deux peuples fondateurs, duquel est occultée toute référence à l’idée de conquête, de génocide ou d’esclavage. Une lecture postcoloniale de la société québécoise met en évidence les effets de la colonisation sur le récit historique et identitaire :
C’est une forme de lecture déconstructive, le plus souvent appliquée aux travaux émanant des colonisateurs, qui démontre jusqu’où le texte contredit ses propres présupposés en termes de civilisation, de justice, d’esthétique, de sensibilité, de race, révélant ses constructions et idéologies coloniales.
Ashcroft, Griffiths et Tiffin, 2000 : 192 [traduction libre]
Une telle lecture permet d’examiner les narratifs fondateurs sur de nouvelles bases. Aujourd’hui, il faut faire le constat que les rapports de pouvoir liés aux processus coloniaux demeurent impensés au sein du féminisme québécois. De la même façon, les rapports de pouvoir entre féministes québécoises, féministes françaises et féministes des ex-colonies demeurent une question non problématisée. Par exemple, les expériences des femmes minoritaires qui vivent au Québec sont souvent amalgamées à la position périphérique et inexacte de la catégorie « femmes immigrantes », une position qui efface l’inscription de chaque expérience de la marginalité que vivent les femmes dites « immigrantes » et corrobore le métarécit d’une société québécoise blanche, homogène, de métissage récent, où la présence d’autres groupes culturels est un phénomène nouveau, alors que la dimension autochtone est abordée comme un élément marginal de l’histoire (Maillé, 2002 : 1). Ces arguments appellent à un féminisme qui s’intéresse enfin aux réalités des femmes à la périphérie et qui se définit par rapport à la marginalité autant que par rapport au centre.
Conclusion
Les féministes des mouvances postcoloniales, de couleur et antiraciste ont fabriqué de nouveaux outils pour penser les différences, avec des résonances différentes selon les contextes culturels. Mais s’agit-il de discours purement savants ? Une des conditions pour permettre le travail entre féministes au-delà des différences qui est souvent mentionnée dans la littérature est la reconnaissance des positions que les femmes occupent de part et d’autre, des privilèges qui s’y rattachent et de leur imbrication dans les systèmes d’oppression. Certaines avancent que la grande leçon à tirer pour les femmes blanches des nouveaux féminismes est qu’elles doivent reconnaître leur responsabilité dans le racisme (Razack, 1996).
La question des différences entre les femmes et la prise de parole des femmes de la périphérie a ouvert la voie à un fantastique renouvellement de l’analyse féministe, mais comment traduire ces analyses en termes organisationnels pour les mouvements de femmes ? À ce sujet, Fraser formule le projet d’une démocratie radicale comme possibilité vers laquelle peuvent se tourner les féministes « anxieuses de développer une perspective politique et théorique viable prenant en compte l’intersection de multiples différences » (2005 : 40), mais elle évoque un problème complexe à résoudre dans le cadre de ce projet, soit l’utilisation de catégories identitaires instables et souvent problématiques comme base d’organisation.
Est-il possible de travailler à l’intérieur de réseaux transnationaux regroupant des féministes qui occupent des positions de pouvoir inégales ? Des féministes libérales comme Martha Nussbaum (1999) et Susan Moller Okin (1997) ont écrit sur le concept de fausse conscience (false consciousness) qui est, selon elles, central dans l’attitude de féministes du Sud qui refusent de dénoncer certaines pratiques culturelles exercées à l’encontre des femmes. Elles accusent les féministes postcoloniales d’indifférence à l’endroit de la souffrance des femmes plus vulnérables dans le monde. Pour Alison Jaggar, il importe de dépasser ce débat, polarisé entre l’interférence coloniale et l’indifférence, en portant davantage attention à la responsabilité de l’Occident dans le maintien de conditions de vie, dans le Sud, qui contribuent au tribalisme et au maintien de traditions oppressives. Celle-ci prône également la prise en compte des inégalités de pouvoir dans les dialogues entre femmes du Nord et femmes du Sud (2005 : 194). Dans Feminism without Borders, Mohanty énonce quant à elle les conditions à partir desquelles il lui semble possible d’envisager un féminisme sans frontières, ainsi que des projets communs entre féministes occidentales et féministes du tiers-monde. La condition essentielle pour le fonctionnement de telles alliances est qu’elles soient bâties à partir d’organisations distinctes et politiquement constituées, où l’on reconnaît les hiérarchies et les différences entre les femmes plutôt que de les noyer dans une fausse sororité universelle. Mohanty (2003b) insiste sur l’importance de développer une pratique féministe transnationale qui serait basée sur la construction de solidarités féministes à travers les divisions, et ce, malgré la difficulté de l’entreprise.
Au Québec, l’expérience de la Marche mondiale des femmes de l’an 2000 constitue un point tournant pour le féminisme québécois, alors qu’à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec plus de 600 groupes en provenance de 163 pays ont participé à une série d’interventions visant à contrer la pauvreté et la violence contre les femmes (Conway, 2008 : 214). Cette action a été conçue à l’origine comme un événement hautement symbolique : « marcher dans le monde entier avec les mêmes revendications pour toutes les femmes de la Terre, autour de deux thèmes rassembleurs : la lutte contre la pauvreté et les violences » (Giraud et Dufour, 2010 : 14). Véritable expérience féministe transnationale, la Marche illustre bien le passage du féminisme québécois vers une analyse intersectionnelle et transnationale. Dès 1998, les militantes féministes québécoises impliquées dans l’organisation de la Marche ont eu le souci d’insuffler une dynamique nouvelle à l’échelle mondiale et n’ont pas voulu répliquer la structure déjà existante de réseaux féministes transnationaux (ibid. : 215). Le féminisme québécois a voulu dépasser les frontières du Québec en créant un réseau mondial de groupes et de solidarités. Il s’est ouvert à l’analyse intersectionnelle sur un fond d’échanges transnationaux. L’expérience de la Marche mondiale des femmes a probablement changé le visage du féminisme québécois à tout jamais ; cependant, sur les dynamiques de pouvoir postcoloniales, il reste un travail important à faire pour en arriver non seulement à comprendre le legs de notre héritage colonial, mais aussi pour envisager des actions permettant de rompre avec les modèles hérités de ce passé colonial, ici au Québec et à l’échelle transnationale. Il faut formuler le souhait d’une fréquentation plus régulière des théories postcoloniales au sein des féminismes de la francophonie. La réflexion sur les rapports de pouvoir entre féminismes et féministes s’enrichira d’une compréhension approfondie de la géographie des pouvoirs propre à la francophonie.
Parties annexes
Note biographique
Chantal Mailléest professeure en études des femmes à l’Institut Simone-De Beauvoir de l’Université Concordia depuis 1989. Ses travaux de recherche sont au confluent de plusieurs influences disciplinaires. Dans ses publications les plus récentes elle a écrit sur les féminismes de la francophonie et sur les théories postcoloniales. Elle s’intéresse également aux liens entre cultures politiques et théories féministes, et plus particulièrement au Québec comme objet postcolonial.
Bibliographie
- Ait Ben Lmadani, Fatima et Nasira Moujoud, 2012, « Peut-on faire de l’intersectionnalité sans les ex-colonisé-e-s ? », Mouvements, no 72, p. 12-21.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, 2000, Postcolonial Studies. The Key Concepts, New York, Routledge.
- Bacchetta, Paola, 2006, « Quand les mouvements lesbiens à Delhi questionnent les théories féministes transnationales », dans (Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, classe et « race », Les Cahiers du CEDREF (Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes), no 14, p. 173-204.
- Bilge, Sirma, 2009, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, no 225, p. 70-81.
- Combahee River Collective, 2007, « Déclaration du Combahee River Collective », dans Elsa Dorlin (sous la dir. de), Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, Paris, L’Harmattan, p. 59-73 [texte original publié en anglais en 1977].
- Conway, Janet, 2008, « Geographies of Transnational Feminisms : The Politics of Place and Scale in the World March of Women », Social Politics : International Studies in Gender, State and Society, vol. 15, no 2, p. 207-231.
- Crenshaw, Kimberlé W., 1989, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, Chicago, University of Chicago Legal Forum, p. 139-167.
- Davis, Angela, 1981, Women, Race and Class, New York, Random House.
- Dorlin, Elsa, 2005, « De l’usage épistémologique et politique des catégories de ‘sexe’ et de ‘race’ dans les études sur le genre », Cahiers du genre, no 39, p. 83-105.
- Dorlin, Elsa (sous la dir. de), 2008, Black Feminism – Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, Paris, L’Harmattan.
- Dorlin, Elsa, 2009 (sous la dir. de), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France.
- Dyer, Richard, 1997, White, Londres, Routledge.
- Fraser, Nancy, 2005, « Multiculturalisme, anti-essentialisme et démocratie radicale. Genèse de l’impasse actuelle de la théorie féministe », Cahiers du genre, no 39, p. 27-50.
- Giraud, Isabelle et Pascale Dufour, 2010, Dix ans de solidarité planétaire. Perspectives sociologiques sur la Marche mondiale des femmes, Montréal, Remue-ménage.
- Graves, Nicola, n.d., Third World and Third World Women, consulté sur Internet (http://www.english.emory.edu/Bahri/ThirdWorld.html) le 6 septembre 2012.
- Hill Collins, Patricia, 1990, Black Feminist Thought, Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, Boston, Unwin Hyman.
- hooks, bell, 2000, Feminism Is for Everybody, Cambridge, South End Press.
- Jaggar, Alison, 2005, « Global Responsibility and Western Feminism », dans Barbara S. Andrew, Jean Keller et Lisa Schwartzman (sous la dir. de), Feminist Interventions in Ethics and Politics. Feminist Ethics and Social Theory, Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, p. 185-198.
- Juteau, Danielle, 2010, « ‘Nous’ les femmes : sur l’indissociable homogénéité et hétérogénéité de la catégorie », L’Homme et la société, nos 176-177, p. 65-81.
- Kebabza, Horia, 2006, « L’universel lave-t-il plus blanc ? Race, racisme et système de privilèges », dans (Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, classe et « race », Les Cahiers du CEDREF (Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes), no 14, p. 145-172.
- Kergoat, Danièle, 2009, « Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Elsa Dorlin (sous la dir. de), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France, p. 111-125.
- Lépinard, Éléonore, 2005, « Malaise dans le concept. Différence, identité et théorie féministe », Nouvelles questions féministes, vol. 24, no 2, p. 107-135.
- Lorde, Audre, 1984, Sister Outsider, Freedom (CA), The Crossing Press.
- Maillé, Chantal, 2002, « Migrations : femmes, mouvement et ‘refondation’ du féminisme », Recherches féministes, vol. 15, no 2, p. 1-8.
- Maillé, Chantal, 2010, « French and Quebec Feminisms : Influences and Reciprocities », dans Paula Ruth Gilbert et Miléna Santoro (sous la dir. de), Transatlantic Passages : Literary and Cultural Relations between Quebec and France, Montréal, McGill-Queens University Press, p. 50-57.
- Maillé, Chantal, 2012, « Transnational Feminisms in Francophonie Space », Women : A Cultural Review, vol. 23, no 1, p. 62-78.
- Maillé, Chantal et Daniel Salée, 2013, « Quebec, Secularism and Women’s Rights : on Feminism and Bill 94 », dans Chantal Maillé, Greg Nielsen et Daniel Salée (sous la dir. de), Revealing Democracy Secularism and Religion in Liberal Democratic States, Bruxelles, Peter Lang, p. 11-33.
- Milhaud, Olivier, 2006, « Post-Francophonie ? » Espaces Temps.Net, consulté sur Internet (www.espacestemps.net/document2077.html) le 14 septembre 2012.
- Mills, Sean, 2010, The Empire within Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties Montreal, Montréal, McGill-Queens University Press.
- Mitchell, Allyson et Lara Karaian, 2005 [5e éd.], « Third Wave Feminisms », dans Nancy Mandell (sous la dir. de), Feminist Issues Race, Class and Sexuality, Toronto, Prentice-Hall, p. 63-86.
- Mohanty, Chandra Talpade, 1998, « Feminist Encounters : Locating the Politics of Experience », dans Ann Phillips (sous la dir. de), Feminism & Politics, New York, Oxford Readings in Feminism, p. 254-272.
- Mohanty, Chandra Talpade, 2003a, « Under Western Eyes Revisited : Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles », Signs, vol. 28, no 2, p. 499-535.
- Mohanty, Chandra Talpade, 2003b, Feminism without Borders : Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Durham, Duke University Press.
- Moller Okin, Susan, 1997, « Is Multiculturalism Bad for Women ? », consulté sur Internet (http://www.bostonreview.net/BR22.5/okin.html) le 7 septembre 2012.
- Moraga, Cherrie et Gloria Anzaldua (sous la dir. de), 1981, This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color, New York, Kitchen Table, Women of Color Press.
- Mugabo, Délice, 2013, « Libérer ma parole », Relations, no 762, p. 14-15.
- Narayan, Uma, 1997, Dislocating Cultures. Identities, Traditions and Third World Feminism. New York, Routledge.
- Nussbaum, Martha, 1999, Sex and Social Justice, New York, Oxford University Press.
- Razack, Sherene, 1996, « Beyond Universal Women : Reflections on Theorizing Differences Among Women », University of New Brunswick Law Journal, vol. 45, p. 209-226.
- Seiler, Naomi, 2003, « Identifying Racial Privilege : Lessons from Critical Race Theory and the Law », The American Journal of Bioethics, vol. 3, no 3, p. 24-25.
- Sharify-Funk, Meena, 2011, « Governing the Face Veil : Quebec’s Bill 94 and the Transnational Politics of Women’s Identity », International Journal of Canadian Studies, no 43, p. 145-163.
- Spivak, Gayatri, 1988, « Can the Subaltern Speak ? », dans Cary Nelson et Lawrence Grossberg (sous la dir. de), Marxism and the Interpretation of Culture, Champaign, University of Illinois Press, p. 271-313.
- Varikas, Eleni, 1993, « Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côtés de l’océan », première publication en avril 1993, consulté en ligne sur le site de Multitudes (http://multitudes.samizdat.net/article992.html) le 6 septembre 2012.
- Weedon, Chris, 2002, « Key Issues in Postcolonial Feminism : A Western Perspective », Gender Forum, An Internet Journal for Gender Studies, consulté sur Internet (http://www.genderforum.org/issues/genderealisations/key-issues-in-postcolonial-feminism-a-western-perspective/) le 7 septembre 2012.
- Yuval-Davis, Nira, 2006, « Intersectionality and Feminist Politics », European Journal of Women’s Studies, vol. 13, no 3, p. 193-209.
- Zaidman, Claude, 2004, « Introduction », dans Genre, travail et migration en Europe, LesCahiers du CEDREF (Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes), no 12, p. 9-22.

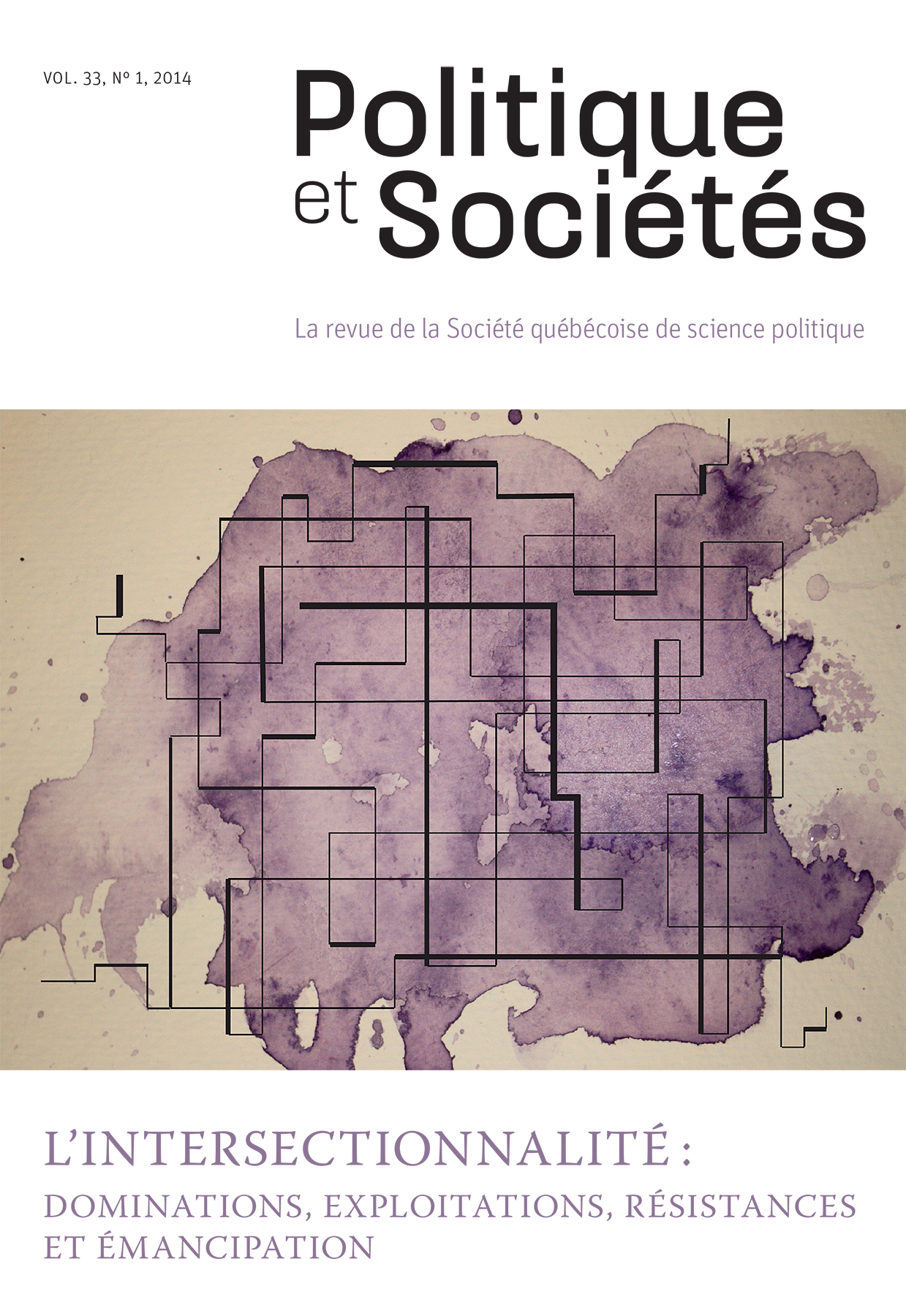
 10.7202/006508ar
10.7202/006508ar